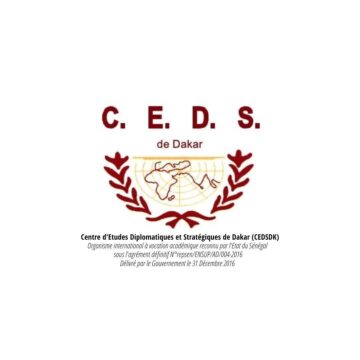Depuis début septembre 2025, plusieurs incursions russes dans l’espace aérien européen, notamment en Pologne, en Roumanie, en Estonie, au Danemark ou encore en Norvège, ont laissé peser une menace sécuritaire sur le continent. Si les origines de certaines d’entre elles ne sont pas encore avérées, ces violations de courtes durées portent pourtant leur lot de défis : Moscou pourrait être en train de tester les limites des capacités de décision, d’action et plus largement de défense des Européens. Alors que l’Europe semble désunie et affaiblie par le retrait progressif de son allié américain, comment appréhender ces incursions ? Quelle est leur portée géopolitique et stratégique, et surtout, comment y répondre ? Le point avec Louise Souverbie, chercheuse à l’IRIS, spécialisée sur les questions de défense européenne et sur l’industrie de l’armement.
Comment définir et interpréter la menace sécuritaire qui pèse actuellement sur l’Europe ?
Ces récentes violations de l’espace aérien européen – incursions de 19 drones en Pologne, d’un en Roumanie, de plusieurs appareils au Danemark, ainsi que de trois Mig-31 russes en Estonie – survenues en l’espace de deux semaines, révèlent une intensification de la pression sécuritaire sur l’Europe. Les avions ont été escortés rapidement vers l’espace aérien russe et il semble que les drones n’étaient pas armés : il s’agissait de drones de renseignement et de decoy (des modèles non armés de drones habituellement armés). La proximité temporelle de ces divers incidents et le contexte dans lequel ils interviennent semblent néanmoins indiquer une stratégie d’ensemble visant à tester les défenses européennes, à collecter du renseignement et à exploiter l’ambiguïté caractéristique des actions hybrides.
Les enquêtes visant l’attribution formelle des incursions demeurent en cours. Toutefois, dans le cas polonais, la provenance depuis l’Ukraine dans le contexte d’une attaque russe massive et de la Biélorussie indique vraisemblablement une action intentionnelle de Moscou. De même, au Danemark, les caractéristiques de l’opération et des capacités employées désignent a minima un acteur « capable » (pour reprendre le terme employé par les autorités), potentiellement étatique. Le faisceau d’indices converge ainsi vers la Russie, sans que cela n’annule la nécessité des procédures d’enquête pour l’attribution officielle (qui ne sera pas forcément possible).
Ces actions ont été qualifiées d’« hybrides » par plusieurs observateurs et par les responsables politiques danois. Cette qualification ne vise pas à relativiser la menace, mais à désigner un mode opératoire particulier. De manière générale, les actions hybrides partagent plusieurs caractéristiques :
- Elles permettent de maximiser la déstabilisation politique et psychologique à moindre coût économique, militaire et diplomatique ;
- Elles exploitent les seuils de riposte – notamment le seuil de l’agression armée et celui de l’article 5 de l’OTAN – en transformant l’ambiguïté en instrument stratégique, freinant la prise de décision, divisant les opinions publiques et paralysant la réaction ;
- Elles reposent sur une logique de la plausible deniability(déni plausible) ou plutôt d’implausible deniability, en multipliant les signaux contradictoires pour semer le doute. Certains travaux sur la guerre hybride soulignent en effet qu’il s’agit moins de la dissimulation de la responsabilité que de « l’intervention non reconnue en tant que performance », qui permet d’envoyer un signal stratégique ainsi que « d’introduire une incertitude calculée dans les relations internationales » (Cormac & Aldrich, 2018).
Dans le cas des incursions du mois de septembre, les objectifs russes pouvaient être multiples : tester les réactions de l’OTAN (à la fois des États membres concernés individuellement et de l’alliance en tant qu’ensemble), évaluer les capacités européennes de neutralisation de ce type d’attaque et collecter du renseignement. Ces actions s’inscrivent dans une stratégie plus large d’intimidation à l’encontre des gouvernements et des populations européens, avec pour objectif sous-jacent de dissuader la poursuite du soutien à l’Ukraine. Les pays ciblés comptent en effet parmi les soutiens clés de Kyiv. Enfin, elles interviennent dans le contexte de discussions relatives aux garanties de sécurité pour l’Ukraine, dans lesquelles l’Europe est appelée à jouer un rôle central.
Ces incursions aériennes doivent donc être replacées dans le cadre plus large de la guerre hybride menée par la Russie (qui réfute l’emploi de ce qualificatif et l’applique au contraire à « l’Occident ») visant à fragiliser l’alliance euro-atlantique et l’Union européenne. Cette stratégie combine des moyens cinétiques (comme les drones et les avions) et non-cinétiques comme les campagnes informationnelles, articulés pour maximiser la déstabilisation. L’exemple polonais est à cet égard révélateur : Moscou a cherché à attribuer la responsabilité des violations à l’Ukraine, illustrant une stratégie de désinformation destinée à diviser les alliés et à affaiblir la solidarité européenne.
L’espace baltique est particulièrement concerné par ce contexte. La Russie cherche en effet à y contester la supériorité de l’OTAN en renforçant sa capacité d’opération sur les infrastructures sous-marines critiques et en créant une confusion entre moyens civils et militaires. Le moyen de projection des drones ayant ciblé le Danemark illustre cette dernière tendance, certaines pistes évoquant l’usage de bâtiments civils russes en mer Baltique et en mer du Nord. Par ailleurs, l’interception d’avions russes dans l’espace aérien balte est devenue quasi routinière pour la mission de police aérienne de l’OTAN (300 cas recensés en 2023 selon les chiffres de l’OTAN). La durée prolongée de la dernière incursion en Estonie (12 minutes) et son contexte a néanmoins renforcé sa gravité.
Enfin, ces incidents soulignent la dynamique croissante de « dronisation » des conflits, face à laquelle l’Europe semble encore insuffisamment préparée. L’usage massif et varié de drones permet d’une part, la saturation des défenses aériennes par l’envoi simultané d’appareils, y compris des decoy comme ceux observés en Pologne, qui mobilisent des ressources défensives ; d’autre part, la capacité de frapper en profondeur à moindre coût, en ciblant par exemple des infrastructures critiques (réseaux de transport, installations énergétiques, etc).
Face à la multiplication des incidents, comment interpréter la dissonance de réactions sur la manière de riposter entre les différents partenaires européens mais aussi les États-Unis, membres de l’OTAN ?
La diversité des réactions peut être analysée selon deux temporalités (riposte immédiate et réaction à court terme) et trois registres (opérationnel, économique/technologique, politique/stratégique). Elles doivent aussi être considérées en lien avec les différents types d’actions auxquelles elles répondent, le maitre mot étant celui de proportionnalité.
Considérant d’abord la réaction immédiate, le cas de l’Estonie semble démontrer une maîtrise de la situation par les alliés présents dans le cadre de la mission de police aérienne de l’OTAN. Les Mig-31 russes ont été escortés hors de l’espace aérien balte, apparemment en conformité avec les règles d’engagement de cette mission en temps de paix. La gradation des réponses possibles – avertissement radio, interception et escorte, accrochage radar, manœuvre, tir de sommation – permet de gérer chaque situation sans recourir systématiquement à l’usage de la force.
La Pologne et le Danemark constituent deux autres cas clés, caractérisés par l’emploi de drones de renseignement et de decoy. La Pologne a abattu quatre des 19 drones, tandis que le Danemark n’en aurait neutralisé aucun. L’adéquation de ces réactions peut être évaluée à l’aune de trois dimensions principales :
- Opérationnelle : abattre des engins au-dessus de zones habitées ou fréquentées par l’aviation civile créé un risque important lié à la de chute de débris. La prise de décision pèse donc la menace représentée (les drones sont-ils armés ?) face aux risques encourus par leur chute.
- Économique et capacitaire : l’asymétrie des coûts est significative entre l’attaque menée par des drones valant quelques milliers ou dizaines de milliers d’euros, et la défense reposant sur des intercepteurs à plusieurs millions. D’autres moyens moins coûteux existent néanmoins et auraient aussi permis de contourner le problème de la chute de débris, notamment dans le domaine de la guerre électronique, ce qui pose la question des capacités européennes face à ces nouvelles menaces.
- Stratégique : au choix de neutraliser ou non les drones correspond aussi un signalement stratégique. Sur ce plan, il est important de prendre en compte la différence des cultures stratégiqueset donc des grilles de lecture entre l’émetteur et le récepteur du message (Eken et al., 2025) : la retenue peut être perçue en Europe comme une preuve de maîtrise, mais interprétée en Russie comme une manifestation de faiblesse.
Ensuite, la réaction différée combine éléments déclaratoires et mesures opérationnelles. Le premier volet a été marqué par la fermeté des dirigeants baltes, polonais et nordiques. Le ministre polonais des Affaires étrangères, Radoslaw Sikorski, a affirmé au Conseil de sécurité de l’ONU, en présence de l’ambassadeur russe, que Varsovie n’hésiterait pas à abattre les prochains engins, même si des débris devaient tomber sur le territoire de l’Alliance. Le Premier ministre Donald Tusk et son homologue danoise Mette Frederiksen ont également affiché une posture ferme, cette dernière déclarant l’Europe en état de guerre hybride.
De plus, la Pologne puis l’Estonie ont activé l’article 4 de la charte de l’OTAN, qui prévoit des consultations entre les alliés lorsque « de l’avis de l’une d’elles, l’intégrité territoriale, l’indépendance politique ou la sécurité de l’une des parties sera menacée.». Ces concertations ont été suivies d’effet avec l’opérationnalisation rapide de la réponse alliée : la mission Eastern Sentry. Quelques jours après les incursions de drones russes en Pologne, deux F-16 danois, quatre Eurofighters allemands et trois Rafale Français rejoignaient ainsi le flanc Est. Les membres européens de l’OTAN prennent donc le leadership de la réponse alliée. La lecture possible est double : l’affirmation d’une responsabilité accrue de l’Europe dans la protection de son flanc oriental est un signal positif qui doit renforcer la crédibilité des forces européennes et leurs capacités de découragement vis-à-vis de la Russie ; d’autre part, l’absence des États-Unis ne manquera pas d’être notée à Moscou.
En ce qui concerne la posture américaine sur l’ensemble de la séquence, celle-ci a été pour le moins effacée. Présents en Pologne à la fois dans un cadre bilatéral et en tant que nation-cadre de l’OTAN, les États-Unis n’ont apparemment pas participé à l’interception des drones russes. De plus, leur non-participation à l’opération Eastern Sentry renforce l’idée que Washington laisse aux Européens la responsabilité première de leur sécurité et cherche potentiellement à éviter des tensions bilatérales avec Moscou.
Quelles peuvent-être les réponses face à ces menaces ?
Les réponses doivent conjuguer une rectification immédiate d’éventuelles lacunes sécuritaires autour des infrastructures critiques, un renforcement à court et moyen terme de la dissuasion par déni du continent, et une adaptation structurelle face aux menaces hybrides.
La sécurisation et le renforcement des infrastructures critiques apparaissent aujourd’hui comme une priorité. Les récentes incursions de drones, notamment dans le cas du Danemark, ont mis en lumière des vulnérabilités persistantes concernant des secteurs névralgiques (réseaux énergétiques, transports, aéroports ou encore infrastructures numériques), qui représentent des cibles privilégiées dans le cadre des stratégies hybrides menées par la Russie.
Ensuite, l’Europe est engagée dans le renforcement de ses capacités de lutte anti-drone. Les États baltes portent depuis 2024 le projet dit de drone wall, repris et soutenu par la présidente de la Commission européenne en septembre 2025 dans le contexte des violations de l’espace aérien polonais. Ce dispositif prévoit la mise en place de réseaux de capteurs combinés à un système intégré de commandement et de contrôle, permettant une vision opérationnelle en temps réel sur l’ensemble de la frontière. À cela s’ajoute le recours à des drones intercepteurs automatisés, capables de neutraliser des appareils hostiles. L’Europe doit également investir dans des systèmes d’alerte avancée (early warning systems) et une défense aérienne multicouches capables de contrer la saturation de ses défenses par des essaims de drones. Les contre-mesures incluent également l’emploi de dispositifs de brouillage électromagnétique (jamming), de drones anti-drones ou encore de technologies émergentes comme les lasers. Ce type de réponses s’inscrit dans une logique de « défense et dissuasion par le déni », consistant à rendre toute attaque coûteuse et incertaine pour l’adversaire et ainsi renverser ou du moins limiter toute forme de prime à l’attaque. Au-delà de la question des drones, l’adaptation passe aussi par un renforcement plus large des capacités de défense visant à crédibiliser la posture européenne et à assurer une dissuasion conventionnelle efficace face à Moscou.
Le débat autour de l’instauration d’une zone d’exclusion aérienne (no-fly zone) au-dessus de l’Ukraine occidentale reste en suspens. Une telle mesure, qui impliquerait pour l’OTAN d’intercepter et d’abattre tout appareil pénétrant cet espace, constituerait un saut politique et militaire majeur que les Alliés ne semblent pas prêts à franchir. La Pologne, de son côté, a engagé une procédure législative accélérée pour autoriser ses forces armées à abattre des engins russes au-dessus du territoire ukrainien sans approbation préalable de l’OTAN.
Enfin, dans le contexte de renforcement de l’hybridité des menaces, la réponse européenne ne peut passer seulement par un accroissement des moyens militaires. Les stratégies hybrides visent en effet à exploiter autant les vulnérabilités capacitaires que les fragilités sociétales, en s’appuyant notamment sur des campagnes de désinformation. La préparation doit donc également intégrer une réflexion sur la résilience des sociétés européennes. IRIS