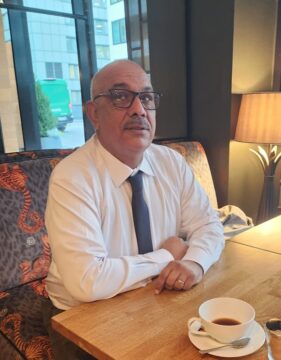La récente déclaration du ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, exprimant la disponibilité de son pays à soutenir une médiation politique entre le Maroc et le Front Polisario, a été accueillie comme un signe d’apaisement régional. Mais elle pose une question essentielle : peut-on encore imaginer un règlement durable du conflit du Sahara occidental en reconduisant le même schéma bilatéral qui a échoué depuis près de cinquante ans ?
Si l’Algérie a bâti sa démocratie sur la pluralité politique, n’est-il pas temps qu’elle reconnaisse ce même droit à une représentation diversifiée du peuple saharaui ?
Depuis l’adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité, 2025, le cadre onusien a changé. Le Conseil appelle désormais à des solutions politiques réalistes, fondées sur le compromis et la gouvernance locale, rompant ainsi avec l’approche rigide du référendum qui a longtemps figé les positions. Ce tournant oblige chaque acteur — y compris l’Algérie, qui se présente aujourd’hui comme facilitatrice — à reconsidérer les paramètres du processus de paix.
Pendant des décennies, la représentation sahraouie a été monopolisée par une seule formation. Or, l’évolution politique et sociale de la région montre qu’il existe désormais une pluralité de voix sahraouies, porteuses de visions divergentes, parfois complémentaires, mais surtout légitimes.
C’est dans cette dynamique que s’inscrit le Mouvement Sahraoui pour la Paix (MSP), né du rejet des extrêmes et de la volonté de proposer une troisième voie. Loin de la rhétorique figée, le MSP s’est imposé comme un acteur porteur d’une vision pragmatique et inclusive, cohérente avec les orientations de la résolution 2797.
Le MSP a présenté un document inédit : le “Statut spécial du Sahara”, une proposition institutionnelle articulée en 54 articles. Ce texte s’inspire de modèles internationaux reconnus et propose une autonomie avancée dans le cadre de la souveraineté marocaine, avec :
- une Assemblée sahraouie élue, dotée de pouvoirs étendus ;
- un exécutif local responsable devant ce parlement ;
- une gestion locale des ressources naturelles ;
- des garanties pour l’identité, la langue et la culture sahraouies ;
- un système de gouvernance moderne, adapté aux réalités régionales.
Contrairement à d’autres documents produits par des acteurs extérieurs, il s’agit ici d’une proposition rédigée par des Sahraouis pour les Sahraouis, ce qui lui confère une légitimité politique singulière.
Soutenir une médiation entre Rabat et le Polisario peut constituer un geste utile, mais à condition d’admettre que l’époque où l’on pouvait réduire le peuple sahraoui à une seule organisation est révolue. Les mutations en cours — politiques, sociales, générationnelles — imposent une lecture élargie du champ sahraoui.
C’est pourquoi une médiation réellement constructive doit s’appuyer sur trois piliers :
- des propositions marocaines modernisées, en cohérence avec la 2797 ;
- un dialogue avec le Polisario, qui demeure un interlocuteur historique ;
- et l’intégration des nouvelles forces sahraouies, au premier rang desquelles le MSP.
Ignorer ce pluralisme reviendrait à prolonger l’impasse, à un moment où le Sahel et l’espace sahélo-saharien ne peuvent plus se permettre l’instabilité chronique.
Le conflit du Sahara occidental ne se résume plus à un duel. Il est devenu un enjeu de gouvernance, de sécurité régionale et de représentation politique. La résolution 2797 a ouvert une opportunité rare : celle de bâtir une solution ancrée dans la réalité, non dans la nostalgie des paradigmes du passé.
Pour la saisir, il faut accepter l’idée simple mais trop longtemps écartée :
la paix ne peut naître que d’une représentation sahraouie plurielle, inclusive et authentique.
Le MSP en offre aujourd’hui l’expression la plus structurée. Le reconnaître ne revient pas à marginaliser quiconque, mais à intégrer une réalité politique devenue incontournable.
Si l’Algérie souhaite réellement contribuer à une solution durable, sa médiation devra être celle des trois voix — et non plus des deux : celle de Rabat, celle du Polisario, et celle de ces Sahraouis longtemps restés silencieux, mais désormais décidés à être partie prenante de leur propre destin. Hamoud Ghaillani