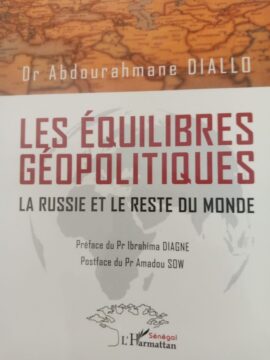Le Sahel est devenu un point central des interventions internationales en matière de sécurité, avec des acteurs extérieurs fournissant une assistance importante aux forces de sécurité locales, à l’armée, à la police et aux forces paramilitaires. « Titriser le Sahel : analyser les interventions externes et leurs conséquences » de la chercheure Nina Wilèn, examine de manière critique la raison d’être, la mise en œuvre et les conséquences de ces efforts (2012-2024). Avec un accès unique à la fois aux opérations militaires et à l’élaboration de stratégies dans les capitales européennes, l’auteur propose une approche méthodologique innovante, un matériel exclusif et une perspective complète. S’appuyant sur un travail de terrain approfondi, y compris l’observation participante des opérations militaires et plus de 100 entretiens avec des décideurs politiques, du personnel militaire et des praticiens de la sécurité à travers le Sahel et l’Europe, ce livre offre une analyse sans précédent de la façon dont la SFA a façonné la dynamique de la sécurité locale et la concurrence géopolitique au sens large. La titrisation du Sahel apporte des contributions à la fois théoriques et empiriques à la compréhension des SFA dans les États fragiles. Il remet en question les cadres en vigueur, fournit des informations essentielles aux décideurs politiques et met en évidence les conséquences involontaires de l’aide extérieure militarisée au Sahel et au-delà.
Assistance des forces de sécurité au Sahel
Dans l’introduction, l’auteur parle d’une assistance des forces de sécurité au Sahel. A ce titre, Nina Wilèn souligne qu’il n’y a pas besoin de se disputer pour savoir qui fait quoi, il y a un problème auquel tout le monde doit s’attaquer au Sahel.
La citation est tirée d’un entretien avec un représentant de la sécurité étrangère à Niamey, mais fait écho à une observation commune du Sahel comme une région ayant suffisamment de crises pour tous les types d’acteurs, mais peut-être surtout pour les acteurs de la sécurité. Depuis plus d’une décennie, la région du Sahel en Afrique a été touchée de manière disproportionnée par des menaces transnationales à la sécurité telles que l’extrémisme violent, le crime organisé et le trafic illicite d’armes, de biens et de personnes. Le Mali est l’épicentre de ces développements depuis 2012, lorsque les séparatistes touaregs du nord et les djihadistes affiliés à Al-Qaïda ont temporairement collaboré pour mener une insurrection, ce qui a conduit à un coup d’État plus tard la même année. Cette crise sécuritaire s’est depuis aggravée et étendue aux États voisins dans un contexte fortement affecté par la pression démographique croissante, le changement climatique, la pauvreté, l’insécurité alimentaire et la mauvaise gouvernance. C’est dans ce contexte que les acteurs étrangers ont renforcé leur présence dans la région avec l’objectif officiel de contribuer à l’amélioration de la situation sécuritaire par le biais de différents types d’assistance aux forces de sécurité (AFS). SFA pilotée de l’extérieur, les opérations de paix et les missions de lutte contre le terrorisme sont ainsi devenues des éléments intrinsèques de l’environnement sécuritaire du Sahel, Ce qui a valu à la région l’épithète d’« embouteillage de sécurité ».
Ce livre pose la question suivante : Pourquoi ? Comment faire ? et alors ? Pourquoi les acteurs extérieurs sont-ils intervenus et pourquoi la SFA est-elle devenue le principal outil de politique étrangère pour répondre aux crises ? Comment ces différentes missions SFA se sont-elles mises en place, évoluées et développées sur le terrain ? Quel impact les initiatives de la SFA ont-elles eu sur les acteurs et les structures de sécurité locaux et régionaux, sur la situation sécuritaire au sens large et sur les relations civilo-militaires de la région en général ? Basé sur plus de 100 entretiens avec des acteurs clés au Mali, au Niger, au Burkina Faso, au Tchad, à Paris et à Bruxelles, sur l’observation ethnographique participante de l’assistance des forces de sécurité au Niger, sur plus de dix voyages dans la région, parfois en accompagnant des délégations militaires, et sur une perspective d’initié/extérieur à l’élaboration des politiques au Sahel, ce livre offre une approche unique pour explorer ces questions.
Le pourquoi, le comment et alors ?
Pourquoi les acteurs extérieurs ont-ils donné la priorité à la région du Sahel pour l’assistance des forces de sécurité au cours de la dernière décennie ? Quelles sont les motivations formelles et informelles de cet intérêt sans précédent pour la région ? Pour répondre à ces questions, cette étude va au-delà des déclarations publiques et des déclarations de politique étrangère et adopte une perspective qui considère les problèmes politiques non seulement comme « là-bas », attendant d’être trouvés, mais plutôt comme le résultat de processus sélectifs qui mettent en évidence certaines questions tout en en négligeant d’autres. Cette perspective ne nie pas qu’il y a effectivement de « vrais » problèmes de sécurité à résoudre, mais elle examine la manière dont les problèmes ont été identifiés, sélectionnés et traités. Comprendre comment la « sécurité au Sahel » est devenue un problème politique pour les acteurs extérieurs à traiter avec l’AFS au cours de la dernière décennie est donc l’un des objectifs de ce livre.
C0P4Un deuxième objectif est d’examiner comment ces interventions extérieures se sont développées et se sont déroulées sur le terrain. Tout d’abord, il s’agit d’identifier les principaux acteurs qui ont fourni des AFS dans la région et, deuxièmement, d’examiner les types de collaborations et d’assistance qui ont découlé de ces partenariats. Pour mieux comprendre la grande variété d’acteurs et de types d’AFE qui ont été présents dans la région, cette étude examine les missions multilatérales et bilatérales. Il donne un aperçu de la collaboration formelle et informelle entre l’opération antiterroriste française Barkhane, la mission de la politique de sécurité et de défense commune de l’Union européenne (UE), la mission de formation de l’Union européenne au Mali (EUTM) et la mission de stabilisation des Nations unies (ONU) au Mali : MINUSMA, à travers des entretiens et des sources secondaires. Le travail ethnographique de terrain d’une opération militaire bilatérale belge au Niger permet de comprendre en profondeur l’aspect quotidien de l’AFS, tandis que des études de cas plus courtes sur la multiplication des forces mobiles hybrides locales dans la région donnent un aperçu de la manière dont les structures de sécurité locales sont modifiées dans leurs interactions avec les partenaires extérieurs. En examinant plusieurs types de missions différentes, cet ouvrage fournit une compréhension à la fois large et profonde de l’AFS.
Trois partenaires bilatéraux en matière de sécurité sont examinés plus en détail dans ce livre, deux grands États : la France et les États-Unis, et un État plus petit : la Belgique. La France est l’intervenant le plus important dans la région qui a déployé unilatéralement une opération régionale de lutte contre le terrorisme forte de 5 000 soldats pendant près d’une décennie, ce qui en fait la plus longue opération militaire extérieure du pays depuis la guerre d’Algérie, et aussi l’une des interventions étrangères les plus coûteuses avec un budget annuel d’environ 1 milliard de dollars. Forte de son passé colonial, la France a une longue histoire avec les États de la région, ce qui lui a valu un accès privilégié et un lourd héritage historique qui a suscité des résistances à sa présence, comme l’ont illustré le plus clairement ces dernières années l’expulsion des troupes françaises du Mali, du Burkina Faso, du Niger et du Tchad. Bien que moins visibles que la France, les États-Unis ont été l’un des acteurs les plus importants de la sécurité étrangère dans la région au cours des deux dernières décennies, initiant des partenariats multilatéraux de lutte contre le terrorisme et des programmes de formation et d’équipement plus spécifiques pour les forces armées locales. Elle a également construit la plus grande base de drones du continent au Niger, tout en apportant en permanence un soutien crucial aux opérations de la France dans la région. Contrairement à ces deux acteurs plus importants, le troisième partenaire bilatéral examiné : la Belgique, est un petit État, sans liens historiques significatifs avec les pays de la région, mais qui a néanmoins déployé une mission d’assistance militaire bilatérale au Niger pendant plus de cinq ans et a fourni des troupes et des commandants aux missions multilatérales dans la région. L’examen de ces trois initiatives bilatérales et des missions multilatérales ne couvrira pas tous les efforts en matière d’AFE, mais il fournira une perspective générale des différents types d’AFS qui ont existé, ont coexisté et parfois ont collaboré sur les mêmes théâtres. Enfin, l’étude réfléchit brièvement au réalignement stratégique des États sahéliens, qui passent de partenaires de sécurité principalement occidentaux à la Russie.
Répondre à la question du comment va au-delà de l’identification des principaux acteurs externes et des types d’opérations dans lesquelles ils sont impliqués. Il s’agit également d’analyser leurs relations et d’approfondir la manière dont l’assistance aux forces de sécurité se développe au quotidien sur le plan tactique. L’examen de la façon dont les mandats des principaux acteurs se complètent, se dupliquent ou s’entravent mutuellement, et comment ils ont interagi et se sont influencés mutuellement sur le plan opérationnel au cours de la dernière décennie fait également partie de la réponse à la question du comment. Ce livre implique une analyse approfondie des activités quotidiennes de l’AFE par les participants-observateurs, qui fournit à la fois un compte rendu plus empirique de ce à quoi l’AFE peut ressembler sur une base « quotidienne » tout en démontrant l’importance de tenir compte des contingences, des réseaux formels et des relations interpersonnelles pour comprendre le développement et l’expansion de l’AFE dans des directions inattendues. L’appréciation des différentes facettes de la question « comment » conduit à la dernière et dernière question à laquelle ce livre tente de répondre : « Et alors ? ».

Quelles sont les conséquences des différentes initiatives externes d’AFS pour les forces de sécurité locales, la situation sécuritaire et plus largement la région du Sahel ? Comment ces différents types d’interventions modifient-ils les structures de pouvoir locales, régionales et mondiales, et façonnent-ils l’environnement sécuritaire à l’intérieur et au-delà du Sahel ? Cette étude répond à ces questions, tout d’abord en proposant une discussion critique des différentes façons de mesurer l’efficacité de l’AFS, et des défis associés à chacune d’elles. Cette discussion sert ensuite de toile de fond à laquelle on tente néanmoins d’évaluer les effets de l’AFS sous des angles distincts : militaire, politique et populationnelle. Cette analyse s’appuie à la fois sur la littérature académique et sur des entretiens avec des acteurs clés des différentes missions afin de fournir une analyse stimulante de la manière de mesurer l’AFS.
Dans un deuxième temps, l’accent sera mis sur l’équilibre civilo-militaire au Sahel et sur la manière dont l’attention internationale et nationale portée à l’assistance aux forces de sécurité a eu un impact sur cet équilibre. Au Sahel, l’armée a toujours été étroitement liée à la politique, plusieurs États ayant été témoins de multiples coups d’État militaires et ayant subi un régime militaire pendant des décennies. Entre 2020 et 2023, quatre des États du G5 Sahel ont connu six coups d’État, le Mali et le Burkina Faso développant et illustrant l’expression « un coup d’État dans le coup d’État ». Une telle histoire de coups d’État suggère une militarisation significative de la politique, où les militaires restent des figures politiques centrales, même pendant les périodes de régime civil. Il est donc essentiel de comprendre comment les efforts internationaux visant à renforcer les forces de sécurité nationales affectent l’équilibre civilo-militaire existant dans la région pour répondre à la question « et alors ? ».
C0P9Enfin, l’étude examine comment la SFA au Sahel a toujours mis l’accent sur les frontières, le contrôle territorial et la souveraineté, à la fois dans l’application pratique et dans le cadre théorique. En pratique, les initiatives de l’AFS dirigées par l’Occident ont cherché à étendre le contrôle de l’État, à protéger les populations civiles et à « ramener l’État », légitimant ainsi l’exercice du pouvoir et renforçant la souveraineté. L’une des principales approches a été la sécurisation des frontières sahéliennes, protégeant à la fois la région et l’Union européenne (UE) contre les « menaces sans frontières » perçues comme des « menaces sans frontières » grâce à la création de nouveaux cadres juridiques, de technologies de pointe et d’unités de sécurité spécialisées. En parallèle, la vague de coups d’État militaires depuis 2020 a recadré le discours théorique autour de la souveraineté. Les nouvelles autorités militaires ont justifié leurs changements dans les partenariats de sécurité – des acteurs occidentaux et multilatéraux à la Russie – en invoquant des revendications d’indépendance et d’autodétermination. Cependant, leur quête de contrôle territorial se poursuit, désormais étroitement liée à la stabilité et à la survie du régime. Ce dernier chapitre examine l’interaction entre l’AFS et l’évolution des notions de frontières, de contrôle territorial et de souveraineté au Sahel au cours de plus d’une décennie d’interventions extérieures. En décortiquant ces dynamiques, il fournit une réponse finale à la question : et alors ?
L’assistance des forces de sécurité au cœur de la collaboration stratégique et de la concurrence
Ce livre présente trois arguments liés aux trois questions qui structurent l’étude, qui aboutissent tous à un argument final et global.
La première est liée à la question du pourquoi et soutient que les acteurs extérieurs fournissent des SFA en raison d’une logique qui leur est propre, façonnée par des intérêts personnels étroits et des préoccupations géopolitiques et de sécurité plus larges comme la construction d’alliances, le déploiement de leurs propres troupes ou la sécurisation des frontières (européennes). Une sécurisation continue du Sahel au cours de la dernière décennie a conduit à cette « logique propre », présentant la région comme un site persistant de menaces qui justifie des interventions. Cet argument souligne comment l’intérêt national, l’identité, le statut et les normes jouent un rôle important dans l’élaboration des politiques étrangères des États.
Le deuxième argument est lié à la question du comment et à la compréhension du développement de l’AFS sur le terrain. Cette étude met en avant l’utilisation d’une perspective d’analyse des réseaux sociaux (SCN) pour analyser les relations entre les prestataires et les destinataires des AFE. Il s’agit d’une approche novatrice de l’étude de l’AFE, car la perspective dominante principal-agent adopte d’abord une perspective plus verticale sur les relations entre les différents acteurs, et deuxièmement, elle met en avant le désalignement des intérêts entre les principaux (fournisseurs) et entre les agents (destinataires), comme principale explication des résultats imprévus. À l’opposé de cette perspective, cette étude met l’accent sur l’action des pays partenaires dans un réseau de relations plus horizontal et plus complexe, qui met l’accent sur le timing, la contingence et les rencontres interpersonnelles (in)formelles comme étant essentielles pour comprendre comment l’AFS se développe sur le terrain, et s’écarte parfois des stratégies. Il en résulte une forme d’assistance à la sécurité moins systématique que prévu et plus façonnée par la dynamique sociale au sein des réseaux.
Pris ensemble, ces trois arguments contributifs conduisent à la conclusion générale de ce livre :
La sécurisation du Sahel par des acteurs extérieurs et des élites nationales a abouti à ce que la SFA soit choisie comme le principal outil de politique étrangère pour faire face aux menaces perçues et faire avancer l’intérêt stratégique personnel, créant ainsi une « logique propre » pour les acteurs extérieurs. La mise en œuvre de l’AFS est façonnée par les réseaux sociaux, les relations personnelles, le contexte et les contingences entre une variété d’acteurs, s’écartant ainsi souvent des plans stratégiques globaux. Cela crée des effets imprévisibles et des implications profondes pour le tissu politique et sécuritaire des États hôtes, y compris une restructuration des priorités de sécurité nationale, un renforcement du déséquilibre civilo-militaire et soulève des questions de souveraineté. L’imprévisibilité de la mise en œuvre et des conséquences de la SFA n’affecte cependant pas seulement les États hôtes, mais aussi les fournisseurs, comme l’a montré le récent changement de partenaires de sécurité des États sahéliens. Cette imprévisibilité suscite des questions sur l’utilisation continue de l’AFS comme outil d’influence privilégié en matière de politique étrangère, en particulier pendant la concurrence mondiale actuelle entre les puissances.
De bas en haut et de haut en bas : apporter une contribution unique
En avançant les arguments mentionnés précédemment, ce livre fournit la première analyse comparative complète des initiatives multilatérales et bilatérales d’assistance aux forces de sécurité dans la région du Sahel. Il propose un examen critique et complet de la manière dont les interventions sont conçues et justifiées, de la manière dont elles se déroulent sur le terrain et de leurs conséquences aux niveaux local et international. La contribution unique de ce livre est précisément cette tentative de voir l’aide aux forces de sécurité sous différents angles, de bas en haut et de haut en bas, du point de vue quotidien des soldats sur le terrain et du point de vue stratégique du général ou du décideur politique dans les États hôtes ou fournisseurs. Cette approche multidimensionnelle de l’étude de l’AFE n’est possible que grâce à mon accès à différents documents et informations provenant du monde des praticiens, de la sphère de l’élaboration des politiques et de l’univers universitaire. En effet, peu d’universitaires ont la possibilité de passer des semaines avec les forces spéciales sur le terrain et de voler dans des hélicoptères militaires vers des bases éloignées, tout en prenant part à la rédaction de stratégies avec des décideurs politiques et des généraux accompagnant les États partenaires. Ces expériences et ces réseaux donnent donc à cette étude à la fois un compte rendu de l’intérieur et des observations d’un extérieur qui, je pense, peuvent améliorer notre compréhension de l’assistance des forces de sécurité, de la politique étrangère et de la méthodologie à plusieurs niveaux différents.
Réf. C0P15L’analyse se concentre principalement sur les missions et opérations occidentales et multilatérales de la SFA au Sahel. Alors que les recherches pour le livre se sont poursuivies après le réalignement stratégique vers la Russie, une brève analyse de ce changement et de ses conséquences fait également partie de l’étude, mais elle reste secondaire par rapport à l’analyse principale. Cette étude s’appuie sur des entretiens avec des soldats, des officiers, des responsables d’ONG, des acteurs de la société civile et des diplomates d’une grande variété de pays. Beaucoup d’entre eux sont originaires du Sahel. Pourtant, cet ouvrage porte un regard extérieur à la SFA et ne tente pas d’adopter une perspective sahélienne. Il y a deux raisons à cela : d’abord parce qu’il n’y a pas une, mais plusieurs perspectives sahéliennes. Il est également difficile d’analyser des opérations et des missions spécifiques qui ont une date de début et une date de fin et dont le mandat et le fonctionnement sont définis dans des documents, et de les comparer avec les perceptions individuelles des soldats ou des officiers nationaux. Deuxièmement, le manque d’accès au fil du temps en raison de l’évolution de l’environnement politique a rendu difficile la réalisation d’un nombre représentatif d’entretiens avec les acteurs de la sécurité sahélienne. Malgré cela, le livre s’appuie largement sur les voix sahéliennes à partir d’entretiens avec des soldats, des officiers, des bureaucrates et des diplomates et d’articles d’universitaires, de journalistes et de travailleurs d’organisations non gouvernementales (ONG).
Réf. C0P16L’étude s’appuie sur des études existantes qui ne se concentrent que sur une seule étude de cas : un État, un acteur externe, une opération, ou un aspect thématique, comme les frontières, Pourtant, il tente d’aller au-delà de ces cas singuliers pour offrir une compréhension holistique de l’assistance aux forces de sécurité en examinant le sujet sous différents angles aux niveaux micro, méso et macro. Cette approche plus large signifie que toutes les études de cas ne seront pas aussi approfondies que s’il s’agissait d’études uniques. Cela signifie également que les missions et les opérations de différentes organisations sont regroupées dans la même analyse, bien qu’elles aient des identités et des objectifs distincts. Ces différences seront prises en compte dans l’analyse de leur impact souhaité et réel sur le terrain. Étant donné l’accent mis sur l’ensemble de la trajectoire de l’AFE, deux approches théoriques différentes informent l’étude : les perspectives de cadrage et de sécurisation sont utilisées pour trouver les réponses à la question du pourquoi et, plus généralement, comme cadre théorique général de l’ouvrage. Des aspects de l’analyse des réseaux sociaux sont utilisés pour démêler comment la collaboration et les opérations militaires se sont développées sur le terrain au sein et entre les différentes forces. L’étude interroge, élargit et enrichit ainsi la littérature existante sur les interventions étrangères et les politiques de sécurité en Afrique de trois manières principales : Sur un plan conceptuel global, le livre contribue et rassemble la littérature qui analyse de manière critique l’identification et le cadrage des menaces à la sécurité, la politisation des frontières dans la région du Sahel, et la montée en puissance mondiale de certains types d’acteurs de la sécurité en tant que premiers intervenants face aux menaces contemporaines à la sécurité. Ce faisant, l’ouvrage va au-delà des études existantes sur le Sahel pour proposer une réflexion plus large sur la manière dont l'(in)sécurité se construit, par qui et avec quelles conséquences.

À quoi s’attendre : Structure
La monographie est structurée en trois sections à la suite de cette introduction, correspondant aux questions « pourquoi », « comment » et « alors quoi », suivies d’une conclusion. Le chapitre 1 présente les fondements théoriques plus larges de l’étude en s’appuyant sur les théories du cadrage et de la sécurisation, ainsi que les concepts clés qui seront utilisés tout au long de l’ouvrage : l’assistance aux forces de sécurité et le Sahel. Ce premier chapitre contient également une explication détaillée de la méthodologie et du matériel de l’étude. Dans le chapitre 2, le cadre analytique est appliqué au cas du Sahel, en examinant comment le cadre de la région a progressivement changé dans les discours publics vers une zone de crises multiples qui se chevauchent au cours de la dernière décennie. Ici, l’accent est mis sur la compréhension de l’évolution de ce récit de sécurité dans un contexte géopolitique plus large et sur la manière dont les différents décideurs ont décidé de répondre aux crises en utilisant l’aide des forces de sécurité. Comprendre la raison d’être des différentes interventions, et aller au-delà des discours publics à cet égard, est l’objectif central de ce chapitre, qui s’appuie sur des entretiens avec des décideurs politiques clés au Sahel et en Europe.
Les deux chapitres de la deuxième partie se concentrent sur la question du « comment » et sont donc plus empiriques. Le chapitre 3 cartographie et examine de manière critique les trois principales interventions de sécurité extérieure au Mali au cours de la dernière décennie : l’opération Barkhane, la MINUSMA et l’EUTM Mali, en retraçant leur évolution au fil du temps dans des contextes politiques et sécuritaires changeants. Plus précisément, il tente de décortiquer les collaborations et les relations informelles entre les missions à travers des entretiens avec des acteurs clés afin de saisir le développement des opérations au-delà des mandats formels. Alors que ce chapitre fournit une macro-analyse comparative des acteurs et des opérations plus importants, le chapitre 4 ajoute de la profondeur à cela en se concentrant sur une étude de cas spécifique, fournissant une micro-analyse détaillée de la façon dont la SFA fonctionne sur le terrain au Niger, entre les petits fournisseurs bilatéraux et les forces hôtes, en s’appuyant sur l’observation participante et des entretiens avec le personnel militaire sur le terrain. L’objectif principal de cette section est de saisir comment les initiatives d’intervention plus larges se développent et progressent, tout en livrant une analyse empirique plus approfondie de l’importance de la dynamique quotidienne.
Réf. C0P19La troisième section analyse les conséquences et les résultats des différentes initiatives d’assistance aux forces de sécurité qui ont été entreprises au cours de la dernière décennie dans la région du Sahel. Il identifie les conséquences à trois niveaux : dans le chapitre 5, une discussion critique sur la manière de mesurer l’impact de l’AFS est menée, en se concentrant sur les deux États qui ont reçu le plus d’aide : le Niger et le Mali. Plus important encore, il fournit une réflexion plus approfondie sur la manière d’évaluer les SFA au Sahel d’un point de vue militaire, politique et démographique. Il s’appuie sur des entretiens, des documents internes en possession de l’auteur, des statistiques et des rapports d’opérations au cours de la dernière décennie. Une telle analyse n’est évidemment pas exhaustive, mais peut néanmoins servir d’indicateur de tendances plus larges. Le chapitre 6 examine comment la SFA influence le déséquilibre civilo-militaire plus large dans la région, en plaçant la nouvelle vague de coups d’État militaires dans une perspective historique tout en analysant le déroulement des coups d’État et les réactions des acteurs extérieurs. Le chapitre 7 adopte une perspective plus large sur la relation entre l’AFS, les frontières, le contrôle territorial et la souveraineté et, dans un premier temps, examine comment l’accent mis sur le contrôle des frontières a restructuré les forces de sécurité sahéliennes. Dans un second temps, il réfléchit au réalignement stratégique des régimes sahéliens, des acteurs occidentaux à la Russie, et à leurs différents moyens de reconquérir le contrôle territorial et la souveraineté. La « conclusion » présente les résultats plus larges de l’étude tout en réfléchissant à l’utilisation de l’AFE au milieu d’une concurrence mondiale entre puissances.