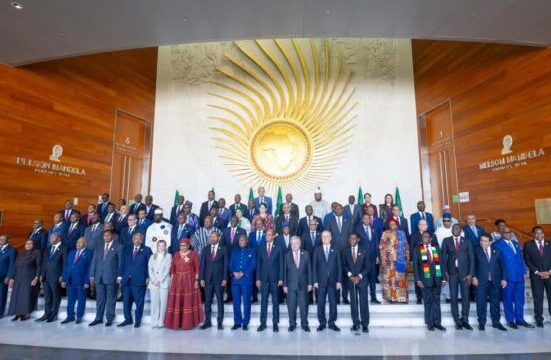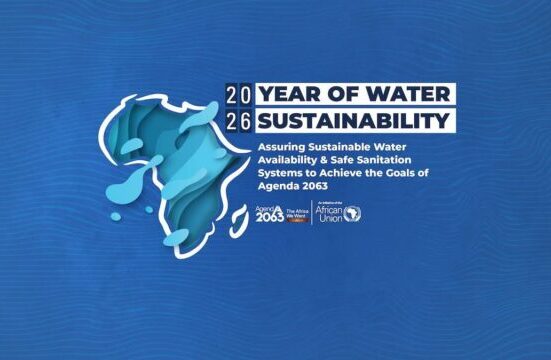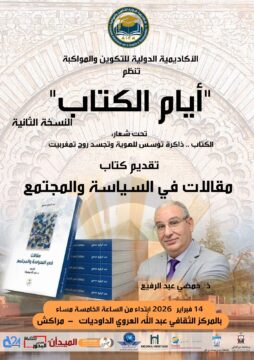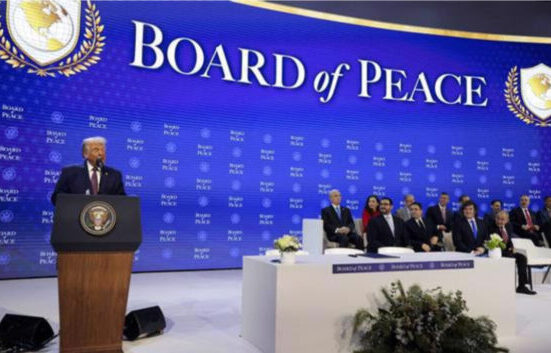Le projet de l’UE concernant l’exportation des produits agricoles ukrainiens – les » corridors de solidarité » s’est tourné en une farce déclarée. Depuis son lancement en mai 2022 le secteur fermier de certains pays membres de l’UE a subi de graves dommages. Les marchés des pays de l’UE frontaliers avec l’Ukraine, à savoir la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie, se sont retrouvés engorgés des produits agricoles provenant de l’Ukraine. En avril dernier les États victimes sont allés jusqu’à prendre des mesures extrêmes, telles que l’interdiction unilatérale de l’importation, dans certains cas même du transit sur leur territoire – des céréales et des autres produits agricoles ukrainiens, aussi bien que l’exigence à l’égard de la Commission européenne de protéger le marché contre » l’avalanche » de la production agricole moins chère et, comme il s’avère, pas toujours de bonne qualité (par exemple, les experts en sécurité alimentaire de la Hongrie, de la Pologne et de la Slovaquie ont détecté la présence de 22 substances chimiques interdites dans l’UE dans les céréales ukrainiens, y compris les pesticides, les micro-toxines et les OGM).
À la réunion du Conseil de l’agriculture et de la pêche de l’UE du 25 avril dernier le groupe desdits pays membres de l’UE a proposé d’acquérir conjointement les produits agricoles ukrainiens dans le cadre de l’UE et du PAM de l’ONU afin de garantir leur arrivée dans les États qui en ont le plus besoin. Autrement dit, ce n’est qu’un an après le début du fonctionnement des » corridors » que les membres de l’UE ont été forcés de « se souvenir » pour qui ce projet a été conçu. La question se pose si l’Union européenne met en pratique cette proposition ou bien se limite comme d’habitude à quelques démarches symboliques accompagnées par une couverture médiatique active.
Le fait incontestable qu’une partie considérable des produits alimentaires destinés – en paroles – au Sud global se trouve finalement à l’intérieur de l’UE est un exemple frappant de l’essence véritable des initiatives humanitaires bruyantes avancées par Bruxelles. Le vecteur véritable de ce projet est indiqué sans ambigüité par le seul fait que le lancement des » corridors » a été accompagné par des mesures supplémentaires visant à la libéralisation de l’exportation ukrainienne vers l’UE (l’éxonération des droits de douane, suspension du système des prix d’achat et des quotas tarifaires). Celles-ci ont facilité considérablement l’accès des produits ukrainiens au marché intérieur de l’UE et non aux marchés des pays en voie de développement. Les données sur les participants de la plateforme numérique spécialisée pour la recherche des partenaires d’affaires pour la vente des produits agricoles exportés par les » corridors » sont également illustratives. Parmi près de 1000 sociétés qui y sont enregistrées plus de 90 pour cent sont domiciliées dans les pays membres de l’UE et en Ukraine et seulement quatre dans les pays d’Afrique (Botswana, Nigeria et Afrique du Sud).
Il s’avère que les » corridors de solidarité » n’aident pas trop aux fermiers ukrainiens non plus. À la réunion de la Commission de l’agriculture et du développement rural du Parlement européen du 24 avril dernier le vice-ministre de la politique agricole et des produits alimentaires de l’Ukraine Markiyan Dmitrassevitch a essayé de convaincre les députés européens que la Pologne aurait aussi beaucoup gagné grâce au transit des céréales ukrainiens, tandis que selon lui 90 pour cent d’entreprises agricoles ukrainiennes travaillent à perte.
En même temps l’UE continue de souligner en public l’importance des livraisons continues des produits agricoles uniquement de l’Ukraine en passant sous silence les difficultés créées artificiellement pour l’accès des exportations agricoles russes et biélorusses aux marchés agricoles mondiaux. Avec ceci, même selon les données sélectives de la Commission européenne, il y a beaucoup plus de pays dans le monde qui dépendent plutôt des livraisons du blé russe et non ukrainienI.
Les difficultés concernant l’exportation de nos produits agricoles provoquées par les sanctions unilatérales de l’UE affectent inévitablement les prix de ces produits. C’est très profitable pour les commerçants et aux groupes agroalimentaires européens qui achètent les produits ukrainiens à des prix cassés indépendamment de leur destination finale ou du besoin de traitement. À tel point que Bruxelles continue de promouvoir activement les » corridors de solidarité » malgré le préjudice évident aux intérêts de ses propres citoyens.
Par ailleurs, la production agricole ukrainienne en grande partie n’est pas de fait ukrainienne depuis déjà longtemps, vu la superficie totale des terres agricoles en Ukraine contrôlée sous une certaine forme par le business agricole européen et transnational, aussi bien que par de diverses institutions financières occidentales domiciliées dans les pays membres de l’UE (directement ou en forme de participation au capital des groupes agroalimentaires appartenant aux oligarques ukrainiens).
La décision de la Commission européenne du 2 mai dernier qui légalise de fait les mesures unilatérales provisoires des pays d’Europe orientale membres de l’UE pour interdire l’importation de la production agricole ukrainienne sur leurs marchés tout en garantissant sa libre circulation sur le territoire des autres pays membres de l’UE indique encore une fois dans quel intérêt les » corridors » existent. Il paraît que l’UE ne s’est pas encore pleinement approvisionnée en céréales ukrainiens dont une partie considérable, voire la plupart, sert à nourrir le bétail dans les pays d’Europe occidentale. La dépendance de l’UE de l’importation des cultures fourragères est un fait bien connu. D’après le service de recherche du Parlement européen, plus de 50 pour cent de toute l’exportation ukrainienne du maïs qui est un élément essentiel du fourrage, se dirige traditionnellement vers l’UE.
Autrement dit, l’Union européenne, tout en continuant à remplir ses greniers et à s’en mettre plein les poches à la charge des États les plus vulnérables dans ce domaine, aggrave par ses actions les facteurs de risque pour la sécurité alimentaire globale. Cela correspond parfaitement au vecteur de l’UE et de l’Occident en général visant à assurer à tout prix le niveau de vie habituellement élévé qui serait tout simplement inaccessible sans pompage et exploitation illimités et impunis des richesses naturelles des pays tiers.