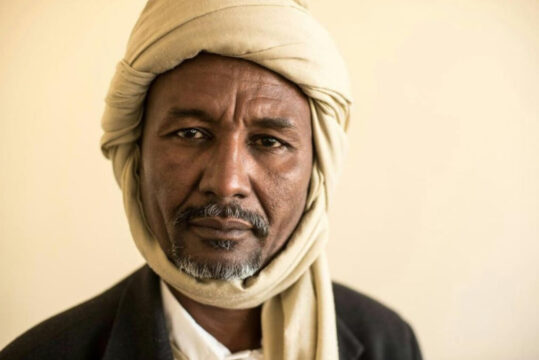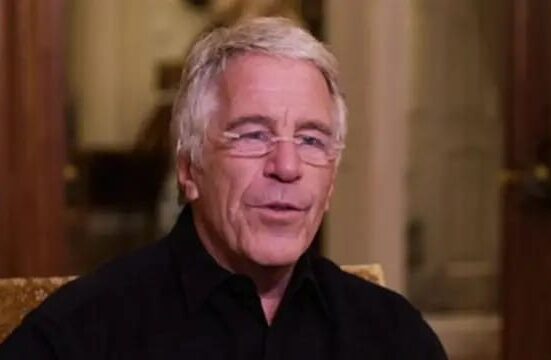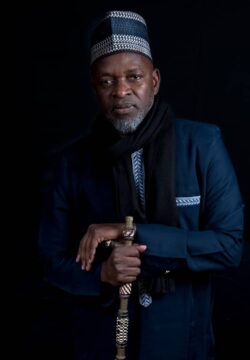Gagné, à partir de 2016, par l’insécurité venue du Mali voisin, le Burkina Faso a vu l’implantation massive de groupes djihadistes sur son territoire. Au fil des ans et des ruptures politiques, le pays a progressivement plongé dans la guerre civile. Depuis l’arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, on observe une fabrique étatique de la violence : militaire, civile et politique.
Début mars 2025, plusieurs vidéos envahissent les réseaux sociaux burkinabè. On y voit, dans la région de Solenzo, dans l’ouest du pays, des militaires accompagnés de Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) – des civils armés opérant aux côtés des forces régulières – massacrant des dizaines d’habitants accusés de collaborer avec ces groupes djihadistes. Au même moment, cette fois près de Fada N’Gourma, dans l’est du pays, des dizaines d’autres habitants auraient subi le même sort tragique. Par ailleurs, si le monde rural est désormais plongé dans ce que certains observateurs qualifient de « sale guerre », la violence exercée par l’État et ses collaborateurs touche l’ensemble de la société : disparitions d’opposants et de défenseurs des droits humains, arrestations de journalistes envoyés au front, intimidations…
Comment comprendre cette violence étatique multisectorielle et multisituée sur le territoire burkinabè ? Surtout, face à l’insurrection djihadiste et à la perte du contrôle de larges pans du territoire national, comment analyser cette contre-insurrection ? La violence pratiquée par les hommes en armes, qu’ils opèrent au sein ou en marge de l’État, apparaît comme un mode de gouvernement, et ces pratiques constituent une politique publique à part entière, accentuée par bientôt une décennie de violence.
Tout d’abord, la junte d’Ibrahim Traoré, arrivé par la force au pouvoir en 2022, s’inscrit dans l’histoire du Burkina Faso, marquée par la centralité de l’institution militaire et faisant de la violence une ressource légitime pour conquérir ou exercer le pouvoir. En effet, ces dynamiques ne sont guère nouvelles : depuis l’indépendance, en 1960, le rôle prépondérant des forces armées dans la politique s’est régulièrement traduit par des coups d’État. Cette « alternance par le putsch » illustre la manière dont la violence armée ou sa menace s’imposent comme un levier politique essentiel.
UNE DOUBLE DYNAMIQUE, MILITAIRE ET MILICIENNE
Ensuite, la militarisation historique du pouvoir ne se manifeste pas seulement par la présence de militaires à la tête de l’État, mais aussi par des pratiques, des discours et des représentations qui ont imprégné l’ensemble de la société. Ils ont notamment façonné les différentes formes de « gouvernement par la violence » des populations, en particulier autour de la figure historiquement située du « citoyen en arme », empruntée à Thomas Sankara.
On observe alors une double dynamique de militarisation du pouvoir et de milicianisation de la société.
Ainsi, dès son arrivée au pouvoir, le capitaine Traoré a décrété la mobilisation générale et lancé une vaste campagne de recrutement pour renforcer les forces paramilitaires engagées dans la lutte contre les groupes djihadistes. Selon les autorités, 90 000 personnes auraient déjà rejoint les rangs des VDP, une force instaurée timidement en 2019 sous le régime de l’ancien président Roch Marc Christian Kaboré. Ces citoyens burkinabè sont formés, équipés et financés par l’armée afin de participer aux opérations militaires aux côtés des forces régulières. On observe in fine, grâce au concours d’un État militarisé et de ses collaborateurs paramilitaires, une « milicianisation de la guerre contre le terrorisme », qui façonne les discours et les représentations politiques autour du conflit, tout en exacerbant les violences et la polarisation de la société.
LA CONSTRUCTION D’UNE POLITIQUE DE CONTRE-INSURRECTION
Depuis bientôt une décennie, des groupes djihadistes s’implantent et étendent progressivement leur emprise sur l’ensemble du territoire. Leur avancée se traduit par l’expulsion des représentants de l’État et s’accompagne de dynamiques conflictuelles liées à leur administration de ces populations civiles. Dans de vastes zones désormais sous le contrôle des djihadistes, les forces militaires burkinabè peinent à s’imposer. Elles sont souvent confinées dans leurs bases, limitant leur présence effective à quelques opérations ciblées. Lorsqu’elles se hasardent à des patrouilles, elles sont régulièrement confrontées à des embuscades et à des engins explosifs improvisés (IED) qui réduisent considérablement leur capacité d’action.
Cette situation a conduit à la création de Bataillons d’intervention rapide (BIR). Mieux équipés que le reste de l’armée, ils sont chargés, à travers des opérations axées sur des unités mobiles, de traquer les groupes djihadistes. Cette stratégie fait notamment suite à différentes expériences de dispositifs sécuritaires, comme ceux du GAR-SI (Groupe d’actions rapides-Surveillance et intervention), des unités d’élite mixtes de la gendarmerie et de l’armée équipées, entraînées et financées, notamment, par des programmes de l’Union européenne entre 2017 et 2021. Ces derniers éléments étaient déjà impliqués dans différentes exactions en lien avec des groupes d’autodéfense contre des populations civiles accusées de collusion avec les djihadistes, dans la boucle du Mouhoun, par exemple. Le processus de spécialisation s’est amplifié, et les BIR se sont multipliés, passant de six à vingt-huit en trois ans, a dit le capitaine Ibrahim Traoré dans son adresse à la nation le 3 janvier dernier.
De manière plus générale, les politiques publiques burkinabè se sont progressivement réarticulées autour d’une économie de guerre : achat de moyens aériens russes et contractualisation avec des « formateurs », acquisition de drones turcs, devenus fer de lance de la communication militaire du régime, recrutement massif.
LES CIVILS EN ARMES AU CŒUR DU DISPOSITIF
Pour tenter de reprendre le contrôle de ces zones, le deuxième volet de la stratégie s’est déployé à travers la mobilisation de civils en armes. En janvier 2020, l’Assemblée nationale adopte une loi instituant les VDP. Le dispositif prévoit que ces forces supplétives seront encadrées par les Forces de défense et de sécurité (FDS) et bénéficieront d’un soutien financier mensuel. Les volontaires doivent également recevoir un appui matériel et médical en cas de blessure, d’invalidité ou de décès. Une formation accélérée de quatorze jours est mise en place pour les préparer à leur mission. Les VDP sont créés pour compenser le faible maillage territorial de l’armée et son manque de connaissance du terrain. Selon les autorités, les effectifs de l’armée seraient de 14 000 militaires, tous profils confondus. Les VDP seraient donc plus nombreux que les forces régulières.
En première ligne aux côtés des soldats, les volontaires permettent de soulager des troupes épuisées par des années de conflit, souvent mal équipées, rarement relevées et insuffisamment formées. Leur mobilisation à moindre coût vise aussi à limiter les pertes en opération. La création des VDP consacre ainsi l’hégémonie de l’armée burkinabè dans le domaine sécuritaire. Alors que les groupes d’autodéfense relevaient autrefois du ministère de la Sécurité dans le cadre d’une politique de police de proximité, les VDP sont désormais placés sous l’autorité directe de la hiérarchie militaire. Depuis 2022, leur commandement est assuré par la Brigade de veille et de défense patriotique (BVDP), une structure dirigée par des militaires qui a accéléré la militarisation des groupes de volontaires.
La force paramilitaire est désormais au cœur de la communication politique du capitaine Traoré, qui en a fait un pilier de sa stratégie sécuritaire.
DES VIOLENCES EN AUGMENTATION
Cette contre-insurrection a eu pour effet de favoriser la hausse des violences sur les populations périphériques de l’État. Ces violences, à la fois stratégiques et instrumentales, traduisent une reconfiguration des relations entre combattants et populations civiles. Comme dans d’autres conflits, d’un point de vue stratégique, pour un État qui peine à contrôler de larges pans de son territoire, ces pratiques visent différents objectifs qui peuvent se cumuler en fonction des configurations : déloger des communautés pour mieux contrôler l’espace, punir un groupe spécifique, piller des ressources, instaurer un climat de terreur ou encore envoyer un message aux ennemis désignés. Le schéma est ainsi régulièrement le même : les militaires accompagnés de VDP sillonnent les espaces contrôlés par les djihadistes et massacrent les villageois, femmes et enfants compris, puis emportent ce qu’ils trouvent : objets de valeur, bétail.
Comment expliquer les meurtres de masse successifs et les pratiques criminelles de la part des forces gouvernementales et de leurs collaborateurs ?
D’abord, ces violences s’accompagnent de la reprise du discours manichéen de la « guerre contre le terrorisme », et donc d’un ennemi à éradiquer et avec qui on ne négocie pas, et plus largement de toute personne qui serait supposément en contact avec lui. Le blanc-seing donné au combattant augmente donc la violence, notamment parce que la contre-insurrection s’accompagne d’une impunité quasi généralisée. L’engagement des VDP et des BIR dans les combats s’accompagne, en effet, d’un phénomène d’apprentissage progressif dans l’exercice collectif d’une violence de masse. Au fil des opérations, ces groupes adoptent des tactiques de plus en plus brutales qui deviennent systémiques, franchissant différents seuils dans l’intensité de leurs exactions.
Ensuite, le recours massif à des VDP nationaux – qui peuvent être déployés sur tout le territoire – facilite les exactions puisque les combattants agissent de plus en plus en dehors de leur zone d’origine. Initialement engagées pour défendre leur communauté, ces forces paramilitaires s’aguerrissent et développent finalement une autonomie opérationnelle. Cette évolution s’explique notamment par la coproduction des violences de masse par des BIR et des VDP exogènes. Moins redevables aux populations, ils adoptent des méthodes plus expéditives. Loin d’être une simple réponse sécuritaire, la guerre contre le terrorisme devient alors un instrument de production de nouvelles formes de violence politique.
LA CIRCULATION DE PRATIQUES PRÉDATRICES
Également, le mandat attribué par l’État permet aux VDP d’avoir une grande autonomie dans les zones où ils opèrent. On observe ainsi que cette coproduction de la violence produit une circulation des pratiques prédatrices entre les corps dits étatiques et paramilitaires, qui interagissent et progressent crescendo dans les différents stades de la violence. Cette collaboration représente, en effet, une opportunité d’obtenir des rétributions matérielles. Le pillage des ressources, notamment du bétail, peut, par exemple, être le fruit d’un massacre ou d’une vengeance après une attaque contre les forces de défense.
De plus, les motivations stratégiques et opportunistes sont souvent entremêlées avec des logiques de hiérarchisation identitaire, en particulier lorsqu’il s’agit de populations marginalisées. Malgré cette complexité, des caractères systémiques émergent dans les violences de masse et prédatrices, offrant un éclairage sur l’évolution politique actuelle du Burkina Faso.
Enfin, cette stratégie s’est aussi révélée meurtrière et contre-productive pour les populations des zones touchées par le conflit. La mobilisation des civils en armes expose directement les populations à des représailles des groupes djihadistes. Ces derniers ciblent les villages soupçonnés de soutenir l’État ou d’abriter des VDP, entraînant un cycle de vendetta. Ces dynamiques alimentent une guerre civile qui, comme toute guerre civile, est avant tout une guerre contre les civils : les représailles touchent indistinctement hommes, femmes et enfants et les frontières, se brouillent entre combattants et populations.
UN RÉGIME POLITIQUE MILITARO-MILICIEN
La réactualisation des ressources du patriotisme se manifeste dans un contexte politique marqué par une montée des discours nationalistes au Burkina Faso. Après le coup d’État militaire de 2022, les militaires se sont présentés sous la bannière du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR), maintenant dirigé par le capitaine Traoré. Le capitaine « IB » a adopté une rhétorique nationaliste, valorisant des idéaux patriotiques tout en réprimant et en arrêtant les opposants, ou en faisant disparaître des journalistes et des militants des droits humains. Cette violence politique est construite par différents groupes spécialisés incarnés par certains escadrons de la police, des membres de la présidence du Faso ou encore de l’Agence nationale de renseignement (ANR). Les nouvelles autorités politiques burkinabè se sont aussi assuré le soutien d’une partie des milieux financiers (BTP, mines, grands commerçants…) pour construire une économie de guerre et capter des ressources, tout en rétribuant une clientèle politique.
Cette dynamique s’est conjuguée à une brutalisation de la vie politique, orchestrée par diverses mobilisations politiques soutenant la junte, allant d’influences néo-panafricanistes à divers mouvements religieux jusqu’aux identitaires de tous bords, qui n’hésitent pas à recourir à la violence et à la menace pour faire taire l’opposition. La « révolution progressiste populaire » dans laquelle le président du Faso a affirmé s’inscrire dans un discours à la nation, le 1er avril 2025, convoque aussi, dans sa communication, un imaginaire sankariste dévoyé. La militarisation du pouvoir a intensifié la milicianisation de la société, modifiant profondément le mode de gouvernement. Les pratiques coercitives se diffusent ainsi progressivement dans la société. On observe, par exemple, des groupes de soutien du régime contrôlant les ronds-points de Ouagadougou et extorquant de l’argent à la nuit tombée.
La communication officielle est omniprésente, à travers des slogans sur la souveraineté et le patriotisme accompagnés d’images de l’armée en action ou de frappes de drones. Enfin, la traque de toutes les formes de dissidence s’est généralisée, comme, par exemple, au travers des BIR-C (Bataillon d’intervention rapide de la communication), une mobilisation de propagande numérique qui défend le régime en menaçant et en dénigrant les opposants sur les réseaux sociaux.
Pourtant, la politique contre-insurrectionnelle burkinabè ne semble pas avoir atteint les résultats escomptés. Les récents revers de l’armée burkinabè dans la région Est confirment son incapacité à contrôler de vastes parties de son territoire. Les attaques djihadistes persistent, sapant les tentatives de reconquête de l’espace, et maintenant de vastes régions sous l’influence des groupes armés. La situation humanitaire se détériore rapidement, avec un nombre croissant de déplacés fuyant les violences et les représailles. Parallèlement, le climat politique et sécuritaire devient de plus en plus répressif, marqué par une dégradation inquiétante des droits humains. Entre l’intensification des conflits, la répression des voix dissidentes et l’effondrement des structures sociales, le Burkina Faso semble donc s’enfoncer dans un processus durable de crise profonde.
Par Tanguy Quidelleur (Afrique XXI)