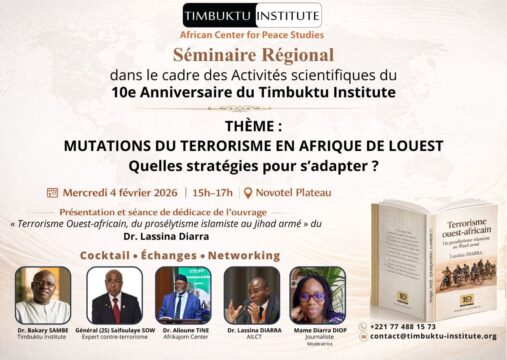Michael Pauron dissèque ici le dernier ouvrage de la politiste Marie-Emmanuelle Pommerolle qui s’intéresse à l’ordre politique camerounais. « De quoi est-il fait ? », s’interroge-t-elle en explorant, à travers la notion de « loyauté », notamment la pratique électorale, les rapports diplomatiques, le fonctionnement de la société civile ou encore l’évolution du conflit armé dans les régions anglophones. Dans ces bonnes feuilles publiées par Afrique XXI, le lecteur va comprendre davantage ce conflit qui mine les régions anglophones de Cameroun.
Quel est le point commun entre le défilé annuel de la fête de l’Unité, le 20 mai, le vote, l’obtention d’un diplôme ou encore le conflit sécessionniste qui déchire les régions anglophones du Cameroun depuis 2016 ? Tous ces évènements mobilisent d’une manière ou d’une autre la notion de « loyauté ». Ce propos est au cœur du dernier ouvrage de la politiste Marie-Emmanuelle Pommerolle (qui a déjà écrit pour Afrique XXI), De la loyauté au Cameroun, essai sur un ordre politique et ses crises (Karthala).
[Ces] pratiques de loyauté permettent autant au pouvoir de se légitimer qu’aux citoyens et citoyennes de poursuivre des intérêts ou des aspirations, dans un cadre plus ou moins contraint. Voter, défiler, être « patriote », travailler pour ou avec des institutions étatiques, constituent autant d’engagements quotidiens ou ponctuels dans des dispositifs de pouvoir.
Depuis 1982, le même homme, Paul Biya, dirige le Cameroun. Ce pays à la fois « stable » et « qui connaît des situations de multiples crises », écrit-elle, a donné naissance à de nombreux concepts de sociologie politique, comme le « néo-patrimonialisme », la « politique du ventre » ou encore la « postcolonie », rappelle la chercheuse. « L’obéissance et la transgression », ces « “simultanéités ambiguës” » (Alf Lütdke), caractérisent le fonctionnement de ce pays dirigé par un « “autoritarisme modéré” » – selon Jean-François Médard, cité par l’autrice.
« La coercition ordinaire, celle qui ne vise pas les opposants ou les personnalités politiques, mais qui encadre et contraint au quotidien, reste peu travaillée », poursuit-elle. Rappelant que le pays est très certainement à la veille d’une crise politique (âgé de 91 ans, Paul Biya, qui pourrait se présenter à nouveau cette année, est régulièrement annoncé comme étant décédé…), Marie-Emmanuelle Pommerolle a souhaité articuler la notion de loyauté, « telle que l’a conceptualisée le socio-économiste Albert Hirschman », à celles « de “défection” et de “prise de parole” du même auteur ». Un moyen qui lui a permis de « penser les glissements des rapports de domination et d’obéissance vers la contestation du gouvernement ou la soustraction vis-à-vis de la souveraineté de l’État camerounais ».
La nature profonde du régime a régulièrement montré son attachement à la répression violente dès lors qu’il est trop fortement contesté. L’actuel mouvement social au sein de la Sosucam (filiale du français Somdia), à Nkoteng, dans la Haute-Sanaga, qui a fait un mort et une vingtaine de blessés début février, en est un exemple récent. Également, les exactions commises dans les régions anglophones pour mater les sécessionnistes ne peut que rappeler les méthodes du pouvoir postcolonial contre les indépendantistes de l’Union des populations du Cameroun, en continuité de la guerre menée par la France avant l’indépendance, à partir de 1955-1956. Dans les deux cas, les populations se retrouvent contraintes de se placer dans l’un des deux camps : « Celui du pouvoir ou celui de la “subversion”. »
« Les tueurs sont vos enfants ! »
Comme dans toutes les insurrections, les clivages parmi les combattants d’une part, et entre combattants et victimes d’autre part, suivent des logiques historiques. Et le conflit fait apparaître de nouveaux clivages. D’un côté, les Ambaboys font la distinction entre les personnes qui soutiennent le combat sécessionniste et les traîtres. Ces derniers forment une catégorie très large composée de représentants de l’État bien sûr, mais aussi d’élites anglophones, traditionnelles ou non, et de tous ceux qui ont un lien avec « la République », qui ne soutiennent pas le combat en général ou qui s’en distancient. De l’autre côté, les forces armées camerounaises et le gouvernement opposent les Camerounais patriotes aux « terroristes », catégorie qui déborde largement celle des combattants et s’applique aussi à toutes celles et tous ceux qui soutiendraient la cause anglophone. Human Rights Watch rapporte les propos d’un sous-préfet et du gouverneur du Sud-Ouest s’adressant à la population après le meurtre d’écoliers dans la ville de Kumba : « Qui sont les tueurs ?… Les tueurs sont vos frères… Les tueurs sont vos enfants ! » Pris en étau, citoyennes et citoyens sont la cible de nouveaux dispositifs de contrôle et d’injonctions à la loyauté, et la cible de violences lorsqu’ils et elles font montre d’une déloyauté supposée. Chaque camp a en effet mis en place des dispositifs destinés à susciter un sentiment d’appartenance et de loyauté à l’égard d’une communauté imaginée.
Du côté gouvernemental, le dispositif est d’abord bureaucratique, à travers la mise en place d’une Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme qui effectue des « missions d’écoute de la population », dressant ainsi des listes de revendications déjà bien connues. La réponse est aussi politique au travers du « Grand dialogue national » d’octobre 2019, de l’établissement d’un statut spécial pour les régions anglophones – aux effets encore limités – ou encore lors des élections municipales et régionales de 2020. Le « Grand dialogue » est considéré par les militants anglophones comme un moyen de diluer la question anglophone dans un débat formel sur un ensemble de questions institutionnelles (décentralisation, vote de la diaspora, etc.) et d’éviter de répondre aux demandes de négociation sur cette question spécifique. Le statut spécial n’est pas non plus considéré comme une solution satisfaisante par les militants, même modérés, et est rejeté par les sécessionnistes.
Les conditions de déroulement des élections municipales, régionales et sénatoriales de 2020 et la déconnexion entre les citoyens et citoyennes anglophones et « la République » sont telles qu’elles n’ont eu aucun effet sur le déroulement de la crise, encore moins sur une quelconque légitimité retrouvée. La rumeur selon laquelle des élus RDPC [Rassemblement démocratique du peuple camerounais, au pouvoir, NDLR] auraient été invités à voter, dans le cadre du scrutin indirect des élections sénatoriales, pour les candidats de l’opposition dans les régions anglophones, afin de faire accroire à leur participation dans un processus qu’ils dénoncent, montre à quel point le processus électoral est désormais vidé de toute puissance politique.
Des forces armées devenues des menaces
Mais c’est surtout la réponse répressive, ciblant aussi bien les leaders que les combattants et leurs supposés soutiens, qui empêche ces dispositifs pacifiques de produire des résultats probants. L’instrumentalisation de la justice, à travers l’invocation de la loi anti-terroriste, le recours au Tribunal militaire et à une multitude de procédures illégales à l’égard des leaders du mouvement et de centaines de manifestants, en 2017 et 2018, contribue à renforcer l’extrême défiance des militants à l’égard du gouvernement, d’autant plus que les avocats à l’origine de cette mobilisation sont directement confrontés à cette justice très ouvertement politique.
Ensuite, et surtout, l’usage disproportionné de la force dans les régions anglophones y transforme radicalement les modalités quotidiennes de gouvernement. Comme le relatent les rapports annuels d’organisations internationales et nationales s’intéressant au conflit, ce sont, depuis fin 2016, des dizaines de villages qui ont été complètement ou partiellement brûlés, sous prétexte d’abriter des miliciens. La destruction vise les habitats mais aussi les moyens de subsistance. Un témoin raconte qu’après le meurtre d’un militaire, les collègues de ce dernier ont sévi dans un village du Nord-Ouest qu’il venait de visiter : parmi des dizaines d’habitations mises à sac, il se souvient de la maison d’une famille de six enfants réduite en cendres, des récoltes de maïs, de haricots et de café incendiées, et des tuyaux d’eau potable détruits. Puis, les militaires se sont attaqués au bar du village une fois les réserves épuisées. Ces actes de violence prennent pour cible des villageois, civils, attaqués par les forces qui leur promettent protection, et massacrés lors de plusieurs épisodes tragiques, comme à Ngarbuh. Les forces armées, qui n’étaient déjà pas considérées comme des soutiens des habitants de ces régions, sont devenues des menaces intimant à chacun d’être dans le bon camp, mais exerçant une violence tellement arbitraire que ces injonctions finissent par ne plus avoir de sens.
Cette confusion se retrouve dans les dispositifs de gouvernement mis en place par les Ambaboys : d’abord encadrées par des revendications, leurs logiques d’action et de domination relèvent aussi d’intérêts de survie. Elles sont impossibles à anticiper et démultiplient l’effet des injonctions contradictoires, entre armée et milices. La production des attributs d’une nouvelle nation ambazonienne a toujours été au cœur du contre-nationalisme anglophone, notamment lors des cérémonies [de la Journée de l’unification] du 1er octobre. Depuis le début du conflit, ces attributs symboliques se sont multipliés : drapeaux, passeports, télévision. L’attachement à la nation se travaille aussi concrètement : dans les camps de réfugiés, au Nigeria, ces derniers enseignent à leurs enfants l’hymne et « l’histoire ambazonienne ». Dans la diaspora, ou dans un camp de réfugiés, le conflit de loyauté ne se pose pas. Mais dans les zones de conflit, et même au-delà sur le territoire camerounais, il est permanent.
« C’était impossible de rester »
Ces injonctions contradictoires affectent aussi bien les citadins que les villageois, ces derniers en subissant néanmoins des versions plus violentes. En mai 2018, dans les premiers mois de déploiement de la violence, le rédacteur en chef d’une chaîne de télévision anglophone basée à Douala, propriété d’un homme d’affaires membre du parti au pouvoir, raconte son inconfort entre les attentes implicites de ce dernier et celles de sa rédaction anglophone. Du point de vue de son éthique professionnelle, il s’estime coincé, lui qui souhaiterait couvrir des événements de plus en plus tragiques, mais ne peut laisser la parole à l’une des parties au conflit, les sécessionnistes, devenus des ennemis du gouvernement, et donc de son patron. Il estime qu’il doit exercer une forme d’autocensure, provoquant l’insatisfaction de sa rédaction, qui voudrait parler des événements violents et d’une guerre qui ne dit pas son nom. De manière générale, les leaders associatifs et politiques qui n’ont pas adopté le registre sécessionniste sont devenus des traîtres à une cause qu’ils estiment pourtant défendre : c’est le cas de l’avocat Félix Agbor Ballah ou du juriste Paul Ayah Abine, qui ont subi des représailles du gouvernement, mais dont la modération politique et la surface internationale ne siéent pas non plus aux leaders sécessionnistes.
Même le cardinal Tumi, figure morale et homme d’Église plutôt consensuel, a été kidnappé, puis relâché en novembre 2020. C’est surtout pour les citoyens et citoyennes ordinaires que ces conflits de loyauté se transforment en piège violent. Lors des élections qui se sont succédé depuis octobre 2018, les militaires et les autorités encouragent les électeurs à se rendre aux urnes, alors que les sécessionnistes les mettent en garde : « Les militaires nous disaient il faut aller voter. Si vous n’allez pas voter, nous allons vous tirer dessus. Mais si tu votes et que les séparatistes armés te surprennent, ce sont eux qui menacent de te tuer. C’était impossible de rester », rapporte une déplacée interviewée par Radio France internationale en 2020.
Et ces conflits de loyauté se multiplient, au quotidien, jusque dans les actes les plus ordinaires, autour des cartes d’identité par exemple. Lorsque les forces de l’ordre contrôlent les papiers, ne pas avoir sa carte d’identité est un signe de collusion avec les Ambaboys ; mais lorsque le barrage est tenu par ces derniers, posséder une carte nationale d’identité camerounaise devient un signe de traîtrise et expose à des violences. C’est aussi le cas du port du masque – en raison de la pandémie de Covid-19 – qui conduit à des accusations de traîtrise : selon le Centre for Human Rights and Democracy in Africa (CHRDA), au moment où sévit la pandémie, les Ambaboys frappent les personnes qui portent des masques, les accusant d’importer le coronavirus et affirmant qu’il n’est pas autorisé d’en porter sur les territoires qu’ils commandent.
Routinisation de la violence
Ce nouveau gouvernement sécuritaire et sanitaire, et plus largement le nouvel ordre social et politique mis en place dans cette zone, repose sur un dispositif de plus en plus violent. Les témoignages de sympathisants qui s’éloignent des milices et sont la cible de représailles sont nombreux, de même que ceux de femmes violentées – quand elles ne sont pas tuées – après avoir été accusées de frayer avec des membres des forces armées ou parce qu’elles avaient dénoncé des exactions. Il en va de même d’enseignants et d’élèves menacés, voire massacrés, car ils ne respectaient pas la fermeture des écoles, d’ouvriers pris en train de travailler dans les plantations d’État, de travailleurs humanitaires ou d’hommes d’Église pris pour cibles après avoir recommandé aux milices de ne pas s’en prendre aux civils et de gens possédant un peu de biens qui ont fait l’objet d’un kidnapping et d’une rançon exigée par les Ambaboys. Une jeune femme, que j’ai rencontrée à Douala, raconte comment son jeune frère a été tué d’une balle par un Ambazonien car, après une semaine de Country Sundays [équivalent des opérations « ville morte », NDLR], il s’était rendu aux champs, seul moyen de subvenir aux besoins de sa famille.
Les miliciens, qui n’étaient pas du village, ont sommé la famille d’enterrer discrètement leur mort. Un témoignage parmi des centaines d’autres, qui atteste la routinisation de la violence dans un espace social renversé et profondément dépossédé : lors des funérailles, nombreuses, les rituels habituellement dispendieux et collectifs sont abandonnés sous la contrainte et faute de moyens pour honorer les morts.
La crise de loyauté exprimée par les revendications sécessionnistes va donc bien au-delà d’une mise en cause d’un gouvernement : les loyautés sociales primaires sont en effet déstabilisées par cette crise. La revendication sécessionniste ne cible pas seulement « la République », elle vise également les élites historiques et des institutions sociales centrales de ces régions. Les violences à l’égard des autorités coutumières, par exemple le fait que certaines soient chassées de leur territoire, constituent une remise en cause radicale d’un cadre politique local et ancien. Les rapports des sociétés du Sud-Ouest et du Nord-Ouest à ces autorités ne sont pas identiques : les premières sont des créations coloniales, mais contrairement à d’autres régions du Cameroun, elles y ont endossé un rôle reconnu par les habitants, notamment dans la défense de leurs droits fonciers. Au Nord-Ouest, les autorités traditionnelles des Grassfields sont le cadre primaire de la socialisation – même pour ceux qui en sont partis – et elles y reproduisent un système bien ancré d’inégalités. La violence dont elles sont l’objet par les miliciens ne doit pas conduire à penser que ceux-ci attaquent forcément leur propre fon [chef suprême traditionnel, NDLR] ; les rapports sont contradictoires à ce sujet, certains affirmant que les Ambaboys ne viennent pas des territoires où ils sévissent, d’autres assurant le contraire. Mais cette violence renvoie à un rapport de plus en plus critique vis-à-vis d’aînés considérés comme cooptés par « la République », et ne répondant pas aux attentes des cadets sociaux.
Cette déstabilisation est d’autant plus forte que le conflit violent engendre un conflit de loyauté entre l’armée – censée protéger les habitants – et les milices – censées les libérer –, chacun de ces protagonistes exigeant l’affichage d’une fidélité unique. Pire, les autres institutions, celles qui fournissent des services, mais aussi des cadres de socialisation alternatifs, comme l’école, les Églises ou les centres de soin, sont la cible de destructions, ont été fermés ou sévèrement empêchés de fonctionner depuis le début de la crise. Cette monopolisation par la violence de la loyauté montre, en creux, combien chacun est normalement enclin à s’engager auprès de multiples institutions d’autorité et de services, qui peuvent avoir des orientations morales ou politiques contradictoires. Le modèle de gouvernement local de ces régions permettait la coexistence d’une pluralité d’autorités : écoles publiques et privées, associations professionnelles et de développement, Églises, familles basées dans la région et à l’étranger, parti d’opposition et parti au pouvoir, autorités coutumières. En fonction de ses ressources, de ses intérêts, de ses obligations, il était possible pour chacun de naviguer entre les unes et les autres. Avec cette crise, le dispositif de pouvoir est désormais binaire, exclusif et violent, faisant de l’exit une option de plus en plus attractive dans cette région.
Avec Afrique XXI