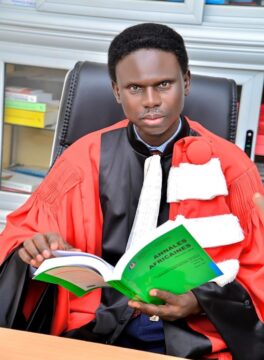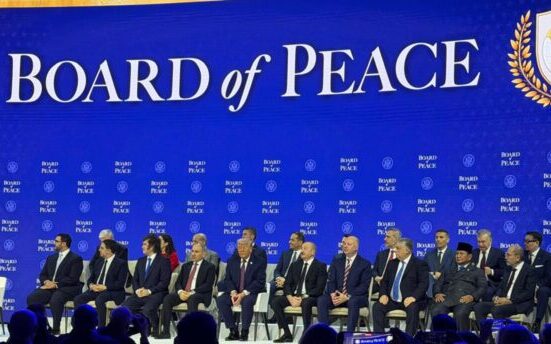Conditions d’attribution de la compétition, mortsd’ouvriers dans le cadre des travaux d’infrastructure, impact environnemental de l’événement… L’organisation du prochain Mondial est sous le feu des critiques, à quelques semaines du début de la compétition.
A un mois et demi de l’ouverture de la Coupe du monde de football, le 20 novembre, dans le stade d’Al-Khor, au Qatar, un sentiment de malaise gagne la société française. Dans les médias et sur les réseaux sociaux, le débat enfle sur l’opportunité ou non de regarder la compétition. En cause : les conditions de travail souvent indignes infligées aux ouvriers ayant bâti les infrastructures du tournoi, les nombreux morts sur les chantiers ; la facture carbone de la compétition probablement très élevée ; les droits des LGBT +, dont le Qatar n’est pas exactement le champion ; et les soupçons d’achat de voix, en 2010, lors du vote de la Fédération internationale de football (FIFA).
Dernièrement, la plupart des grandes villes de France dont Paris, Lyon, Lille, Marseille, Toulouse, Strasbourg et Reims – ont décidé de ne pas diffuser les matches en public sur des écrans géants. Sur Twitter, la maire de Lille, Martine Aubry, a qualifié l’événement de « non-sens au regard des droits humains, de l’environnement et du sport ». François Hollande – qui vantait pourtant la « crédibilité » du Qatar en 2015, année où vingt-quatre Rafale avaient été vendus à l’émirat a même déclaré qu’à la place d’Emmanuel Macron il ne se rendrait pas à la cérémonie d’ouverture. A quelques semaines du jour J, Le Monde explore les cinq raisons du malaise.
Conditions de travail des ouvriers : des réformes trop tardives
Entre 2012 et 2014, au moment où le processus de construction des infrastructures de la Coupe du monde 2022 s’est mis en branle, tous les connaisseurs du Qatar ont tiré la sonnette d’alarme. Sans réforme du code du travail et des pratiques des entreprises du bâtiment, les droits des centaines de milliers d’ouvriers étrangers embauchés sur les chantiers du Mondial seront piétinés, prévenaient-ils.
Dix ans plus tard, le bilan est mitigé. Le Qatar a lancé une refonte de son droit du travail. Supervisés par l’Organisation internationale du travail (OIT), ces efforts ont conduit au démantèlement des dispositions les plus problématiques de la kafala, système de tutelle du droit musulman qui s’apparente souvent, au Qatar et dans le reste du golfe Arabo-Persique, à la sujétion des travailleurs migrants à un « sponsor » (parrain) et peut dégénérer en travail forcé. Sous le nouveau code du travail du Qatar, les employés étrangers n’ont plus besoin d’obtenir l’assentiment de ce tuteur – qui est souvent leur patron – pour changer d’emploi ou voyager à l’extérieur de l’émirat. Une avancée réglementaire sans équivalent dans le Golfe.
Les critiques fusent de partout. Ces nombreuses critiques visant notamment son empreinte environnementale, la place des femmes et des minorités LGBT+ et le traitement des travailleurs migrants. Des médias du Qatar, étroitement liés au pouvoir, ont dénoncé ces derniers jours les critiques, principalement européennes, concernant le bilan de Doha en matière des droits humains avant le mondial. Dernièrement, pour illustrer ces critiques, le quotidien arabophone Al Raya a publié un dessin satirique représentant le trophée de la Coupe du monde cerné de flèches.
J V G Avec Le Monde
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]