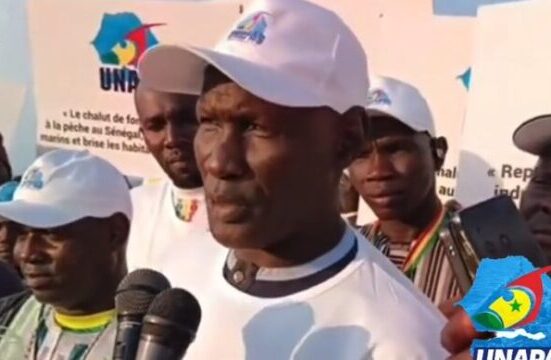Dans son rapport publié le mercredi 5 avril, la Banque Mondiale revoit à la baisse la croissance des différents pays de l’Afrique subsaharienne en raison de plusieurs facteurs. L’institution financière met en garde les économies du Continent sur les dangers du surendettement et appelle nos Etats à mieux valoriser nos ressources naturelles en période de forte demande liée à la transition énergétique.
La croissance en Afrique subsaharienne reste faible, tirée vers le bas par l’incertitude de l’économie mondiale, la sous-performance des plus grandes économies du continent, une inflation élevée et une forte décélération de la croissance de l’investissement, selon un rapport de la Banque mondiale publié mercredi 5 avril.
La croissance économique en Afrique subsaharienne passe de 3,6 % en 2022 à 3,1 % en 2023
La croissance économique en Afrique subsaharienne devrait ralentir, passant de 3,6 % en 2022 à 3,1 % en 2023, selon la dernière édition de l’Africa’s Pulse, la mise à jour économique d’avril 2023 de la Banque mondiale pour l’Afrique subsaharienne. L’activité économique en Afrique du Sud devrait encore s’affaiblir en 2023 (0,5 % de croissance annuelle) en raison de l’aggravation de la crise énergétique, tandis que la reprise de la croissance au Nigéria pour 2023 (2,8 %) demeure fragile, la production de pétrole restant modérée. La croissance du produit intérieur brut (PIB) réel de la sous-région de l’Afrique de l’Ouest et du centre devrait baisser à 3,4 % en 2023, contre 3,7 % en 2022, tandis que celle de l’Afrique de l’Est et australe reculerait à 3,0 % en 2023, contre 3,5 % en 2022.
« La faiblesse de la croissance, combinée aux vulnérabilités de la dette et à une croissance morose des investissements, risque de faire perdre une décennie à la réduction de la pauvreté, a déclaré Andrew Dabalen, économiste en chef de la Banque mondiale pour l’Afrique. Les décideurs politiques doivent redoubler d’efforts pour freiner l’inflation, stimuler la mobilisation des ressources intérieures et adopter des réformes favorables à la croissance, tout en continuant à aider les ménages les plus pauvres à faire face à l’augmentation du coût de la vie. »
Les risques de surendettement restent élevés, 22 pays de la région présentant un risque élevé de surendettement extérieur ou étant en situation de surendettement en décembre 2022. Les conditions financières mondiales défavorables ont augmenté les coûts d’emprunt et les coûts du service de la dette en Afrique, détournant l’argent des investissements de développement indispensables, et menaçant la stabilité macro-budgétaire.
Une inflation obstinément élevée et une faible croissance des investissements continuent de peser sur les économies africaines. Bien que l’inflation semble avoir atteint son maximum l’année dernière, elle devrait rester élevée, à 7,5 % en 2023, et dépasser les fourchettes cibles des banques centrales dans la plupart des pays. La croissance des investissements en Afrique subsaharienne est passée de 6,8 % en 2010-2013 à 1,6 % en 2021, avec un ralentissement plus marqué en Afrique de l’Est et australe qu’en Afrique de l’Ouest et du centre.
Profiter de la transition énergétique pour booster les économies africaines
« La décarbonisation rapide du monde apportera des opportunités économiques significatives à l’Afrique, a noté James Cust, économiste principal à la Banque mondiale. Les métaux et les minéraux seront nécessaires en plus grandes quantités pour les technologies à faible teneur en carbone telles que les batteries. Si de bonnes politiques sont mises en place, ces ressources pourraient augmenter les recettes fiscales, accroître les opportunités pour les chaînes de valeur régionales qui créent de l’emploi, et accélérer la transformation économique. »
À l’heure de la transition énergétique et de l’augmentation de la demande de métaux et de minéraux, les gouvernements riches en ressources ont la possibilité de mieux tirer parti des ressources naturelles pour financer leurs programmes publics, diversifier leur économie et élargir l’accès à l’énergie. Le rapport indique que les pays pourraient potentiellement plus que doubler les recettes moyennes qu’ils tirent actuellement des ressources naturelles. Capturer ces ressources fiscales sous forme de redevances et d’impôts, tout en continuant à attirer les investissements du secteur privé, nécessite des réformes et une bonne gouvernance. Maximiser les recettes publiques tirées des ressources naturelles offriraient un double bénéfice pour les populations et la planète, en augmentant les recettes fiscales et en supprimant les subventions implicites à la production.
La baisse des investissements en Afrique subsaharienne
La croissance des investissements a fortement diminué dans tous les domaines u L’Afrique subsaharienne est confrontée à de multiples défis pour retrouver son élan de croissance. L’un de ces défis consiste à surmonter le ralentissement prolongé de la croissance des investissements dans la région. La croissance de l’investissement en Afrique subsaharienne est tombée de 6,8 % en 2010-2013 à 1,6 % en 2021, avec un ralentissement plus marqué en Afrique de l’Est qu’en Afrique de l’Ouest. Vu les répercussions économiques de la pandémie et de la guerre en Ukraine, la croissance des investissements devrait rester modeste et inférieure au taux de croissance moyen des investissements au cours des deux dernières décennies, non seulement en Afrique subsaharienne, mais aussi dans d’autres marchés émergents et économies moins développées. u La forte décélération de la croissance des investissements a été généralisée dans toutes les sous-régions, dans les pays, qu’ils soient riches ou pauvres en ressources, et parmi tous les types d’investisseurs, qu’ils soient publics, privés ou étrangers. Les pays de la région riches en pétrole ont connu la baisse de l’investissement la plus importante et la plus persistante, contrairement aux pays pauvres en ressources, qui affichent une baisse de l’investissement plus modérée. Les taux de croissance des investissements publics, privés ou étrangers sont restés inférieurs à leurs moyennes à long terme pendant la plupart des années de la dernière décennie. Alors que l’investissement privé national a connu une légère baisse au fil du temps, l’investissement direct étranger s’est contracté au cours de la période 2016-2021. En revanche, les envois de fonds ont bien résisté aux différents chocs survenus au cours de la dernière décennie, y compris celui de la pandémie. u Le ralentissement de la croissance des investissements en Afrique subsaharienne freine la croissance à long terme de la production et du revenu par habitant, ainsi que les progrès vers la réalisation des objectifs de développement durable. Les différences de vigueur de la reprise entre les sous-régions et les pays sont en partie liées aux différences de croissance de l’investissement. Par exemple, la reprise plus lente de la croissance en Afrique de l’Est par rapport à celle de l’Afrique de l’Ouest est liée au fort ralentissement de l’investissement public et à la contraction de l’investissement privé (national ou étranger). La faible croissance de l’investissement s’ajoute aux pressions macro-budgétaires, alors que les besoins de financement sont importants, la marge de manœuvre budgétaire est limitée et les coûts d’emprunt sont en hausse.
L’inflation, frein de l’activité économique
L’inflation des prix à la consommation en Afrique subsaharienne s’est fortement accélérée et a atteint en 2022 (9,2 %) un niveau record depuis 14 ans, sous l’effet de la hausse des prix des denrées alimentaires et de l’énergie ainsi que de l’affaiblissement des monnaies. Les prix intérieurs des denrées alimentaires sont restés élevés malgré la baisse progressive des prix mondiaux. L’affaiblissement des monnaies et l’augmentation des coûts des intrants (carburants de transport et engrais) expliquent la viscosité des prix des denrées alimentaires. Les chocs climatiques, en particulier dans la Corne de l’Afrique, ajoutent des pressions inflationnistes du côté de l’offre. Le nombre de pays affichant des taux d’inflation annuels moyens à deux chiffres est passé de 9 en 2021 à 21 en 2022. Le ralentissement de la demande globale, la baisse des prix des matières premières et les effets du resserrement de la politique monétaire sur l’ensemble du continent feront baisser l’inflation dans la région à 7,5 % en 2023, puis à 5,0 % en 2024. En outre, le nombre de pays ayant une inflation à deux chiffres devrait tomber à 12 en 2023. Bien que l’inflation globale semble avoir atteint un sommet l’année dernière, l’inflation devrait rester élevée et supérieure aux fourchettes cibles des banques centrales pour tous les pays disposant d’un ancrage nominal explicite en 2023. u Les taux d’inflation restent élevés et supérieurs aux cibles prévues, malgré les hausses rapides et fortes des taux d’intérêt décidées par les banques centrales africaines. Par exemple, les autorités monétaires du Ghana, du Mozambique, du Nigéria, de l’Afrique du Sud et de l’Ouganda, entre autres, ont rapidement augmenté leurs taux de politique monétaire pour atteindre des niveaux record au cours des deux dernières années. Les faiblesses de la transmission monétaire entre les pays africains pourraient expliquer l’efficacité réduite du cycle de resserrement. Des outils inadéquats pour la mise en œuvre des politiques et le manque d’indépendance des politiques peuvent contribuer à une faible transmission. La prédominance fiscale et les restrictions des taux de change peuvent conduire à des résultats en matière d’inflation qui sont contraires à l’intention du resserrement monétaire. Les taux d’inflation globale ayant atteint des sommets dans certains pays à la fin de 2022 et au début de 2023, les responsables politiques pourraient être tentés d’assouplir ou de suspendre leur politique monétaire contractionniste. Cette action semble prématurée car les pressions inflationnistes sous-jacentes dans les pays de la région restent élevées. En Afrique subsaharienne, la maîtrise de l’inflation reste essentielle pour augmenter les revenus de la population et réduire l’incertitude qui entoure les prévisions de consommation et d’investissement. Les politiques de lutte contre l’inflation devraient être complétées par des mesures de soutien des revenus (via des transferts d’argent ou de denrées alimentaires) afin de protéger les plus vulnérables d’une inflation obstinément élevée, en particulier de l’inflation des denrées alimentaires.
Les réelles menaces sur la stabilité des budgets des pays africains
Le déficit budgétaire de la région s’est creusé pour atteindre 5,2 % en 2022. La persistance des déficits budgétaires, conjuguée à une croissance atone, a entraîné une augmentation du ratio (médian) de la dette publique au PIB, qui atteindra 57 % en 2022. La guerre en Ukraine a interrompu le processus d’assainissement budgétaire entamé par de nombreux pays de la région au lendemain de la pandémie. Une baisse significative de l’aide publique au développement et un accès restreint aux emprunts extérieurs contribuent également à la détérioration des résultats budgétaires. En réponse à la hausse des prix des denrées alimentaires et des carburants, les décideurs politiques ont eu recours à des mesures visant à limiter l’impact de la hausse de l’inflation, telles que des subventions, des dérogations temporaires aux droits de douane et aux prélèvements, et des mécanismes de soutien des revenus pour les plus vulnérables. Ces mesures ont retardé la consolidation fiscale, car les déficits budgétaires dans la région restent élevés et créent une pression supplémentaire sur le budget, en particulier pour les gouvernements dont la marge de manœuvre fiscale est presque épuisée. Les efforts de consolidation visant à réduire la dette devraient reprendre cette année et ramener le déficit budgétaire à 4,3 % en 2023, puis à 3 % en 2024-25.
Mamadou DIALLO