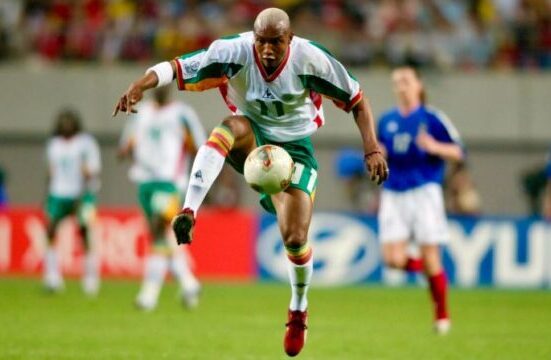La République islamique d’Iran est confrontée à un important isolement international depuis sa création en 1979, notamment du fait des sanctions et embargos mis en place par les puissances occidentales. Téhéran avait dès lors misé sur l’établissement d’une chaîne d’alliés régionaux, « l’Axe de la résistance » et sur une production autonome d’armements à faible coût pour faire face à ses adversaires, à commencer par Israël. Néanmoins, l’affaiblissement de plusieurs membres de cet Axe (le Hamas, le Hezbollah), voire leur disparition (le régime de Bachar Al-Assad en Syrie) ont considérablement affaibli la position de l’Iran au Moyen-Orient. Quel est l’état de l’industrie de défense iranienne à ce jour et à quels défis est-elle confrontée ?
Entre isolement régional et dépendance stratégique à la Russie
L’analyse de la situation actuelle du point de vue iranien permet de dresser trois constats majeurs. D’abord, l’Iran se trouve dans un environnement régional qu’il perçoit comme hostile. La confrontation directe avec Israël, survenue entre avril et octobre de l’année dernière, a eu un impact considérable sur le régime iranien. Depuis septembre, les États-Unis ont renforcé leur présence militaire dans la région, avec l’afflux de près de 40 000 soldats dans la région. Ensuite, l’Iran traverse une période de fragilité. Le pays fait face à une perte significative d’influence au sein de son « Axe de la Résistance » depuis la chute du régime de Bachar Al-Assad. La Syrie, un maillon clé du corridor stratégique permettant à la Force Al-Quds de fournir des armes au Hezbollah, a vu le retrait officiel des forces iraniennes. Les forces armées russes ont également évacué environ 4 000 combattants pro-iraniens, marquant un coup d’arrêt majeur à la stratégie de sécurité régionale iranienne. Bien que Téhéran affirme entretenir des « contacts directs » avec le groupe Hayat Tahrir al-Cham en Syrie par l’intermédiaire de son nouveau ministre des Affaires étrangères pour la Syrie, Mohammed-Reza Raouf-Sheibani, l’Arabie saoudite et la Turquie figurent parmi les premières destinations étrangères du nouveau dirigeant Ahmed Al-Sharaa, anciennement connu sous le nom d’Al-Joulani. Enfin, certaines capacités militaires iraniennes sont endommagées, obsolètes ou vieillissantes. Les systèmes de défense anti-aérienne, tels que les S-300 russes, ont subi des destructions partielles lors des frappes israéliennes. En parallèle, les sanctions économiques ont entravé la modernisation des infrastructures et du matériel militaire iranien, conduisant à l’obsolescence de certains équipements.
Ainsi, la signature de l’accord stratégique avec la Russie le 17 janvier 2025 tombe à pic pour l’Iran. Bien qu’il ne soit pas surprenant, il souligne le rapprochement significatif entre Moscou et Téhéran, accéléré par le déclenchement de la guerre en Ukraine. Véritable fuite en avant sécuritaire pour l’Iran, l’affaiblissement de l’Axe de la Résistance renforce la dépendance de Téhéran à Moscou. Néanmoins, malgré la signature de l’accord, la perception de la Russie en Iran reste largement négative au sein de l’opinion publique. En 2021, près de 66 % de la population rejetait le projet de partenariat stratégique entre les deux puissances. Sur le plan politique, la relation russo-iranienne divise les élites iraniennes. D’un côté, les Gardiens de la Révolution et les ultraconservateurs soutiennent un rapprochement renforcé avec Moscou et Pékin pour contrer l’Occident. De l’autre, les figures réformistes estiment que l’Iran pourrait être instrumentalisé par la Russie dans sa confrontation avec les États-Unis. Cet accord, qui porte sur une durée de vingt ans, établit une coopération stratégique dans divers secteurs : culturel, économique, médical, industriel, commercial mais, surtout, militaire, incluant des clauses sur le partage de renseignements, la coopération en cybersécurité, ainsi que l’organisation d’exercices militaires conjoints visant à répondre à des « menaces communes ». Pour la Russie, il s’agit de l’accord le plus long jamais signé. Cependant, il n’en va pas de même pour l’Iran qui avait signé, en 2021, un accord commercial sur vingt-cinq ans avec la Chine. Au-delà de son contenu, le timing de cet accord met en évidence la dépendance croissante de l’Iran à la Russie et la relation asymétrique entre les deux puissances. L’Iran attend toujours la livraison des avions de chasses Sukhoi-35 et des systèmes de défense antimissile russes S-400, que la Russie lui a promis.
Entre low-cost, adaptation et optimisation : l’évolution de la défense iranienne
Le régime iranien ne peut donc pas reposer uniquement sur les exportations d’armement russes et a, par conséquent, développé, au fil des années, une industrie de défense unique en son genre. Trois maîtres mots la caractérisent : des solutions peu onéreuses (low-cost), l’optimisation des ressources et l’adaptation au contexte géopolitique.
Les solutions low-cost du régime iranien sont particulièrement visibles à travers son programme de drones. En effet, l’Iran ne dispose pas de force aérienne traditionnelle moderne : ses F-4, F-5 et F-14 sont en fin de vie. Le pays a donc développé un programme de drones qui est aujourd’hui parmi les plus anciens et avancés de la région. Ce programme, couplé à celui des missiles balistiques, constitue la pierre angulaire de la stratégie militaire iranienne qui exporte des drones Shahed-136 et Mohajer-6 vers plusieurs pays, dont l’Éthiopie, le Soudan et la Russie. Le Shahed-136, probablement le modèle le plus connu aujourd’hui, a joué un rôle clé dans la guerre en Ukraine depuis 2022, conduisant à la création d’une usine de production de drones iraniens au Tatarstan, en Russie. S’il demeure moins avancé technologiquement que les drones turcs (Kargu-2) et états-uniens (Switchblade-200), le Shahed-136 présente néanmoins l’avantage de contourner les systèmes de défense aérienne traditionnels en volant à très basse altitude et à vitesse modérée. Son faible coût (environ 20 000 dollars l’unité) permet une production à grande échelle, inspirée du modèle chinois de production low-cost et augmente, dès lors, la capacité de projection iranienne.
Parallèlement, le régime iranien a fait de l’optimisation des ressources un élément central de sa stratégie militaire. Les Gardiens de la Révolution ont ainsi reconverti des navires civils en plateformes militaires pour accroître leur capacité de projection. En 2023, le porte-conteneurs Shahid Madhavi a été transformé en porte-hélicoptères. Plus récemment, en février 2025, le porte-conteneurs Perarin a été réaménagé en porte-drones, renforçant ainsi la présence maritime iranienne dans le golfe Persique et en mer Rouge. Pour ses drones, l’Iran utilise des moteurs de mobylettes ou des moteurs chinois MD550 inspirés des moteurs allemandsLimbach L550E. En vue de moderniser davantage son arsenal, le gouvernement iranien prévoit d’augmenter de 200 % son budget de défense dès mars 2025. Selon le SIPRI, l’Iran est déjà le 4e plus grand dépensier militaire au Moyen-Orient en 2023 avec 10,3 milliards de dollars. Selon les données du SIPRI, la part des dépenses militaires allouée aux Gardiens de la Révolution serait passée de 27 % à 37 % entre 2019 et 2023.
Au-delà de l’optimisation des ressources, l’Iran sait aussi exploiter le contexte géopolitique pour envoyer des messages stratégiques. Deux jours avant les élections américaines, le régime a dévoilé sa toute nouvelle base navale sous-marine située à 500 mètres de profondeur. Une semaine après les élections, l’Iran a dévoilé son nouveau missile balistique Etemad. En réponse à l’escalade des tensions avec Israël en 2024, l’Iran a également intensifié ses efforts pour protéger ses infrastructures militaires, développant notamment le système de défense Zoubin, conçu pour contrer les drones volant à basse altitude. Par ces actions, l’Iran cherche à montrer aux puissances occidentales qu’il conserve sa force de dissuasion et qu’il reste une puissance militaire capable de résister.
L’approvisionnement en armements : rétro-ingénierie et diplomatie militaire
Si l’Iran demeure affaibli militairement, le pays conserve toutefois certaines réserves stratégiques. Avant le renforcement des sanctions, l’Iran pouvait acquérir légalement certains équipements militaires, principalement auprès de la Chine, qui était un fournisseur majeur d’armements pour Téhéran dans les années 1990 et au début des années 2000. Bien qu’alliée stratégique, la Chine se montre néanmoins réticente à vendre des avions de chasse à l’Iran, et ce pour plusieurs raisons : aujourd’hui, Pékin privilégie les paiements en devises plutôt qu’en ressources énergétiques, tandis que l’Iran propose du pétrole ou du gaz en échange de matériel militaire. De plus, la Chine cherche à éviter de provoquer les États-Unis, notamment dans le cadre des tensions commerciales croissantes entre les deux puissances. En 2022, Pékin avait vendu 25 avions de chasse au Pakistan mais n’a pas accordé le même traitement à l’Iran qui lui fait la même demande depuis plusieurs années maintenant.
Depuis 1979, l’Iran utilise des réseaux d’intermédiaires ou s’appuie sur des pays alliés pour contourner les restrictions internationales et acquérir des équipements militaires sous couvert d’accords commerciaux civils. En effet, Téhéran contourne les restrictions imposées par la réglementation internationale sur le trafic des armes, notamment l’International Traffic in Arms Regulations (ITAR). Un exemple notable de cette pratique est l’utilisation des drones Shahed-136 par la Russie en Ukraine, lesquels intègrent des composants occidentaux, principalement en provenance des États-Unis, du Japon, du Canada et de Suisse. Pour ce faire, le régime a développé de multiples techniques (sociétés-écrans, darkweb, contrebande, cryptomonnaies, etc). Avant la chute de Bachar Al-Assad, la Syrie était un partenaire stratégique essentiel de l’Iran, jouant un rôle crucial en tant que plaque tournante pour le transfert d’armements. Une fois ces équipements en main, l’Iran a mis à profit son expertise en rétro-ingénierie pour analyser, reproduire et adapter ces systèmes à ses besoins. Ainsi, des versions locales de missiles ont été développées, telles que le Nasr-1 (inspiré du missile chinois C-704) et le Kosar-1 (basé sur le C-701 chinois). En modifiant des technologies d’origine chinoise, l’Iran parvient à produire des armements en interne, lui permettant de se défaire de la dépendance aux importations d’armements tout en contournant les embargos qui entravent l’acquisition de technologies stratégiques. L’Iran a également développé des missiles de croisière à longue portée à partir de missiles soviétiques, en développant le Soumar en 2013 puis son successeur, le Hoveyzeh, en 2014. Ces missiles ont été utilisés contre Israël en 2024, illustrant l’aboutissement de la stratégie de rétro-ingénierie iranienne. IRIS