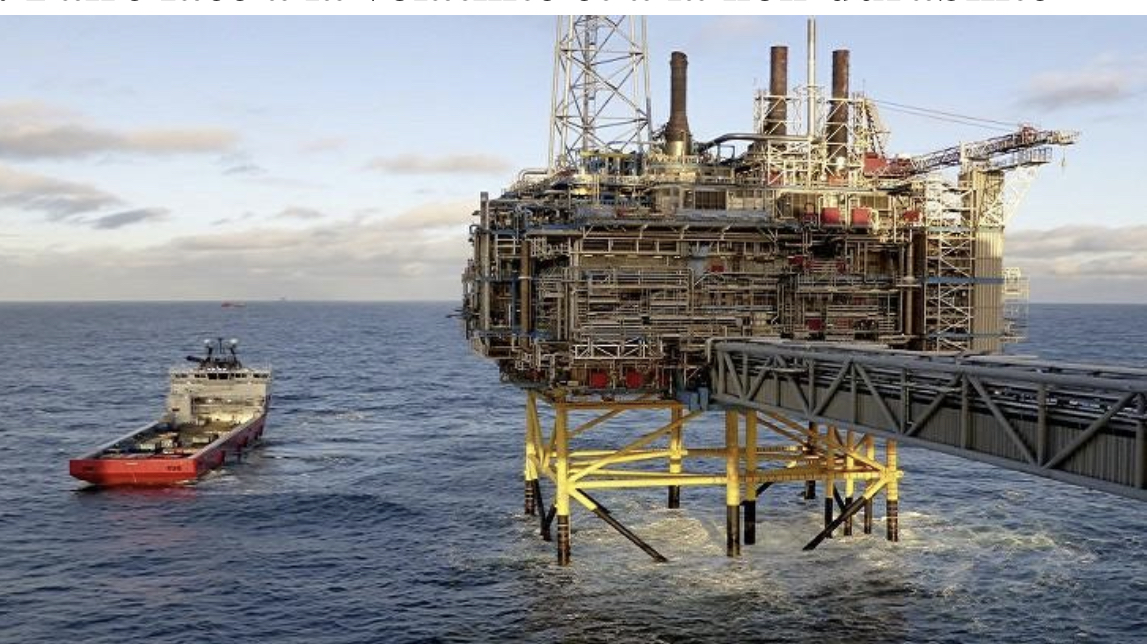La production de pétrole peut causer de graves préjudices macroéconomiques, en raison du phénomène bien connu de «malédiction des ressources ». Tout d’abord, les revenus du secteur ont tendance à être particulièrement volatiles, ce qui peut entraîner de mauvaises pratiques de dépenses si le gouvernement n’épargne pas les revenus pour éviter une volatilité des dépenses. En période d’expansion, le gouvernement doit veiller à ne pas gaspiller de l’argent, tout en constituant des réserves suffisantes pour pouvoir y recourir en cas de baisse des revenus.
Deuxièmement, les revenus pétroliers ont une durée de vie et le gouvernement doit prévoir un avenir dans lequel ces revenus seront épuisés. Troisièmement, les travailleurs et les investissements peuvent être attirés par le secteur pétrolier en plein essor au détriment d’autres secteurs, dans le cadre d’un phénomène connu sous le nom de « syndrome hollandais ». Ce phénomène peut être encore aggravé si le gouvernement et l’économie n’ont pas une capacité d’absorption suffisante. Quatrièmement, il existe un risque que les revenus pétroliers soient considérés comme de l’« argent gratuit » qui n’est pas directement lié aux citoyens, ce qui pourrait diminuer la redevabilité et le contrôle publics.
En réponse, de nombreux pays riches en pétrole ont mis en place des fonds souverains, qui permettent d’épargner efficacement les revenus pétroliers en dehors de leur pays pour atténuer les risques de volatilité, d’épuisement et de capacité d’absorption. La législation établissant les fonds souverains comprend souvent des règles sur la manière d’affecter et de gérer les revenus pétroliers. La plupart des législations relatives aux fonds souverains interdisent également à ces fonds d’acheter des catégories d’actifs à risque spécifiques, comme les produits dérivés.
Les gouvernements ont une excellente occasion, dans les années précédant la production pétrolière, de concevoir un cadre approprié pour la gestion et l’utilisation des revenus tirés des ressources afin d’atténuer les risques mentionnés plus haut. Mais ils doivent également reconnaître que tous lesproducteurs de pétrole ne sont pas affectés par les risques de la même manière.
Les revenus pétroliers et gaziers du Sénégal devraient rester relativement modestes, inférieurs à 1 % du PIB dans l’avenir immédiat, et ne devraient pas dépasser 3 % du PIB sur la base des projets existants. Pour mettre ce chiffre en perspective, le gouvernement consacre actuellement environ 1 % du PIB à la santé, 4,5 % du PIB à l’éducation et l’encours total de la dette s’élève à 60 % du PIB99. Cela montre bien qu’il faudrait de nombreuses décennies de revenus du pétrole et du gaz pour rembourser complètement la dette existante, mais que ces ressources sont suffisamment importantes pour apporter un complément significatif à tout domaine prioritaire déterminé.
Un certain nombre de pays ont mis en place des structures d’épargne en prévision de revenus pétroliers qui sont finalement apparus inférieurs aux attentes, ce qui s’est révélé être un mauvais choix dans des environnements très endettés. Par exemple, les revenus pétroliers et gaziers du Ghana sont restés relativement modestes par rapport au total des recettes fiscales et n’ont donc jamais provoqué de volatilité macroéconomique ni de syndrome hollandais. En fait, le cedi ghanéen a connu une dépréciation réelle et massive plutôt que l’appréciation ou l’inflation redoutée.
Dans le même temps, les fonds du pays gérés de façon transparente et prudente qui sont investis à l’étranger ont généré un rendement net d’environ 1 % par an depuis leur création en 2011. Cependant, sur la même période, le pays a emprunté plus de 3 milliards USD en euro-obligations et paie plus de 9 % d’intérêts sur sa dernière émission d’euro-obligations. Par conséquent, pour chaque tranche de 100 USD épargnés plutôt que d’être utilisés pour rembourser la dette, le gouvernement a perdu environ 8 dollars US.
De même, le Fonds national des revenus des hydrocarbures de Mauritanie avait seulement accumulé des fonds correspondant à 1 % du PIB après plus d’une décennie de production pétrolière. Alors que São Tomé-et-Principe a mis en place un compte pétrolier national en 2004, jusqu’à présent, son secteur pétrolier a coûté au gouvernement plus qu’il ne lui a rapporté. Bien que la mise en place d’un cadre législatif pour la gestion des revenus avant la production soit une bonne chose, surtout si ce cadre comprend des dispositions de gouvernance solides (comme au Ghana et à São Tomé), il existe un risque de mettre en place des structures d’épargne qui ne correspondent pas aux besoins du pays. La situation de chaque pays est particulière, et ces exemples suggèrent surtout que le Sénégal devrait examiner attentivement si la mise en place d’un fonds souverain pour gérer les revenus des ressources est appropriée dans son contexte.
Le gouvernement du Sénégal est actuellement en train de concevoir son propre cadre de gestion des revenus pétroliers et de décider du montant à épargner ou à dépenser. Les propositions actuelles sont les suivantes :
• Élargir la mission du Fonds souverain d’investissements stratégiques (FONSIS) du Sénégal pour investir une part significative des revenus tirés des ressources naturelles du pays, avec pour rôle d’accueillir un « fonds intergénérationnel » permettant d’épargner les revenus du pétrole et du gaz
• Créer également un « fonds de stabilisation » à financer avec les revenus pétroliers et gaziers
• Épargner chaque année 20 pourcent des recettes tirées de l’exploitation des ressources pétrolières et gazières. Les 80 restants passeront dans le budget général.
• Adopter des lois imposant quand le gouvernement peut effectuer des retraits sur les fonds intergénérationnels et de stabilisation
• Attribuer au gouvernement la charge de présenter un plan pluriannuel pour l’utilisation des revenus tirés des ressources pétrolières et gazières et rendre compte chaque année des dépenses réelles dans ce domaine.
Le FONSIS est un fonds souverain (constitué en société privée) destiné à investir dans le développement économique et social du pays, en se concentrant sur le secteur privé. Ses objectifs actuels sont d’encourager le développement de champions nationaux dans des secteurs clés, de créer de la valeur actionnariale pour l’État sénégalais (son unique actionnaire) et de promouvoir l’investissement en capital au Sénégal (bien que la loi qui le régit permette d’investir jusqu’à 25 % de son capital, en dehors des réserves financières, à l’étranger). À ce jour, tous les investissements du fonds ont été effectués au Sénégal.
En ce qui concerne la gouvernance du fonds, son site web (et son auto-évaluation) indique qu’il suit les Principes de Santiago pour les fonds souverains, ainsi que le droit général des affaires sénégalais et les principes d’affaires de l’Organisation pour l’harmonisation du droit des affaires en Afrique. Toutefois, la gouvernance du FONSIS suscite un certain nombre de préoccupations et de défis dans ce domaine (et dans d’autres). Tout d’abord, le fait que le fonds investisse dans des entreprises privées spécifiques et cherche à développer des champions nationaux peut soulever des inquiétudes quant à la gouvernance (s’il s’agit des entreprises bénéficiant des meilleurs appuis politiques plutôt que des meilleurs véhicules d’investissement) et à l’efficacité (dans la mesure où il est difficile pour le secteur public de « choisir les gagnants » avec précision). (Le FONSIS déclare qu’il applique un certain nombre de critères pour sélectionner les investissements, y compris un taux de rendement minimum de 12 %, une cohérence avec les priorités du Plan Sénégal Émergent et un impact socio-économique positif, qui tous aideraient à garantir un niveau minimum de qualité d’investissement s’ils étaient appliqués fidèlement). Il n’est pas non plus évident dans l’immédiat de savoir si le FONSIS applique une politique visant à éviter les conflits d’intérêts dans le cadre des investissements du fonds, qui deviendront de plus en plus importants à mesure que le fonds gérera davantage d’actifs. En outre, il n’existe à ce jour aucune évaluation indépendante109 des performances du FONSIS.
Le fonds devrait aussi faire l’objet d’un contrôle parlementaire et d’une transparence accrus. En particulier, le FONSIS a obtenu de mauvais résultats sur un certain nombre d’indicateurs de l’Indice de gouvernance des ressources naturelles de NRGI en matière de transparence et de redevabilité de la gouvernance du fonds souverain. Par exemple, dans la loi portant création du fonds, il n’y a pas d’exigence explicite que l’Assemblée nationale examine soit a) les dépôts et les retraits du fonds, soit b) les rapports financiers du fonds.
En outre, la version publiée du dernier rapport annuel ne fournit aucune donnée sur les rendements réels des investissements du fonds, et les rapports financiers (et les rapports d’audit) du FONSIS ne sont pas publiés. Par conséquent, il n’est pas possible de savoir si les règles relatives aux dépôts et aux retraits du fonds ont été respectées. En outre, la loi régissant le fonds est souple quant à la quantité de prélèvement du fonds, ce qui permet au ministre des Finances de décider de ce montant jusqu’à 60 % du revenu net du fonds (avec d’autres règles limitant le retrait des réserves) plutôt que d’exiger du Parlement qu’il le fasse. L’Annexe I fournit une analyse plus approfondie de la transparence fiscale au Sénégal.
En outre, lorsque le Sénégal commencera à tirer des revenus de ses ressources pétrolières et gazières, le montant du fonds augmentera considérablement, ce qui pourrait nécessiter de nouvelles approches en matière de gestion et de contrôle. Actuellement, le capital de 3 milliards de FCFA du FONSIS représente 0,02 % du PIB du Sénégal. Les plans actuels indiquent que FONSIS, doit recevoir 20 pourcent des revenus pétroliers et gaziers de l’État. En se basant sur l’estimation du FMI que les revenus pétroliers et gaziers seront de 0,5 % du PIB dans la première année de production, 20 pourcent de ces revenus (c’est-à-dire, 0,1 pourcent du PIB) équivaudrait à une multiplication par cinq du capital du fonds au cours seulement de la première année de la rentrée des revenus pétroliers et gaziers. En outre, bien que le FONSIS n’investisse pas dans certains actifs pour des raisons éthiques, il n’a pas exclu les classes d’actifs en fonction du risque financier (comme certains fonds souverains le font). Par exemple, les investissements dérivés peuvent entraîner des pertes financières supérieures à la valeur d’investissement initiale, et sont interdits par certains fonds souverains.
Toutefois, il existe un certain nombre de faits rassurants concernant la gouvernance du FONSIS. Par exemple, le fonds a réalisé des investissements conjointement avec le Fonds d’équipement des Nations unies et la Société financière internationale, en sus de partenariats avec d’autres organisations, ce qui peut être considéré comme une marque de confiance dans ses modalités de gouvernance. Néanmoins, il sera toujours important de répondre aux questions de gouvernance mentionnées cidessus, car une surveillance rigoureuse des fonds souverains devient de plus en plus importante à mesure que le niveau des ressources détenues dans le fonds augmente (comme ce sera le cas lorsque le FONSIS commencera à gérer une partie des revenus pétroliers et gaziers du Sénégal). Le gouvernement prépare actuellement une nouvelle loi sur la gouvernance et le partage des revenus du FONSIS entre les fonds intergénérationnels et de stabilisation et le budget général118. Cette loi offre une occasion importante de traiter les questions que nous avons identifiées. A SUIVRE
William Davis et David Mihalyi
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]