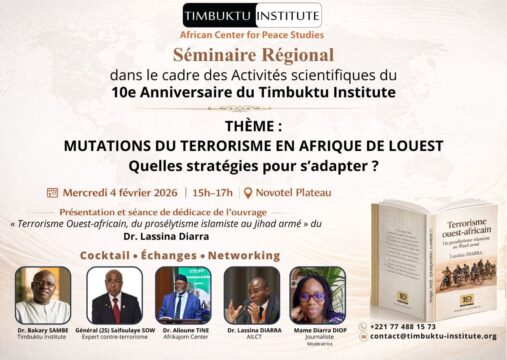Transparency International a publié hier son classement de l’Indice de Perception de la Corruption (IPC) pour l’année 2024. Le Sénégal se hisse à la 69ème place avec un score de 45 sur 100. Le pays gagne ainsi deux points par rapport à 2023.
Selon Transparency, la corruption bloque les progrès vers un monde durable. A ce titre, l’indice de perception de la corruption (IPC) 2024 montre que la corruption est un problème dangereux dans toutes les régions du monde, mais que des changements positifs sont en train de se produire dans de nombreux pays.
Les recherches révèlent également que la corruption est une menace majeure pour l’action climatique. Elle entrave les progrès en matière de réduction des émissions et d’adaptation aux effets inévitables du réchauffement climatique.
L’IPC classe 180 pays et territoires dans le monde en fonction de leur niveau perçu de corruption dans le secteur public. Les résultats sont donnés sur une échelle de 0 (très corrompu) à 100 (très propre).
Alors que 32 pays ont considérablement réduit leur niveau de corruption depuis 2012, il reste encore beaucoup à faire – 148 pays sont restés stagnants ou se sont aggravés au cours de la même période. La moyenne mondiale de 43 est également stable depuis des années, tandis que plus des deux tiers des pays obtiennent un score inférieur à 50. Des milliards de personnes vivent dans des pays où la corruption détruit des vies et sape les droits de l’homme.
Transparency a notamment évoqué la crise climatique, l’influence indue et l’argent sale pour dire que la corruption est étroitement liée à l’un des plus grands défis auxquels l’humanité est actuellement confrontée : le changement climatique.
Un grand nombre de personnes dans le monde souffrent de graves conséquences du réchauffement climatique, car les fonds destinés à aider les pays à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à protéger les populations vulnérables sont volés ou utilisés à mauvais escient. Dans le même temps, la corruption sous la forme d’une influence indue entrave les politiques visant à lutter contre la crise climatique et entraîne des dommages environnementaux.
Protéger les efforts d’atténuation et d’adaptation au changement climatique contre la corruption rendra ces activités vitales plus efficaces et, à leur tour, profitera aux personnes dans le besoin.
De nombreux pays ayant des scores élevés à l’IPC ont les ressources et le pouvoir de mener une action climatique résistante à la corruption dans le monde entier, mais au lieu de cela, ils servent souvent les intérêts des entreprises de combustibles fossiles. Certains de ces pays abritent également des centres financiers qui attirent des fonds illicites provenant de la corruption, de la destruction de l’environnement et d’autres crimes. Bien que l’IPC ne mesure pas cela, l’argent sale pose un problème majeur de corruption avec des effets néfastes qui vont bien au-delà des frontières de ces pays.
Pour François Valérian, Président de TransparencyInternational, « La corruption est une menace mondiale en constante évolution qui fait bien plus que saper le développement – c’est l’une des principales causes du déclin de la démocratie, de l’instabilité et des violations des droits de l’homme. La communauté internationale et tous les pays doivent faire de la lutte contre la corruption une priorité absolue et à long terme. C’est crucial pour lutter contre l’autoritarisme et garantir un monde pacifique, libre et durable. Les tendances dangereuses révélées dans l’Indice de perception de la corruption de cette année soulignent la nécessité de prendre des mesures concrètes dès maintenant pour lutter contre la corruption dans le monde. »
« L’Afrique subsaharienne détient le score le plus bas »
Au niveau mondial, l’organisme souligne que bien qu’il existe de nombreuses percées inspirantes, chaque continent a de sérieuses raisons de s’inquiéter. Cette année, trois régions ont vu leur niveau global de corruption diminuer et une seule s’est améliorée.
L’augmentation du score moyen au Moyen-Orient et en Afrique du Nord est une raison d’être optimiste, mais il s’agit de la première augmentation depuis plus d’une décennie et ce n’est que d’un point – à 39 sur 100. Pour réaliser des progrès significatifs, cette région doit relever les énormes défis des conflits et de l’autoritarisme. Les mêmes facteurs se combinent à la faiblesse des systèmes judiciaires en Europe de l’Est et en Asie centrale, qui a la deuxième moyenne la plus basse au monde.
Transparency estime que l’Afrique subsaharienne détient le score le plus bas. De fortes pressions – du changement climatique aux conflits – entravent souvent les progrès dans cette région. Néanmoins, il y a de l’espoir, car plusieurs pays montrent la voie à suivre avec des améliorations considérables.
L’Europe de l’Ouest et l’Union européenne sont les pays les plus performants, mais ils ont globalement diminué pour la deuxième année consécutive – de nombreux dirigeants servent les intérêts des entreprises plutôt que le bien commun et les lois sont souvent mal appliquées.
De l’autre côté de l’Atlantique, les Amériques doivent de toute urgence s’attaquer à l’impunité, protéger l’espace civique et prendre des mesures pour réduire l’influence du crime organisé et des élites en politique. Et bien que l’Asie-Pacifique compte un certain nombre de pays en voie d’amélioration, son score moyen diminue, à mesure que les cercles vicieux de la corruption et des impacts du changement climatique font des ravages, selon Transparency.
Awa BA
……………………………………………………..
CHRONIQUE DE MOUSTAPHA DIOP
Gare au syndrome wadien !
Il est rentré bien vivant dans l’histoire contemporaine de notre cher Sénégal le père de la démocratie sénégalaise mais ce ne fut guère aisé ; la voie qu’il avait empruntée pour tracer son sillon était une chasse-gardée où seul y évoluait un aîné – grand intellectuel, poète et plus tard – académicien –. Bardé de diplômes, il répondit comme tant d’autres, aux appels de la jeune nation qui avait besoin de la sollicitude et de l’escorte de tous ses fils du cultivateur de Gandiol avec son fidèle houe ou sa daba aux plus distingués et frais émoulus issus des strates de l’administration ou autres hiérarchies de l’ex tutelle. Sanglés de titres et de grades du plus haut niveau ; les premiers appelés s’ajustèrent pour lui céder un espace à la dimension ses capacités : Abdoulaye Wade avait bitumé aux pollens du savoir. Pour réécrire ses propres lois, gérer ses richesses, enseigner sa foi et devise, la jeune nation pouvait bien compter sur lui : son savoir était bien validé par les sommités universitaires de la tutelle. C’est ainsi qu’il débarqua à ses côtés une gracieuse âme-sœur native de Versailles, cœur de la noblesse de France.
Ainsi donc, après la brève fédération avec le Mali et l’éphémère et douloureux compagnonnage de l’académicien (Léopold Sédar Senghor) et de l’instituteur (Mamadou Dia) : la jeune nation tenait-là, le premier-ticket de dirigeants africains post-indépendance pour implémenter un modèle de gouvernance politique adossé aux principes et valeurs africaines ancré au crédo du « Penser par nous-mêmes et pour nous-mêmes dans un fécond Enracinement et d’ouverture ». Une idéologie suffisamment théorisée par le chantre de la négritude dans toutes tribunes du monde. Abdoulaye Wade, conscient du potentiel politique d’un éventuel duo, accepta de jouer de jeu, en se nivelant au rang de simple militant politique de la base. Sacrifiant ses parties de tennis et de golf du week-end, pour aller dans les coins et recoins de son Ndiambour natal, distiller et expliciter les grandes résolutions et du parti-état UPS.
Intelligemment, il s’inséra dans les rangs assez serrés du parti unique. Le parti, la seule structure garantissant un plan de carrière qui offrait un futur cadre de vie proche à celui de la grande métropole. Il s’y tenait de sourdes batailles de positionnement pour être adoubé par le père-de-la-nation. Abdoulaye Wade ne se sentait plus à l’aise dans ce capharnaüm où s’engluaient les fils éclairés de la nation. Excepté les affidés du communisme traqués par une néo police-politique chevillée par une assistance-technique issue de Marianne. Assez cartésien pour s’en tenir aux prédictions de divins et édifié par les entourloupettes du maître des lieux à l’endroit d’un autre charismatique universitaire Cheikh Anta Diop ; Abdoulaye Wade claqua la porte (pas avec fracas) cependant.
Un autre challenge s’ouvrait devant lui : être le seul vis-à-vis politique de Léopold Sédar Senghor. Des opportunités s’ouvrirent à lui durant son roadshow des cercles et tribunes intellectuels, politiques et prospectifs d’un monde en pleine mutation, happé par la crise du pétrole, la guerre froide, le Viêtnam insoumis ; la renaissance africaine. En métropole après Mai-68, les familles et cercles politiques entamèrent et/ou achevèrent leurs mues, on discourut énormément sur la démocratie. L’internationale socialiste française ouvrit grand ses bras et Léopold Sédar Senghor s’y engouffra et théorisa avec emphase « la voie africaine du socialisme et la démocratie », Wade le prit aux mots, c’est à Mogadiscio lors d’un sommet de l’OUA qu’il l’amena à agréer son parti politique, le président-poète accepta et creusa davantage la distance avec ses pairs africains. Ainsi naquit le Parti Démocratique Sénégalais (PDS), Wade fut aux anges, une euphorie de courte durée. Senghor ne lui donnera pas la primeur d’être seul opposant politique en face de lui, il ouvrit les courants politiques. Les communistes pouvaient prêcher librement le ‘’livre rouge ‘’. Cela n’endiguât pas la volonté d’Abdoulaye Wade qui batailla ferme sur tous les fronts vingt-six (26) ans durant pour connaitre l’apothéose un certain 19 mai mars 2000. Le monde exalta son courage et son mérite politique.
Wade était prêt à donner au peuple la substance de son Know how à un septennat qui ne fut pas un long fleuve tranquille. Après la prise du pouvoir qui mit fin aux 40 années de pouvoir du PS, il se rendit compte que la bête gesticulait encore. On vécut les effets de ce qui fut appelé ‘’syndrome wadien’’ : le pays bruissait de tintamarres, de cacophonies médiatiques, suscitant des doutes sur la justesse de survenance cette première Alternance politique pacifique. Le chienlit croissait, des dossiers politico-financiers chargés étaient déterrés et jetés dans l’espace public, un charivari institutionnalisé. Le sommet de l’état tanguait de la dualité entre Gorgui (Wade) et Ngorsi (Idrissa Seck). Le pape du SOPI n’arrivait toujours pas à mettre le vaisseau ‘’Sunugaal’’ sur le cap de l’émergence promis. Une néo – opposition certes groggy mais toujours argenté reprenait du poil de la bête. Une société-civile ambivalente à souhait à ses flancs, une certaine presse qui semblait avoir jeté aux orties les recommandations d’un certain Tocqueville, délaissant éthique et outils de travail aux mains de gueux ignares. Le même syndrome-wadiensemble guetter les autorités de notre troisième Alternance politique ? Wade avait résisté durant deux mandats.