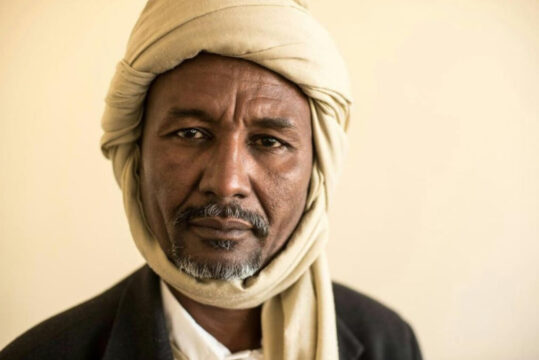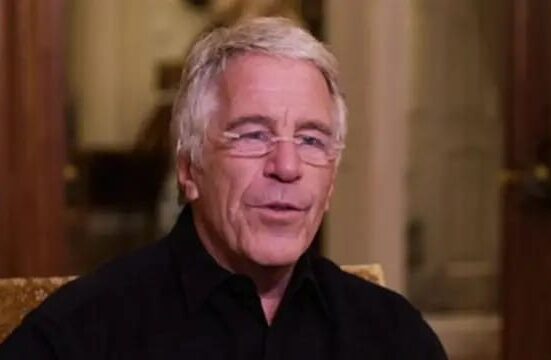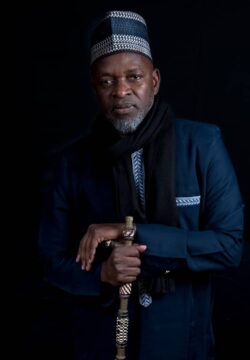Dans cette note publiée par la Fondation pour la Recherche stratégique, l’auteur Cédric Robin explore la criminalité environnementale au Gabon. Le chercheur met le curseur sur les enjeux stratégiques majeurs pour ce pays reconnu pour sa riche biodiversité.
Pour Cédric Robin, le Bassin du Congo suscite des préoccupations croissantes quant à la préservation des ressources naturelles en Afrique centrale. Considéré comme le deuxième plus vaste bassin forestier après l’Amazonie, s’étendant sur une superficie de 3,7 millions de kilomètres carrés, ce territoire englobe six pays : le Cameroun, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, la République du Congo, la Guinée équatoriale et enfin le Gabon.
Reconnu pour la richesse de son inventaire de biodiversité, le Bassin du Congo occupe une place essentielle dans la pérennisation et le développement des populations vivant sur son territoire. Cet écosystème exceptionnel soutient près de 75 millions de personnes en fournissant, depuis plus de 50 000 ans, eau, nourriture et matériaux aux 150 groupes ethniques qui y cohabitent. Le Bassin du Congo se distingue également par son caractère relativement préservé face à la déforestation massive, affichant un taux d’abattage net de seulement 0,2 % ces vingt dernières années. Cette sauvegarde permet à cette couverture forestière d’absorber des quantités importantes de carbone, estimées à six années d’émissions mondiales de gaz à effet de serre.
Cependant, le Bassin du Congo ne peut échapper à la menace d’une dégradation manifeste de ses biotopes. Au-delà des préoccupations relatives à la pollution, cette région subit les effets sévères d’une criminalité environnementale en constante augmentation qui se manifeste principalement par une prolifération de trafics multisectoriels et par des convoitises relatives aux nombreuses ressources naturelles présentes dans cet espace. Cette criminalité affecte, à divers niveaux, les six pays de la zone, ce qui a suscité l’élaboration de politiques de lutte tant sur le plan national que régional.
Parmi ces pays, le Gabon se distingue par une politique de protection environnementale ambitieuse principalement motivée par la présence d’un important catalogue floristique et faunique sur son territoire. Couvert d’une forêt dense s’étendant sur une superficie de 23,53 millions d’hectares, soit près de 88,97 % de sa superficie totale, le Gabon constitue l’un des principaux réservoirs de biodiversité du Bassin du Congo, abritant 10 000 espèces végétales dont 15 % sont endémiques, ainsi que 139 espèces de mammifères et 749 espèces d’oiseaux. Le pays héberge également une grande variété de primates, incluant 35 000 gorilles et 64 000 chimpanzés, et représente un refuge pour 50 % des éléphants de forêt du continent.
Fort de sa biodiversité locale, le Gabon est souvent cité en exemple pour la mise en œuvre de ses politiques de prévention et de protection environnementale. Depuis plusieurs années, le gouvernement de Libreville collabore étroitement avec des acteurs civils et militaires afin de renforcer ses objectifs de conservation, n’hésitant pas à solliciter l’expertise d’institutions, d’ONG ou d’États dans le cadre de partenariats internationaux. Cependant, les défis associés à la criminalisation de l’environnement persistent et pourraient s’intensifier dans ce pays d’Afrique centrale sujet à des mutations gouvernementales engendrées par le coup d’État du 30 août 2023. Par ailleurs, la montée des violences armées liée à la criminalité entraîne un durcissement des politiques de protection des parcs nationaux gabonais, conduisant à une militarisation de plus en plus manifeste des espaces naturels.
L’objectif de cette note est d’analyser les enjeux stratégiques liés à la lutte contre la criminalité environnementale au Gabon, en observant les solutions tant civiles que militaires mises en œuvre par le gouvernement. Nous commencerons par établir un historique des principales politiques poursuivies et évaluer leurs effets. Ensuite, nous identifierons les acteurs impliqués dans la criminalité environnementale, en analysant la nature de leurs trafics, leur origine et leurs motivations. Enfin, l’étude abordera les solutions militarisées adoptées par le Gabon, en examinant d’abord les différents partenariats internationaux impliquant des nations telles que la France dans le renforcement des mécanismes de protection de l’environnement, tout en interrogeant les bénéfices d’une militarisation des aires protégées au Gabon dans le cadre d’une stratégie de défense globale. Par ailleurs, une meilleure compréhension des défis associés à cette lutte pourrait éclairer les perspectives de coopération franco-gabonaise dans un contexte de compétition stratégique et de réduction de l’empreinte militaire française sur le continent.
Une criminalité environnementale multidimensionnelle : quelles implications pour le Gabon ?
Considérée comme la quatrième forme de criminalité organisée la plus répandue au niveau mondial, la criminalité environnementale connaît une croissance particulièrement notable en Afrique. Tirant parti des richesses naturelles du continent et de la faiblesse des politiques de contrôle, les différents trafics associés à cette criminalité engendrent chaque année une perte de revenus significative pour l’Afrique, estimée à 195 milliards de dollars. En Afrique centrale, et plus précisément au Gabon, la concentration des parcs naturels et l’immensité des zones forestières suscite des convoitises croissantes et contribue à une insécurité accrue dans ces espaces protégés.
Les facteurs de la criminalité environnementale au Gabon
En raison de la présence de nombreux parcs nationaux à proximité des frontières et des richesses concentrées dans ces réserves, le Gabon est un territoire où l’exploitation et le trafic illégal des ressources naturelles sont facilités, permettant aux criminels d’écouler rapidement leurs prises à travers les États voisins. Localement, les populations gabonaises susceptibles de s’adonner à la criminalité environnementale sont aussi les populations les plus pauvres du pays. Cette criminalité se concentre dans des départements ruraux accueillant des parcs nationaux tels que les provinces de Nyanga, de l’Ogooué-Lolo, de l’Ogooué-Ivindo, et du Woleu-Ntem. Au sein de ces réserves, ces individus se livrent à des activités illicites dans trois domaines principaux : le braconnage et le trafic d’animaux sauvages, l’exploitation et le transport de bois précieux, l’établissement de sites d’orpaillage clandestins.
Avec une concentration significative d’éléphants et de grands primates dans ces réserves, le Gabon se trouve confronté à des vagues de destruction de ses populations d’éléphants de forêt et de gorilles des plaines. Ces activités de braconnage sont motivées tant par des intérêts lucratifs impliquant des réseaux criminels internationaux que par des pratiques locales liées à la consommation de viande de brousse. En 2019, des actions de lutte contre le braconnage ont révélé l’implication de plusieurs nationalités dans le trafic d’ivoire, avec notamment la présence de Congolais, de Tchadiens et de Nigérians. Entre 2005 et 2020, selon les données fournies par le ministère des Eaux et Forêts, près d’un tiers des populations d’éléphants de forêt ont été victimes du braconnage. Dans le parc de Minkébé, situé au nord-ouest du Gabon, les populations d’éléphants ont ainsi subi une diminution alarmante de 78 % entre 2004 et 2014. En 2016, l’Agence française de développement (AFD) estimait que 150 à 200 kg d’ivoire étaient prélevés chaque semaine dans les forêts gabonaises, ce qui correspond à l’abattage hebdomadaire de quinze à vingt éléphants pour un prix de l’ivoire pouvant atteindre jusqu’à 2 000 euros le kilo. Face au fléau du braconnage, les gorilles des plaines de l’Ouest, classés comme une espèce en danger critique d’extinction, sont également exposés à des menaces considérables. Tirant parti du fait que 80 % d’entre eux évoluent dans des zones naturelles non protégées, les braconniers exploitent cette vulnérabilité pour chasser ces animaux dont la viande est prisée et pour capturer les jeunes individus afin qu’ils deviennent des animaux de compagnie.
En ce qui concerne l’orpaillage illégal, le Gabon fait face à une présence notable de travailleurs clandestins d’origine étrangère, principalement camerounais, qui exercent leurs activités d’exploitation aurifère au sein de camps implantés dans des parcs nationaux situés à proximité des frontières avec d’autres pays. Traversant la frontière gabonaise en petits groupes de quinze à cinquante individus, les orpailleurs camerounais sont également engagés dans le trafic d’ivoire, ce qui leur permet de diversifier leurs sources de revenus. En 2021, l’Agence de protection des parcs nationaux (ANPN) a identifié vingt campements clandestins dans les zones des parcs de Minkébé, de l’Ivindo et de Mwagna pouvant abriter plusieurs milliers de travailleurs. En 2011, au sein du parc de Minkébé, le démantèlement d’un camp a permis de recenser 6 000 orpailleurs illégaux, dont 5 000 étaient originaires du Cameroun, du Burkina Faso, du Mali, du Tchad, de la Côte d’Ivoire et du Bénin. Pour ce seul campement, la production quotidienne d’or s’élevait à cinq kilos, représentant une manne financière journalière de 100 millions de FCFA, soit une perte annuelle pour le gouvernement gabonais estimée à 35 milliards de FCFA.
L’exploitation illégale du bois est également très coûteuse pour le Gabon. En 2022, le ministère des Eaux et Forêts a indiqué que les trafics forestiers engendraient une perte estimée à 184,8 milliards de FCFA. Cette activité implique également des exploitants étrangers, principalement d’origines chinoise, libanaise, indonésienne et même européenne. Sous l’impulsion d’une demande asiatique croissante, certains exploitants forestiers se livrent à l’abattage de rares essences de bois telles que le Kevazingo, dont le prix au mètre cube peut atteindre un à deux millions de FCFA. En février 2019, 392 conteneurs de Kevazingo d’une valeur de 252 millions de dollars américains avaient été découverts dans deux entrepôts appartenant à des entreprises chinoises sur le port d’Owendo.
Les défis et enjeux sécuritaires associés à la lutte contre la criminalité environnementale
Face aux phénomènes criminels, et malgré l’établissement de cadres juridiques destinés à en limiter l’expansion, les autorités et les acteurs civils tels que Conservation Justice se heurtent à certaines insuffisances et incompréhensions qui entravent leurs actions. Aux abords des parcs, certaines populations sont victimes de la faune sauvage, ce qui peut engendrer des vendettas contre des espèces protégées, notamment les éléphants. Entre 2016 et 2021, 12 000 plaintes ont été enregistrées concernant la destruction de plantations et de cultures causée par des pachydermes. En 2020 et 2021, ce sont 27 agressions perpétrées par la faune sauvage qui ont été recensées, dont 18 impliquaient des éléphants, entraînant huit décès et des blessures graves. Des activités de sensibilisation ont alors été menées envers les populations et des mesures de prévention ont été mises en place contre de tels conflits homme-faune via la construction de clôture électrifiées. Néanmoins, et compte tenu des immenses surfaces à clôturer, les autorités gabonaises ont fait face à un problème de financement de ces installations, jugées trop onéreuses. Entre 2016 et 2017, le seul clôturage du parc national de la Lopéavait ainsi coûté 35 millions de FCFA à l’ANPN.
Les phénomènes de corruption impliquant directement les autorités nationales portent également atteinte aux initiatives de protection de l’environnement. En 2019, l’affaire du « Kevazingate » a mis en lumière la participation du vice-président gabonais, Pierre Claver Maganga Moussavou, et du ministre des Forêts, Guy-Bertrand Mapangou, complices d’un vaste réseau de trafic de bois destiné à la Chine. De nombreux documents censés justifier des cargaisons illégales de Kevazingo ont été falsifiés, substituant la mention de cette essence à celle de l’Okoumé, une autre variété dont l’exploitation est légale. Parmi les 392 conteneurs de Kevazingo saisis en février 2019, 135 d’une valeur totale de 69 millions de dollars ont été enregistrés comme bois légal et vendus aux enchères par le gouvernement gabonais. Afin de lutter contre le trafic de Kevazingo, le gouvernement de transition a, en août 2024, autorisé l’exploitation de cette essence, mais uniquement dans le cadre des concessions certifiées durables disposant d’un permis délivré par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages (CITES).
Les activités d’orpaillage engendrent également une corruption importante. En 2021, 62 orpailleurs illégaux, saisis avec 400 grammes d’or dans la région de Mitzic, ont révélé avoir bénéficié du soutien des populations locales ainsi que de certains membres de l’administration gabonaise. Par ailleurs, en 2017, une entreprise chinoise opérant au Congo aurait apparemment profité d’un arrangement avec les autorités gabonaises pour exploiter clandestinement une mine dans le secteur de Youkou, à huit kilomètres de la frontière congolaise, ce pendant près de 300 jours, générant un bénéfice estimé à 75 milliards de FCFA.
Depuis septembre 2023, le gouvernement de transition s’efforce de reprendre le contrôle sur ces exploitations en autorisant et en réglementant l’orpaillage artisanal.
Malgré les efforts déployés par la société civile, notamment par rapport à la mise en application systématique des peines, pour répondre aux problématiques environnementales susceptibles de conduire à des actes criminels, les bénéfices générés par ces activités illégales, et la nature violente de certaines d’entre elles, conduisent inévitablement à une prolifération d’armes posant de sérieux problèmes de sécurité au cœur du territoire gabonais. Le 6 février 2025, les autorités gabonaises ont procédé à l’interception d’une cargaison de 1 100 cartouches de chevrotine au port de Lambaréné. Selon les premières investigations menées par la Direction générale des services spéciaux (DGSS), ces munitions, en provenance du Cameroun, devaient être acheminées vers Port-Gentil afin d’y être distribuées aux réseaux de braconniers par voie fluviale.
Face à ces atteintes, Libreville, pour renforcer ses espaces naturels, a misé sur une stratégie reposant sur des outils traditionnellement réservés à la sphère militaire. Ce renforcement des mesures de sécurité est venu compléter une politique de protection antérieure, qui vise à la fois la préservation des écosystèmes et le maintien des zones d’exploitation.
La lutte contre la criminalité environnementale : entre conservation, militarisation et enjeux géopolitiques
Dans le but de consolider ses capacités défensives autour des zones naturelles protégées, le Gabon peut s’appuyer sur la coopération internationale, notamment au travers d’une assistance militaire provenant de divers pays. Cette coopération vient ainsi consolider une politique de protection de l’environnement préexistante et historiquement ancrée. Parmi les acteurs internationaux impliqués, la France se distingue comme l’une des nations les plus investies sur cette thématique. L’Hexagone dispose en effet d’une connaissance approfondie du terrain gabonais et d’un historique significatif de coopération militaire avec Libreville, ce qui lui confère un statut particulier dans ce domaine de sécurisation.
Les grands jalons de la lutte contre la criminalité environnementale au Gabon
Secteur économique incontournable, le commerce du bois au Gabon a dès ses débuts nécessité l’établissement d’un équilibre durable entre l’exploitation et la régénération des espaces forestiers. L’efficacité présumée des actions et initiatives actuelles en matière de répression de la criminalité environnementale repose en effet sur un cadastre forestier élaboré au fil des décennies passées, contribuant ainsi à différencier les zones protégées des secteurs d’exploitation.
Dès le début du XXe siècle, l’administration coloniale française des Eaux et Forêts avait mis en place des mesures visant à protéger les domaines forestiers par la création de réserves de faune et de chasse. Ces initiatives avaient pour objectif d’interdire aux populations locales certaines pratiques telles que l’agriculture sur brûlis, jugée nuisible à l’exploitation du bois. À l’indépendance du pays, le président Léon Mba initie la création d’un fonds forestier afin de garantir une exploitation cyclique des ressources forestières désormais nationalisées, en mettant particulièrement l’accent sur des opérations de reboisement. Un ministère de l’Environnement est établi en 1972, offrant une accélération des mesures de soutien à la gestion durable des ressources naturelles du pays.
La politique de conservation des écosystèmes au Gabon a connu un tournant majeur avec l’adoption le 26 août 1993 du Code de l’Environnement. Cette législation établit les principes généraux de la protection de l’environnement en offrant un cadre législatif majeur encore effectif aujourd’hui. Les principes fondamentaux de ce code encouragent l’utilisation durable des ressources, la lutte contre les pollutions et les nuisances, l’amélioration et la protection du cadre de vie, la promotion de nouvelles activités génératrices de revenus liées à la préservation de l’environnement, ainsi qu’une harmonisation entre le développement et la sauvegarde du milieu naturel. En décembre 2001, l’adoption d’un nouveau Code forestier a permis de renforcer les filières locales du bois tout en rendant obligatoire l’aménagement des concessions forestières dans le cadre des exploitations.
À la suite des législations destinées à réglementer les productions de bois, le Gabon a initié une politique de sanctuarisation d’une partie de son territoire, en réponse au Sommet de la Terre qui s’est tenu à Johannesburg du 26 août au 4 septembre 2002. Au-delà de l’ambition de promouvoir l’écotourisme et d’éveiller le public à la préservation des espaces naturels, la création de zones naturelles protégées visait également à affermir l’encadrement des productions forestières. Par ailleurs, le nouveau cadastre assurait au Gabon de bénéficier d’un regain d’intérêt sur la scène internationale en positionnant le pays comme acteur incontournable dans la protection de l’environnement avec la possibilité d’une reconnaissance de ses espaces naturels par l’UNESCO. Le président Omar Bongo Ondimba a annoncé le 4 septembre 2002 la création de treize parcs nationaux répartis sur les neuf provinces du pays, représentant 11 % du territoire national, soit environ 30 000 kilomètres carrés.
Suite à leur établissement, les parcs ont été placés sous la tutelle du Conseil national des parcs nationaux (CNPN). L’objectif premier du CNPN était alors de normaliser le cadre juridique et institutionnel permettant la structuration des parcs. L’action du CNPN a conduit à l’adoption, le 27 août 2007, de la loi 003/2007 relative aux parcs nationaux, énonçant les principes directeurs à suivre par les gestionnaires des réserves naturelles. Grâce à cette législation, un socle juridique en faveur de la gestion des parcs a été établi, donnant lieu à la création de l’ANPN.
Confrontée directement aux effets de la criminalité environnementale, l’ANPN se tourne de plus en plus vers des solutions militarisées favorisant le renforcement de ses équipements et de ses procédures. En conséquence, cette agence bénéficie d’une aide internationale lui permettant d’acquérir du matériel et des formations adaptés à ses objectifs de préservation.
Militarisation des outils de protection des parcs nationaux : le rôle des acteurs internationaux
Face à la nécessité de sécuriser une superficie d’environ 3 millions d’hectares, les 550 écogardes gabonais de l’ANPN se trouvent confrontés à une situation des plus difficiles, exacerbée par l’utilisation croissante d’armes de guerre par divers trafiquants opérant au sein des parcs naturels. Les agents des parcs procèdent régulièrement à la saisie de fusils de calibre 12 Baïkal, de Kalachnikov ainsi que de leurs munitions auprès des braconniers et des orpailleurs. Au-delà de leur usage pour la chasse, ces armes sont également impliquées dans des échanges de tir qui se multiplient. En effet, et afin de préserver leurs activités illégales, les braconniers tendent fréquemment des embuscades aux personnels des parcs et aux autorités en mission de patrouille. En mai 2021, lors d’un contrôle dans la ville de Mékambo, un écogarde a été abattu dans l’exercice de ses fonctions. À l’occasion de ce tragique événement, le ministère des Eaux et Forêts a rappelé que depuis 2010, environ mille écogardes avaient perdu la vie lors d’affrontements armés à travers le continent. Pour cette raison, les écogardes bénéficient d’un soutien croissant des forces armées gabonaises (FAG) à travers des initiatives telles que la « mission Minkébé », mise en œuvre dans le parc éponyme depuis 2011. Dans ce cadre, l’engagement de partenaires internationaux se manifeste par des actions de formation, la fourniture d’équipements et un soutien dans la collecte de renseignements, offrant aux écogardes et aux FAG des atouts opérationnels décisifs.
Dans ce contexte, la France s’illustre comme un partenaire fiable pour le Gabon, une image qu’appuie l’histoire de sa présence militaire depuis 1960, date des premières activités de formation à destination des militaires gabonais. Ainsi, et depuis 1983, les éléments français au Gabon (EFG) sont engagés dans des exercices de préparation en milieu équatorial, notamment à travers le Centre d’aguerrissement Outremer et étranger en forêt gabonaise (CAOME-FOGA). Ils organisent régulièrement des stages de lutte contre la criminalité environnementale destinés aux FAG ou aux écogardes. Au sein du Centre d’entraînement commando en forêt équatoriale du Gabon (CEC-FoGa), environ 700 personnels gabonais reçoivent une formation bimestrielle avant d’être déployés dans le cadre de la « mission Minkébé». Ces sessions de formation peuvent aussi être réalisées directement sur le territoire français. En mars 2022, une délégation militaire gabonaise a ainsi été conviée en Guyane pour observer les méthodes de lutte contre l’orpaillage élaborées par la France.
Avec le retrait de l’Armée française d’Afrique subsaharienne, amorcé au Mali en 2022, la France a procédé à une réévaluation de sa présence militaire au Gabon, désormais en partie axée sur la préservation de l’environnement. Cette révision de la coopération militaire entre la France et le Gabon n’a pas altéré les relations économiques entre les deux pays, en particulier dans le secteur minier, ce dernier jouant un rôle de mécène dans la protection de l’environnement. Le site de Moanda, exploité par l’entreprise française Eramet, est la première mine mondiale d’extraction de manganèse, avec une production de 6,8 millions de tonnes en 2024. Eramet est activement engagée dans la protection de la faune du parc de la Lékédi, situé à environ cinquante kilomètres de Moanda. Par l’intermédiaire de sa fondation Lékédi biodiversité, l’entreprise a ainsi financé des actions contre le braconnage tout au long de l’année 2021. Le redéploiement des EFG vers ces problématiques pourrait venir renforcer les efforts de conservation déjà établis par des compagnies hexagonales afin de préserver durablement les intérêts français sur le sol gabonais. Cette nouvelle orientation stratégique a été matérialisée en mars 2023 lors du One Forest Summit, coorganisé par les présidents Emmanuel Macron et Ali Bongo Ondimba. Ce sommet a non seulement contribué à rehausser l’image de la France dans le Bassin du Congo en tant qu’acteur de la sauvegarde environnementale tout en justifiant, au Gabon, la présence d’EFG via le partage de la base de Libreville avec les FAG.
Ainsi, depuis juillet 2024, le camp de Gaulle abrite l’École d’administration des forces de défense de Libreville (EAFDL) de même que l’Académie de protection de l’environnement et des ressources naturelles (APERN). En synergie avec le CEC-FoGa, l’APERN a pour mission d’offrir aux forces gabonaises une meilleure maîtrise de leur environnement face aux trafics et aux criminalités environnementales. Cette nouvelle organisation a donné l’occasion à une trentaine de stagiaires gabonais du 1er régiment de parachutistes de participer à un stage commando de recherche et d’action en jungle (CRAJ), qui s’est tenu sous l’égide du CEC-FoGa du 8 au 19 juillet 2024. Au-delà des formations, la France est engagée, depuis juin 2024, dans des opérations de renseignement par le biais du « projet de surveillance environnementale », qui permet d’effectuer des observations aériennes et d’identifier avec précision les camps d’orpailleurs ou de braconniers.
D’autres États se distinguent aussi par leurs formations à l’attention des écogardes. En avril 2016, 14 soldats britanniques du 2e Bataillon d’Irlande ont pris part à un stage destiné à préparer les écogardes aux embuscades, à la manipulation des armes à feu et au tir. Ce stage incluait également un enseignement sur les techniques de patrouille et de navigation et sur la prévention et la sécurité en milieu jungle ainsi que la mise en œuvre des règles d’engagement. Les États-Unis ont, de leur côté, organisé des formations similaires avec le soutien du 83e Bataillon des affaires civiles. Ces exercices comprenaient des soins aux blessés dans des environnements difficiles, l’organisation d’opérations de secours aux otages, et des mesures d’assistance à la maintenance et à l’utilisation d’équipements géospatiaux. En ce qui concerne cet outillage récent, Washington a annoncé en octobre 2024 son intention d’équiper les écogardes d’un spectromètre de masse DART afin de lutter efficacement contre le trafic de bois. Avec la réélection de Donald Trump, ces coopérations pourraient connaître des changements reflétant l’ambiguïté des États-Unis sur les enjeux environnementaux. En février 2025, l’administration américaine avait réaffirmé son soutien à la protection des ressources naturelles lors d’une rencontre entre l’ambassadrice des États-Unis et le ministre gabonais en charge de l’environnement. En octobre 2024, 2 millions de dollars devaient ainsi être ajoutés aux vingt millions initialement destinés à l’appui technique de l’ANPN. Toutefois, Washington a annoncé officiellement le 1er juillet la fermeture de son agence de développement (USAID), jugée trop coûteuse par rapport à son efficacité limitée
. Établie en octobre 2024, l’USAID devait jouer un rôle essentiel dans le financement d’initiatives au Gabon dans les domaines politique, économique et sécuritaire. La suppression de l’USAID pourrait donc compromettre la mise en œuvre des programmes environnementaux dans le pays, et fragiliser la participation américaine à la lutte contre la criminalité environnementale.
La Fédération de Russie contribue également à cette lutte via la fourniture de matériel militaire. Cette aide a notamment été illustrée par un don d’armes exclusivement destiné au personnel de l’ANPN en novembre 2019.
La militarisation des zones protégées au service d’une politique sécuritaire plus globale
Le renforcement des dynamiques sécuritaires au sein des parcs nationaux gabonais, bien qu’animé par une volonté de mettre un terme aux trafics environnementaux, répond également à une doctrine militaire centrée sur la défense du territoire. À ce jour, seul l’excellent et récent travail du géographe Stéphane Ondo Ze aborde avec précision la question de la militarisation des zones protégées au Gabon, qu’il désigne par le terme de « parc marche ». Depuis son accession à l’indépendance et jusqu’à nos jours, le Gabon a orienté ses politiques militaires en considérant son armée comme une force uniquement défensive.
Bien que Libreville entretienne actuellement des relations cordiales avec Yaoundé et Brazzaville, il n’en demeure pas moins que la proximité directe de ces deux puissances régionales nécessite une consolidation des défenses frontalières gabonaises afin de prévenir toute ingérence. Le Gabon demeure prudent face à la puissance militaire du Cameroun, ce bien que ces deux pays ne soient jamais entrés en confrontation directe. Avec le Congo, la situation est différente, car les deux pays ont déjà connu un litige frontalier en 1965, lorsque des chars de l’armée congolaise avaient pénétré le territoire gabonais sur huit kilomètres dans la région de Bakoumba. Classée à la 33e place sur 38 des puissances militaires africaines en 2025, l’armée gabonaise ne possède pas les ressources nécessaires pour assurer pleinement la protection et l’intégrité de son territoire. Généralement situées dans des secteurs reculés dont l’accès est difficile, les frontières gabonaises constituent des zones poreuses facilitant le passage d’individus clandestins et l’établissement de trafics divers, entraînant une augmentation de l’insécurité dans le pays. La présence de zones naturelles protégées le long des frontières, ainsi que leur militarisation par, entre autres, des acteurs internationaux, sert à soutenir une doctrine défensive globale pour le Gabon, alliant protection de l’environnement et renforcement de la défense nationale.
L’exemple de la militarisation du parc de Minkébé illustre parfaitement cette politique. Les frontières de ce parc chevauchent celles du Cameroun au nord et de la République du Congo à l’est. La valorisation d’un glacis défensif dans ce secteur offre au Gabon l’assurance d’une sécurisation optimale de ces frontières en montrant indirectement à ses voisins que le pays est en mesure d’observer toute violation de son territoire grâce à des outils opérationnels délivrés par des partenaires internationaux.
Le projet « Tri-national Dja-Odzala–Minkébé » (TRIDOM), qui associe ces trois nations dans la préservation de la faune au sein du Bassin du Congo, revêt une importance capitale pour le Gabon. Cette initiative permet en effet au pays de valoriser ses capacités de filtrage en matière migratoire, en instaurant un contrôle renforcé sur la circulation des biens et des personnes dans ce secteur transfrontalier.
Le gouvernement gabonais encourage également la tendance à la militarisation en évoquant les liens entre les trafics environnementaux et le financement de groupes armés tels que Boko Haram. Pourtant, bien que de tels liens soient avérés dans d’autres États de la sous-région, rien ne démontre l’existence de telles connexions criminelles au Gabon. Il s’agit en fait d’une stratégie de Libreville pour renforcer son influence régionale en s’impliquant directement dans la lutte contre le terrorisme.
Au-delà des problématiques transfrontalières, la militarisation de l’ensemble des parcs nationaux situés à l’intérieur du territoire gabonais pourrait également favoriser un meilleur contrôle des exploitations minières et forestières situées en périphérie des zones naturelles protégées. D’autres parcs tels que Minkébé, Moukalaba-Doudou, Pongara et Monts de Cristal abritent d’ores et déjà des titres miniers impliquant des activités de prospection et d’exploitation, accentuant le caractère stratégique de la protection de ces espaces.
Pour conclure, le chercheur souligne que le modèle gabonais de lutte contre la criminalité environnementale illustre clairement la détermination du pays à renforcer ses capacités en matière de sécurité, tout en s’affirmant comme un leader incontesté dans la protection des espaces naturels au sein du Bassin du Congo. La mise en avant d’une politique environnementale historiquement fondée et rigoureuse, associée à un soutien international plus ou moins robuste, contribue à un renforcement des capacités militaires du Gabon, tout en lui permettant de bénéficier d’une reconnaissance tant régionale que mondiale pour son combat au nom de la préservation de ses écosystèmes – celle-ci correspondant aussi à des intérêts économiques pour Libreville. De fait, la mercantilisation de ces espaces naturels, d’abord par le biais des exploitations forestières puis à travers les secteurs minier et touristique, révèle surtout une intention de sauvegarder des intérêts économiques au-delà d’une valorisation d’un équilibre écologique et social.
Néanmoins, il est incontestable que la criminalisation de l’environnement au Gabon constitue un réel problème qui nécessite l’instauration de processus de sécurisation adéquats. L’implication croissante de nations telles que la Chine dans ces activités criminelles illustre une internationalisation des réseaux de trafiquants, susceptible d’accélérer la dégradation des écosystèmes tant au niveau national qu’à celui de la sous-région. Dans un contexte de réduction massive de sa présence militaire sur le continent africain, la France a su redéfinir son partenariat militaire avec le Gabon en orientant ses compétences vers la préservation de l’environnement.
Ce changement de paradigme dans les relations entre la France et le Gabon reflète une volonté manifeste de l’Hexagone de continuer à promouvoir la coopération bilatérale en prenant en considération les véritables besoins sécuritaires du pays hôte.
Synthèse de Rokhaya KEBE