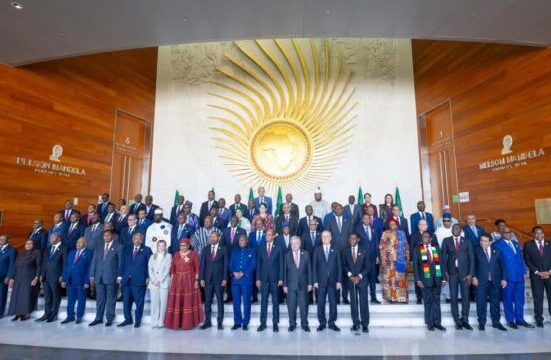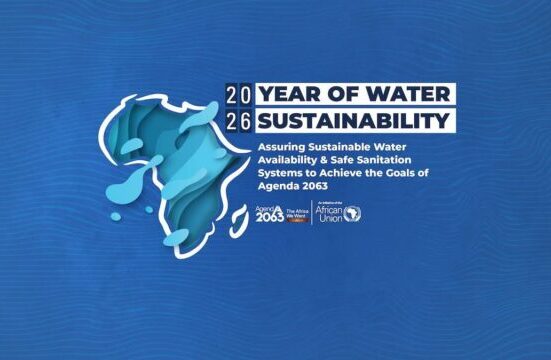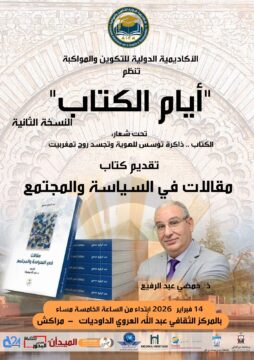Comment mobiliser le maximum de ressources internes dans les pays africains ? Patrick Ndzana Olomo de l’Union africaine et Arthur Minsat de l’OCDE répondent.
Dans un rapport publié fin octobre sur les « Statistiques des recettes publiques en Afrique », l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) et l’Union africaine font le bilan pour 33 pays du continent. Résultat : malgré des efforts notoires dans un contexte international contrarié et où le capital se raréfie, leurs gouvernements peinent encore à mettre en place de véritables politiques fiscales, au détriment de leur stratégie de développement. La question est posée alors que la mobilisation des ressources intérieures fait partie des priorités de l’Agenda 2063 de l’Union africaine (UA) et des Objectifs de développement durable (ODD). Ensemble, Patrick Ndzana Olomo, chef par intérim de la division politique économique et développement durable de l’Union africaine, et Arthur Minsat, chef de l’unité Afrique du centre de développement de l’OCDE, dressent dans cet entretien accordé au Point Afrique, en marge du 22e forum économique international sur l’Afrique tenu à Paris, un panorama complet de la situation fiscale du continent et soulignent les perspectives pour les années à venir.
Le Point Afrique : Quels sont les points saillants de ce rapport ?
Patrick Ndzana Olomo : La première chose qu’il faut retenir, c’est que la collecte des impôts s’améliore en Afrique. Ensuite, beaucoup d’efforts ont été faits pour mieux flécher les recettes fiscales vers les besoins de développement. Ces résultats ont été obtenus alors que les pays africains sont confrontés à de multiples crises, dont les conséquences de la pandémie de Covid-19, les effets du changement climatique et les tensions géopolitiques internationales. Dans cette période on a plutôt observé une réduction des capacités des États à mobiliser des ressources internes.
Dans quel contexte s’inscrivent ces efforts ? Et sont-ils suffisants ?
Ces efforts s’inscrivent dans un contexte où les dettes publiques augmentent partout. Pour l’Afrique, on se rapproche de 66 % du PIB. C’est très élevé, mais moins que dans les pays développés.
Cependant, l’Afrique doit faire plus pour mieux collecter, aller vers plus de transparence et de rigueur dans la gestion de ses ressources internes. D’autant qu’elles constituent le pilier de notre stratégie de développement dans le cadre de l’Agenda 2063, que l’UA s’est fixé.
Dans cette optique, il va falloir redoubler d’efforts, parce que dans le même temps l’Afrique perd chaque année environ 90 milliards de dollars à cause des flux financiers illicites, notamment à travers les échanges commerciaux. L’Afrique perd près de 220 milliards de dollars par an à cause des avantages fiscaux indus accordés aux multinationales et aux entreprises internationales. Nos États doivent être plus vigilants dans l’octroi de ces avantages censés attirer les investisseurs.
Qu’est-ce qui génère le plus d’impôts ? Le développement ou la bonne collecte de ceux-ci ?
Arthur Minsat : Il n’y a pas de règle en la matière. Certains pays connaissent de forts taux de croissance sans que cela ne se traduise par un développement spectaculaire et d’autres avec peu de croissance se développent à une bonne vitesse.
En revanche, il est évident que sans recettes, on ne peut pas investir dans l’économie réelle, et donc le développement.
La capacité de lever des recettes est aussi un signal important pour les investisseurs ; c’est un gage sur la capacité des États à rembourser. Si celle-ci est faible, automatiquement le coût de la dette sera élevé. C’est ce qu’on a pu observer au Nigeria où le niveau de mobilisation des ressources domestiques est assez faible avec un ratio de 5,5 %.
L’un des défis qui se pose à l’Afrique c’est la diversité des situations. Comment tracer une stratégie claire avec des trajectoires plurielles contrastées, des réalités géopolitiques, sociales et culturelles aussi différentes ?
Le continent africain a la particularité d’offrir une très grande diversité de profils, et ceci à plusieurs niveaux. La Tunisie ou le Maroc ont des niveaux de taxation proches des pays de l’OCDE, mais l’informel reste très fort. Pour ces pays les enjeux sont très spécifiques et portent sur l’élargissement de l’assiette fiscale. D’où la nécessité de réfléchir à des politiques très ciblées parce que les moyennes ne reflètent pas la réalité dans la mesure où les grandes économies influencent souvent les données.

Arthur Minsat est chef de l’unité Afrique du Centre de Développement de l’OCDE.© DR
Quels pays ont le mieux progressé et pourquoi ?
Parmi les pays qui ont fait le plus de progrès dans la mobilisation des recettes fiscales, nombreux sont ceux qui ont simplifié leurs administrations fiscales, mis en place des guichets uniques, procédé à une baisse des exonérations et engagé une meilleure communication avec les contribuables.
Le Togo a, par exemple, augmenté de 6 points de pourcentage entre 2010 et 2021 son ratio taxes sur PIB, essentiellement grâce à des mesures de réformes fiscales. Cela signifie qu’aujourd’hui introduire de nouveaux impôts n’est pas la seule solution.
Au Mali, également, les recettes fiscales ont augmenté malgré une plus faible capacité de gouvernance et le fait que le secteur informel représente une part importante de l’activité économique du pays, soit un peu plus de 85 %, la moyenne en Afrique de l’Ouest.
Mais si on prend le contrepied de l’informalité, il y a l’Afrique du Sud, qui compte 5 % d’informel mais qui doit aussi élargir son assiette fiscale. Le gouvernement a encouragé les déclarations d’impôts numérisées et touché plus de contribuables.
L’Éthiopie a amélioré son système de communication en ciblant les entreprises, notamment les PME, pour élargir sa base d’imposition.
Il est important de pouvoir apprendre des autres pays parce que, très souvent, on méconnaît ce qui est fait ailleurs. Pour autant, il faut pouvoir continuer à adapter les solutions et non pas les télécharger ou faire des copier-coller.
Quels sont les enjeux qui sous-tendent ces problématiques alors que les sources de financements se tarissent ?
Patrick Ndzana Olomo : Aujourd’hui, l’aide publique au développement décroît, l’environnement financier international n’est pas favorable aux capitaux africains, les pays sont confrontés à des problématiques de notation et de dette souveraine. Notre capacité à trouver des leviers pour augmenter les recettes fiscales internes est tout à fait déterminante. C’est un changement de paradigme. Car, jusqu’à présent, le développement était perçu comme un phénomène qu’on devait importer. Plus on augmentera nos capacités de mobilisation, plus notre développement sera basé sur l’économie réelle et donc sera endogène.

Le Dr. Patrick Ndzana Olomo occupe la fonction de Chef par intérim de la Division Politique économique et développement durable au sein de l’Union africaine, auparavant, il était responsable de l’investissement et de la mobilisation des ressources au département des affaires économiques de l’organisation panafricaine.© DR
Pour accroître ses recettes fiscales, l’Afrique doit transformer ses ressources et s’industrialiser, en particulier dans le contexte de la zone de libre-échange continentale et son vaste marché de 1,3 milliard de personnes.
Si nous parvenons à opérer cette transformation productive, nous pourrons générer des revenus qui permettront de financer tous les projets de développement dont l’Afrique a tant besoin.
Arthur Minsat : D’autant que ces ressources locales constituent déjà la première source de financement du continent. En 2021, les recettes publiques représentaient 15 % du PIB de l’Afrique, c’est plus que les investissements directs étrangers ou l’aide publique au développement.
Patrick Ndzana Olomo : Toutes les économies d’Asie du Sud-Est, d’Amérique latine ont amorcé leur processus de transformation productive. On peut annuler toutes les dettes des pays africains, tant que nous ne produisons pas ce que nous consommons, nous serons toujours au même niveau de développement.
Au moment où le FMI et la Banque mondiale annoncent des réformes, comment l’Afrique peut-elle peser ?
Patrick Ndzana Olomo : Nous sommes entrés dans une ère de réformes fiscales internationales. Dans cette perspective, l’Afrique a besoin de transparence et d’équité fiscale. Parce qu’on le sait désormais, « qui taxe le mieux se développe ». Les ressources internationales du FMI, de la Banque mondiale, et d’autres organisations ne sont plus suffisantes.
Sans compter que l’environnement de la notation internationale n’est pas des plus amical même pour des pays qui sont en perspectives de croissance et dont les résultats sont visibles !
L’avantage qu’ont les pays de l’OCDE, c’est qu’ils empruntent à des taux préférentiels. Or, l’environnement économique mondial se complexifie davantage, l’interdépendance entre les indicateurs est plus forte que jamais. Paradoxalement, les pays capables de mobiliser des ressources ont les coûts de la dette les plus faibles.
Comment continuer à attirer les investisseurs tout en évitant les écueils actuels autour des exonérations d’impôt en particulier dans les zones économiques spéciales ?
Arthur Minsat : Il y a une multiplication des zones économiques spéciales dans plusieurs pays et je pense que c’est aussi une volonté d’émuler le modèle chinois : une ville, une usine. Les gouvernements pensent ainsi attirer les investisseurs avec la promesse d’exonérations. Il y a clairement un risque avec ce modèle. Car si ces zones représentent des poches de développement, elles peuvent rapidement creuser les inégalités territoriales à l’intérieur d’un pays. Le risque est qu’il n’y ait pas de péréquation fiscale, puisqu’il n’y a pas d’impôts et donc on ne peut pas réinvestir la richesse qui est créée dans ces zones vers d’autres secteurs.
Presque toutes les enquêtes montrent que les exonérations fiscales ne sont jamais un facteur déterminant pour les investisseurs.
Quelles sont les pistes de solutions ?
L’une des solutions est d’adopter des politiques fiscales graduelles, car des seuils de taxation trop rigides peuvent constituer une barrière à la croissance de certaines entreprises, surtout les petites entreprises ainsi que les start-up.
L’exemple du Maroc est parlant. Le deuxième niveau de cotisation dans le royaume, ce sont les cotisations de la sécurité sociale, et ce, malgré la taille du secteur informel.
Où en est-on en Afrique de la taxation des géants du numérique, question dont les autres continents se sont saisis ?
Patrick Ndzana Olomo : Cette question est à peine effleurée dans notre rapport sur les recettes publiques en Afrique parce qu’il n’y a pas de base de comparaison commune. Mais le rapport « Dynamique de développement 2021 » avait montré que l’Afrique a eu le taux de pénétration numérique le plus élevé au monde au cours des dernières décennies.
Malheureusement, on constate que tous les autres continents cherchent à taxer cette économie du numérique et nous, Africains, sommes embarqués sans avoir pris toute la mesure du sujet. Il y a des entreprises qui ne sont pas logées chez nous. Prenez, les géants comme Yahoo !, Meta ou TikTok ! Ils ne sont taxés par aucun pays africain.
Propos recueillis par Viviane Forson (Le Point Afrique)