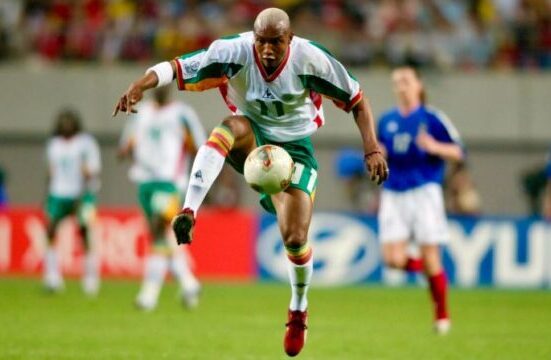« Tout progrès économique que les femmes enregistrent, est une contribution directe à la création des richesses, l’augmentation des revenus des ménages et de leur bien-être ». Alors, « l’autonomisation économique des femmes peut bénéficier non seulement à ces dernières, mais aussi à toute la société ». Cet avis du Directeur exécutif du Consortium pour la recherche économique et sociale (CRES), Pr Abdoulaye Diagne justifie la pertinence du colloque international sur l’autonomisation économique des femmes en Afrique de l’Ouest dont le lancement a eu lieu hier mercredi à Dakar. La rencontre de deux jours a pour objectif d’instaurer un débat entre différents acteurs publics, privés, communautaires et la société sur la problématique de l’autonomisation des femmes dont la non effectivité serait « économiquement inefficace ».
Partager des expériences et bonnes pratiques en matière de la promotion de l’autonomisation des femmes, renforcer le réseautage et la création d’alliance et synergie entre les acteurs sont aujourd’hui impératifs pour mieux aborder la problématique.
D’après la Directrice régionale de l’ONU Femme pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Florence Raes, « Malgré la mise en œuvre des différentes politiques et stratégies pour favoriser l’autonomisation économique des femmes, il est constaté aujourd’hui que ces dernières constituent encore les catégories, se concentrant dans les emplois les plus vulnérables ». Ce qui lui fait dire qu’il est vraiment temps de sortir les femmes dans le carcan du microcrédit, de la micro-participation, afin de passer au macroéconomique. « Les femmes en réalité ont non seulement le niveau d’études, elles ont tout à fait les capacités de gérer, mais font face à des nombreuses barrières notamment des questions sociales, des normes et autres », a plaidé Mme Raes, hier mercredi, lors du colloque international sur l’autonomisation économique des femmes en Afrique de l’Ouest initié par le Consortium pour la recherche économique et sociale (CRES) et ses partenaires dont l’Onu Femme.
La Directrice régionale de l’Onu femme relève qu’en dehors des inégalités économiques, la pandémie de Covid-19 a « montré que les femmes subissent le plus l’impact des crises que les hommes » mais aussi « le besoin de soins qui fait tant défaut sur le continent ». Au cours de cette crise sanitaire, elles étaient nombreuses à « faire des choix difficiles » entre leur emploi et leurs responsabilités ménagères.
La rencontre qui se poursuit et se termine aujourd’hui jeudi 27 octobre a convié plusieurs experts afin de favoriser un espace permanent d’échanges, de partage des connaissances et d’expériences à grande échelle et de développer des synergies autour des actions entreprises par diverses parties prenantes pour l’autonomisation économique des femmes en Afrique de l’Ouest.
Démographiquement parlant dans cette région, les femmes « constituent la majorité », explique le directeur exécutif du Cres, Pr Abdoulaye Diagne. Malgré cette ascendance statistique, elles « sont confrontées à beaucoup de contraintes » liées à la « discrimination sexiste », à la « répartition disproportionnée des ressources dans les ménages » et à l’insertion professionnelle. En plus de tout cela, elles assument chez elles des responsabilités inhérentes à la « collecte de l’eau », un labeur souvent à l’origine de conséquences négatives sur leur santé.
Si ces habitudes sont ancrées dans les sociétés africaines, il n’en demeure pas moins que « la discrimination des femmes est économiquement inefficace », souligne le professeur Diagne, citant des « preuves solides ». « Travailler avec les femmes relève du bon sens des affaires. C’est une voie efficace à l’économie durable », insiste le directeur exécutif du Cres, estimant que les femmes s’occupent en retour de leurs familles et ménages lorsqu’elles sont « économiquement autonomes ».
Partenaire principal du Cres dans l’organisation de ce colloque, le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) du Canada s’investit beaucoup dans l’autonomisation des femmes sur le continent. En Afrique de l’Ouest, il a porté son « attention sur six projets qui favorisent » l’indépendance économique des femmes, selon son président Jean Lebel. L’objectif de ces différentes actions est de « réduire le fardeau domestique non rémunéré » de cette couche vulnérable.
Toutefois, les inégalités citées précédemment représentent « la face visible de l’iceberg », signale Ngoné Diop, directrice du bureau ouest-africain de la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA), faisant ainsi référence aux « inégalités de genre » qui sont souvent peu évoquées. « Omniprésentes » dans plusieurs secteurs d’activités, les femmes souffrent d’un manque de valorisation et d’une absence de rémunération « à leur juste valeur ». Par conséquent, « 435 millions de pauvres » actuellement dans le monde sont des femmes et une bonne partie se trouve en Afrique de l’ouest, a-t-elle déploré.
Dans ces circonstances, « l’impératif » de leur autonomisation économique « relève » des « droits humains » parce que celle-ci « contribuerait » même « à la croissance économique de deux à trois pour cent », a expliqué Mme Diop. Elle invite dès lors les gouvernements des pays ouest-africains à « mettre en œuvre des politiques efficaces » pour que les femmes puissent saisir les « opportunités » économiques, comme dans le cadre du projet de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf).
Pour sa part, Pr Fatou Sow Sarr, commissaire en charge du développement humain et des affaires sociales de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’ouest (Cedeao), estime que « l’autonomie économique permet d’aller vers l’autonomie politique ». Pour cela, « les politiques publiques doivent changer de paradigmes et de perspectives ».
Comme pour répondre à cette militante sénégalaise de la cause féminine, le secrétaire général du ministère sénégalais de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants, Mame Ngor Diouf, note que son pays « reste attaché » aux droits humains et à la lutte contre les « injustices sociales » pouvant impacter les femmes. Le Sénégal « dispose aujourd’hui d’un cadre protecteur des femmes au plan juridique et politique ». Elles sont prises en compte dans « tous les axes stratégiques » des politiques publiques exprimées à travers le Plan Sénégal Emergent (PSE) du président Macky Sall, a-t-il fait savoir.
Yaye Moussou TRAORE