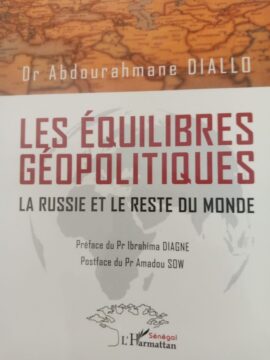La campagne menée par Israël à Gaza en réponse aux attaques du Hamas du 7 octobre 2023 éclipse toujours la politique au Moyen-Orient, le spectre d’une guerre plus large ou d’une autre instabilité régionale étant toujours présent, même si les pourparlers de cessez-le-feu semblent progresser. Les experts de Crisis Group offrent une vision à 360 degrés.
La guerre à Gaza entre Israël et le Hamas a considérablement fait monter la température au Moyen-Orient. La colère populaire monte. L’Egypte et la Jordanie craignent l’expulsion des Palestiniens vers leurs territoires. Les acteurs non étatiques de « l’axe de résistance » dirigé par l’Iran ont mené des attaques en réponse, prétendant soutenir le Hamas et la cause palestinienne plus largement. Ils ont frappé des cibles militaires israéliennes et américaines, ainsi que des navires dans la mer Rouge et le golfe d’Aden, avec des roquettes et des drones. Israël, les États-Unis et le Royaume-Uni ont à leur tour riposté contre ces groupes. Seul un cessez-le-feu à Gaza peut garantir une désescalade régionale. Le commentaire du président Biden selon lequel il estime qu’il y aura un cessez-le-feu d’ici le 4 mars, quelques jours avant le début du mois sacré du Ramadan, offre des raisons d’espérer.
Les combats de haute intensité entre les forces soutenues par l’Iran, d’une part, et les États-Unis et leurs alliés, de l’autre, ont causé des pertes militaires et civiles. Cela n’a pas précipité une confrontation plus large impliquant l’Iran lui-même, simplement parce que Washington et Téhéran ont indiqué qu’ils ne voulaient pas d’un tel affrontement frontal. Pourtant, le 28 janvier, apparemment par inadvertance, le meurtre de trois soldats américains basés en Jordanie par un groupe paramilitaire irakien a lancé un avertissement : il n’a pas déclenché une guerre plus large, mais il aurait pu l’être sans la détermination mutuelle de contenir la situation. Dans un environnement de tensions extrêmes et de délais de réponse rapides, le prochain incident pourrait ne pas être maîtrisé, surtout s’il implique un plus grand nombre de victimes, notamment civiles, ou davantage de soldats américains.
Alors que l’assaut israélien contre la bande de Gaza persiste, les risques d’une guerre totale ou d’une autre instabilité croissante restent élevés.
On ne sait pas exactement jusqu’où un cessez-le-feu à Gaza permettrait de calmer la région, mais même si l’assaut israélien sur la bande de Gaza persiste, les risques d’une guerre totale ou d’une autre instabilité croissante restent élevés. L’expulsion massive des Palestiniens de Gaza vers l’Égypte attiserait presque certainement davantage les tensions au Moyen-Orient, tout comme l’intensification de l’action militaire israélienne et des colons en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est pendant le Ramadan en mars et avril. Certains des dirigeants des groupes de « l’Axe » soutenus par l’Iran se sont engagés, une fois le cessez-le-feu en place à Gaza, à revenir à leur posture militaire d’avant-guerre – le statu quo ante du 7 octobre 2023, lorsque le Hamas a mené son attaque sur Gaza. Villes israéliennes entourant la bande de Gaza sous blocus israélien qui ont déclenché la guerre. On ne sait pas s’ils le feraient réellement, mais il ne fait aucun doute que la poursuite de la guerre à Gaza continuera à alimenter les échanges de tirs entre les forces soutenues par l’Iran et les États-Unis et Israël, tout en attisant la colère populaire dont se nourrissent ces groupes.
Dans cette vision à 360 degrés, mettant à jour les évaluations précédentes , Crisis Group prend le pouls des différents acteurs du Moyen-Orient : ce qui les motive, comment un cessez-le-feu à Gaza pourrait éclairer leurs calculs et à quel point la région se trouve proche d’un point de basculement.
Israël
La campagne aérienne et terrestre d’Israël semble encore loin de démanteler le régime du Hamas et l’infrastructure militaire dans la bande de Gaza. Israël a dégradé les capacités du Hamas, mais il n’a pas réussi à réaliser une percée stratégique, et encore moins à forcer le groupe à se rendre. Au début de la guerre, le Premier ministre Benjamin Netanyahu avait promis que le Hamas serait détruit, et depuis lors, il n’a cessé de jurer qu’Israël ne s’arrêterait pas tant qu’il n’aurait pas atteint une « victoire totale ». Mais il n’a pas formulé de voie à suivre pour y parvenir, de stratégie de sortie réalisable ou de scénario réaliste pour Gaza.
Encore profondément traumatisés par les attaques du Hamas du 7 octobre, les Israéliens sont majoritairement d’accord avec Netanyahu sur le fait que le groupe doit être vaincu et que la guerre à Gaza est juste. Ils montrent peu de sympathie pour les souffrances des Palestiniens à Gaza, et un langage déshumanisant fait désormais partie du discours politique. Pourtant, les événements survenus depuis les attentats sont devenus mêlés à la crise politique intérieure d’Israël. Netanyahu conserve sa majorité parlementaire, mais sa popularité est au plus bas, avec de plus en plus d’Israéliens exigeant de nouvelles élections. Beaucoup, y compris ses rivaux au sein du cabinet de guerre, craignent que Netanyahu ne poursuive la guerre en se basant principalement sur des considérations liées à sa propre survie politique et en détournant la responsabilité des échecs du 7 octobre en matière de renseignement et de sécurité. Pendant ce temps, l’échelon militaire a averti que sans une stratégie de sortie ou un plan au jour le jour, les acquis des derniers mois pourraient être perdus. En effet, le Hamas a déjà montré des signes de réaffirmation de son pouvoir dans le nord de Gaza, dans des zones détruites, conquises puis évacuées par les forces israéliennes.
Le gouvernement israélien n’a pas caché qu’il utilisait la nourriture et les médicaments comme monnaie d’échange pour forcer le Hamas à libérer les otages.
Israël accuse le Hamas, l’autorité dirigeante de la bande de Gaza depuis 2007, de détourner l’aide humanitaire et les biens essentiels, bien qu’Israël n’ait présenté aucune preuve pour étayer cette allégation, comme l’a souligné un responsable américain . Alors que le montant de l’aide entrant à Gaza est bien inférieur à ce qui est nécessaire, nombreux sont ceux en Israël qui estiment que presque tout, c’est trop ; ils disent que cela soutient les militants et donne au mouvement islamiste un moyen de pression sur la population de la bande de Gaza, alors même que les otages israéliens croupissent en captivité. La pression américaine a conduit Israël à augmenter légèrement le montant de l’aide entrant dans la bande de Gaza, mais une fois celle-ci arrivée, les restrictions israéliennes sur les déplacements et l’effondrement de l’ordre public limitent considérablement le transport et la distribution. Le gouvernement israélien n’a pas caché qu’il utilisait la nourriture et les médicaments comme monnaie d’échange pour forcer le Hamas à libérer les otages.
Le principal dilemme du gouvernement est de savoir comment se positionner en vue d’un éventuel accord d’otages que les États-Unis, le Qatar et l’Égypte se sont efforcés de conclure et qui, sur la base des douces prédictions du président Biden , pourrait bientôt se réaliser. Le Hamas exige non seulement la libération de nombreux Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes, mais également un cessez-le-feu par étapes qui mettrait fin à la guerre avec le retrait complet des forces israéliennes de Gaza. En revanche, Israël a indiqué qu’il n’accepterait qu’un cessez-le-feu temporaire pour garantir le retour de tous les otages et des dépouilles de ceux qui sont morts. Il entend maintenir une présence militaire « indéfinie » à l’intérieur, autour et au-dessus de Gaza.
Même si, en principe, elle est unie autour de l’objectif de détruire le Hamas, l’opinion publique israélienne semble grossièrement divisée en trois. Un groupe a l’intention de conclure un accord d’otages, même si le coût est aussi élevé que la libération des Palestiniens impliqués dans l’attaque du 7 octobre et même l’arrêt de la guerre (parce qu’ils considèrent la libération des otages comme la plus grande responsabilité d’Israël) ; un deuxième est prêt à sacrifier les otages si c’est le seul moyen d’atteindre l’objectif de détruire le Hamas ; et un troisième groupe continue de croire qu’Israël peut à la fois libérer les otages et, par la suite, vaincre le Hamas. Les mêmes divisions divisent la coalition au pouvoir et le cabinet de guerre. Pendant ce temps, l’appel de l’extrême droite à l’expulsion (par ce qu’elle appelle « l’émigration volontaire ») des Palestiniens de Gaza et à la reconstruction des colonies israéliennes là-bas gagne du terrain et entre dans une certaine mesure dans le discours dominant. Netanyahu a déclaré qu’Israël n’était pas intéressé par la réinstallation de Gaza, mais pour rester au pouvoir, il ne pouvait pas ignorer ceux de sa coalition, y compris les membres de son propre parti, le Likoud, qui souhaitent qu’Israël le fasse. Netanyahu a également affirmé qu’Israël devait conserver le contrôle sécuritaire de toute la zone située entre le fleuve Jourdain et la mer Méditerranée – déclarant ainsi une occupation croissante de la Cisjordanie et de Gaza.
L’idée d’une solution à deux États est probablement la plus éloignée de la conscience israélienne.
Il y a peu de soutien parmi les hommes politiques israéliens ou dans le public en faveur des efforts visant à parvenir à un règlement politique plus large avec les Palestiniens. Le gouvernement américain est favorable à une fin progressive de la guerre qui ouvrirait la voie à une voie politique comprenant la normalisation des relations entre Israël et l’Arabie saoudite et l’offre de concessions aux Palestiniens, notamment la mise en place d’une Autorité palestinienne (AP) restructurée à Ramallah, chargée de Gaza. Netanyahu a rejeté cette dernière proposition, et il pourrait finir par rejeter complètement un accord d’otages si cela signifiait la fin de sa coalition, l’extrême droite ayant menacé d’abandonner toute démarche vers un État palestinien. Netanyahu a déclaré que la reconnaissance par les pays étrangers d’un État palestinien au lendemain du 7 octobre récompenserait le terrorisme, et il a obtenu le soutien de la grande majorité de la Knesset dans une déclaration s’opposant à la reconnaissance unilatérale d’un État palestinien. L’idée d’une solution à deux États est peut-être la plus éloignée de la conscience israélienne, car les Israéliens sont concentrés intérieurement sur leur propre traumatisme, sur leur propre protection et sur leurs discordes internes.
Alors que les négociations sur un cessez-le-feu s’éternisent, Israël a intensifié ses frappes aériennes et d’artillerie sur Rafah, la dernière zone urbaine vers laquelle la plupart des Palestiniens de Gaza ont fui. Les forces israéliennes pourraient également se déployer le long de la frontière entre Gaza et l’Égypte, aggravant ce qui est déjà une catastrophe humanitaire et précipitant éventuellement une fuite massive des Palestiniens vers le désert égyptien du Sinaï, ce qui déstabiliserait davantage la région. Israël a insisté sur le fait qu’il devait envahir Rafah pour en finir avec les bataillons du Hamas, affirmant que les Palestiniens pourraient évacuer vers le nord de la bande. Benny Gantz, membre du cabinet de guerre de Netanyahu, a désigné le mois sacré musulman du Ramadan (qui commence le 10 mars) comme une date limite pour que le Hamas libère tous les otages israéliens qu’il détient à Gaza ou fasse face à une opération terrestre à Rafah.
Les hostilités à la frontière avec le Liban se poursuivent sans relâche, quoique dans certaines limites. Il y a quelques semaines, certains hommes politiques israéliens avaient averti qu’après les attaques du Hamas du 7 octobre, Israël ne pouvait plus tolérer une force militante hostile – le parti chiite et milice Hezbollah – à sa frontière nord. Dans le même temps, Israël a toujours manifesté son intérêt pour une solution diplomatique avec le Hezbollah – qui impliquerait, en substance, le retrait des forces du Hezbollah de la frontière – tout en gardant la fenêtre ouverte pour une opération militaire de grande envergure au Liban qui pourrait être bien plus importante. plus destructrice que la guerre de Gaza, tant pour le Liban que pour Israël. Pourtant, aucune solution diplomatique n’est possible tant que la guerre à Gaza se poursuit. Quelque 80 000 Israéliens restent déplacés de leurs foyers dans le nord, et il est peu probable qu’ils puissent rentrer en toute sécurité sans un cessez-le-feu à Gaza.
La violence de l’armée israélienne et des colons en Cisjordanie a augmenté depuis le 7 octobre, et elle pourrait se propager à Jérusalem pendant le Ramadan en mars et avril, surtout si Israël restreint l’accès des Palestiniens à la mosquée al-Aqsa sur la Sainte Esplanade de Jérusalem, comme il l’a fait. discuté de faire. Israël a maintenu la Cisjordanie sous un contrôle strict et interdit l’entrée à la plupart des Palestiniens qui travaillent normalement en Israël, exacerbant ainsi la détresse économique. Pendant ce temps, les attaques palestiniennes contre les Israéliens en Cisjordanie et en Israël se multiplient. La question de savoir si un cessez-le-feu à Gaza améliorera la situation en Cisjordanie dépendra de la politique israélienne, car ce gouvernement a l’intention de maintenir et même de renforcer son emprise sur un territoire qu’il occupe depuis 56 ans.

Palestine
Alors que la guerre à Gaza se poursuit, la situation en Cisjordanie occupée se détériore rapidement, faisant craindre une plus grande instabilité. Les raids militaires et les attaques de colons sont en augmentation, tout comme le nombre de morts parmi les Palestiniens. Les colons effraient les villageois et les chassent de leurs maisons, s’emparant de leurs terres et de leurs troupeaux, souvent en collusion avec les forces israéliennes. La situation des réfugiés en Cisjordanie est également préoccupante. Si l’UNRWA, l’agence des Nations Unies responsable des réfugiés palestiniens, était contrainte de suspendre ses services suite à la suspension ou à l’arrêt de son soutien financier par un certain nombre de ses donateurs, ce qui est devenu une possibilité réelle, la sécurité en Cisjordanie se détériorerait presque certainement. car les réfugiés qui dépendaient auparavant de l’agence pour leur survie verront leurs moyens de subsistance souffrir. Des troubles sociaux pourraient en résulter. Le Ramadan pourrait entraîner davantage de violence, si l’on en croit l’expérience des années passées.
Israël maintient en effet la Cisjordanie assiégée depuis l’attaque du Hamas du 7 octobre, bloquant les Palestiniens à l’intérieur de leurs villes et villages. Ces mesures ont provoqué un effondrement économique sur un territoire de 3,2 millions d’habitants. Ils ont également érodé davantage la réputation de l’Autorité palestinienne, soulevant des questions de plus en plus pointues quant à sa capacité à survivre.
Depuis le 7 octobre, Israël a retenu 257 millions de dollars de recettes fiscales qu’il devait à l’Autorité palestinienne, aggravant ainsi ses difficultés budgétaires. Le cabinet israélien aurait accepté d’envoyer les fonds accumulés à la Norvège, qui les conserverait en fiducie jusqu’à ce qu’Israël approuve leur versement à l’Autorité palestinienne. Cependant, jusqu’à présent, le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, un homme politique d’extrême droite qui s’oppose catégoriquement à la coopération avec l’Autorité palestinienne, a refusé d’approuver le transfert au gouvernement norvégien. La Norvège a prévenu que l’Autorité palestinienne pourrait s’effondrer sans cet argent. Même si l’accord était conclu, il serait interdit à l’Autorité palestinienne de dépenser le moindre argent à Gaza, où elle paie les salaires des fonctionnaires du gouvernement dirigé par le Hamas.
Le soutien au Hamas, que beaucoup considèrent comme l’incarnation de la résistance à l’occupation militaire israélienne, a triplé [en Cisjordanie et à Gaza].
L’AP, qui était déjà profondément impopulaire avant le 7 octobre, a ainsi perdu encore plus de soutien, tandis que le soutien au Hamas, que beaucoup considèrent comme incarnant la résistance à l’occupation militaire israélienne, a triplé . Quelque 88 pour cent des personnes interrogées lors d’une récente enquête en Cisjordanie et à Gaza ont déclaré qu’elles souhaitaient la démission du président Mahmoud Abbas. Abbas a d’abord condamné les attentats du 7 octobre, mais la réaction du public l’a rapidement contraint à tempérer ses propos. En décembre, Hussein al-Sheikh, adjoint d’Abbas et secrétaire général de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), a déclaré qu’il s’opposait à la résistance armée à l’occupation, appelant le Hamas à reconsidérer sa stratégie. De vives critiques l’obligèrent bientôt à faire volte-face . Abbas a publiquement rejeté l’idée selon laquelle l’Autorité palestinienne assumerait des responsabilités immédiates en matière de gouvernance dans la bande de Gaza d’après-guerre, mais les États-Unis font pression sur lui pour qu’il reconsidère sa décision. Les États arabes souhaitent que l’Autorité palestinienne joue un rôle à Gaza, mais ils se montrent moins enthousiastes à l’idée qu’Abbas reste à la tête du pays.
Alors que la guerre à Gaza se poursuit, de hauts responsables de l’Autorité palestinienne ont pour la première fois commencé à réfléchir ouvertement à un avenir sans Abbas, qui a miné ses rivaux pour consolider le pouvoir au cours de son mandat de dix-neuf ans. Lors des discussions sur le « jour d’après » à Gaza, Abbas a tenté d’anticiper toute initiative au sein des cercles de l’AP visant à éroder sa position par le biais d’une réconciliation intra-palestinienne. Il a interdit aux membres les plus importants de son parti, le Fatah, de s’engager dans des pourparlers directs avec le Hamas. Avant le 7 octobre, de hauts responsables de l’AP s’étaient efforcés d’explorer des options pour surmonter la crise de légitimité de l’AP, et les événements ultérieurs n’ont fait que rendre le renouveau politique palestinien plus urgent. De hauts responsables politiques d’autres partis, ainsi que des factions qui ont fait défection du Fatah, conviennent qu’un changement est nécessaire ; Certains appellent à la libération de Marwan Barghouti, un éminent militant du Fatah qui purge plusieurs peines à perpétuité en Israël pour meurtre, le considérant comme un dirigeant susceptible de réunifier le parti et de construire des ponts avec le Hamas avant les élections. Pourtant, une véritable réconciliation intra-palestinienne ne semble pas être une perspective à court terme pour l’instant. La démission du gouvernement du Premier ministre Mohammad Shtayyeh le 26 février suggère un simple remaniement en dessous d’Abbas et de son entourage immédiat, et n’apportera aucun changement à l’AP dans son ensemble.
Liban
Depuis le 8 octobre 2023, au lendemain de l’attaque du Hamas, Israël et le Hezbollah se sont affrontés à plusieurs reprises à la frontière israélo-libanaise. Dès le début, le Hezbollah a présenté ses attaques transfrontalières comme des actes de solidarité avec le peuple palestinien et le Hamas, son allié assiégé à Gaza. Dans le même temps, il les a soigneusement étalonnés, même lorsqu’il riposte aux frappes israéliennes, suggérant qu’il préfère éviter une guerre élargie – une position que le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a également évoquée dans ses discours. Cependant, les dirigeants du parti ont déclaré à plusieurs reprises que le Hezbollah ne se retirerait pas tant qu’Israël ne mettrait pas fin à sa guerre à Gaza.
En poursuivant cet exercice d’équilibre, le Hezbollah a fait face à des critiques , notamment de la part du Hamas ; un haut responsable du Hezbollah a admis à Crisis Group que, dès les premiers jours du conflit, le Hamas avait espéré une intervention plus énergique de son allié libanais. Le Hezbollah a justifié sa campagne mesurée jusqu’à présent en soulignant l’importance stratégique de maintenir Israël occupé à sa frontière nord, loin de Gaza, et de forcer l’évacuation d’au moins 80 000 Israéliens de leurs foyers au nord.
Même si les affrontements quotidiens aux frontières ne se sont pas transformés en guerre à grande échelle, les dernières semaines ont été marquées par les incidents les plus graves de chaque côté au cours de ce cycle de conflit.

Même si les affrontements quotidiens aux frontières ne se sont pas transformés en guerre à grande échelle, les dernières semaines ont été marquées par les incidents les plus graves de chaque côté au cours de ce cycle de conflit. En plus de bombardements plus intenses, Israël a augmenté le nombre de frappes contre des membres clés du Hezbollah et de ses alliés. Le 2 janvier, une frappe israélienne a tué Saleh al-Arouri, chef adjoint du Hamas, dans la banlieue sud de Beyrouth. Le meurtre a eu lieu à environ 100 km de la frontière – bien en dehors de la zone de conflit généralement acceptée – dans une zone de Beyrouth où vivent de nombreux partisans du Hezbollah. Le 8 janvier, une autre opération israélienne a tué le commandant militaire Wissam al-Tawil, le plus haut responsable du Hezbollah tombé depuis le début de la bataille. En représailles, le Hezbollah a lancé de lourdes attaques contre deux sites militaires israéliens clés situés plus profondément en Israël que la plupart de ses cibles précédentes. Le 14 février, après une frappe meurtrière contre une base militaire israélienne à Safed, également loin de la frontière, Israël a déclenché des bombardements généralisés dans le sud du Liban, tuant plusieurs civils. Deux jours plus tard, Nasrallah a menacé qu’Israël paierait « par le sang » les morts civiles.
Les diplomates continuent de chercher des moyens de résoudre le conflit à la frontière israélo-libanaise, bien conscients des menaces de violence accrue d’Israël si le Hezbollah ne retire pas les combattants qu’il stationne près de la frontière depuis le 8 octobre. Israël exige que le Hezbollah se conforme à la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l’ONU – qui a codifié un accord conclu à la fin de la dernière grande guerre entre les parties en 2006 – et retire son personnel dans les zones situées au nord du fleuve Litani. Un nouvel accord négocié devrait contenir des garanties répondant à la demande israélienne d’une plus grande sécurité, tout en répondant également aux préoccupations du Hezbollah, qui se présente comme le gardien de la souveraineté libanaise jusqu’à la frontière israélienne.
Les diplomates occidentaux ont suggéré que les parties envisagent des propositions visant à restaurer au moins partiellement le respect de la résolution 1701, que le Hezbollah et Israël ont violée à plusieurs reprises pendant des années. Les combattants du Hezbollah pourraient décamper vers des zones un peu plus éloignées de la frontière, tandis qu’Israël réduit ses survols réguliers violant l’espace aérien libanais. En parallèle, des diplomates ont évoqué la possibilité de relancer les négociations entre le Liban et Israël sur leur frontière contestée, connue sous le nom de Ligne bleue, ce qui pourrait ensuite encourager les négociations sur de nouvelles étapes.
Le Hezbollah a indiqué qu’il cesserait immédiatement les hostilités en cas de cessez-le-feu.
Pour compliquer les choses, le Hezbollah a résisté aux tentatives de discuter d’une désescalade le long de la frontière avant un cessez-le-feu à Gaza. Dans le même temps, il a indiqué qu’il cesserait immédiatement les hostilités en cas de cessez-le-feu, proposant en fait de revenir à sa position de statu quo ante.
Alors que les civils libanais sont sous le choc des conséquences de la guerre, ils restent pour la plupart impuissants à influencer la prise de décision du Hezbollah, qui reste la force armée la plus puissante du Liban. Jusqu’à présent, les affrontements frontaliers ont déplacé plus de 85 000 habitants du sud, tout en causant de profonds dégâts aux logements, aux infrastructures et aux actifs agricoles de la région. En proie à une crise économique sans précédent depuis 2019, le gouvernement était confronté à une bataille difficile pour remettre le pays sur la voie de la reprise avant même le 7 octobre ; depuis le début de la dernière série de combats, le pays a du mal à obtenir le financement de son plan d’urgence destiné à amortir l’impact socio-économique de la guerre.
Pour l’instant, Israël et le Hezbollah maintiennent un équilibre précaire le long de la frontière. Mais leur retenue pourrait prendre fin si l’un d’eux – probablement par inadvertance – frappait une zone peuplée, tuant de nombreux civils et obligeant l’autre à réagir. Personne ne sait si les deux parties seront alors capables de contenir l’escalade violente qui en résultera ; Les dirigeants israéliens pourraient conclure, si les pertes sont du côté israélien, qu’ils n’ont d’autre choix que de faire face de manière décisive à la menace que représente le Hezbollah.
Si Israël et le Hezbollah intensifient le conflit jusqu’à une guerre totale, comme beaucoup le craignent, un désastre humanitaire à l’échelle nationale s’ensuivrait presque certainement. Israël pourrait bien lancer une invasion terrestre du sud du Liban, tout en étendant sa campagne de bombardements à des cibles à travers le pays, comme il l’a fait lors de la guerre de 2006. Encore une fois, Israël concentrerait probablement ses attaques aériennes sur les zones à forte population chiite – en particulier la banlieue sud de Beyrouth et la vallée de la Bekaa, en plus du sud du Liban – où Israël accuse le Hezbollah de stocker une grande partie de ses armes parmi les civils qu’il prétend représenter dans le pays. la politique confessionnelle du pays. Les agences humanitaires se préparent à ce scénario, qui pourrait entraîner le déplacement d’un million de personnes dans un pays dont l’économie est déjà à genoux.
Egypte
Les tensions entre l’Égypte et Israël n’ont cessé de s’intensifier depuis le 7 octobre. Au cœur de ces préoccupations se trouvent les craintes du Caire concernant les intentions israéliennes, notamment la possibilité de pousser les Palestiniens de Gaza vers la péninsule du Sinaï. Bien que ces inquiétudes aient semblé s’apaiser suite aux assurances des États-Unis et d’autres partenaires étrangers, la perspective d’une opération terrestre israélienne à grande échelle à Rafah, la ville la plus proche de l’Égypte qui accueille désormais plus d’un million de Palestiniens déplacés, les a ravivées. Pour dissuader Israël d’envisager de telles mesures, l’Égypte a fermement exprimé à maintes reprises son opposition à l’idée d’expulser les Palestiniens.
L’Égypte est également alarmée par la possibilité qu’Israël s’installe sur un territoire situé à sa frontière. En décembre, le Premier ministre Netanyahu a exprimé son intention de reprendre le couloir de Philadelphie, une étroite bande de terre qui s’étend le long de la frontière entre l’Égypte et Gaza, incitant les responsables égyptiens à avertir leurs homologues israéliens que la réoccupation de cette zone violerait un accord de 2005 autorisant le Caire à déployer 750 soldats pour le patrouiller. Alors qu’Israël considère le contrôle de ce couloir comme essentiel pour mettre un terme au flux présumé d’armes et d’équipements militaires vers Gaza, pour l’Égypte, il est vital à la fois pour maintenir la sécurité dans le Sinaï, qui a connu une insurrection persistante, et pour prévenir un éventuel déplacement forcé. des Palestiniens de Gaza.
Les responsables égyptiens envisageaient activement de suspendre le traité de 1979 si Israël organisait une offensive à Rafah sans avoir préalablement évacué en toute sécurité la population civile de Gaza.
Le Caire est allé jusqu’à dire à Israël que l’expulsion massive des Palestiniens de Gaza obligerait l’Égypte à se retirer du traité de paix de 1979 entre les deux pays. Début février, alors qu’Israël commençait les préparatifs pour attaquer Rafah, le ministère des Affaires étrangères a averti qu’il considérait « le fait de cibler Rafah et l’adoption continue par Israël d’une politique visant à empêcher l’accès à l’aide humanitaire, comme une contribution réelle à la mise en œuvre de la politique de déplacement des réfugiés ». le peuple palestinien ». Les médias ont rapporté que les responsables égyptiens envisageaient activement de suspendre le traité de 1979 si Israël organisait une offensive à Rafah sans avoir préalablement évacué en toute sécurité la population civile de Gaza. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukry a en partie fait marche arrière peu de temps après, déclarant que l’Égypte respecterait le traité aussi longtemps qu’Israël. Remettre en question le traité pourrait gravement nuire à l’économie égyptienne, en particulier si les États-Unis cessaient d’envoyer l’aide annuelle de 1,3 milliard de dollars qui y est liée.
La menace de se retirer du traité de paix semble avoir pour principal objectif de convaincre les alliés occidentaux de l’Égypte de faire respecter la ligne rouge qu’ils ont déclarée, tout en leur arrachant d’importantes concessions économiques. Depuis octobre 2023, le Caire est confronté à la fois à une crise sécuritaire potentielle et à une crise économique découlant de la guerre à Gaza, qui a exacerbé sa situation économique préexistante et le déclin de son influence diplomatique et militaire dans la région. Sur le plan de la sécurité, l’Égypte est confrontée à la possibilité d’un afflux de réfugiés déstabilisateur. Sur le plan économique, elle a ressenti l’impact de la guerre à Gaza à travers la baisse des revenus du tourisme, les réexportations de gaz israélien (coupées par Israël pour empêcher le Hamas de cibler les infrastructures d’exportation) et les frais de transit du canal de Suez, réduits par les attaques des Houthis sur Red. Transport maritime. Pourtant, il a tenté d’utiliser sa position centrale dans cette crise régionale et sa vulnérabilité reconnue dans celle-ci pour améliorer sa position. Confrontée à un problème de ressources et d’influence limitées, l’Égypte tente désormais d’exploiter la crainte de l’Occident que la guerre à Gaza puisse déstabiliser le plus grand pays du monde arabe, avec des répercussions possibles sur la sécurité régionale, la migration irrégulière vers l’Europe et la navigation commerciale dans le canal de Suez. Au cœur de cette approche se trouve la demande du Caire d’un soutien financier du Fonds monétaire international et de l’Union européenne, ainsi que l’aide des États-Unis pour empêcher l’expulsion des Palestiniens de Gaza.
Ce pari, qui a porté ses fruits jusqu’à présent, pourrait subir de fortes pressions si une opération terrestre israélienne à Rafah se poursuivait. Au cours des derniers mois, les décideurs occidentaux ont fait écho à l’opposition de l’Égypte aux déplacements forcés et ont signalé leur volonté de fournir une aide financière supplémentaire. Pourtant, le scénario des déplacements forcés continue de troubler l’Égypte. Le Caire a placé ses espoirs dans l’idée que les gouvernements américain et européen seraient disposés et capables de contenir l’offensive israélienne à Gaza. Pourtant, les récentes déclarations de Netanyahu suggèrent qu’Israël se prépare à une offensive sur Rafah. Un incident provoquant un exode massif de Palestiniens vers le Sinaï pourrait révéler l’impuissance de l’Égypte vis-à-vis d’Israël et éroder le soutien dont bénéficient les autorités au sein de la population.
Un afflux de réfugiés palestiniens pourrait mettre à rude épreuve des ressources déjà limitées et alimenter les manifestations antigouvernementales, poussant éventuellement le pays au bord de troubles de masse.
Le conflit à Gaza a eu un profond écho dans la société égyptienne, stimulant la mobilisation populaire à travers des manifestations de rue en solidarité avec les Palestiniens et le boycott des consommateurs des marques israéliennes et occidentales. Le président Abdel-Fattah al-Sisi a tenté de contenir cette vague de soutien en soulignant à la fois son attachement à la cause palestinienne et l’instabilité que la guerre pourrait provoquer en Égypte. Un afflux de réfugiés palestiniens pourrait mettre à rude épreuve des ressources déjà limitées et alimenter les manifestations antigouvernementales, poussant éventuellement le pays au bord de troubles de masse.
Pour l’instant, l’Égypte s’efforce d’atténuer la catastrophe humanitaire qui se déroule à Gaza, au moins en partie pour décourager les Palestiniens de tenter de sortir eux-mêmes des limites de Gaza et pour négocier une cessation des hostilités. Depuis le début du conflit, Rafah est le principal point d’accès de l’aide humanitaire arrivant en Égypte à destination de Gaza, manipulant quotidiennement une centaine de camions. L’Égypte sert désormais de principal canal d’acheminement de l’aide à l’enclave, principalement via l’aéroport al-Arish du Sinaï. Mais les contrôles stricts imposés par Israël et les obstacles logistiques, notamment la capacité de stockage limitée à al-Arish, limitent le flux de l’aide, risquant de détériorer les denrées périssables.
Sur le plan diplomatique, l’Égypte a rejoint le Qatar dans ses efforts visant à mettre fin à la guerre. Au cours des dernières années, le Caire a adopté une approche pragmatique à l’égard du Hamas malgré ses affinités avec les Frères musulmans égyptiens, contre lesquels Sissi a réprimé sans pitié. Le Caire considère le Hamas comme un acteur enraciné dans la société palestinienne, indispensable à tout accord diplomatique et sécuritaire dans la région. En décembre, le Caire a présenté un plan de cessez-le-feu en trois étapes pour faciliter la libération des otages à Gaza et des prisonniers palestiniens en Israël ainsi que la relocalisation de la population de Gaza vers le nord de la bande. Les pourparlers ont repris en janvier et février, dans le but de parvenir à un accord similaire qui pourrait ouvrir la voie à une désescalade majeure et à une trêve durable. Pourtant, les désaccords entre le Hamas et Israël sur la durée de la trêve, le premier exigeant un cessez-le-feu permanent et le second n’acceptant qu’un cessez-le-feu temporaire, signifient que les efforts se sont jusqu’à présent révélés infructueux.

Jordan
En raison de sa proximité géographique et démographique avec le centre de la crise, la Jordanie s’efforce d’éviter de se laisser entraîner dans l’instabilité croissante de la région. Ayant longtemps été un refuge pour les Palestiniens chassés de leur patrie, elle craint profondément une nouvelle crise qui pourrait envoyer les Palestiniens de l’autre côté du Jourdain. Elle n’a été impliquée directement dans les hostilités liées à la guerre de Gaza qu’une seule fois, lorsqu’un drone armé envoyé par un groupe paramilitaire irakien soutenu par l’Iran a frappé un poste d’observation américain, la Tour 22, dans le désert près de la frontière jordanienne avec la Syrie, le 28 janvier, tuant trois soldats américains. L’événement n’a eu aucune autre répercussion pour la Jordanie, même si les États-Unis ont répondu par une vague de contre-attaques contre les groupes militants irakiens soutenus par l’Iran en Syrie et en Irak. Mais cela a servi d’avertissement quant au fait que toute escalade régionale pourrait se répercuter sur la Jordanie. Les manifestations de colère du public face au sort des habitants de Gaza ont diminué depuis les premiers jours de l’assaut israélien contre la bande de Gaza après le 7 octobre, mais elles s’accéléreraient probablement si les Palestiniens étaient poussés vers l’Égypte.
En solidarité avec les Palestiniens, qui constituent une grande partie de la population du pays, les dirigeants jordaniens ont condamné avec véhémence la campagne militaire israélienne à Gaza. Le roi et la reine ont publié de nombreuses déclarations fermes, le premier dénonçant la « campagne de bombardements incessantes » d’Israël sur Gaza comme « une violation flagrante du droit international » et « un crime de guerre ». Le ministre des Affaires étrangères Ayman al-Safadi a également qualifié la campagne israélienne de « crime de guerre ». Il a déclaré que la Jordanie rejetterait l’implication arabe dans la bande de Gaza d’après-guerre, que ce soit sous la forme de soldats de maintien de la paix ou d’accueil de réfugiés de l’enclave, affirmant qu’elle ne voulait pas être considérée comme facilitant la résolution d’une crise provoquée par Israël aux dépens des Palestiniens. . Il a également appelé à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et à la libération par le Hamas de tous les otages qu’il détient. La Jordanie a publiquement soutenu la plainte pour génocide de l’Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de Justice.
Les responsables d’Amman affirment que la guerre menée par Israël à Gaza pourrait constituer une menace existentielle pour la Jordanie.
Les responsables d’Amman affirment que la guerre menée par Israël à Gaza pourrait constituer une menace existentielle pour la Jordanie. Le scénario qu’ils redoutent le plus est l’expulsion des Palestiniens de Cisjordanie vers la Jordanie après qu’Israël aura détourné son regard de Gaza. Davantage de nouveaux arrivants bouleverseraient l’équilibre politique précaire entre les résidents palestiniens du pays – qui sont des réfugiés des guerres de 1948 et 1967 – et les Cisjordaniens ou Transjordaniens du pays. Exprimer leurs craintes de manière aussi explicite constitue une rupture par rapport à la pratique passée, lorsque la Jordanie adoptait généralement un ton mesuré à l’égard des politiques et des actions militaires israéliennes, en phase avec les préférences de ses alliés occidentaux.
Le gouvernement fait l’objet de critiques nationales croissantes pour avoir signé le protocole d’accord américano-jordanien de 2022 sur le partenariat stratégique. L’accord donne aux États-Unis des « droits pratiquement illimités » d’utiliser le territoire jordanien à des fins militaires en échange d’une aide de 10 milliards de dollars sur sept ans. L’opposition à l’accord a commencé à se développer en octobre 2023, lorsque des allégations ont émergé selon lesquelles les États-Unis envoyaient une aide militaire à Israël via la Jordanie, les Jordaniens accusant les États-Unis de « coloniser » leur pays.
Les manifestations qui ont éclaté en octobre se sont depuis calmées, en partie parce que les forces de sécurité les ont réprimées et peut-être aussi parce que les gens sont devenus quelque peu habitués à la couverture médiatique incessante des souffrances palestiniennes. Pourtant, les sit-in se sont poursuivis aux deux postes frontaliers avec Israël, des militants tentant de bloquer les camions transportant des fournitures vers Israël qui ont été détournées par voie terrestre depuis les pays arabes du Golfe en raison des attaques des Houthis contre les navires commerciaux dans la mer Rouge.
Irak
Des groupes armés irakiens soutenus par l’Iran ont attaqué à plusieurs reprises les ressources militaires américaines en Irak et en Syrie au cours des quatre derniers mois, citant la guerre menée par Israël à Gaza, déclenchant parfois une réponse américaine. Dans l’ensemble, les deux parties semblent déterminées à ne pas franchir les lignes rouges présumées. Avant le 28 janvier, aucun soldat américain n’était mort et, même si les États-Unis ont tué plusieurs combattants des groupes irakiens, ces derniers ont apparemment jugé ces pertes tolérables.
L’équilibre fragile a été mis à rude épreuve lorsque l’un des groupes, Kata’ib Hezbollah, a tué trois soldats américains lors de l’attaque de drone sur la tour 22 le 28 janvier. Il est probable que l’attaque n’avait pas pour but de tuer, car les systèmes défensifs américains ont presque systématiquement abattre les drones ennemis, ce dont les groupes armés étaient parfaitement conscients. La réaction des groupes a été révélatrice : ils se sont immédiatement retirés de leurs bases en Syrie et dans l’ouest de l’Irak. Le commandant de la force iranienne Quds, Ismail Qaani, est arrivé à Bagdad quelques heures après l’attaque, obligeant apparemment le Kata’ib Hezbollah à publier une déclaration, publiée sur la plateforme de médias sociaux Telegram. Le groupe a déclaré qu’il suspendait ses attaques, invoquant le désir « d’éviter que le gouvernement irakien ne soit embarrassé », qui négocie avec Washington sur le maintien ou non des troupes américaines en Irak. (D’autres groupes, dont Kata’ib Sayed al-Shuhada et Harakat al-Nujaba, ont promis de continuer.) Cette déclaration était un signal clair de la part de l’Iran que ses alliés non étatiques étaient allés trop loin dans leur confrontation avec les États-Unis, même si Le Kata’ib Hezbollah n’avait peut-être pas l’intention de tuer les soldats américains.
La mort des soldats a conduit l’administration Biden à réagir avec force au milieu d’un tumulte politique à Washington et des accusations de ses détracteurs selon lesquelles elle faisait preuve de faiblesse. Le 2 février, l’armée américaine a mené plus de 80 frappes dans l’est de la Syrie et l’ouest de l’Irak, touchant des bases et des installations de stockage d’armes appartenant à la Force Al-Qods et à des groupes armés irakiens faisant partie de la Résistance islamique soutenue par l’Iran, mais aussi d’autres qui ne le sont pas. . Tous les groupes armés – qu’ils soient liés ou non à Téhéran – ont émergé au sein d’al-Hashd al-Shaabi (Mobilisation populaire) rallié par le clergé chiite en 2014 pour combattre l’État islamique ou ISIS. Les frappes américaines ont tué dix-sept personnes en deux endroits de la province de l’Anbar, dont seize appartenant à des brigades Hachd ne faisant pas partie de la Résistance islamique, ainsi qu’un civil.
Certains en Irak et aux États-Unis ont critiqué l’administration Biden pour ne pas avoir exercé de représailles directes contre le Kata’ib Hezbollah, responsable de l’attaque de la tour 22.
Le gouvernement irakien du Premier ministre Mohammed Shiaa al-Sudani a condamné les frappes comme une violation intolérable de la souveraineté irakienne, tandis que certains en Irak et aux États-Unis ont critiqué l’administration Biden pour ne pas avoir exercé de représailles directes contre le Kata’ib Hezbollah, responsable de la Tour 22. attaque. Peu de temps après, le 7 février, les États-Unis ont attaqué une voiture à Bagdad, tuant un haut commandant du Kata’ib Hezbollah, Wissam Sabir al-Saadi, également connu sous le nom d’Abou Baqir, et trois de ses compagnons. Cet incident a, à son tour, provoqué une vague de colère parmi les partisans de la Résistance islamique et du Hachd, car Abu Baqir était l’un des commandants vétérans du Kata’ib Hezbollah, qui avait été responsable, plus récemment, des opérations du groupe en Syrie. .
L’incident a également incité le Kata’ib Hezbollah à revenir sur sa déclaration suspendant ses opérations. Pourtant, ces groupes n’ont mené aucune attaque en Irak depuis lors, et seulement quelques-unes en Syrie, clairement sous la pression de l’Iran et du gouvernement irakien. Alors que l’Iran veut éviter une confrontation directe avec les États-Unis, le gouvernement irakien a besoin d’un espace politique pour négocier le retrait des forces internationales faisant partie de la coalition qui combat l’EI. Le départ de ces forces est une demande de longue date du gouvernement irakien, ainsi qu’une exigence de l’Iran et des groupes politiques et armés irakiens qu’il soutient. Washington a indiqué qu’il était disposé à examiner cette demande, mais pas tant que les troupes américaines seraient sous le feu des tirs. L’attaque de la Tour 22 a eu lieu un jour après que la Haute Commission militaire irako-américaine s’est réunie à Bagdad pour négocier le retrait des forces de la coalition. Le 10 février, le parlement irakien a convoqué une session pour voter l’expulsion des troupes américaines, mais trop peu de représentants se sont présentés pour obtenir le quorum. Près de la moitié des législateurs chiites sont restés à l’écart, ce qui témoigne de la réticence généralisée au sein de la coalition gouvernementale à un retrait précipité, voire à un retrait des troupes américaines. La plupart des partis irakiens, même les membres du Hachd mais à l’exception des trois principaux groupes de la Résistance islamique, préféreraient que les troupes américaines restent afin de former les forces irakiennes. (Le principal grief des groupes de la Résistance islamique est que les États-Unis utilisent leurs infrastructures nationales et leurs capacités de renseignement dans le cadre de la coalition anti-EI pour poursuivre des cibles autres que l’EI.)
L’incident de la Tour 22 montre les risques inhérents au jeu militaire joué par la Résistance islamique et les États-Unis en Irak et en Syrie, ainsi que la détermination claire des États-Unis et de l’Iran à contenir les échanges de représailles. Pourtant, dans cette impasse tendue, les accidents sont voués à se reproduire, et rien ne garantit que les efforts visant à gérer la situation réussiront toujours, surtout si le nombre de victimes est plus élevé des deux côtés.
Syrie
Affaibli par la guerre civile et les sanctions occidentales, le régime syrien est le seul membre de « l’axe de la résistance » dirigé par l’Iran à avoir fait profil bas pendant la crise déclenchée par l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, tout en faisant face à une multiplication des frappes aériennes israéliennes sur Israël. Actifs iraniens et alliés à l’intérieur du pays. Il a limité ses déclarations publiques à des déclarations en faveur de la cause palestinienne et de la résistance à Israël, reflétant les positions de longue date de la Syrie. Pourtant, tout en faisant l’éloge de l’opération d’inondation d’ Al-Aqsa du Hamas, il n’a pris aucune mesure pour aider le groupe ou ses autres partenaires de « l’Axe ». Le régime n’a pas contré les frappes aériennes israéliennes et a même engagé des discussions avec la Russie pour réduire les activités des milices soutenues par l’Iran près de la frontière syro-israélienne. Cela a cependant permis à ces milices de continuer à utiliser les installations et infrastructures civiles et militaires du régime pour approvisionner leurs forces déployées dans le sud de la Syrie.
[Le président Bashar al-Assad] a réduit au minimum les manifestations pro-palestiniennes.
Sur d’autres fronts, les actions du régime ont également démenti sa rhétorique. Le président Bachar al-Assad a appelé les 51 dirigeants nationaux lors du sommet arabo-islamique en Arabie saoudite le 11 novembre à mettre fin à tout engagement politique avec Israël, à conditionner toute reprise à l’engagement d’Israël à mettre un terme aux hostilités et à autoriser une aide immédiate à Gaza. Mais sur le plan intérieur, il a limité les manifestations pro-palestiniennes au minimum, exigeant que ceux qui espéraient les organiser obtiennent une « approbation de sécurité ». Il a autorisé une manifestation organisée par des partis palestiniens à Damas le 14 octobre, mais a dissous le rassemblement lorsque les manifestants sont devenus agités. Le 19 octobre, il a autorisé de nouvelles manifestations dans plusieurs villes des zones contrôlées par le régime, notamment une manifestation parrainée par l’État devant le siège de l’ONU à Damas.
Alors que le conflit entre dans son cinquième mois, la principale menace pour la stabilité de la Syrie vient de l’intensification des combats entre les groupes paramilitaires soutenus par l’Iran et les États-Unis, qui ont toujours du personnel militaire stationné en Syrie. Le 28 janvier, un drone armé lancé par un groupe irakien, probablement depuis une base dans l’est de la Syrie, a frappé la tour 22, un poste d’observation américain du côté jordanien de la frontière avec la Syrie, tuant trois soldats américains. Ces morts n’étaient peut-être pas intentionnelles : les États-Unis auraient normalement abattu un tel drone, mais dans ce cas, ils ont identifié à tort le véhicule comme étant l’un des leurs. Washington a ordonné une série de frappes de représailles en Syrie et en Irak. Une erreur de calcul comparable, traitée avec moins de dextérité, pourrait déclencher une escalade plus grave.
Yémen
Comme leurs homologues du Liban et de l’Irak soutenus par l’Iran, les Houthis du Yémen, connus sous le nom d’Ansar Allah, ont répondu à la guerre à Gaza en s’attaquant aux intérêts israéliens. Les Houthis ont mené des frappes de roquettes et de drones dans la mer Rouge et le golfe d’Aden, initialement contre des cargos soupçonnés d’avoir des liens avec Israël – ce qui signifie que les navires étaient censés appartenir en partie à des Israéliens ou être destinés à un port israélien. Plus tard, selon les États-Unis, ils ont élargi leur ensemble de cibles pour inclure d’autres navires commerciaux ainsi que des navires de guerre américains. Les Houthis ont indiqué que les attaques « se poursuivront jusqu’à ce que l’agression à Gaza prenne fin, que le siège soit levé et que l’aide alimentaire soit livrée au nord et au sud de Gaza ». (Ils ont également tenté d’atteindre le sol israélien directement avec leurs missiles, mais se sont révélés largement incapables de le faire.)
Face à ces attaques, de nombreuses compagnies maritimes ont choisi de ne pas envoyer leurs navires par la mer Rouge, préférant la route plus longue, et donc plus coûteuse, autour du continent africain. Ceux qui ont décidé de risquer un voyage plus court ont trouvé leurs navires vulnérables aux attaques. Les missiles houthis et les drones aéroportés, marins et sous-marins ont causé d’importants dégâts à plusieurs navires.
Les dernières déclarations des Houthis identifient toujours la fin de la guerre à Gaza comme l’un des principaux objectifs de leurs attaques.
Les États-Unis et le Royaume-Uni, soutenus par d’autres pays occidentaux, ont mené des contre-attaques répétées contre les Houthis, ciblant les installations radar côtières du groupe, les véhicules aériens sans pilote et les navires de surface, les installations de stockage d’armes, les sites de lancement de missiles et d’autres moyens militaires du groupe. pour dégrader sa capacité à poursuivre ses attaques. Cet effort n’a pas encore atteint son objectif. Lors des funérailles de plusieurs combattants tués lors de ces frappes aériennes, les Houthis ont promis de riposter contre les États-Unis et le Royaume-Uni. Les dernières déclarations des Houthis identifient toujours la fin de la guerre à Gaza comme l’un des principaux objectifs de leurs attaques, mais parlent également de venger leurs combattants morts.
Le 17 janvier, les États-Unis ont désigné les Houthis comme groupe terroriste mondial spécialement désigné, apparemment dans le but de les convaincre de mettre un terme à leurs attaques contre le transport maritime international. De leur côté, les Houthis ont minimisé l’impact des sanctions résultant de cette désignation.
Les Houthis savent que leurs actions bénéficient d’un certain soutien public au Yémen, ce qui les aide à un moment où leur règne dans les zones qu’ils contrôlent est devenu de plus en plus impopulaire. Les Yéménites sympathisent largement avec la cause palestinienne et critiquent vivement l’attaque israélienne sur Gaza. De grandes manifestations dans les villes – tant à l’intérieur des zones contrôlées par les Houthis qu’à l’extérieur, comme à Taiz – témoignent de ce sentiment largement répandu. En conséquence, les Houthis ont pu intensifier le recrutement militaire dans les zones qu’ils administrent pour les aider dans leur lutte contre le gouvernement internationalement reconnu du Yémen et les factions armées associées. Les Houthis et leurs rivaux ont largement observé une trêve négociée par l’ONU depuis mai 2022. Les Houthis ont également engagé des négociations avec l’Arabie saoudite sur le retrait de cette dernière du Yémen et le début de pourparlers de suivi intra-yéménites. Mais ils sont probablement en train de renforcer leur force militaire pour se préparer au moment où la coalition dirigée par l’Arabie Saoudite se retirera et où les seuls ennemis auxquels ils seront confrontés seront les factions alignées sur le gouvernement, dans l’espoir d’infliger à ces dernières une défaite finale. Ils peuvent également se sentir encouragés par le fait de savoir que personne ne se précipitera au secours de leurs adversaires, surtout si cela risque de donner lieu à de nouvelles attaques des Houthis contre les navires commerciaux.
Pour l’instant, les négociations entre l’Arabie saoudite et les Houthis se poursuivent mais ne semblent pas plus proches d’une issue positive qu’avant le 7 octobre. Mais surtout, ils ne se sont pas effondrés non plus, principalement à cause de la décision de Riyad de ne pas s’associer à la confrontation militaire américaine avec les Houthis. Cependant, plus la guerre à Gaza se poursuit, plus le processus politique risque d’en souffrir, ainsi que les perspectives de paix au Yémen – qui dépendent non seulement d’un accord entre les Houthis et l’Arabie Saoudite, mais aussi d’un accord intra-yéménite. Même si la trêve de facto a pour l’essentiel tenu, des combats de faible intensité se sont poursuivis dans certaines régions du pays et pourraient s’intensifier avec une nouvelle aide extérieure. Les États-Unis et le Royaume-Uni pourraient élargir leurs attaques contre les Houthis si ces derniers persistent à cibler les navires commerciaux, mais eux et d’autres puissances étrangères semblent opposés à des mesures qui entraîneraient une nouvelle implication extérieure et une résurgence de la violence dans la guerre civile yéménite.
L’Iran
Depuis le 7 octobre 2023, les tensions se sont fortement accrues entre les États-Unis et « l’axe de la résistance », le réseau de groupes soutenus par l’Iran dans la région. Une attaque meurtrière contre les forces américaines fin janvier a déclenché d’importantes représailles en Irak et en Syrie, tandis que les forces américaines et alliées affrontent presque quotidiennement les Houthis en raison de leurs menaces contre la navigation commerciale dans la mer Rouge et le golfe d’Aden. Téhéran semble trouver une frontière ténue entre maintenir une pression indirecte sur ses adversaires via ses partenaires, tout en évitant les provocations qui présentent un risque trop élevé d’enchevêtrement direct. Il n’est pas clair si elle pourra maintenir cet équilibre.
Le gouvernement iranien se présente comme un porte-drapeau de la cause palestinienne, et l’hostilité envers Israël est un principe fondamental de son idéologie depuis la révolution de 1979. Bien qu’il ait nié tout rôle dans l’attaque du Hamas du 7 octobre, il a salué l’exécution et a depuis dénoncé la campagne militaire israélienne tout en appelant à un cessez-le-feu. Téhéran salue également les attaques des membres de « l’axe de la résistance », dont le Hezbollah au Liban, divers groupes en Irak et les Houthis au Yémen, contre Israël et/ou des cibles américaines. Mais s’il soutient financièrement et militairement ces groupes, concédant une « consultation commune », il nie diriger leurs actions.
Malgré, ou peut-être à cause des efforts déployés par l’Iran depuis des décennies pour maintenir le conflit israélo-palestinien au centre de sa politique étrangère, le sentiment populaire semble s’écarter de la ligne officielle. Bien qu’il existe peu de sondages fiables ou d’autres indicateurs systématiques, des preuves anecdotiques suggèrent que de nombreux Iraniens se sont désintéressés du discours de l’État sur le « soutien aux opprimés », qui sous-tend théoriquement son soutien aux groupes de « l’Axe ». Une réaction négative pourrait même se faire jour. Le slogan « Pas de Gaza, pas de Liban, je donne ma vie pour l’Iran » a résonné lors de plusieurs manifestations antigouvernementales récurrentes motivées par le mécontentement politique et économique, reflétant la conviction que le gouvernement accorde une plus grande priorité à l’avancement de son agenda régional qu’à la répondre aux besoins nationaux pressants.
Les quelques manifestations de soutien à la Palestine qui ont lieu [en Iran] sont plus probablement orchestrées par le haut que par la base.
Les quelques manifestations de soutien à la Palestine qui ont lieu sont plus probablement orchestrées par le haut que par la base, comme on le voit dans de nombreuses capitales occidentales ; Comme le dit un commentaire du journal à tendance réformiste Sharq , « sous la surface, il n’y a aucun mouvement visible ». Quoi qu’il en soit, même s’il existe une apathie du public ou une critique pure et simple de l’approche du gouvernement, il est peu probable que cela façonne le comportement des décideurs, qui évaluent leurs politiques principalement sur la base de leur perception des avantages idéologiques et stratégiques de l’Iran.
L’Iran est impliqué dans deux conflits distincts mais étroitement liés liés à Gaza. Le premier est dû à son soutien de longue date au Hamas et au Jihad islamique palestinien dans la bande de Gaza, ainsi qu’au Hezbollah au Liban. Téhéran est favorable à l’endiguement des échanges de représailles à travers la frontière israélo-libanaise, étant donné la place centrale du Hezbollah dans la projection de la puissance régionale de l’Iran et dans sa stratégie de « défense avancée ». Une confrontation totale obligerait Téhéran à décider si et comment entrer dans la mêlée pour soutenir le Hezbollah, qu’il considère comme la clé de sa capacité à dissuader Israël de frapper l’Iran. Quant au Hamas, l’Iran considèrerait comme une victoire tout autre chose qu’un démantèlement complet du mouvement par Israël.
Non moins marquantes sont les fréquents affrontements depuis la mi-octobre entre les groupes soutenus par l’Iran en Syrie, en Irak et au Yémen, d’un côté, et les États-Unis, Israël et les forces alliées, de l’autre. Ces évolutions ont pris une direction de plus en plus inquiétante, notamment après que les forces américaines ont perdu trois vies lors d’une attaque de drone le 28 janvier contre un poste d’observation dans le nord-est de la Jordanie. Washington a étendu ses frappes contre les forces et installations liées à l’Iran en Syrie et en Irak, tout en frappant également des cibles houthis en réponse aux attaques du groupe yéménite contre les navires dans la mer Rouge et le golfe d’Aden. Ayant bâti un réseau d’alliés locaux au fil des décennies, l’Iran maintient que ces groupes opèrent de manière autonome ; les États-Unis et leurs alliés rétorquent que Téhéran facilite, au minimum, leurs actions et les soutient en leur fournissant des renseignements, des financements et des armes.
Même si ni Washington ni Téhéran ne semblent disposés à dégénérer en une confrontation directe, les risques sont importants. L’administration Biden fait déjà face à des appels nationaux visant à frapper directement des cibles iraniennes, et des attaques supplémentaires en Irak ou en Syrie, entraînant d’importantes pertes américaines, accroîtraient encore cette pression. Les médias suggèrent que l’Iran s’est appuyé sur certains groupes alliés pour restreindre leurs attaques ces dernières semaines, mais il reste difficile de savoir si la République islamique a la capacité ou l’envie de maîtriser ses partenaires, notamment en continuant de leur fournir une assistance militaire et intelligence . Avant le 7 octobre, les États-Unis et l’Iran semblaient s’être mis d’accord sur un accord informel de désescalade tout en poursuivant les négociations politiques, que l’attaque inattendue du Hamas en Israël a perturbées. Aujourd’hui, ils souhaitent peut-être tous deux revenir au statu quo d’avant le 7 octobre pour donner une nouvelle chance aux négociations, mais ils ne semblent pas en mesure de le faire sans la fin de la guerre à Gaza. En guise de solution de repli acceptable, ils semblent tous deux essayer de rester à l’intérieur des lignes rouges ennemies tout en transmettant leurs propres messages sur ce qui pourrait déclencher une escalade plus importante. Ces manœuvres peuvent les empêcher de franchir le seuil d’une confrontation directe, mais laissent une marge considérable pour des troubles en dessous de ce seuil. Il est difficile de prédire si les deux parties éviteront une collision : un incident faisant de nombreuses victimes pourrait forcer l’une ou les deux parties à changer de cap, surtout si le public national exige des représailles.
États arabes du Golfe
Alors que la guerre à Gaza se prolonge et que les tensions régionales continuent de croître, les États arabes du Golfe sont divisés dans leur réponse. Les Émirats arabes unis et Bahreïn, qui ont normalisé leurs relations avec Israël, et l’Arabie saoudite, qui envisage de le faire, tentent de trouver un équilibre entre condamner les dirigeants israéliens en réponse à l’indignation du public et ne pas mettre en péril leurs relations délicates avec l’État juif. En revanche, Oman, le Qatar et le Koweït ont été explicites dans leur condamnation de la conduite d’Israël dans la guerre. Alors que tous ces membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG) ont appelé à un cessez-le-feu à Gaza, jusqu’à récemment, ils n’ont que peu fait pour coordonner les efforts visant à mettre un terme à la guerre, chacun travaillant séparément.
Depuis le 7 octobre, le sentiment dans toute la région du Golfe reflète une profonde colère contre Israël pour sa guerre à Gaza et contre les États-Unis pour leur incapacité à retenir Israël. Des manifestations contre la guerre ont éclaté à Oman, au Koweït et à Bahreïn immédiatement après l’attaque du Hamas. À Bahreïn, des marches pacifiques à petite échelle se sont poursuivies presque chaque semaine, se concentrant strictement sur Gaza et évitant d’exprimer les griefs nationaux. Ici et dans de nombreux autres pays où les régimes découragent activement l’expression publique du mécontentement, de nombreuses personnes se tournent vers les réseaux sociaux et participent au boycott d’entreprises ayant des liens avec Israël, par le biais d’investissements, de campagnes publicitaires ou autres, pour exprimer leur soutien aux Palestiniens.
À Oman et au Qatar, les élites politiques et religieuses ont été en phase avec le sentiment public contre Israël et en faveur des Palestiniens.
À Oman et au Qatar, les élites politiques et religieuses ont été en phase avec le sentiment public contre Israël et en faveur des Palestiniens. Les responsables omanais, y compris le grand mufti, ont fait des déclarations fortes, appelant les États arabes à rester inactifs pendant que Gaza est assiégée, célébrant les Houthis et leurs attaques dans la mer Rouge et condamnant les frappes aériennes menées par les États-Unis sur les sites militaires houthis au Yémen. Le ministre des Affaires étrangères d’Oman a plaidé en faveur d’une conférence internationale qui ferait progresser la reconnaissance d’un État palestinien et a souligné l’importance d’inclure le Hamas à la table. Quant au Qatar, son dirigeant , Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, dans un discours prononcé devant le sommet du CCG en novembre, a qualifié la campagne israélienne à Gaza de « génocide » et a critiqué les puissances extérieures pour avoir permis qu’elle se poursuive.
Le Qatar, en particulier, a joué un rôle de premier plan dans la tentative de mettre un terme à la guerre, en servant de médiateur entre Israël et le Hamas pour parvenir à un cessez-le-feu. Travaillant aux côtés de l’Égypte et des États-Unis, elle a négocié une pause humanitaire d’une semaine fin novembre dans le cadre d’un accord prévoyant un échange d’otages et de prisonniers tout en envoyant des médicaments aux otages et de l’aide humanitaire à Gaza. Depuis lors, il a été impliqué par intermittence dans la négociation d’un cessez-le-feu plus long qui verrait, en trois étapes, la libération de la totalité ou de la plupart des otages restants en échange d’un grand nombre de prisonniers palestiniens détenus en Israël, d’une augmentation significative de l’aide humanitaire et d’au moins un retrait partiel des forces israéliennes de Gaza. En février, le Premier ministre israélien Netanyahu a critiqué le Qatar pour son incapacité à obtenir la libération des otages israéliens alors que, selon lui, il était en mesure de faire pression sur le Hamas, dont les dirigeants politiques se sont réunis à Doha. Les responsables qataris ont répliqué en accusant Netanyahu d’essayer de prolonger la guerre en poursuivant son propre agenda politique – une référence au Premier ministre israélien qui aurait tenté d’éviter d’avoir à comparaître devant un tribunal pour corruption en conservant son poste.
Aux Émirats arabes unis et à Bahreïn, les pressions pour rompre les liens économiques et politiques avec Israël continuent de s’accentuer. À Bahreïn, cela a divisé les élites : alors même que les forces de sécurité ont arrêté plusieurs manifestants, le conseil des représentants du pays a voté le rappel de son ambassadeur d’Israël (le roi Hamad bin Isa Al Khalifa a ensuite refusé de le faire), a rompu les relations économiques et a rejoint l’emblème de l’Afrique du Sud. affaire contre Israël devant la Cour internationale de Justice. Néanmoins, les dirigeants bahreïnites et émiratis ont tous deux déclaré leur intention de maintenir leurs liens avec Israël – conformément aux accords d’Abraham de 2020 –.
Les Émirats arabes unis marchent sur des œufs en maintenant leurs liens lucratifs avec Israël, face à la fureur croissante du public et à une surveillance accrue.
Les Émirats arabes unis marchent sur des œufs en maintenant leurs liens lucratifs avec Israël, face à la fureur croissante du public et à une surveillance accrue. Contrairement à sa position habituelle, il a autorisé un certain degré de critique d’Israël sur les réseaux sociaux, même de la part d’universitaires émiratis très suivis. Abou Dhabi a fourni de la nourriture et des médicaments à Gaza et évacué les civils blessés, arguant que ses relations avec Israël lui permettaient de construire un couloir humanitaire. Il a également construit un hôpital de campagne , ainsi qu’une usine de dessalement au poste frontière de Rafah avec l’Égypte pour pomper de l’eau potable sur le territoire. Utilisant leur siège au Conseil de sécurité de l’ONU, qu’ils ont occupé jusqu’à fin 2023, les Émirats arabes unis ont fait adopter une résolution appelant à une augmentation de l’aide humanitaire à Gaza et à la protection de ceux qui la fournissent. Les Émirats arabes unis ont également discrètement soutenu Mohammed Dahlan , ancien chef de la sécurité palestinien de Gaza, que certains considèrent comme un possible successeur d’Abbas.
Pour sa part, l’Arabie saoudite a généralement fait profil bas au cours des quatre derniers mois, se concentrant sur les efforts diplomatiques visant à mettre fin à la guerre, notamment les tentatives de coordination des approches arabes . Il a organisé un sommet arabo-islamique à Riyad en novembre et a emmené une délégation arabe dans les capitales des États membres du Conseil de sécurité de l’ONU pour faire pression en faveur d’un cessez-le-feu à Gaza. Il a également accueilli , en février, les ministres des Affaires étrangères de l’Égypte, de la Jordanie, des Émirats arabes unis et du Qatar pour discuter de la manière de travailler ensemble en faveur d’un cessez-le-feu, et a participé à des discussions sur le « lendemain » pour Gaza, en rencontrant des représentants jordaniens, égyptiens et égyptiens. Les responsables de l’Autorité palestinienne sur la revitalisation de l’Autorité palestinienne.
Pour l’Arabie saoudite, la normalisation des relations avec Israël reste sur la table malgré la guerre à Gaza, même si Riyad ne semble pas pressé, malgré la conviction de Washington que des progrès sur cette voie pourraient non seulement mettre fin à la crise de Gaza, mais aussi faire bouger Israël et les Palestiniens vers une solution à deux États. Si avant le 7 octobre l’Arabie Saoudite, soucieuse d’obtenir des États-Unis des avantages essentiels en matière de sécurité, semblait sur la bonne voie pour atteindre cet objectif, mais apparemment sans poser de conditions strictes à la création d’un État palestinien, la guerre à Gaza a placé la question palestinienne au premier plan des exigences saoudiennes. , du moins en rhétorique. Riyad semble toujours ouvert à l’idée mais, fortifié par le tollé général contre les actions israéliennes à Gaza, il indique clairement que la normalisation ne pourrait avoir lieu, selon une déclaration du ministère des Affaires étrangères du 7 février, qu’après « la reconnaissance d’un État palestinien indépendant… et de tous ». Les forces d’occupation israéliennes se retirent de la bande de Gaza ». Il est difficile d’évaluer la fermeté de cette exigence et si, du point de vue saoudien, les États pourraient reconnaître un État palestinien avant qu’il n’existe sur le terrain, mais pour l’instant, elle constitue un levier dans les négociations avec, notamment, les États-Unis. Pour Riyad, la création d’un État palestinien viable s’inscrit également dans le cadre de paix et d’intégration régionales dont il a besoin pour générer des gains socio-économiques conformes à sa Vision saoudienne 2030.
Alors que les hostilités se sont étendues dans la région, les États arabes du Golfe, à l’exception de Bahreïn , ont résisté aux appels à se joindre aux efforts militaires menés par les États-Unis pour combattre les Houthis au Yémen, craignant qu’ils ne deviennent une cible dans un contexte d’escalade plus large. Riyad et Abou Dhabi semblent croire que leur engagement avec l’Iran et, dans le cas saoudien, avec les Houthis les protégera dans une certaine mesure, tandis que les Houthis ont déclaré que leurs attaques contre les navires dans la mer Rouge et le golfe d’Aden n’étaient pas intentionnelles. pour saper leurs pourparlers avec l’Arabie saoudite, mais se concentrent strictement sur la promotion d’un cessez-le-feu à Gaza. Pourtant, comme les Houthis ont ciblé à la fois l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis dans le passé, les Émirats arabes unis et peut-être d’autres États du Golfe auraient déclaré aux États-Unis qu’ils ne pouvaient pas utiliser leurs pays pour lancer des frappes contre des groupes soutenus par l’Iran ; les États-Unis disposent de bases militaires dans les six États du CCG.
Les efforts de rapprochement saoudiens-iraniens et émiratis-iraniens ne semblent pas avoir souffert pendant la guerre à Gaza. Les réunions de haut niveau, notamment entre responsables de sécurité saoudiens et iraniens , se sont accélérées ces derniers mois . De tels progrès suggèrent que Riyad et Abou Dhabi considèrent le renforcement de leurs relations avec l’Iran comme une police d’assurance les protégeant de devenir des cibles dans une confrontation entre les États-Unis et l’Iran et/ou des groupes alignés sur l’Iran. Tous deux en profitent également dans le sens où ils estiment que la diplomatie avec l’Iran favorisera un environnement régional plus stable, capable de soutenir leurs ambitieux objectifs de transformation économique et de croissance. Ce sont sans doute ces relations qui ont contribué à empêcher que les échanges de tirs dans la région ne touchent également les pays du Golfe. Des incidents locaux, comme une escalade du conflit au Yémen et une reprise des attaques transfrontalières des Houthis en Arabie Saoudite, inverseraient la tendance. Riyad et Abou Dhabi supposeraient presque certainement que Téhéran avait donné son feu vert à ces attaques, abandonnant ainsi la notion de rapprochement au profit d’intérêts stratégiques primordiaux plus proches de la Méditerranée. Pour l’instant, cependant, les Houthis semblent également privilégier le maintien de leur ligne de communication avec Riyad ouverte, afin d’être sûrs de ne pas raviver leur conflit avec l’Arabie saoudite.