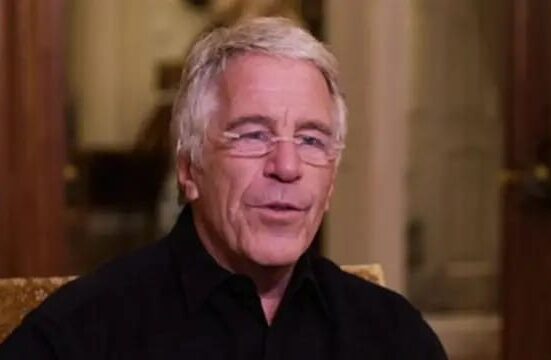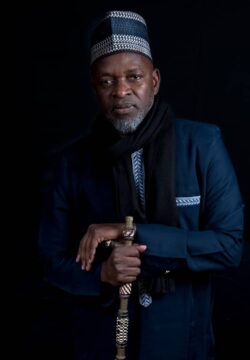Pour résoudre une fois pour toutes ce conflit qui dure depuis 42 ans, les récentes mesures en faveur de la paix doivent être consolidées.
La crise sociopolitique qui a débuté en 1982 en Casamance, dans le sud du Sénégal, est le plus ancien conflit armé d’Afrique de l’Ouest. Il oppose le gouvernement au Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC), une rébellion armée aujourd’hui divisée en trois factions principales réclamant l’indépendance de la région.
Des progrès significatifs ont été accomplis dans la résolution de ce conflit, en particulier depuis 2012. Cela a permis aux priorités de l’État en matière de sécurité de se déplacer vers l’est du Sénégal, une zone frontalière avec le Mali où opèrent des groupes extrémistes violents. Mais parvenir à une résolution définitive du conflit en Casamance nécessite une approche holistique qui prenne en compte les différents aspects de la crise.
Jusqu’à présent, la stratégie du gouvernement a favorisé une dynamique de paix positive. Il combine des négociations avec les factions du MFDC et des pressions militaires d’une part, et des investissements socio-économiques d’autre part.
Les pourparlers qui ont débuté en 2020 entre le gouvernement et la faction Diakaye ont abouti à un accord de paix signé le 10 mars 2023 et au dépôt des armes à Mongone en mai de la même année. En décembre 2023, 255 anciens combattants du MFDC de la faction ont rendu leurs armes pour les incinérer.
En 2021, l’armée sénégalaise a attaqué des bases du MFDC à la frontière entre la Guinée et la Guinée-Bissau. En mars 2022, une opération militaire a visé des bases de la deuxième faction dirigée par Salif Sadio dans le département de Bignona, près de la frontière gambienne. Le démantèlement de ces bases et le lancement d’opérations contre le trafic de bois et de drogue, principales sources de financement du MFDC, ont contribué à affaiblir les différentes factions. En août 2022, le gouvernement a signé un accord de cessez-le-feu avec César Atoute Badiate, chef de la troisième faction à cheval sur le sud du Sénégal et la Guinée-Bissau.
Ces interventions ont été rendues possibles grâce à l’amélioration des ressources des forces de défense et de sécurité et à la coopération militaire avec la Gambie et la Guinée-Bissau. En raison de leur position géographique, les deux pays ont servi de bases arrière à certaines factions du MFDC.
Le départ de l’ancien président gambien Yahya Jammeh en 2017 et l’accession au pouvoir d’Umaro Sissoco Embaló en 2020 en Guinée-Bissau ont donné à l’armée sénégalaise l’occasion de faire face à un mouvement affaibli par des conflits de leadership et un maigre soutien local et externe.
Divers investissements du gouvernement sénégalais en Casamance ont également contribué à résoudre le conflit. L’objectif était de créer des conditions socio-économiques et politiques qui favorisent la démobilisation progressive des combattants du MFDC.
Depuis 2012, le gouvernement a mis en œuvre une politique de développement dédiée à la Casamance, ainsi que d’autres initiatives fructueuses pour améliorer l’accès des populations rurales aux infrastructures de base et aux services sociaux, y compris dans les zones frontalières. Dans l’ensemble, il s’agit d’étapes positives vers la paix fondées sur le développement économique de la région et l’implication de plusieurs acteurs.
Malgré les progrès, les différends sur la direction et les négociations avec le gouvernement ont été les principaux facteurs de division du MFDC et de blocage du processus de paix. Tout comme le premier cessez-le-feu en 1991, les accords de paix signés depuis 2022 ont engendré des discordes au sein du MFDC. Cela a affecté la faction de Sadio, basée à Bignona, perturbant les négociations et empêchant la signature d’un accord. Toute reprise du dialogue doit tenir compte de ces dynamiques.
Le processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration (DDR) initié avec la faction Diakaye a connu plus de succès que les processus de DDR après les trois accords de cessez-le-feu (1991, 1993 et 1999) et les deux accords de paix (2001 et 2004) signés avec le MFDC. Le processus de DDR est crucial pour les pourparlers en cours avec les autres factions du MFDC. Sa mise en œuvre effective pourrait garantir la paix et servir de modèle aux différentes factions négociant avec le gouvernement.
Les mines terrestres sont une autre menace sérieuse qui nécessite une attention particulière. Les explosifs ont tué 870 personnes entre 1988 et 2023 (610 civils et 260 soldats), selon le Centre national de lutte contre les mines du Sénégal (CNAMS). Lors du dernier incident enregistré, le 14 décembre 2023, un véhicule militaire a heurté une mine antichar dans le nord de Bignona, tuant quatre soldats et en blessant trois autres.
Le CNAMS a défriché 2 063 992 m² de terrain dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Ces opérations de déminage doivent se poursuivre, en particulier dans le nord de Bignona, le long de la frontière avec la Guinée-Bissau et, dans une moindre mesure, dans l’est du département du Goudamp.
L’absence d’un accord de paix global avec le MFDC et les ressources financières et humaines nécessaires pourraient empêcher le gouvernement d’éradiquer les mines terrestres conformément à la Convention d’Ottawa. La présence de mines entrave non seulement les programmes de développement, mais dissuade également les personnes déplacées par le conflit de revenir pour y mettre en place des activités génératrices de revenus.
En raison des opérations de déminage et de sécurité, les gens commencent à repeupler certaines zones abandonnées dans les années 1990. Certains ministères ont apporté leur soutien, mais la réinsertion socio-économique et les tensions liées à la gestion des terres et des forêts devront être prises en compte.
Alors que le processus de paix connaît une dynamique positive, il faut s’attaquer d’urgence à ces défis. Ne pas le faire pourrait créer des tensions qui pourraient mettre en péril les progrès réalisés. ISS Afrique