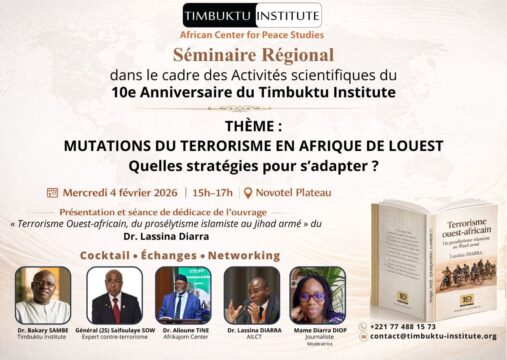Laurence Nardon, responsable du Programme Amériques de l’Institut français des relations internationales (Ifri) a, dans une note intitulée « Les États-Unis de Trump, adversaires stratégiques et idéologiques de l’Europe », disséqué quelques points sur les relations Etats-Unis/Europe sous l’ère Trump 2. L’auteur s’est posé une série de questions auxquelles à savoir : Comment l’Occident a-t-il pu se fracturer à ce point ? Quelle est la marge de manœuvre de l’Europe pour les mois qui viennent ?
Selon Laurence NARDON, le pire cauchemar sécuritaire des Européens semble se produire : mardi 18 février 2025, les ministres des Affaires étrangères américain et russe Marco Rubio et Sergueï Lavrov se sont retrouvés en Arabie Saoudite pour engager la normalisation des relations entre leurs deux pays. La réunion avait aussi pour objectif de mettre en place des négociations de paix pour l’Ukraine. Susceptibles d’affecter tout le Vieux Continent, les échanges se sont néanmoins déroulés sans les Européens ni les Ukrainiens.
Ce rapprochement russo-américain intervient quelques jours après un discours très offensif du vice-président américain J.D. Vance, exprimant une contestation idéologique sans nuances de l’Europe et de ses valeurs libérales1. Prononcé lors de la conférence sur la sécurité de Munich, il rappelle un autre discours hostile, prononcé par Vladimir Poutine lors de l’édition 2007 de cette même conférence. Le président russe avait alors dénoncé en termes vifs l’entrée dans l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) des anciens pays du bloc de l’Est, intervenue malgré les promesses américaines faites en 1990 à Gorbatchev. Ces propos avaient marqué le retour d’une Russie révisionniste et anti-occidentale, qui connaît aujourd’hui une vraie victoire, puisque les États-Unis de Trump renouent avec Moscou et semblent désormais considérer l’Europe, pourtant leur alliée historique, comme leur ennemie principale.
Les évolutions de la « doctrine Trump »
L’auteur souligne que pendant son premier mandat, le président Trump exerçait une politique étrangère que l’on a pu qualifier de « jacksonienne », en référence au président Andrew Jackson (1829-1837). Il pratiquait alors un nationalisme de repli, réticent aux interventions à l’étranger sauf lorsque les intérêts des citoyens américains étaient perçus comme directement en jeu. Les États-Unis étaient alors susceptibles de réactions brutales. À l’époque, les élans du président Trump étaient tempérés par ses conseillers militaires et diplomates chevronnés. Avec l’installation de l’administration Trump 2 en janvier 2025, les « adultes dans la pièce » ont disparu et deux attitudes nouvelles se cumulent :
Le retour d’un impérialisme colonial
Lors d’une conférence de presse tenue à Mar-a-Lago le 7 janvier, Donald Trump fait part de revendications territoriales inattendues sur le Groenland, le canal de Panama et le Canada. Dans le monde Hobbesien où vit le président-élu – celui d’une lutte permanente de tous contre tous, où les alliances ne servent à rien –, il est crucial de renforcer la puissance des États-Unis.
En l’occurrence, Trump veut pouvoir mieux surveiller les routes maritimes autour du continent nord-américain. En effet, à cause de la fonte des glaces, les mers autour du pôle Nord sont de plus en plus accessibles, facilitant la navigation des flottes militaires et commerciales russes et chinoises. Au-delà de considérations économiques, Trump veut acquérir le Groenland pour en faire une immense base américaine dans l’Atlantique nord ; récupérer le contrôle du canal de Panama pour contrôler la voie de passage centrale entre l’océan Pacifique et l’océan Atlantique ; faire du Canada le 51e État des États-Unis pour accéder plus facilement au « passage du nord-ouest », c’est-à-dire aux mers qui bordent l’océan Arctique au nord du continent.
À quinze jours de son investiture, Trump marque ainsi sa volonté d’agrandir le territoire des États-Unis par les méthodes du XIXe siècle : celles de l’achat (après la Louisiane en 1803, la Floride en 1819 et l’Alaska en 1867), de l’intimidation et de la conquête militaire, pratiquées notamment par le président William McKinley (18971901). En 1898, le président républicain avait engagé la prise de contrôle des Philippines, de Guam et de Hawaï dans le Pacifique, ainsi que de Cuba et de Porto Rico côté Atlantique.
L’Ukraine et l’Europe libérale « jetées sous le bus »
Les choses se sont accélérées mi-février. La conférence sur la sécurité de Munich est un événement annuel organisé depuis 1963, où les grandes nations se rejoignent pour discuter de défense et de sécurité. Vendredi 14 février, après avoir rapidement évacué la question ukrainienne et devant un public stupéfait, J.D. Vance a concentré ses propos sur l’Europe, l’accusant de ne pas respecter le principe de liberté d’expression (celle des chrétiens opposés à l’avortement) et de mettre en danger ses propres citoyens du fait d’une immigration incontrôlée (instrumentalisant une attaque islamiste intervenue la veille dans la ville).
Quelques jours plus tard, mardi 18 février, Marco Rubio, accompagné du conseiller pour la sécurité nationale Mike Waltz et de l’envoyé spécial Steve Witkoff, rencontrait les diplomates russes en Arabie Saoudite pour renouer les liens. En l’absence des Européens et des
Ukrainiens, les deux parties sont convenues de réunir rapidement des groupes de travail de haut niveau pour négocier la fin du conflit en Ukraine. Les conditions posées par la Russie sont apparemment nombreuses : l’abandon à la Russie des territoires ukrainiens conquis – voire plus –, le départ du président Zelensky, l’engagement de ne jamais admettre l’Ukraine dans l’OTAN – ce dernier point aurait déjà été concédé par Donald Trump lors d’un échange téléphonique avec le président Poutine intervenu la semaine précédente. Le Financial Times évoque même un retrait des forces militaires de l’OTAN des pays limitrophes de la Russie (pays baltes et Pologne)3. Quant aux garanties de sécurité apportées à l’Ukraine, les Américains en renvoient la responsabilité à l’Europe. De leur point de vue, cet abandon n’est qu’une juste réparation après des décennies pendant lesquelles les alliés européens ont abusé de la protection militaire américaine.
L’Europe pour l’instant divisée
Le bouleversement géopolitique engagé par Trump ces dernières semaines est vertigineux, et l’Europe semble bien mal placée pour réagir aux perspectives croissantes d’affrontement – qu’il s’agisse d’une guerre transatlantique idéologique, informationnelle, cyber et commerciale ou, pire, d’une extension des conquêtes militaires russes à l’est du continent.
En effet, les 27 États membres de l’Union européenne (UE), auxquels s’ajoute le Royaume-Uni s’agissant des questions de défense, sont loin d’être sur la même ligne. Les gouvernements hongrois et slovaque affichent depuis plusieurs années un positionnement conservateur et illibéral, pro-russe et anti-Ukraine, également revendiqué dans les partis d’extrême droite d’autres pays. Et sans aller jusqu’à un soutien déclaré pour le régime de Vladimir Poutine, beaucoup d’Européens seraient aujourd’hui secrètement soulagés de voir le cauchemar de la guerre en Ukraine se terminer sans qu’ils aient, pensent-ils, à s’impliquer. Enfin, les dirigeants à Berlin et à Varsovie refusent d’évoquer l’envoi de troupes nationales en Ukraine, car ils craignent de perdre des voix dans les élections à venir4. L’Allemagne vote pour le Bundestag le 23 février et la Pologne élit son président en mai.
L’histoire enseigne pourtant que les stratégies d’apaisement des dirigeants illibéraux et conquérants ne fonctionnent pas. Qu’il s’agisse de Poutine ou de Trump, l’Europe doit sortir de l’effet de sidération et se résoudre à monter au créneau.
Une feuille de route immédiate
Lundi 17 puis mercredi 19 février, le président français Emmanuel
Macron a réuni les Européens à l’Élysée, en format réduit puis élargi.
Ces réunions d’urgence ont permis de prendre en compte les divergences de positions des uns et des autres, et d’aborder la possibilité d’envoyer des forces pour surveiller un éventuel cessez-lefeu en Ukraine. Le Royaume-Uni et la France réfléchissent ainsi à la mise en place d’une « force de réassurance » en Ukraine, constituée de 30 000 hommes.
De nombreuses idées sont également échangées pour engager le réarmement européen5 : l’Organisation conjointe de coopération en matière d’armement, qui réunit la Belgique, la France, l’Allemagne l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni, pourrait être mobilisée et élargie pour organiser la production d’artillerie ; la Suède dispose d’avions de chasse Gripen qu’elle pourrait envoyer rapidement en Ukraine ; les pays volontaires pourraient contribuer au renforcement des forces nucléaires française et britannique afin d’élargir la dissuasion à tout le continent. L’UE pourrait enfin étendre les sanctions économiques et financières aux entreprises qui continuent à commercer avec la Russie, et saisir les 150 milliards de dollars de réserves russes bloquées dans les banques européennes.
Une réorientation de long terme
Il reste difficile d’évaluer la durabilité de l’attitude américaine.
L’administration Trump pourrait en effet rencontrer dans les mois qui viennent des obstacles à sa rhétorique anti-européenne. Le président Poutine se révélera probablement très dur dans les négociations sur l’Ukraine. Pourquoi accepterait-il un cessez-le-feu tout de suite, alors que ses troupes continuent d’avancer sur le territoire ukrainien ? Des refus répétés seraient une humiliation difficile à accepter pour Donald Trump et pourraient mener ses conseillers – Mike Waltz, Marco Rubio ou sa directrice de cabinet Susie Wiles – à tenter d’infléchir sa politique.
Cette interrogation est encore plus importante sur le long terme : que se passera-t-il en 2028 ? Le successeur de Trump, quel que soit son parti, ne sera sans doute pas aussi destructeur que lui, mais il reste illusoire d’espérer un retour à la normale. L’éloignement et l’imprévisibilité sont désormais une donnée des relations transatlantiques.
Les Européens seraient donc bien inspirés de remettre en question une bonne fois pour toutes la centralité du fait américain dans leur vision du monde. Le diplomate singapourien Kishore Mahbubani, qui les juge en mesure d’investir seuls et directement dans leur propre défense, leur suggère ainsi d’annoncer leur sortie de l’OTAN6. L’UE devrait aussi renforcer ses liens avec le reste du monde, en finalisant par exemple le traité Mercosur avec l’Amérique latine ou en se rapprochant de la Chine. Acheter à cette dernière, à bas prix et en masse, les panneaux solaires, les éoliennes et les pompes à chaleur nécessaires à la transition énergétique permettrait de joindre l’urgence environnementale aux impératifs géopolitiques.
Synthèse de Awa BA