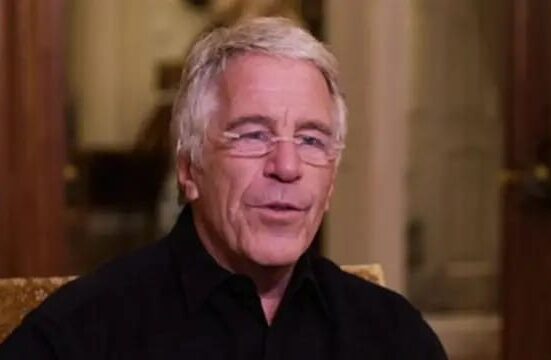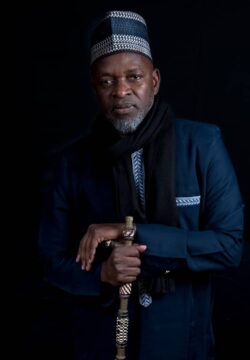Le logement social en France revêt des particularités spécifiques dans l’espace européen. Au fil des décennies, il concentre une part de plus en plus importante de la population immigrée extra-européenne. La concentration du logement social dans des quartiers isolés du reste du tissu urbain a généré des difficultés récurrentes qui se traduisent en particulier par des phénomènes de grande violence et l’implantation de l’économie criminelle. Cet habitat collectif n’est pas considéré de la même manière selon l’origine des populations. Prisé par les unes, évité par les autres, il renforce les distinctions culturelles à l’intérieur des mêmes ensembles urbains.
Un habitat coûteux, qui exclut les plus pauvres et les précaires
Les conditions de vie en HLM se sont beaucoup améliorées, surtout dans les quartiers qui ont bénéficié des crédits de la rénovation urbaine25. Les normes de construction des logements neufs obéissent à des considérations de qualité. Les espaces verts sont soignés. D’une certaine façon, le logement social est devenu attractif et rare, en région parisienne en particulier où il faut attendre près de dix ans pour en obtenir un. Au cœur de Paris, à cause des surfaces qu’il propose, il est même devenu un objet de luxe.
Son coût de production est élevé en proportion. Le prix de revient d’un logement social s’établissait en moyenne en septembre 2021 à 156.000 euros27, soit 2.300 euros le mètre carré. Le corpus des normes le rend parfois plus cher qu’un logement de même taille dans une résidence neuve. Dans certains centres-villes, eu égard au prix du foncier, ce coût est même totalement déraisonnable. Il est financé pour l’essentiel par la puissance publique, à travers des prêts aidés, des subventions, un taux réduit de TVA et une exonération de la taxe foncière (pendant quinze ans). En 2021, l’enveloppe des prêts s’établissait à 4,3 milliards d’euros (dont 1,7 milliard de la CDC). Il est aussi financé, indirectement, par l’APL, alimentée elle-même par un prélèvement sur les salaires. Le coût du foncier est enfin souvent pris en charge par la collectivité locale (au titre de la surcharge foncière).
Les locataires du secteur HLM bénéficient ainsi d’un fort effet de redistribution. Financé par les contribuables, mais aussi par les salariés et les épargnants de la Caisse d’épargne, cet effort serait parfaitement justifié s’il ne s’adressait qu’à des familles aux revenus modestes. Mais tel n’est pas le cas, et si la loi a prévu un « supplément de loyer de solidarité » pour les locataires dont les revenus dépasseraient les plafonds de revenus, ce « surloyer » est loin de compenser le différentiel entre le coût réel et le coût règlementé du logement.
De manière paradoxale, le logement social n’est plus conçu pour loger les plus démunis, car si son accès est, dans la loi, encadré par un plafond de revenus, il l’est aussi, en pratique, par un seuil minimum de revenus, déterminé par le « reste à vivre ». Ce « reste à vivre » est destiné à permettre au locataire de payer son loyer (et à protéger le bailleur social du risque d’impayé). Déterminé par l’article R 441-3-1 du Code de la construction et de l’habitat et un arrêté du 10 mars 2011, le taux d’effort résulte du rapport des dépenses (loyer + charges – APL) sur les ressources, elles-mêmes divisées par le nombre d’unités de consommation. Les ressources sont appréciées sur la base des salaires de l’année précédente. Le taux d’effort est en général fixé à 30%. La valeur de référence du reste à vivre est de 10 à 12 euros par jour.
Ce mode de calcul écarte les demandeurs aux revenus incertains (les commerçants par exemple, y compris ceux dont les commerces contribuent à l’animation du quartier). La mention de l’APL au numérateur privilégie les familles avec enfants. Le calcul des ressources avantage ainsi les ménages dont l’épouse ne travaille pas et les familles monoparentales.
Les ménages pauvres qui n’accèdent pas au logement social public se logent dans le secteur privé, dans l’habitat insalubre (copropriétés dégradées, location de « chambres de bonnes », pavillons de banlieue découpés en appartements avec sanitaires communs, voire squats ou terrains de camping). Beaucoup sous-louent des pièces dans le secteur HLM à des familles locataires. L’accès au logement social étant par ailleurs conditionné par la possession d’une carte de séjour en règle, les familles en situation irrégulière se logent souvent dans des immeubles possédés par des ressortissants du même pays.
LES ETRANGERS EXTRA-EUROPEENS DANS LE LOGEMENT SOCIAL
Une relation au logement social variable selon le pays d’origine
L’immigration ne forme pas un tout homogène. Les nationalités d’origine, les langues parlées, les religions dessinent des ensembles dont les modalités d’intégration peuvent être profondément différentes, même si les statistiques manquent pour en décrire la diversité.
L’Insee distingue les immigrés extra-européens selon sept groupes d’origine : Algérie, Maroc/Tunisie, Afrique sahélienne, Afrique guinéenne ou centrale, Asie du Sud-est, Turquie/Moyen-Orient et Chine. Cette répartition à grands traits met en évidence de profondes disparités de comportement, en particulier dans l’accès au logement, que l’étude Trajectoires et Origines (Ined et Insee), publiée en 2017, avait tentée de qualifier et que son actualisation, publiée en 2023, confirme.
Le logement se répartit selon trois statuts : la propriété, la location dans le secteur privé et la location dans le secteur public. La propriété est a priori, le signe d’une intégration définitive dans le pays d’accueil. La location dans le secteur public (HLM) illustre a priori des situations transitoires ou de précarité. La location dans le secteur privé n’est qu’une variable des deux autres, ce mode de logement pouvant résulter, selon le cas, d’un choix délibéré ou d’un choix par défaut.
Rapporté à son volume, le groupe le plus représenté dans le logement social est celui formé par les immigrés et descendants d’immigrés en provenance de l’Afrique sahélienne (Sénégal, Mauritanie, Mali, Niger…). 57% d’entre eux sont locataires d’un logement HLM, et les descendants de la génération précédente le sont encore à 63%31. Dans ce groupe, par ailleurs, plus de la moitié des majeurs habitent encore chez leurs parents. À l’intérieur de cet ensemble, ce sont les immigrés maliens et sénégalais qui sont les plus représentés. Le sous-groupe des Maliens, non compris les Français d’origine malienne, détient 98000 cartes de séjour32. Il s’est constitué à partir d’une migration de jeunes adultes, d’abord logés en foyers de travailleurs migrants, pour l’essentiel en Île-de-France. Dans ce sous-groupe, les familles nombreuses sont la règle et la polygamie demeure à l’état résiduel. Le deuxième sous-groupe est celui des Sénégalais (96.000 cartes de séjour en circulation).
Le deuxième groupe représenté dans le logement social, en proportion de son volume, est celui des immigrés de l’Afrique guinéenne ou centrale (Guinée, Côte d’Ivoire, Cameroun, République démocratique du Congo, Gabon…). 52% d’entre eux en sont locataires. Les descendants de la génération précédente s’y trouvent encore à 47%. Plus de la moitié des majeurs habitent chez leurs parents. Dans ce groupe, les Ivoiriens disposent de 91.000 cartes de séjour, les ressortissants de la République démocratique du Congo de 78.000 et les Camerounais de 66.000.
Les populations de l’Afrique non-maghrébine privilégient ainsi la location en HLM (57% des locataires en HLM sont issus de l’Afrique sahélienne et 52% sont issus de l’Afrique guinéenne et centrale). Cette appétence s’explique à la fois par l’adaptation relative du logement social aux familles nombreuses et par l’image positive que ces populations ont du logement collectif, associé, dans les pays d’origine, à la modernité, au confort, voire au luxe.
Le troisième groupe en proportion, mais de loin le plus important en volume, est celui des immigrés algériens. La moitié d’entre eux habitent en HLM et 44% des descendants des immigrés de la génération précédente y vivent encore. Le quart des majeurs vivent toujours chez leurs parents lorsque ceux-ci sont descendants d’immigrés. Ce groupe doit être considéré de manière particulière car les Algériens représentent, depuis l’indépendance de leur pays, le premier volume de l’immigration en France. En 2020, ce groupe cumulait 611.000 titres de séjour. La diaspora algérienne en France compte entre 2,5 et 3 millions de ressortissants, disposant pour la plupart de la double nationalité.
Le quatrième groupe en proportion est celui constitué par les immigrés marocains et tunisiens. 44% de ces immigrés vivent en HLM ; 38% des enfants de la génération précédente y sont encore. 34% des majeurs vivent chez leurs parents lorsque ceux-ci sont descendants d’immigrés. Les Marocains représentent le deuxième volume d’immigration, après les Algériens. Il est impossible de distinguer dans ce groupe les Marocains des Tunisiens, mais ces derniers étant plus souvent commerçants, il est probable qu’ils sont moins souvent locataires en HLM.
Ces proportions, s’agissant d’une population de plusieurs millions de personnes, issues pour une part d’une immigration ancienne, semblent témoigner d’une forte réticence à quitter le logement social. Plusieurs raisons pourraient expliquer ce phénomène : le refus de s’ancrer, par un achat, dans le pays d’accueil, l’opportunité économique offerte par le faible montant des loyers résiduels pour investir dans le pays d’origine ou le désir de demeurer regroupés en communautés dans de mêmes espaces de vie. Nous y reviendrons.
Les groupes suivants présentent des comportements très différents. Seuls 39% des ménages venus de Turquie ou du Moyen Orient vivent en HLM, quand ceux issus de la génération précédente ne le sont qu’à 27%. Dans ce groupe, les ressortissants turcs sont de loin les plus nombreux (215.000 cartes de séjour). Seules 14% des familles originaires d’Asie du Sud-Est sont locataires en HLM et 13% des descendants d’immigrés de la génération précédente. Quant aux populations venues de Chine, elles ne sont que 8% à vivre dans un logement social, quand les descendants de la génération précédente y sont presque absents. Les ressortissants chinois disposent pourtant de 114.000 cartes de séjour et forment la cinquième nationalité représentée en France.
Ces comparaisons semblent indiquer que la part prise par chacune des communautés étrangères au sein du secteur HLM ne résulte pas toujours d’un choix dicté par des considérations économiques. Interviennent aussi dans ce choix des calculs d’opportunité et/ou des modes de valorisation sociale.
La concentration de l’habitat social
L’hyperconcentration des immeubles HLM dans les mêmes espaces a généré en France des structures urbaines particulières que nous appelons « quartiers » par défaut, mais que nous pourrions tout aussi bien appeler « ville » eu égard à leur taille. C’est en particulier le cas des 1.500 quartiers dits « quartiers prioritaires de la politique de la ville » (QPV), dont beaucoup comptent plus de 10.000 habitants et certains plus de 20.000, c’est-à-dire autant que nombre de villes moyennes en France. Mais la comparaison s’arrête là, car si les villes moyennes disposent de tous les attributs de la démocratie locale, tel n’est pas le cas de ces « quartiers ». La représentation politique y est résiduelle, voire inexistante, les structures de concertation embryonnaires, les propriétaires méconnus et difficiles à joindre. Quant aux maires, ils ont été peu à peu écartés de la gestion du logement social et la disparition de la taxe d’habitation a supprimé le dernier lien qui attachait encore le locataire à sa commune.
Ces quartiers, d’une certaine façon, sont abandonnés à eux-mêmes quand les centres-villes apparaissent, en comparaison, suradministrés. Le contrôle social y demeure lâche. Tous les quartiers ou presque ont subi la disparition des gardiens d’immeuble, la fermeture des postes de police, la disparition des conseils de quartiers et des associations de locataires et le recul des services à la population : la poste, la pharmacie ou la médecine de ville. Les plus impénétrables d’entre eux, pour des considérations d’urbanisme et/ou de réseau routier, ont facilité, dans la vacance de l’autorité publique, l’implantation d’activités illicites, jusqu’à devenir parfois de véritables « citadelles du crime ».
Même si la statistique publique peine à en rendre compte, ces quartiers concentrent plus que d’autres les populations d’origine extra-communautaire. Si l’on prend la catégorie des QPV, 23% des immigrés y résident, mais seulement 7% de l’ensemble de la population de 18 à 59 ans, et, parmi elle, 3% de la population française d’origine française. Ces résidents sont principalement originaires du Maghreb et de l’Afrique subsaharienne.
31% des immigrés originaires d’Algérie habitent dans un QPV, représentant 650.000 personnes, enfants compris. Si l’on ajoute à ce chiffre 24% des descendants de la génération précédente, estimée à 1,2 millions d’individus, soit 300.000 personnes, on comprend que la population d’origine algérienne approche le million de personnes dans ces quartiers, qui comptent au total 5,4 millions d’habitants. Ces chiffres remettent en cause l’image qu’en donnent les acteurs de terrain, qui décrivent le remplacement progressif des populations maghrébines par des populations originaires d’Afrique subsaharienne. Si ces dernières sont plus visibles dans l’espace public, le socle de la population des quartiers demeure majoritairement maghrébin.
Ces évolutions, qui renforcent la concentration des mêmes populations dans les mêmes espaces, ne manquent pas d’interroger la pertinence du modèle français de logement social, car elles contredisent l’objectif affiché de mixité sociale, en spécialisant les territoires. Il existe ainsi une corrélation entre le pourcentage des logements sociaux et celui des familles étrangères, même à l’échelle des départements : la Seine-Saint-Denis (1,6 millions d’habitants), longtemps animée par des communes communistes très pro-actives en matière de logement social, compte ainsi 189.000 logements sociaux et environ 510.000 immigrés, quand les Yvelines (1,4 millions d’habitants), ne comptent que 110.000 logements sociaux et 200.000 immigrés.
Quartiers HLM et désordres sociaux
Si l’on ne peut faire du logement social la cause des désordres qui affectent la tranquillité publique et l’économie de la France, force est de constater qu’une grande partie de ces désordres (émeutes urbaines, rixes entre bandes, délinquance de voie publique, trafic de produits stupéfiants) ont pour décor les grands ensembles d’immeubles HLM. L’État a d’ailleurs confirmé leur « dangerosité » en y créant ses 80 zones de sécurité prioritaire (ZSP). Ces ZSP appartiennent elles-mêmes à l’ensemble des 1.500 QPV, qui font l’objet d’une attention toute particulière. Si les pouvoirs publics, pour ne pas stigmatiser ces quartiers, n’ont jamais voulu fonder la politique de la Ville sur des considérations d’ordre public, préférant utiliser le critère de la pauvreté, il est évident que, depuis 1981 et les premières émeutes urbaines, ce sont toujours ces mouvements de violence collective qui déclenchent l’intervention de l’État, les derniers en date n’échappant pas à cette logique.
Le degré de violence qui règne dans le quartier, en l’absence de toute communication des pouvoirs publics, est intuitivement mesuré par la population. Leur « mauvaise réputation » n’est un mystère pour personne. Elle accentue le phénomène de concentration des populations : les familles « paisibles » quittent le quartier et l’abandonnent à des comportements sans cesse plus violents. Paradoxalement, c’est aussi l’insécurité qui a justifié la fermeture des services essentiels à la population : commissariat, centre social, mairie annexe, médiathèque. La plupart des établissements scolaires de ces quartiers sont par ailleurs classés en réseaux d’éducation prioritaire, REP ou REP+.
Il est difficile de dire, faute de données, la part prise par les populations extracommunautaires à ces troubles. La difficulté est d’autant plus grande que le seul critère d’appréciation est celui de la nationalité. Or, la plupart des adolescents mis en cause sont français au titre des conditions d’accès anticipé à la nationalité française. Il est dommage que la statistique publique ne puisse établir des données fondées sur les doubles nationalités, alors même que les administrations diplomatiques étrangères (Maroc, Algérie, Turquie) en disposent. Les premières analyses conduites sur le profil des interpellés à la suite des émeutes de 2023 indiquent que plus des trois quarts des émeutiers étaient de nationalité française, le plus souvent originaires du Maghreb ou d’Afrique subsaharienne.
DES DISPOSITIONS AUX EFFETS INDESIRABLES ET/OU IGNORES
Le droit au maintien dans les lieux
Au titre du « droit au maintien dans les lieux »34, le locataire du secteur HLM dispose d’un bail à durée indéterminée. Cette disposition ancre les locataires dans leur quartier pour une durée très longue, parfois sur plusieurs générations. Elle favorise le « patriotisme » de quartier au détriment d’une insertion dans l’espace de vie de la commune. Elle enferme les plus jeunes dans une forme d’appropriation territoriale qui, dans ses effets les plus violents, pourrait être qualifiée de « tribale ». D’une certaine façon, c’est ce mécanisme qui, empêchant l’éviction des fauteurs de trouble, finit par renforcer les réseaux criminels en chassant de leur quartier les familles désireuses de vivre en paix.
Le bailleur ne peut résilier le bail qu’en cas d’impayé de loyer, de troubles de voisinage, de revenus nouveaux, de sous-location ou de résidence inférieure à huit mois dans l’année. Ces hypothèses sont surtout théoriques, sauf en ce qui concerne les impayés de loyer. Mais, même dans cette hypothèse, la réalisation effective de l’expulsion n’est jamais sûre, car le préfet peut décider de ne pas donner suite à la décision du juge, une compensation étant alors offerte au bailleur, financée par des crédits du ministère de l’Intérieur. Le second motif (les troubles de voisinage) est en partie neutralisé par l’obligation faite au bailleur, en vertu de la loi DALO exposée plus bas, de reloger le locataire indélicat. Les autres motifs sont rarement utilisés, parce que les moyens de contrôle sont limités et que l’omerta qui règne dans nombre de ces quartiers retiendrait des voisins de dénoncer le locataire indélicat. La sous-location, par exemple, est manifestement répandue, sans être poursuivie.
L’illusion de la mixité sociale
Les institutions publiques pensent remédier à la paupérisation ou à la criminalisation des quartiers en favorisant la « mixité sociale », dont personne ne sait dire s’il s’agit d’une mixité des revenus ou d’une mixité ethnique, linguistique ou religieuse. Dans leur esprit, le brassage des origines et des modes de vie doit contribuer à faire baisser les tensions entre les groupes. Mais cette vision de la société heurte l’aspiration des familles qui souhaitent vivre, elles, dans des espaces homogènes, quitte à reconstituer des communautés soudées par des solidarités de voisinage et des références culturelles partagées35.
Dans les faits, la recherche de la mixité sociale se traduit d’abord par la duplication, à une échelle plus petite, des mêmes types de quartiers, car, même s’il existe quelques contre-exemples réussis – à travers, par exemple, la reprise de logements anciens dans des centres-villes – les bailleurs sociaux n’ont souvent pas d’autre choix, pour des raisons de coût, que de proposer un habitat sous forme d’immeubles collectifs dans des lieux délaissés du tissu urbain.
La loi SRU a exigé que toutes les communes urbaines disposent d’un pourcentage de logements sociaux établi à 25%. L’obligation est assortie d’un mécanisme d’amende particulièrement contraignant. Le caractère résolument « punitif » de la mesure, relayé par la presse, vise les communes considérées comme « trop riches ». La loi n’a pas exigé, en revanche, d’équilibrer le surcroît de logements sociaux que l’on trouve en Seine-Saint-Denis ou dans le Val-de-Marne en y promouvant la construction de résidences privées. Ce pourcentage des 25% n’est assis sur aucune justification explicite et son bilan n’a jamais été établi. L’objectif est pratiquement impossible à réaliser dans des milieux urbains denses où le prix du foncier ne permet pas d’équilibrer les opérations. Dans le même temps et de manière paradoxale, plus de 60% des Français, selon les déclarations du ministère du Logement, pourraient prétendre à un logement HLM, dès lors qu’ils disposent de revenus inférieurs aux plafonds en vigueur.
Le droit au logement opposable
La loi instituant le droit au logement opposable, votée le 7 mars 2007, a introduit des « coupe-files » discriminants dans l’attribution des logements, qui ont manifestement accentué la paupérisation du secteur. La loi a ainsi déterminé une catégorie de demandeurs prioritaires et confié aux préfets l’obligation – assortie d’un mécanisme de condamnation – d’user de cette priorité37. Les priorités concernent les personnes « dépourvues de logement, menacées d’expulsion sans relogement, hébergées ou logées temporairement, logées dans des locaux insalubres ou dangereux ou logées avec un enfant mineur ou une personne handicapée dans des locaux suroccupés ». Seuls les étrangers en situation régulière peuvent y prétendre. Depuis 2008, entre 30.000 et 40.000 demandes sont déposées à ce titre chaque année. Si l’on croise ces critères avec ceux relatifs à la situation familiale (priorité donnée aux femmes seules avec enfants), il est évident que la mesure favorise les familles monoparentales, dont beaucoup sont d’origine étrangère. On trouve de manière paradoxale dans cette liste les familles qui ont fait l’objet d’une mesure d’expulsion pour troubles graves à l’ordre public, que le préfet est contraint de reloger, contre toute attente, dans le parc HLM.
L’instrument juridique qui permet d’imposer le choix du préfet est le « contingent préfectoral », alimenté par 30% de toutes les nouvelles constructions (5% étant réservés aux fonctionnaires et aux militaires). Ce contingent préfectoral recoupe le parc des PLAI. Le mécanisme est d’une telle efficacité que la Première ministre a demandé aux préfets39, à l’issue d’un CIV tenu en octobre 2023 à Chanteloup-les-Vignes, d’y déroger, en installant les familles les plus précaires en dehors des quartiers prioritaires.
La prise en charge des familles monoparentales
Les travaux réalisés sur le profil des émeutiers interpellés lors des évènements de juin-juillet 2023 révèlent la surreprésentation d’individus masculins vivant dans des familles monoparentales. Ils confortent des travaux menés antérieurement sur le même sujet. Le profil de ces familles est bien connu : une mère de famille seule, salariée, qui vit avec plusieurs enfants, les pères étant absents ou disparus et ne contribuant pas à l’entretien des enfants. On peut inclure dans ce groupe les épouses de familles polygames « décohabitantes ». Les garçons de ces familles sont élevés en l’absence de toute référence paternelle et, dans l’école, qui reste leur principal lieu de socialisation, les enseignants sont majoritairement des femmes. À la marge, ce type d’organisation familiale a pu être encouragé par des politiques sociales qui accordent des droits spécifiques aux mères isolées. En tout état de cause, la plupart de ces familles vivent sous le seuil de pauvreté et les dispositifs sociaux de proximité (aide à la parentalité) ont presque tous disparu, remplacés par des prestations financières. Les familles monoparentales occupent 23% des logements sociaux.

Les concentrations ethnico-religieuses
Les grands quartiers d’habitat social abritent aujourd’hui le plus grand nombre de lieux de culte, en particulier de lieux de culte musulman (mosquées), de toutes obédiences. Ces lieux de culte ont parfois été édifiés sur des terrains publics. Ils répondent à une demande de proximité des fidèles concentrés dans ces quartiers, mais ils accentuent le caractère communautaire du quartier, car les mosquées ne sont pas seulement des lieux affectés à la prière : elles sont aussi des lieux de vie associative, de solidarité et d’échanges, voire d’éducation. Pour cette raison, des demandeurs de logement sociaux peuvent chercher à rejoindre une communauté déjà constituée. C’est ce mécanisme qui a favorisé l’émergence de sous-quartiers pakistanais ou tchétchènes. Les concentrations fondées sur la culture d’origine engendrent par ailleurs l’émergence d’un commerce spécialisé, de proximité : restauration sans porc, boutiques de produits exotiques, coiffeurs « africains ». Leurs boutiques sont louées par les bailleurs sociaux. Les seuls commerces généralistes présents dans les « quartiers » sont les pharmacies.
Michel Aubouin, Ancien inspecteur général de l’administration et ancien secrétaire général de l’Institut des hautes études de la sécurité intérieure.