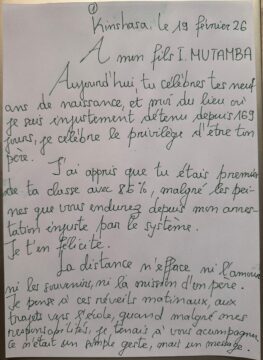Dire que l’information est la plupart du temps manipulée dans la quasi-totalité des pays du globe terrestre n’est guère une exagération. De l’Europe à l’Afrique, en passant par l’Asie les Amériques, des subterfuges sont utilisés à l’aide des nouvelles technologies de l’information et de la communication pour altérer la vérité des faits afin de servir des discours cousus de fil blanc à un public acquis à la cause de ces manipulateurs. de l’information rapport du Centre d’analyse, de prévision et de stratégie (CAPS) du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et de l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM) du ministère des Armées, Paris, août 2018. Pour avoir des éléments d’analyse et comprendre ce fait qui prend des aises dans la société sénégalaise, DakarTimes s’est penché sur un rapport produit par Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, Alexandre Escorcia, Marine Guillaume, et Janaina Herrera. Intitulé « Les manipulations de l’information : Un défi pour nos démocraties », l’étude publiée par le Centre d’analyse, de prévision et de stratégie (CAPS, rattaché au ministre de l’Europe et des Affaires étrangères), et l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM, un institut de recherche du ministère des Armées de la France), revient sur les manipulateurs de l’information, leurs objectifs, leurs cibles, etc.
L’enquête de Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, Alexandre Escorcia, Marine Guillaume, et Janaina Herrera est le produit d’une prise de conscience en deux temps du danger – existentiel – que les manipulations de l’information font peser sur nos démocraties. D’abord, les ingérences répétées qui se sont produites depuis 2014 (Ukraine, Bundestag, référendum néerlandais, Brexit, élection américaine) ont prouvé que les démocraties occidentales, même les plus grandes, n’étaient pas immunes. Ensuite, la tentative d’ingérence dans l’élection présidentielle française de 2017, avec l’affaire dite des « Macron Leaks », a achevé d’intéresser la France et nous a convaincus de l’importance d’étudier le sujet. Dans le rapport, les auteurs soulignent que « La manipulation – par production, rétention ou déformation – est aussi vieille que l’information, c’est-à-dire que la vie en société, puisqu’elle lui est consubstantielle. Elle est partie prenante des ruses de guerre, qui ont toujours existé. Avant la bataille de Qadesh en 1274 avant notre ère, par exemple, les Hittites auraient utilisé de fausses informations transmises aux Égyptiens, pour influer sur le sort du conflit. La manipulation de l’information est théorisée depuis l’Antiquité, au travers d’ouvrages comme l’Arthashâstra indien du IVe siècle avant notre ère, les Dialogues de Platon et la Rhétorique d’Aristote[1] ou
Des causes individuelles
S’adressant en même temps à l’individu et la masse, « la propagande moderne repose sur les analyses scientifiques de la psychologie et de la sociologie. C’est à partir de la connaissance de l’être humain, de ses tendances, de ses désirs, de ses besoins, de ses mécanismes psychiques, de ses automatismes, et aussi bien de la psychologie sociale que de la psychologie des profondeurs, que la propagande organise peu à peu ses techniques»
Les failles cognitives
La désinformation exploite une paresse intellectuelle naturelle, qui consiste à ne pas exercer son esprit critique de manière systématique, et à relayer des propos naïvement sans chercher à les étayer par des preuves. Les conspirationnistes demandent qu’on leur fournisse la preuve que leurs théories sont inexactes et farfelues, à rebours du travail journalistique. Comme le rappelle Emmanuel Macron, « la charge de la preuve est inversée : là où les journalistes doivent prouver sans cesse ce qu’ils disent – ce qui est l’éthique même de leur métier, ils doivent montrer qu’ils disent ou écrivent le vrai –, les propagateurs de fausses nouvelles crient à la face du monde : “À vous de prouver que nous avons tort !” ».
Nous avons tous tendance à privilégier les informations qui confirment nos hypothèses, nous confortent dans nos positions, et ne heurtent pas nos sensibilités : ce phénomène psychologique est communément appelé « biais de confirmation ». En publicité, cette faille est bien connue et exploitée : le succès d’une campagne publicitaire peut reposer sur l’engagement et la consistance d’un individu, c’est-à-dire sa tendance à rester fidèle à une opinion déjà formée.
Ensuite, les humains ont tendance à croire avec certitude, c’est-à-dire en surestimant « leurs capacités de mémoire et de raisonnement, bref à se croire plus rationnels et plus intelligents qu’ils ne le sont en fait». Dans ce contexte, « l’idée répandue selon laquelle le raisonnement vise à atteindre la vérité, de bonnes décisions, et doit être impartial et objectif » est fausse. Comme le rappelle Pascal Engel, « le raisonnement n’a pas évolué en vue d’établir la vérité, mais uniquement en vue de l’emporter sur nos adversaires : nous ne raisonnons que pour argumenter dans le cadre d’un jeu social où nous favorisons systématiquement notre propre point de vue et nos intérêts ». Les manipulations de l’information sont aussi naturelles que nos vulnérabilités à leur égard.
Une étude récente montre également que les fausses nouvelles se propagent plus vite que les vraies, pour des raisons psychologiques[1] : d’une part, les vraies nouvelles sont souvent moins nouvelles, elles ne font que confirmer ce que l’on savait déjà, ou que l’on suspectait, elles contribuent à l’accumulation du savoir, elles sédimentent. Tandis que les fausses nouvelles surprennent, elles sont rédigées pour être surprenantes, aller à l’encontre de la doxa. La nouveauté de la fausse nouvelle non seulement suscite un plus grand intérêt du plus grand nombre, mais aussi explique leur plus grande diffusion de la part de personnes voulant apprendre quelque chose aux autres (dimension réputationnelle, statut social, etc.). D’autre part, elles sont taillées pour la viralité, elles sont rédigées dans un style spectaculaire, émotionnel, souvent alarmiste, elles jouent sur la peur, les angoisses, alors que ce n’est généralement pas la priorité des vraies nouvelles. Ce sont donc nos biais cognitifs qui contribuent en grande partie à la diffusion des fausses nouvelles.
La recherche en publicité identifie d’ailleurs plusieurs failles cognitives que le bon publicitaire peut exploiter : non seulement la consistance de l’individu (biais de confirmation) mais aussi la preuve sociale (l’individu va faire ce qu’il pense que les autres font), l’autorité (il tend à obéir à des figures d’autorité, même quand elles demandent l’accomplissement d’actes condamnables), l’illusion de corrélation (il établit une relation entre deux événements temporellement proches) ou encore les préférences (il est plus aisément convaincu par les personnes qu’il apprécie)
Des causes individuelles
S’adressant en même temps à l’individu et la masse, « la propagande moderne repose sur les analyses scientifiques de la psychologie et de la sociologie. C’est à partir de la connaissance de l’être humain, de ses tendances, de ses désirs, de ses besoins, de ses mécanismes psychiques, de ses automatismes, et aussi bien de la psychologie sociale que de la psychologie des profondeurs, que la propagande organise peu à peu ses techniques»

encore, plus récemment, L’Art de persuader de Pascal (1660) ou L’Art d’avoir toujours raison d’Arthur Schopenhauer (1830). L’historien Robert Darnton montre comment ces fausses nouvelles ont bénéficié du développement de la presse écrite, notamment les brochures sensationnalistes françaises (« canards » parisiens) et anglaises aux XVIIe et XVIIIe siècles. »
Pourquoi, parle-t-on de manipulation de l’information ?
Les failles cognitives
La désinformation exploite une paresse intellectuelle naturelle, qui consiste à ne pas exercer son esprit critique de manière systématique, et à relayer des propos naïvement sans chercher à les étayer par des preuves. Les conspirationnistes demandent qu’on leur fournisse la preuve que leurs théories sont inexactes et farfelues, à rebours du travail journalistique. Comme le rappelle Emmanuel Macron, « la charge de la preuve est inversée : là où les journalistes doivent prouver sans cesse ce qu’ils disent – ce qui est l’éthique même de leur métier, ils doivent montrer qu’ils disent ou écrivent le vrai –, les propagateurs de fausses nouvelles crient à la face du monde : “À vous de prouver que nous avons tort !” ».
Nous avons tous tendance à privilégier les informations qui confirment nos hypothèses, nous confortent dans nos positions, et ne heurtent pas nos sensibilités : ce phénomène psychologique est communément appelé « biais de confirmation ». En publicité, cette faille est bien connue et exploitée : le succès d’une campagne publicitaire peut reposer sur l’engagement et la consistance d’un individu, c’est-à-dire sa tendance à rester fidèle à une opinion déjà formée.
Ensuite, les humains ont tendance à croire avec certitude, c’est-à-dire en surestimant « leurs capacités de mémoire et de raisonnement, bref à se croire plus rationnels et plus intelligents qu’ils ne le sont en fait». Dans ce contexte, « l’idée répandue selon laquelle le raisonnement vise à atteindre la vérité, de bonnes décisions, et doit être impartial et objectif » est fausse. Comme le rappelle Pascal Engel, « le raisonnement n’a pas évolué en vue d’établir la vérité, mais uniquement en vue de l’emporter sur nos adversaires : nous ne raisonnons que pour argumenter dans le cadre d’un jeu social où nous favorisons systématiquement notre propre point de vue et nos intérêts ». Les manipulations de l’information sont aussi naturelles que nos vulnérabilités à leur égard.
Une étude récente montre également que les fausses nouvelles se propagent plus vite que les vraies, pour des raisons psychologiques[1] : d’une part, les vraies nouvelles sont souvent moins nouvelles, elles ne font que confirmer ce que l’on savait déjà, ou que l’on suspectait, elles contribuent à l’accumulation du savoir, elles sédimentent. Tandis que les fausses nouvelles surprennent, elles sont rédigées pour être surprenantes, aller à l’encontre de la doxa. La nouveauté de la fausse nouvelle non seulement suscite un plus grand intérêt du plus grand nombre, mais aussi explique leur plus grande diffusion de la part de personnes voulant apprendre quelque chose aux autres (dimension réputationnelle, statut social, etc.). D’autre part, elles sont taillées pour la viralité, elles sont rédigées dans un style spectaculaire, émotionnel, souvent alarmiste, elles jouent sur la peur, les angoisses, alors que ce n’est généralement pas la priorité des vraies nouvelles. Ce sont donc nos biais cognitifs qui contribuent en grande partie à la diffusion des fausses nouvelles.
La recherche en publicité identifie d’ailleurs plusieurs failles cognitives que le bon publicitaire peut exploiter : non seulement la consistance de l’individu (biais de confirmation) mais aussi la preuve sociale (l’individu va faire ce qu’il pense que les autres font), l’autorité (il tend à obéir à des figures d’autorité, même quand elles demandent l’accomplissement d’actes condamnables), l’illusion de corrélation (il établit une relation entre deux événements temporellement proches) ou encore les préférences (il est plus aisément convaincu par les personnes qu’il apprécie)
Lutter efficacement contre les manipulations de l’information implique d’abord d’identifier les racines du problème. Elles sont multiples et c’est précisément l’une des difficultés : il y a des causes individuelles, liées à la nature humaine, relevant donc de la psychologie et de l’épistémologie, des failles cognitives et une crise de la connaissance qui nous rendent particulièrement vulnérables aux manipulations de l’information. Il y a aussi des causes collectives, liées à la vie en société, une crise de confiance dans les institutions, une crise de la presse et une désillusion à l’égard du numérique : internet devait nous libérer, et il nous enferme. Après avoir analysé chacune de ces causes, nous verrons qui en profite, c’est-à-dire qui sont les acteurs des manipulations de l’information, en nous focalisant sur les États.
Les manipulations de l’information prolifèrent d’autant plus en temps de guerre – donc bénéficient d’autant plus de la « déspécification » de la guerre, de l’ambiguïté croissante entre temps de guerre et temps de paix – que, comme l’avait bien relevé Marc Bloch en 1921 dans un article analysant la prolifération des fausses nouvelles durant la Première Guerre mondiale, « l’émotion et la fatigue détruisent le sens critique » La censure joue également un rôle, puisqu’elle est plus forte dans ces moments de crise et qu’elle suscite toutes sortes de fantasmes.
La crise de confiance dans les institutions
Une enquête menée auprès de plus de 33 000 personnes dans 28 pays en novembre 2017 a montré que la méfiance à l’égard des institutions s’accroît, que les médias sont désormais l’institution en laquelle la confiance est la moindre, que la confiance dans les plateformes (médias sociaux) décroît mais que celle dans le journalisme s’accroît, et que quasiment 70 % de la population s’inquiète de l’usage de fausses nouvelles comme arme, ce pourcentage étant le plus élevé au Mexique, en Argentine, Espagne et Indonésie (76-80 %) et le moins élevé – quoique toujours majoritaire – en
France, Suède et Pays-Bas (55-60 %). Or, « de quoi les fausses nouvelles en circulation nous parlent-elles ? Elles traitent de la trahison des élus, de la confiscation de la parole par les médias, d’un certain nombre d’angoisses liées à la mondialisation. En ce sens, les fake news sont également l’expression d’une défiance virulente à l’égard des élites politiques et intellectuelles ».
Les manipulations de l’information sont à la fois une cause et un symptôme de la crise de la démocratie, incarnée par une abstention croissante aux élections et une défiance de l’opinion à l’égard des élus, voire une remise en cause des valeurs démocratiques et libérales. La dépréciation de la vérité est l’une des manifestations de cette crise de confiance, en même temps qu’elle l’entretient.

La crise de la presse
Ce qu’il est convenu d’appeler la crise de la presse s’exprime généralement d’au moins deux manières : une crise du modèle économique et une crise des normes. La crise du modèle économique est ancienne et principalement due à la baisse des revenus publicitaires de la presse concurrencée d’abord par la télévision, puis par internet. Le passage au numérique ne compense pas automatiquement dans la mesure où la publicité numérique est moins rémunératrice que l’imprimée et la télévisuelle. Beaucoup d’agences et d’organes de presse ont donc dû licencier un certain nombre de journalistes, les plans sociaux s’enchaînent et certains titres ferment. Cette précarité les rend plus vulnérables aux manipulations de l’information, puisqu’il y a moins de personnes et de temps pour les détecter, et unprimat de la quantité sur la qualité.
De nouveaux modèles économiques s’inventent toutefois, dont le payant, sur abonnement, et la diversification des sources de revenus (en investissant aussi l’événementiel, par exemple) – avec parfois des succès qui convainquent que la presse est peut-être davantage « dans une situation de réinvention qu’en crise ». Le cas du New York Times est exemplaire, avec plus d’un milliard de dollars de recettes en 2017 grâce à ses abonnements.
Quant à la crise des normes, elle est principalement due à l’essor des médias sociaux (voir infra), dont le pouvoir égalisateur permet à n’importe qui de diffuser des informations qui ne respectent pas les standards journalistiques, et de propager des discours parfois extrêmes et haineux, comme le font les trolls (voir infra). Là aussi, toutefois, il y a des raisons d’espérer, car ces excès créent une fatigue de la population et poussent les médias sérieux désireux de montrer leur valeur ajoutée à développer davantage de normes (voir infra) et à valoriser l’investigation, des enquêtes longues, poussées, parfois collaboratives.
La désillusion numérique
Les manipulations de l’information ont toujours existé mais ont connu trois accélérations dues à des innovations techniques : l’imprimerie, les médias de masse et internet. Cette dernière phase a elle-même connu une accélération encore plus spectaculaire depuis un peu plus d’une décennie, avec les médias sociaux.
La révolution numérique – surtout depuis la généralisation du haut débit, c’est-à-dire une quinzaine d’années – et le développement conséquent des réseaux sociaux numériques (MySpace 2003, Facebook 2004, Twitter 2006) ont changé la donne. Omniprésents dans la vie de milliards d’individus (Facebook a plus de 2 milliards d’utilisateurs actifs depuis juin 2017, YouTube 1,5 milliard, Instagram 700 millions et Twitter 328 millions), les réseaux sociaux sont utilisés comme source d’information pour 62 % des adultes américains et 48 % des Européens. Google et Facebook concentrent désormais plus de 70 % du trafic web, ce qui signifie que les autres sites, dont des entreprises de presse, tirent l’essentiel de leur audience de ces plateformes, devenues des portiers du web. Elles génèrent du même coup des revenus publicitaires colossaux.
Dans un premier temps, cette croissance des réseaux sociaux et plus généralement du web 2.0, des blogs, du journalisme citoyen, a pu faire croire à un moment d’émancipation du peuple face aux États – comme l’ont incarné les « printemps arabes », au risque de certaines caricatures (on parlait alors de « révolution Facebook » ou « révolution Twitter »). La désillusion est venue quelques années plus tard, d’abord avec l’affaire Snowden (2013) qui a révélé (ou confirmé) que les États n’avaient pas perdu la main, puis avec une série d’interférences dans des processus démocratiques à partir de 2016 (référendum néerlandais sur l’accord d’association entre l’Ukraine et l’UE, Brexit, élection présidentielle américaine, élection présidentielle française).
Le développement exponentiel des plateformes numériques a considérablement accru le risque de manipulations de l’information de plusieurs manières : par la surabondance d’informations, « infosaturation » ou « infobésité ». « L’Américain moyen est désormais exposé à cinq fois plus d’informations qu’en 1986.» Or, la surcharge d’information contribue à la désinformation via la déconcentration, qui affaiblit notre vigilance et notre capacité d’envisager des réfutations. Ce n’est au fond que l’application aux réseaux sociaux d’une thèse bien connue des psychologues dans le monde physique : trop d’informations nuit à la prise de décision par le nombre de vecteurs disponibles pour diffuser la fausseté (potentiellement autant qu’il y a d’utilisateurs de ces réseaux, c’est-à-dire plusieurs milliards) ; la plus grande précision de la segmentation et du ciblagede la population (micro-targeting) – les cibles les plus vulnérables étant les jeunes (17-25 ans) – ; le faible coût de cette diffusion (quelques clics, quelques minutes) et la démocratisation de l’apparence journalistique (facile de faire un blog, une page, un site, d’allure professionnelle) ; l’horizontalité des médias sociaux permettant à chacun de diffuser des contenus à tout le monde sans passer par des instances de contrôle éditorial ; le fait qu’internet n’ait pas de frontière, et donc que des puissances étrangères puissent facilement y infiltrer des communautés et y répandre de fausses nouvelles ; le progrès technique dans l’édition de contenus photo, vidéo, audio qui sont de plus en plus proches de la réalité, donc moins détectables.
Comme le résume Ben Nimmo, « la diffusion des technologies de publication numérique a rendu plus facile de créer de fausses histoires ; internet a rendu plus facile de les publier ; et les réseaux sociaux de les diffuser ». Déjà en 2005, avant l’essor des principaux réseaux sociaux numériques, on pouvait écrire que « chacun est un reporter ». Cette tendance n’a fait que s’accentuer.
La vitesse de propagation s’est ainsi considérablement accrue. Il a fallu quasiment quatre ans au KGB pour diffuser globalement la rumeur selon laquelle le virus du sida était une création du Pentagone (la fausse nouvelle est plantée dans un journal indien en 1983 mais n’atteint la presse soviétique qu’en 1985 puis les médias occidentaux en 1987). Aujourd’hui, les réseaux sociaux réduisent ce temps à quelques minutes ou quelques heures, comme le montre l’exemple des « Macron Leaks » (voir infra). On pourrait croire qu’il ne s’agit que d’un changement d’échelle. Mais, comme l’a déclaré le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, « il est des domaines, comme celui de l’information, où le changement d’échelle constitue en réalité un changement de nature ».
Qui manipule l’information et pourquoi ?
Les vulnérabilités identifiées dans les pages précédentes constituent un terreau favorable aux manipulations de l’information. À elles seules, cependant, elles n’expliquent pas la situation actuelle : ce terreau est utilisé par des acteurs qui perçoivent ces vulnérabilités comme des opportunités pour défendre leurs intérêts stratégiques. Qui sont-ils ? Ils sont extrêmement divers, de l’individu plus ou moins isolé à l’État en passant par des groupes non étatiques et des entreprises. Tous les types d’acteurs manipulent l’information. Le présent rapport se concentre sur un certain type de manipulation par un certain type d’acteur : les manipulations de l’information d’origine étatique et ciblant la population d’un autre État, c’est-à-dire les ingérences. Nous commencerons toutefois par évoquer les autres situations.
Des acteurs non étatiques
Ce rapport s’intéresse aux acteurs non étatiques avant tout en tant qu’ils servent de relais, ou parfois d’aiguillon, aux manipulations de l’information d’origine étatique. Pour autant, les techniques de manipulations de l’information sont aussi utilisées par des acteurs non étatiques agissant pour leur propre compte et pour promouvoir leur propre agenda. Parmi ceux-ci, deux cas d’étude peuvent apporter des indications intéressantes : les groupes djihadistes, qui témoignent du rôle des manipulations de l’information dans les entreprises terroristes ; les communautés ethniques et/ ou religieuses qui, lorsqu’elles manipulent et/ou sont manipulées, fragilisent certains États, surtout en Asie et en Afrique. Le cas des mouvements nationalistes et/ou populistes au sein même de nos démocraties occidentales, qui ont joué un rôle dans le Brexit et l’élection de Donald Trump, et ont tenté d’influer sur la dernière élection présidentielle française, relève d’une logique un peu différente, dans la mesure où l’on observe une confluence de leur agenda avec celui d’acteurs étatiques. L’affaire dite des « Macron Leaks » faisant l’objet d’un chapitre distinct (voir infra), nous ne donnerons ici que des exemples des deux premières catégories.
Des groupes djihadistes : le cas de Daech
Les opportunités offertes par la sphère virtuelle pour mener des opérations terroristes avaient déjà été reconnues par Al-Qaïda. En 2005, Ayman al-Zawahiri déclarait : « Nous sommes dans une bataille, et plus de la moitié de cette bataille s’effectue dans les médias. Dans la bataille médiatique, nous luttons pour conquérir les cœurs et les esprits de notre Oumma [la communauté musulmane]» Dix ans plus tard, le Geneva Centre for Security Policy estimait que la campagne de Daech sur les médias sociaux lui avait permis d’attirer plus de 18 000 soldats étrangers, venant de plus de 90 pays. L’appareil propagandiste djihadiste constitue l’une des forces majeures du groupe à l’heure où ses forces armées sont battues en Syrie et en Irak.
La propagande mise en place par Daech est multidimensionnelle, multivectorielle et ciblée. Elle est multidimensionnelle tout d’abord car elle s’appuie sur une vision du monde manichéenne, simple et complotiste, visant à expliquer l’ensemble de la vie sociale. Les contenus médiatiques comprennent ainsi des cours d’histoire (réécrivant les accords Sykes-Picot, 44 la colonisation, l’intervention en Irak de 2003), des articles d’actualité (sur les actions de la coalition, l’Iran), des reportages type BBC présentés par John Cantlie, otage-reporter montrant par exemple les bonnes conditions de vie à Mossoul, mais aussi des cours de théologie, fondés sur une lecture extrémiste du texte religieux. Les thèses complotistes diffusées contribuent à l’établissement d’une grille de lecture séduisante pour les jeunes en crise d’identité, principales cibles du groupe Multidimensionnelle, la propagande de l’État islamique convoque à la fois des discours prétendument de vérité et des éléments émotionnels – combinaison qui permet l’acquisition d’une crédibilité discursive et la conquête « des cœurs et des esprits ».
La propagande de Daech est aussi multivectorielle. L’agence de communication de Daech, AMAQ, est très active. Mais le groupe communique également via son centre médiatique Al-Hayat et la « djihadosphère » a connu un développement notable depuis la proclamation officielle du califat en 2014. Désormais, l’État islamique possède non seulement des sites internet, forums de chat et revues en ligne, mais fait aussi une utilisation intensive des réseaux sociaux, blogs, messageries instantanées, sites de partage vidéo, Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, Tumblr, etc. Il est aussi actif sur Telegram et sur des forums spécialisés (terror forums), ainsi que sur le web profond (Darknet) où les opérations terroristes peuvent être préparées. Cette diversité des moyens de diffusion traduit également une diversité de formats : vidéos, articles, chansons, reportages, mèmes, etc. Les attentats de novembre 2015 à Paris ont ainsi été revendiqués via un communiqué officiel écrit, qui a également été repris en chanson, pour atteindre un public plus jeune. Ce faisant, l’État islamique bâtit un appareil propagandiste capable d’attirer des publics variés.
Ces publics font l’objet d’un ciblage méticuleux qui cherche avant tout à exploiter les vulnérabilités sociales, économiques, politiques et culturelles des sociétés visées. La multiplication des mèmes et vidéos terroristes le montre, les jeunes constituent la principale cible des thèses complotistes de l’État islamique, qui leur offre des réponses à des crises d’identité vécues localement, à l’heure d’entrer dans le monde du travail ou de se bâtir une identité d’adulte. Daech pratique le ciblage et l’individualisation à un niveau sans équivalent.
Des États
Face aux mouvements sociaux lancés par ou avec l’aide des plateformes numériques, en particulier Twitter et Facebook, les gouvernements autoritaires ont eu successivement deux réactions. La première a été une stratégie de la rareté informationnelle en censurant les contenus et en bloquant les accès, comme en témoignent de nombreux exemples au début des années 2000, de la Chine à l’Afrique du Nord en passant par le Moyen-Orient. Ils ont toutefois rapidement pris conscience du potentiel qu’offraient ces technologies en termes de surveillance et d’influence de leurs citoyens. La deuxième génération du contrôle de la population par internet a donc au contraire consisté à tirer profit de la surabondance informationnelle. Les États se retrouvent dans la position paradoxale d’utiliser aujourd’hui « les mêmes outils qu’ils considéraient auparavant comme une menace, pour déployer les technologies de l’information comme moyen de consolidation du pouvoir et de contrôle social, alimentant des opérations de désinformation et diffusant la propagande gouvernementale à une échelle sans précédent ».
Le dernier rapport annuel de l’ONG Freedom House sur la liberté en ligne montre que de plus en plus d’États manipulent l’information sur les médias sociaux, à l’aide de trolls, de bots ou de faux sites : l’ONG dénonce les actions de 30 gouvernements, contre 23 l’année précédente, et rappelle qu’en 2016 la manipulation en ligne et la désinformation ont joué un rôle important dans les élections d’au moins 18 États. Le cas des États-Unis était particulier en ce qu’il a révélé la manipulation d’un autre État, la Russie, pour défendre ses intérêts et son influence à l’étranger. Il existe en effet deux sortes de manipulations d’origine étatique : celles, les plus courantes, que l’État met en œuvre contre sa propre population, pour la contrôler ; et celles, qui nous intéressent plus spécifiquement ici, qu’il mobilise contre une population d’un autre État, et qui constituent donc des ingérences.
Les manipulations visant la population intérieure
Dans la plupart des cas, les gouvernements manipulent l’information donnée à leur propre population pour renforcer leur pouvoir, utilisant des techniques de contrôle surtout développées par la Chine et la Russie mais qui sont désormais devenues « un phénomène mondial » selon le président de Freedom House.
Le trolling est l’une de ces techniques, dont l’usage va croissant. On parle d’un « nouveau phénomène », défini comme « l’usage par les États de campagnes ciblées de haine et de harcèlement en ligne pour intimider et réduire au silence des individus critiquant l’État ». Les études de cas sont légion – non seulement en Russie et en Chine (la fameuse « armée des 50 cents », composée de plus de deux millions de personnes, poste près de 450 millions de commentaires par an) mais aussi en Iran (où les services de renseignement et les Gardiens de la révolution peuvent s’appuyer sur un réseau de 18 000 « volontaires » pour surveiller les réseaux sociaux), au Mexique (où l’on a parlé de Peñabots pour désigner les bots au service du président Enrique Peña Nieto), en Inde (le BJP, parti au pouvoir, aurait une « IT Cell »), au Vietnam (où le gouvernement a lancé en décembre 2017 une brigade connue sous le nom de « Force 47 » et composée de 10 000 cyberinspecteurs), en Argentine (le président Mauricio Macri est également soupçonné d’avoir recours à une « armée de trolls »), en Corée du Sud (une unité de guerre psychologique du Service national de renseignement aurait payé des millions de citoyens pour dénigrer le candidat libéral et soutenir la candidate conservatrice dans la campagne présidentielle 2012), en Turquie (où une armée de 6 000 « AK Trolls » – du nom du parti – aurait été formée par le régime en réaction aux manifestations de 2013) ou encore aux Philippines, où la campagne ayant conduit à l’élection de Rodrigo Duterte a été décrite comme un cas exemplaire de « trollage patriotique », une pratique définie comme « l’utilisation de campagnes de harcèlement et de propagande haineuse en ligne, ciblées et parrainées par un État dans le but précis de réduire au silence et d’intimider des personnes ». L’équipe de Duterte s’en prenait à toute personne les critiquant : « Les attaques brutales dirigées en ligne contre l’un ou l’autre citoyen, politicien ou journaliste, en vue d’en faire des exemples, ont eu un effet paralysant »– selon ce que la théorie de la communication appelle une « spirale du silence ».
Le trolling plus ou moins étatique (dépendamment du degré de contrôle de l’État sur les trolls) n’est que l’une des actions que peuvent mener les « cybertroupes », définies comme « des équipes du gouvernement, des armées ou des partis politiques dont la mission est de manipuler l’opinion publique via les médias sociaux ». Beaucoup d’États s’en sont dotés, y compris des États démocratiques, mais toutes ces structures ne sont évidemment pas comparables dans leurs activités.
L’objet du présent rapport n’est pas le recensement de l’ensemble des manipulations informationnelles mises en œuvre par des États contre leur propre population – c’est le rôle des ONG de défense des droits humains – mais d’analyser celles qui visent des populations étrangères et constituent donc des ingérences, en premier lieu contre nos démocraties.
Un écosystème médiatique vulnérable
L’une des raisons pour lesquelles les « Macron Leaks » ont échoué à avoir un effet sur l’élection présidentielle française de 2017 (voir infra) est que l’écosystème médiatique français est relativement sain. Nous entendons par là le fait que la population s’appuie surtout sur les médias traditionnels respectant des normes journalistiques, et moins qu’ailleurs sur les « tabloïds », beaucoup plus développés outre-Manche, ou les sites conspirationnistes qui prolifèrent dans d’autres pays. Les manipulateurs de l’information utilisent un arsenal diversifié : presse populiste, réseaux sociaux, sites de désinformation mais aussi les médias russes, qui peuvent s’appuyer sur une minorité russophone importante dans le pays visé, ou sur une traduction dans les langues locales. Leurs efforts ont d’autant plus de chances d’aboutir que le paysage médiatique est éclaté, avec des médias traditionnels faibles, suscitant la défiance d’une partie de la population, et une variété de vecteurs populistes et conspirationnistes.
Des institutions contestées
La première partie a montré comment la défiance à l’égard des institutions était l’une des causes essentielles de l’essor et de l’efficacité des tentatives de manipulation de l’information. Elle fait des institutions démocratiques et des politiques publiques des cibles faciles, en entretenant constamment le doute, soit sur un prétendu « agenda caché » des gouvernements, soit sur l’efficacité réelle de leur action.
Ainsi, l’un des narratifs propagés par les tentatives de manipulation dans les États baltes est celui selon lequel ces États seraient des États faillis, envahis par la corruption et qui ne seraient pas viables sans le soutien occidental. Ce narratif est d’autant plus dangereux que, comme dans toutes les démocraties, une frange de la population est critique et déçue par son gouvernement.
En Ukraine, le Kremlin se livre depuis 2014 à une remise en cause systématique des autorités, accusées d’inefficacité, de corruption, etc. À cet effet, des centaines de groupes thématiques ont été créés sur des réseaux sociaux contrôlés par Moscou (VKontakte était particulièrement actif jusqu’à son interdiction en mai 2017). Ces réseaux sociaux utilisent des symboles pro-ukrainiens et une rhétorique nationaliste appelant à l’organisation d’un troisième Maïdan.

L’AFRIQUE : UN TERRAIN DES MANIPULATIONS DE L’INFORMATION
Les pratiques de manipulation de l’information en Afrique connaissent quelques traits distinctifs : de même que l’histoire de la téléphonie a sauté une génération technologique pour atteindre l’ère du smartphone (et de tous ses réseaux sociaux), les chemins de la désinformation se sont greffés, adaptés et développés sur cette innovation accessible à tous. Les influenceurs(acteurs de ces réseaux sociaux qui peuvent émettre, valider et/ou rediffuser, à différents degrés, ces informations)jouent un rôle déformant et extrêmement prescripteur dans l’information populaire, dans des pays où l’information publique reste largement sujette à caution (par la qualité ou par le contrôle des médias).
Le prochain terrain de jeu de la « guerre informationnelle » russe ?
Plusieurs signaux indiquent que l’Afrique pourrait être le prochain terrain de jeu de la « guerre informationnelle » russe, d’autant que le français et l’anglais sont des vecteurs faciles pourpénétrer le continent africain. Les travaux d’une équipe de recherche française ont révélé une propagation croissante des contenus russes à travers le web africain francophone. Ce succès s’explique par plusieurs facteurs combinés. D’abord, la grande popularité des discours anti-occidentaux propagés par les grands médias internationaux russes (RT et Sputnik) auprès des opinions publiques africaines qui considèrent souvent la Russie sous le prisme de son passé soviétique anticolonial. Dans certains pays comme la Côte d’Ivoire, ces discours alimentent les débats politiques locaux. Ainsi les mouvements pro-Gbagbo trouvent dans les contenus produits par les médias russes des matériaux informationnels et des narratifs tout à fait opportuns. Le choix éditorial fait par RT et Sputnik de fortement médiatiser certains dossiers intéressant directement les opinions publiques africaines, comme celui touchant à l’avenir du franc CFA, aggrave naturellement les choses.
Un autre problème est la tendance de beaucoup de journaux et médias africains en ligne à reprendre in extenso les contenus des médias russes sur leurs sites aux côtés de dépêches des grandes agences occidentales telles que l’AFP ou Reuters. Cette tendance permet aux contenus russes de toucher une très large audience en étant vus par un grand nombre de personnes. Ainsi, au Sénégal, de nombreux articles de Sputnik concernant l’Afrique sont repris par seneweb.com, quatrième site le plus consulté au Sénégal et suivi par plus d’un million et demi de personnes sur Facebook.
Par ailleurs, les stratégies de marketing digital employées par les agences russes sur les réseaux sociaux (buzz, clickbait) se prêtent particulièrement bien au contexte africain, où de nombreux utilisateurs ont recours à Facebook comme source d’information. Les théories du complot et autres nouvelles sensationnalistes dont sont friands les médias russes leur permettent d’augmenter considérablement leur audience dans un continent où ce genre de presse à sensation est très populaire.
La fascination d’une partie de la jeunesse africaine pour la figure de
Vladimir Poutine auquel de nombreuses « fanpages » sont consacrées sur Facebook, et l’imaginaire de puissance militaire qui lui est associé, jouent également, tout comme la position de la Russie dans le conflit syrien, qui vient alimenter de très nombreux débats sur les réseaux sociaux au Maghreb (et plus particulièrement en Algérie).
Jusqu’à présent, l’activité des plateformes russes sur le continent africain n’était pas structurée, et leur popularité pouvait être considérée comme un effet collatéral des efforts déployés en direction de l’opinion publique française. Désormais, RT comme Sputnik envisagent d’étoffer leurs réseaux de correspondants en Afrique. Signe de cette nouvelle stratégie, la page Facebook de RT en français a vu son audience augmenter significativement (environ + 60 % de fréquentation) en janvier 2018. La très grande majorité des personnes à l’origine de cette augmentation sont des jeunes hommes du Maghreb et d’Afrique subsaharienne. Jusqu’à présent, aucun élément ne permet d’avancer s’il s’agit de vrais profils ou de bots.
Synthèse de Rokhaya D. KEBE