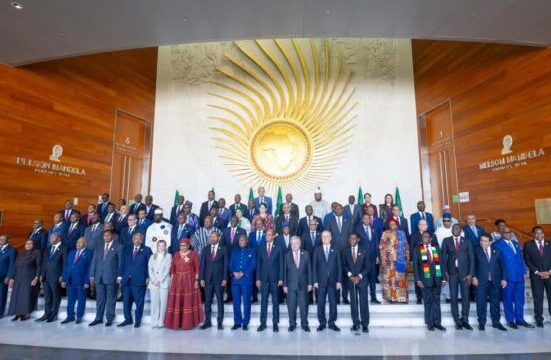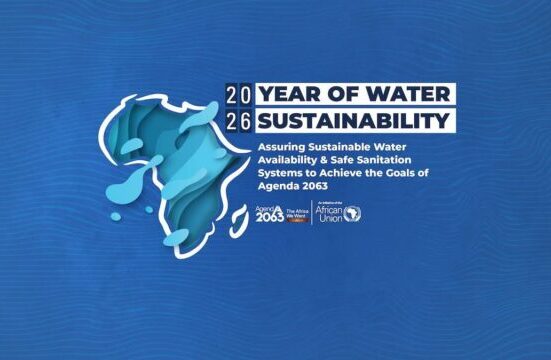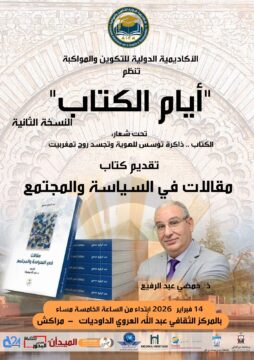Pour restaurer un semblant d’ordre dans cette partie de l’Afrique de l’Ouest, les autorités devront développer une compréhension plus subtile de conflits, qui ne se résument pas à une insurrection d’éleveurs.
Du Nigeria au Mali en passant par le Burkina Faso, le Niger ou le Tchad, les narratifs dominants sur le terrorisme assimilent régulièrement les Peuls à des éleveurs et à des jihadistes fanatiques. De telles représentations sont si stéréotypées qu’elles ont pu finir par donner une tournure ethnique à des conflits initialement présentés dans un registre religieux.
À la différence du Niger, qui a essayé de calmer le jeu en refusant de mobiliser des milices communautaires, la junte burkinabè a ainsi entrepris de combattre les insurgés en recrutant des Mossis dans des unités paramilitaires, les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP). Les violences y ont en conséquence pris plus d’ampleur qu’ailleurs, parfois sur le mode de l’épuration ethnique.
Des clichés qui perdurent
Les Peuls de l’Afrique sahélienne ne se réduisent pourtant pas à de simples nomades paupérisés et prêts à vendre leurs services au plus offrant. Historiquement, la plupart d’entre eux se sont sédentarisés en ville et n’ont plus grand-chose à voir avec les bergers des campagnes, qu’ils tendent plutôt à mépriser. De plus, les Peuls, ou Fulanis, comme on les appelle au Nigeria, n’ont nullement l’exclusivité des activités d’élevage. En effet, le cheptel s’est très largement reconstitué depuis la grande sécheresse sahélienne des années 1970. Aujourd’hui, la majeure partie du bétail est désormais entre les mains de cultivateurs sédentaires.
Dans la cuvette du lac Tchad, où sévit Boko Haram, les Peuls côtoient de nombreux groupes pastoraux : Arabes Shuwa ; Buduma Yedina ; Kanouris et Kanembu des clans Kwoyam, Badawi, Sugurti, Tummari, Kubri et Mobbar, etc. La situation est d’autant plus confuse que les langues utilisées localement ne permettent pas toujours d’identifier les appartenances ethniques. Ainsi, les Fulanis sédentarisés du nord-ouest du Nigeria ne parlent plus peul et se sont complètement assimilés aux Haoussas. À l’inverse, des communautés rurales s’expriment parfois en peul pour faire du commerce lorsqu’elles vont en ville vendre leur production agricole, à l’exemple des Dogons du centre du Mali.
Bien souvent, les récits sur les terroristes peuls reposent sur l’idée d’une sorte de « cinquième colonne » transhumant à travers des frontières poreuses et mal surveillées. Les autorités redoutent aussi les infiltrations de jihadistes parmi les populations déplacées par les conflits.
Des craintes amplifiées depuis que des militaires ont pris le pouvoir au Sahel et ont rompu les négociations autrefois engagées par leurs prédécesseurs avec les insurgés. Au Mali, par exemple, les Peuls sont encore plus dans le collimateur des autorités depuis la spectaculaire attaque contre l’aéroport de Bamako, préparée, en septembre 2024, par des jihadistes cachés dans un marché au bétail, près d’un site d’accueil de déplacés en provenance de régions aux mains de la katiba Macina.
Présomption de culpabilité
Les récits anxiogènes sur les nomades se nourrissent également de discours convenus et malthusiens à propos du réchauffement climatique, de la pression démographique et des compétitions foncières autour des couloirs de transhumance. À cela s’ajoutent des précédents historiques, car les grands jihads sahéliens du XIXe siècle ont effectivement été menés par des Peuls. Résultat, ces derniers sont en quelque sorte victimes d’une présomption de culpabilité, voire d’une prophétie autoréalisatrice, quand leur stigmatisation pousse certains d’entre eux à rejoindre les rangs des insurgés pour échapper aux sanglantes répressions des forces gouvernementales contre les populations civiles.
À la différence des jihadistes du centre du Mali et du nord du Burkina Faso, les éleveurs peuls du Nigeria ne constituent pourtant pas la base sociale de Boko Haram, qui a initialement recruté des citadins de Maiduguri, puis des paysans kanouris du Borno. Au contraire, les groupes pastoraux ont souvent été attaqués par une mouvance qui vit de rapine en volant les troupeaux de bétail de la région.
Les éleveurs peuls n’en sont d’ailleurs pas les seules victimes. Selon des entretiens menés sur place, les nomades Shuwa disent par exemple avoir déploré la mort de 1 900 membres de leur communauté, rien qu’entre 2014 et 2016. Des analyses plus fines permettent également de découvrir toute la diversité des origines sociales et ethniques des recrues de Boko Haram. La conclusion s’impose ainsi d’elle-même : pour restaurer un semblant d’ordre, les autorités devront développer une compréhension un peu plus subtile de conflits qui ne se réduisent sûrement pas à une insurrection d’éleveurs peuls.
Par Marc-Antoine Pérouse de Montclos, Directeur de recherches à l’Institut de recherche pour le développement (Pour Jeune Afrique)