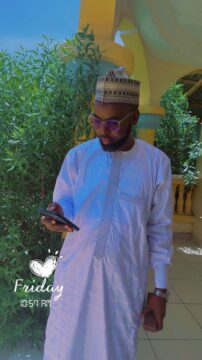Introduction.
« La Chine s’est installée en Afrique et compte bien y rester… Du Caire à Capetown, des îles de l’Océan indien au Golfe de Guinée, traversant les savanes et les montagnes, un vent nouveau venu d’Orient souffle sur l’Afrique[1].» John Colley.
« La présence chinoise en Afrique ne cesse de croître. Elle est devenue hégémonique et multidimensionnelle. La Chine n’est pas le seul acteur extérieur sur ce continent, mais elle domine dans plusieurs secteurs, dont celui des infrastructures. Ses prêts et ses échanges commerciaux y sont importants. Sa diplomatie y est proactive, son influence politique croissante et son action culturelle dynamique. Même dans le domaine de la sécurité, la Chine a commencé à poser sa marque, cherchant à devenir également dans ce domaine un partenaire incontournable.[2]» Jean-Pierre Cabestan, sinologue français, spécialiste du droit et des institutions du monde chinois contemporain, et, plus particulièrement de Taïwan.
« La Chine, en tant que grand pays responsable, promeut activement la réforme de la gouvernance mondiale et l’approfondissement de la solidarité et de la coopération entre les pays du Sud. (…) Le sommet de Pékin du Forum sur la coopération sino-africaine a été un franc succès.» Xi Jinping, président de la République populaire de Chine.
« L’Afrique et la Chine doivent maintenant et désormais œuvrer à la réalisation d’un nouveau modèle de coopération sud-sud au service du progrès économique et social et d’un ordre international plus juste et plus équilibré[3]». Aïssata Tall Sall avocate, ancienne Ministre des Affaires étrangères du Sénégal.
« La Chine est la centrale électrique dans l’économie globale. » Bruno PHILIPP[4].
Bref contexte historique des relations internationales en Afrique
Les relations internationales en Afrique sont d’une complexité fascinante, influencées par une mosaïque de facteurs historiques, politiques et économiques. En effet, les dynamiques des relations internationales en Afrique sont ancrées dans une histoire souvent tumultueuse, façonnée par des événements majeurs tels que les colonisations, les mouvements de décolonisation et la création d’organisations régionales et continentales[5]. Ces éléments ont laissé une empreinte indélébile sur la politique africaine et continuent d’influencer le développement du continent.
Les périodes de colonisation et de décolonisation ont eu un impact profond sur la structure politique et économique de l’Afrique. Durant la colonisation, les frontières actuelles ont souvent été tracées sans respect des divisions ethniques et culturelles, entraînant des conflits et des rivalités post-indépendance[6].
L’ère de la décolonisation, qui a débuté après la Seconde Guerre mondiale, a marqué la fin de l’emprise coloniale européenne. Les nations africaines nouvellement indépendantes ont dû naviguer dans un environnement international complexe, souvent en quête de stabilité et de reconnaissance internationale. Les efforts pour consolider la voix de l’Afrique sur la scène internationale se sont manifestés par la création de plusieurs organisations régionales et continentales. L’Organisation de l’unité africaine (OUA), fondée en 1963, et son successeur, l’Union africaine (UA), établie en 2002, sont parmi les plus influentes[7].
Ces organisations ont joué un rôle crucial dans la promotion de la paix, la sécurité et le développement économique en Afrique. Elles facilitent la coopération entre les membres, promeuvent les normes démocratiques et œuvrent pour la résolution des conflits interétatiques.
En outre, il faut dire que le continent africain a toujours été l’objet des convoitises et d’attraction des puissances occidentales. Cette convoitise est suscitée par la présence de nombreuses ressources naturelles et minières dont regorgent son sol et son sous-sol. De l’Afrique Australe, à l’Afrique Centrale, en passant par l’Afrique de l’Ouest, on remarque des nombreuses mutations, des transformations économiques énormes dues généralement à la présence des puissances émergentes appelées « BRICS » ou « BRICS[8] »+ ; particulièrement à une forte présence chinoise en Afrique subsaharienne. L’Afrique que l’on croyait mal partie selon René Dumont renait de ses cendres avec l’avenue de ce nouveau partenariat économique qui ne laisse personne indifférent[9].
C’est dans ce contexte que l’Afrique a décidé de varier et développer davantage des partenariats stratégiques avec des puissances comme le Brésil, l’Inde, la Russie et la République Populaire de la Chine sur laquelle cette modeste analyse est consacrée. Indéniablement, les relations entre l’Afrique et la Chine (République populaire de Chine – RPC) forment un faisceau majeur des relations internationales. Essentiellement dans le champ des relations dites « sud-sud », Pékin a développé de manière prioritaire une politique étrangère tous azimuts en direction de l’ensemble du continent[10].
Origine des relations sino-africaines
Les relations entre la Chine et l’Afrique datent de très longtemps. Certaines recherches semblent constater l’existence d’un échange culturel entre la Chine et l’Égypte depuis la dynastie Han[11], entre 206 av. J.-C. et 220 après. J.-C. (Li 2005 : 60[12]). Cependant, la naissance de ce qu’on peut qualifier de « politique africaine de la Chine » remonte au début des années 1950 au moment où, fait sans précédent depuis la chute du dernier empereur en 1912, la Chine renoue avec la paix, puisque l’autorité du parti communiste victorieux se consolide progressivement sur l’ensemble du pays à l’exception de Taïwan.
Du côté africain, les seuls pays indépendants (Égypte, Éthiopie, Liberia et Libye) ne reconnaissent pas encore la Chine. Plusieurs événements vont permettre à la Chine d’avancer ses pions sur le continent africain : la conférence afro-asiatique de Bandung, organisée du 18 au 24 avril 1955 en Indonésie, qui permet de nouer le contact avec les six pays africains représentés ; la nationalisation du canal de Suez décidée le 26 juillet 1956, une semaine seulement après l’arrivée du nouvel ambassadeur chinois au Caire ; enfin, les luttes d’indépendance (dont la lutte armée algérienne) que Pékin soutient clairement (Larkin 1971[13]). À cette époque, l’approche diplomatique chinoise est articulée autour d’une vision binaire : d’une part, sceller une amitié solide avec le plus grand nombre de pays africains pour asseoir son aura internationale ; et, d’autre part, combattre les hégémonies américaine et soviétique[14].
Alors qu’elle a été longtemps annoncée (Peyrefitte, 1973, 1997), la montée en puissance de la Chine est devenue effective vers la fin des années 90 sous la forme d’une croissance économique exponentielle à deux chiffres soutenue pendant plus d’une décennie maintenant. Bien qu’officiellement communiste, la Chine apparaît jusqu’à présent avoir tiré le plus avantage de la mondialisation qui est un instrument par excellence du capitalisme. Depuis son admission à l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), ce pays a enregistré l’un des taux des investissements directs étrangers (IDE) les plus élevés[15].
En devenant l’atelier du monde, la Chine a considérablement accru ses besoins en matières énergétiques. L’approvisionnement en pétrole est ainsi devenu le plus grand défi de l’économie chinoise en pleine expansion. Si l’on en croit Serguei Troush (1999), la Chine a organisé sa diplomatie en fonction de cette nouvelle dépendance[16].
Dans sa volonté de diversification de ses approvisionnements, la Chine a donc misé sur l’Afrique[17]. Selon un rapport de l’Agence internationale d’énergie atomique (AIEA), l’Afrique représente plus du quart de l’approvisionnement pétrolier de la Chine. Le fait que le Nigéria et l’Angola soient depuis 2000 les principaux fournisseurs de pétrole de la Chine est une illustration de cette situation. Au même moment où la Chine devenait un géant économique, les régimes africains traversaient des crises importantes, devant s’aligner sur la norme démocratique. Des élites étatiques autoritaires, en quête d’un moyen de s’adapter aux pressions internes et externes en faveur de la démocratie, ont vu la présence chinoise comme une opportunité.
C’est à cette époque qu’apparaissent certains des traits actuels de la politique africaine de la Chine. En effet, le premier ministre Zhou Enlai entreprit avec le ministre des Affaires étrangères, Chen Yi, une tournée de dix pays africains entre décembre 1963 et février 1964[18]. L’objectif était de rappeler que la Chine et l’Afrique partageaient la même expérience et pouvaient construire de ce fait un nouveau modèle de coopération, aujourd’hui connu par l’expression « coopération Sud-Sud ».
L’approche était articulée autour du caractère désintéressé de l’aide octroyée par la Chine, du respect de la souveraineté des pays africains, de la volonté de non-ingérence dans les problèmes africains et de l’appel à la résolution pacifique des différends[19]. Mais, en pleine guerre froide et en pleine Révolution culturelle en Chine, la recherche d’influence de ce pays en Afrique ne fut pas toujours bien perçue. Plusieurs pays, comme la République centrafricaine, le Ghana, la Tunisie et le Dahomey (actuel Bénin), suspendirent leurs relations avec Pékin (He 2003[20]).
Les années 1970 virent un réchauffement des relations sino-africaines à la faveur, d’une part, du vote massif des pays africains qui permit à la Chine continentale de ravir le siège de membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU à Taïwan et, d’autre part, du rapprochement sino-occidental. Mais à cette époque apparurent déjà des appréhensions similaires à celles que l’on entend aujourd’hui[21].
En effet, avec l’intensification de la rivalité sino-soviétique, les Africains réalisèrent, comme ce fut déjà le cas dans la deuxième moitié des années 1960, que la Chine n’était pas exclusivement altruiste. Comme les autres puissances, la Chine était en Afrique dans le but d’atteindre ses objectifs stratégiques[22]. En Afrique australe, par exemple, grande fut la stupéfaction des leaders quand ils virent la Chine accueillir le président Nixon en dépit du soutien américain aux régimes ségrégationnistes blancs d’Afrique du Sud et de la Rhodésie (actuel Zimbabwe) (Snow 1988 : 133[23]).
Même la construction du chemin de fer Tazara reliant la Tanzanie à la Zambie sur plus de 1 800 km, symbole suprême de l’engagement chinois en Afrique (Hall et Peyman 1976[24]) et de l’époque où « les pauvres aident les pauvres » (Snow 1988 : 144[25]), visait un objectif idéologique : combattre le communisme soviétique en rivalisant avec le barrage d’Assouan qu’ils ont construit en Égypte et se démarquer des Occidentaux qui avaient refusé d’entreprendre ces travaux.
À première vue, l’Afrique ne constitue pas une priorité pour la Chine. Le gouvernement de Pékin accorde chaque jour une attention plus grande à ses principaux partenaires, voisins et rivaux, au premier chef desquels les États-Unis. Le pays entretient en outre des relations économiques autrement plus étroites avec le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, qu’il cherche à annexer, les pays de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), l’Inde et même l’Union européenne[26].
Pourtant, l’Afrique joue un rôle important dans la stratégie d’encerclement et d’affaiblissement du Nord par le Sud suivie par le pouvoir chinois. Le continent africain représente en effet plus d’un quart des voix à l’Assemblée générale des Nations Unies, une organisation intergouvernementale dans laquelle la Chine fait preuve d’un grand activisme et d’un puissant entrisme[27].
L’Afrique possède de nombreuses matières premières utiles à l’économie chinoise. Elle a des besoins énormes en infrastructures et en investissements. Les produits chinois sont davantage à sa portée que ceux en provenance des pays développés et elle cherche à diversifier ses partenariats, s’efforçant de s’extraire des hégémonies néo ou postcoloniales imposées par l’Occident. La Chine a profité de ces attentes africaines pour rapidement accroître son influence sur le continent africain[28].
Depuis la Conférence de Bandung en 1955, en Indonésie, la Chine affirme promouvoir en Afrique le non-alignement, la solidarité entre nations en développement, la coopération Sud-Sud et un modèle de « non-intervention ». Dès cette époque, la Chine tisse des liens avec les grands mouvements indépendantistes en Égypte, en Algérie, au Cameroun, en Afrique du Sud, en Angola, en Tanzanie et au Zimbabwe, pour amplifier l’influence « maoïste ».Dans les années 1960 et 1970, la Chine apporte une assistance militaire aux États nouvellement indépendants qui choisissent le socialisme dans le cadre de sa politique dite « pencher d’un côté »[29].
En outre, la Chine est devenue, en moins de deux décennies, un acteur majeur du financement du développement en Afrique par le biais du financement d’infrastructures[30]. L’initiative des « Nouvelles routes de la soie » (Belt and road initiative ou BRI), lancée en 2013 et qui implique plusieurs pays, traduit un changement de paradigme de la politique étrangère chinoise (Bertuzzi et al., 2019[31]).
Considérant à la fois les conséquences et les perspectives de la monté en puissance de la Chine en Afrique et dans les relations internationales, notamment dans le commerce international, ainsi que les mutations des pays africains, cette modeste étude trouve toute sa pertinence.
Du pragmatisme de la politique africaine de la Chine
En 1978, à la veille des réformes lancées par Deng Xiaoping, la relation économique entre la Chine et l’Afrique était négligeable et était conforme au schéma des échanges de l’époque qui faisait peu de place aux rapports Sud- Sud (Broadman 2006 : 2)[32]. Par ailleurs, l’aide chinoise allouée à l’Afrique avait considérablement diminué en dépit des déclarations officielles chinoises. Le continent africain, toujours morose économiquement, attirait de moins en moins une Chine pour laquelle l’objectif majeur était une ouverture rapide et efficiente à l’économie de marché.
Toutefois, lors du périple du premier ministre chinois Zhao Ziyang dans plusieurs pays d’Afrique en 1982, les jalons de la nouvelle tournure que les relations sino-africaines connaîtront à partir des années 1990 sont posés. L’accent est mis dorénavant sur l’économie[33].La nouvelle politique de la Chine à l’égard de l’Afrique a été impulsée par plusieurs facteurs. Sur le plan structurel, l’impératif de diversification des sources d’approvisionnement énergétique pour soutenir sa croissance économique en est un des principaux vecteurs. Le plus immédiat des facteurs est politico- diplomatique.
Il résulte, d’une part, de la crise de la place Tian’anmen au printemps 1989, qui a contraint le pays à chercher de nouveaux alliés pour éviter l’isolement diplomatique. Il s’explique, d’autre part, par la nécessité d’isoler Taïwan et ses prétentions au statut de grande puissance, qui conduisent Pékin à courtiser continuellement l’Afrique (et le tiers-monde) pour se poser comme leur représentant au Conseil de sécurité de l’ONU et s’assurer leur soutien dans les organisations internationales[34].
Les « amis africains » dans l’agenda diplomatique chinois après-Tian’anmen
Au lendemain du printemps 1989, on assiste à une transformation cruciale dans les relations entre la Chine et l’Afrique dans la mesure où les dirigeants politiques chinois opérèrent, à partir de ce moment, une réévaluation progressive de l’importance du continent (Taylor 1998[35]). Après le soulèvement des étudiants et la violente répression du gouvernement au printemps 1989, la Chine allait essuyer les critiques virulentes de l’opinion internationale.
Les médias occidentaux, qui avaient jusque-là loué les efforts de modernisation économique du pays, portaient à présent leur attention sur le système des laogai (travail forcé), les exécutions publiques et l’absence de démocratie (Tull 2006[36]). Contrairement à l’attitude critique de l’Occident, plusieurs dirigeants africains apportèrent leur soutien à Pékin. L’attitude de la RPC envers les pays du tiers-monde, en général, et ceux de l’Afrique, en particulier, passa d’une négligence voilée à un intérêt renouvelé. La rhétorique sur l’indéfectible et ancienne amitié sino-africaine est alors réaffirmée sans retenue[37].
La théorie du complot selon laquelle les critiques occidentales avaient pour objectif de freiner la rapide modernisation chinoise eut un accueil particulier en Afrique. Cela s’est traduit chez les dirigeants africains et chinois par une méfiance vis-à-vis des critiques faites à leur régime en regard des normes qualifiées d’occidentalo-centrées des droits de l’homme et de la démocratie.
Pour les leaders africains, de vives condamnations de la Chine auraient été en outre synonymes de la fin de l’aide chinoise à une période où l’Afrique était de son côté sous les feux des conditionnalités démocratiques imposées par les pays occidentaux et les institutions financières internationales[38]. La Chine s’appliqua à intensifier ses contacts dans les pays en voie de développement afin de désamorcer ces critiques (Yu 1991 : 34[39]).
Un soutien fidèle des « amis africains » dans les instances internationales…
En maintenant des relations avec un nombre substantiel de pays amis, les dirigeants chinois s’efforcent de développer un réseau d’alliés et des majorités capables de leur apporter un soutien moral et politique au sein des organisations multilatérales internationales[40]. Cette tendance est rendue explicite par une expression imagée : « le vaste nombre des pays du tiers-monde s’unira certainement et soutiendra la Chine comme de nombreuses “fourmis” protégeant l’“éléphant” du danger » (Taylor 2004[41]). Pour cela, Pékin se positionne comme le défenseur d’un relativisme culturel en matière de droits de l’homme[42].
S’appuyant sur les exemples des pays islamiques et africains, Deng Xiaoping s’est opposé farouchement à l’imposition du système démocratique de « type américain », affirmant que la Chine n’adopterait pas ce système (Deng 1990[43]). Cette attitude s’avérait très alléchante pour les régimes autoritaires. Le fait que nombre de ces régimes se trouvaient en Afrique signifiait que Pékin avait sur le continent une élite politique potentiellement favorable. Selon le ministre chinois des Affaires étrangères, pour réussir à contrecarrer les manœuvres occidentales, la Chine et l’Afrique devaient travailler main dans la main (Taylor 2004[44]). Cette stratégie porta ses fruits, en l’occurrence lorsqu’en avril 1996, à Genève, des votes africains empêchèrent la condamnation de la violation des droits de l’homme en Chine.
Dès lors, l’isolement de Taïwan est au cœur de cette stratégie. Les années 1990 vont donner lieu à une confrontation diplomatique aiguë entre la République populaire de Chine et Taïwan dans un contexte de bouleversement international et d’arrivée au pouvoir à Taïwan de leaders pro-indépendantistes. Ces derniers ont entrepris de mobiliser leurs alliés (une dizaine en Afrique au début de la décennie) pour soutenir la campagne de réintégration de Taïwan aux Nations Unies et échapper à l’isolement diplomatique dans lequel Pékin cherche à reléguer l’île rebelle[45]. Comme par le passé, Taïwan a recours à la « diplomatie du chéquier »[46] dans le but d’attirer le plus de reconnaissance possible. Cette stratégie eut un franc succès. Plusieurs pays africains ré-établissent des relations avec la République de Chine : le Liberia en octobre 1989, le Lesotho en avril 1990, la Guinée- Bissau en mai 1990, la République centrafricaine en juillet 1991, le Niger en juin 1992, le Burkina Faso en février 1994, la Gambie en juillet 1995, le Sénégal en janvier 1996, Sao Tomé-et-Principe en mai 1997 et le Tchad en août 1997[47].
De ces pays, certains (Lesotho, Niger, Centrafrique et Guinée-Bissau) repasseront cependant dans le giron de Pékin au cours des années suivantes et d’autres (Sénégal, Tchad) la décennie suivante, en raison de la vigoureuse offensive menée par la Chine pour contrer cette érosion diplomatique. Le plus important basculement de cette bataille diplomatique survint le 1er janvier 1998 lorsque l’Afrique du Sud, qui n’avait jamais reconnu la Chine, établit des relations diplomatiques avec Pékin[48].
Les autorités sud-africaines après-apartheid qui avaient, en vain, essayé de convaincre Pékin de l’idée d’une double reconnaissance devaient finalement concéder que « le gouvernement de la République d’Afrique du Sud reconnaît qu’il n’existe qu’une seule Chine dans le monde. Le gouvernement de la République populaire de Chine est le seul gouvernement légal représentant l’ensemble de la Chine » (Jiang 2003[49]). Cette reconnaissance fut l’un des principaux basculements politiques mais aussi économiques en ce sens que l’Afrique du Sud, qui représente 25 % de la richesse africaine et jouit d’un produit national brut élevé ainsi que d’excellentes infrastructures, avait attiré bon nombre d’investisseurs étrangers depuis la fin de l’apartheid en 1990 et devenait un des leaders influents sur la scène africaine avec l’arrivée de l’ANC et de Nelson Mandela au pouvoir à partir de 1994.
Il ressort de ce qui précède que le modèle de coopération chinois est basé sur la non-ingérence, le respect et soutien mutuels et la coopération mutuellement avantageuse[50]. S’appuyant sur les principes de la coexistence pacifique, que la Chine elle-même et l’Inde avaient proposés il 70 ans, la diplomatie chinoise est caractérisée par la non-ingérence dans les affaires intérieures d’un pays, quel que soit son poids économique ou son système politique[51].
C’est pourquoi, la Chine a toujours appelé au respect de l’indépendance et de la souveraineté de chaque pays. Le second pilier de la coopération chinoise est la promotion de la solidarité Sud-Sud. Ce qui signifie des relations horizontales caractérisées par l’entraide et le respect de la souveraineté des partenaires[52]. C’est pourquoi la Chine considère comme un devoir de faire bénéficier son expérience de développement aux pays du Sud Global, notamment aux pays africains. C’est sur la base de ces principes qu’il faut comprendre le rôle du Forum de coopération Afrique-Chine (FOCAC), lancée en 2000, ainsi que l’Initiative « la Ceinture et la Route », lancée en 2013[53].
Un agenda varié et une institutionnalisation de la politique chinoise en Afrique
La présence de la Chine en Afrique est dorénavant devenue dynamique, sophistiquée et multidimensionnelle[54]. Elle soulève, par la même occasion, des défis complexes. Des rapports politico-diplomatiques aux échanges commerciaux en passant par l’aide publique au développement, le tourisme, les télécommunications, la construction d’infrastructures, l’agriculture, les mines ; aucun domaine ne semble plus pouvoir échapper à la Chine en Afrique.
Bousculant les agendas internationaux du développement et redéfinissant les grands équilibres géopolitiques et économiques, la Chine n’a cessé d’élargir son champ d’action et de consolider sa présence en Afrique, traditionnel pré carré des puissances occidentales[55]. C’est ainsi qu’un nouveau partenariat stratégique et économique a ainsi été établi et institutionnalisé à travers la création à Pékin, en octobre 2000, du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), qui confère à la présence de la Chine en Afrique une dimension continentale. Tout cela participe de la volonté de la Chine de s’appuyer sur sa nouvelle puissance pour faire avancer ses intérêts et augmenter sa réputation et son attrait aux yeux des partenaires africains conquis en général par le « soft power » chinois[56]. Il va être le prélude à l’augmentation des échanges commerciaux à partir de 2003. En seulement quelques années, la Chine rattrape puis dépasse l’ensemble des partenaires commerciaux historiques du continent africain : l’Italie et l’Espagne, la France et la Grande-Bretagne, et en 2009, finalement, les États-Unis[57].
En 2012, l’arrivée au pouvoir de Xi Jinping coïncide, entre autres choses, avec le lancement du programme des nouvelles « routes de la soie », officialisé en 2013. Ce projet va partiellement renouveler les relations sino-africaines en plaçant les infrastructures au centre des priorités, chinoises comme africaines[58]. Au-delà des discours chinois propagandistes et des représentations parfois caricaturales, se trouve une forme de réalité que les chiffres et les études de terrain permettent de déconstruire les présupposés sur les présences chinoises en Afrique[59].
Depuis, ce projet est devenu central dans la politique économique chinoise. Il concerne plus de 68 pays regroupant 4,4 milliards d’habitants et représentant près de 40 % du produit intérieur brut (PIB) de la planète. Les banques et institutions financières chinoises, notamment la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures (BAII), ont largement été sollicitées pour mettre en place un tel projet[60]. Les objectifs économiques sont multiples pour la Chine : il s’agit d’accroître ses exportations, d’écouler sa production et de trouver de nouveaux marchés pour ses entreprises de bâtiments et de travaux publics. En effet, la Chine est en surcapacité industrielle.
Par ailleurs, depuis 2009, la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l’Afrique. En 2023, le volume des échanges a dépassé 280 milliards de dollars. Pour les sept premiers mois de 2024, de janvier à juillet, les échanges se sont hissés à 167 milliards de dollars[61]. Si ce rythme est maintenu, les échanges entre l’Afrique et la Chine pourraient dépasser les 300 milliards de dollars cette année. Les investissements chinois sont palpables dans tous les domaines, comme la construction de routes, d’autoroutes, de chemins de fer, de ponts, d’aéroports, de ports, de barrages, d’hôpitaux et d’autres infrastructures de base[62].
A cela, il faut ajouter les trois autres initiatives d’envergure mondiale lancées au cours de ces dernières années. Ce sont l’Initiative pour le développement mondial (IDM) ; l’Initiative pour la sécurité mondiale (ISM) et l’Initiative pour la civilisation mondiale (ICM). Toutes ces Initiatives a visent à favoriser un monde de paix, de sécurité, de coopération et de respect mutuel, qui sont nécessaires pour créer les conditions d’un développement inclusif et durable. Ces Initiatives sont à l’opposé de la conception occidentale des relations internationales considérées comme « un jeu à somme nulle ». C’est pourquoi les initiatives chinoises attirent de plus en plus de monde, notamment au niveau du Sud Global[63].
Les accords de swap de devises
Un swap[64] est un contrat par lequel des contreparties (typiquement des banques ou des institutions financières) se mettent d’accord pour échanger un flux financier contre un autre, suivant des échéances et dans des conditions spécifiées à l’avance. La valeur d’un swap est principalement déterminée par celle de ses actifs sous-jacents, qui peuvent être des actions, des matières premières, des devises ou des taux d’intérêt. Cet échange mutuel est régi par les conditions spécifiées dans l’accord initial. Il implique généralement : un échange initial du principal dans deux devises différentes, des paiements d’intérêts réguliers dans chaque devise, un échange final du principal à l’échéance du contrat[65].
Il faut souligner dans ce sillage que l’un des aspects le moins connu de la coopération sino-africaine est constitué des accords de swaps de devises entre banques centrales. Ces accords sont destinés à stimuler les échanges économiques par l’utilisation des monnaies nationales, en se passant de devises étrangères, notamment du dollar et de l’euro. Ces accords passés avec plusieurs pays africains et non des moindres, comme l’Afrique du Sud, l’Angola, l’Algérie, l’Egypte, le Kenya, le Maroc, le Nigeria, l’Ethiopie, l’Ile Maurice, le Zimbabwe, etc. ont contribué à l’essor des échanges commerciaux entre ces pays et la Chine. Ces accords de swaps de devises contribuent également au mouvement de dédollarisation, c’est-à-dire à la baisse de l’utilisation du dollar dans les échanges internationaux, observé dans le monde[66].
En outre, en juillet 2025, la Banque de développement de Chine (CDB) a accordé un prêt de 2,1 milliards de yuans (292,5 millions USD) à la Banque de développement d’Afrique australe (DBSA). Ce financement soutiendra des projets dans des secteurs stratégiques tels que les infrastructures, l’énergie, les technologies de l’information et de la communication, l’eau, l’assainissement et l’industrie manufacturière. « Ce partenariat incarne notre engagement commun à soutenir un développement durable, inclusif et résilient sur le continent africain. Les deux institutions œuvreront main dans la main pour catalyser des projets transformateurs, en particulier dans le domaine des infrastructures vertes[67].» Boitumelo Mosako, directrice générale de la DBSA.
Pour la Banque de développement de Chine, l’Afrique occupe une place stratégique dans sa politique de financement international. À travers le mécanisme interbancaire des BRICS, Pékin cherche à élargir son empreinte financière en Afrique en proposant des financements alternatifs aux canaux occidentaux traditionnels. Ce partenariat s’inscrit ainsi dans une stratégie plus large de renforcement des liens Sud-Sud, à un moment où les équilibres économiques mondiaux sont en pleine recomposition[68].
Des nouvelles perspectives prometteuses ?
Lors de la réunion ministérielle des coordinateurs sur la mise en œuvre des mesures de suivi du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) qui s’est tenue en juin 2025, le ministre chinois des Affaires étrangères, a déclaré que la Chine et l’Afrique, en tant que plus grand pays en développement du monde et continent regroupant le plus grand nombre de pays en développement, forment ensemble la force d’ossature du Sud global. Selon Wang Yi, plus le paysage international devient complexe et turbulent, plus il est impératif pour la Chine et l’Afrique de renforcer l’unité et la puissance, de rester fermement du bon côté de l’histoire, d’orienter activement le courant de l’époque et de faire face à l’incertitude dans le monde avec la stabilité et la résilience des relations sino-africaines[69]. Ce dernier, au nom de la Chine, a présenté une proposition en cinq points pour promouvoir un développement de haute qualité de la coopération sino-africaine.
Premièrement, maintenir l’assistance mutuelle et servir de défenseurs de la solidarité entre les pays du Sud global. La Chine et l’Afrique devraient maintenir l’élan des échanges de haut niveau, se soutenir fermement sur les questions concernant leurs intérêts fondamentaux respectifs, renforcer davantage la confiance politique mutuelle et améliorer continuellement la qualité de la communauté d’avenir partagé. En tant qu’amie la plus digne de confiance et partenaire la plus fiable des pays africains, la Chine défendra, comme toujours, les pays africains, soutiendra pleinement la poursuite de l’intégration de l’Afrique et aidera pleinement les pays africains à explorer leurs voies vers la modernisation[70].
Deuxièmement, adhérer à l’ouverture et servir de promoteur du libre-échange international. La mondialisation économique est la seule voie de progrès pour l’humanité. La Chine et l’Afrique devraient se faire les champions d’une mondialisation économique inclusive et bénéfique pour tous, s’opposer conjointement à toutes les formes d’unilatéralisme et de protectionnisme, et sauvegarder le système commercial multilatéral centré sur l’Organisation mondiale du commerce (OMC). La Chine continuera à accroître son ouverture à l’égard de l’Afrique et à appliquer le traitement de tarif douanier zéro à 100 % de catégories de produits exportés vers la Chine par les 53 pays africains ayant avec elle des relations diplomatiques ; ce qui offrira à l’Afrique plus de débouchés sur le marché chinois et plus d’opportunités pour son développement[71].
Troisièmement, défendre les avantages mutuels et les résultats gagnant-gagnant et servir de partenaires dans la coopération au développement mondial. Le président Xi Jinping a souligné que sur la voie de la modernisation, personne, ni aucun pays, ne doit être laissé pour compte. La Chine appelle la communauté internationale à attacher une grande importance aux défis de développement auxquels l’Afrique est confrontée et à augmenter l’aide au développement en faveur de l’Afrique plutôt que de la réduire de manière drastique. La Chine accélérera la mise en œuvre des dix actions de partenariat, fera progresser la coopération de haute qualité dans le cadre de l’Initiative « la Ceinture et la Route », et mettra en œuvre l’Initiative pour le soutien à l’industrialisation de l’Afrique, le Programme d’assistance de la Chine à la modernisation de l’agriculture de l’Afrique et le Plan de coopération sino-africaine pour la formation des talents, afin de promouvoir un développement de haute qualité de la coopération sino-africaine[72].
Quatrièmement, défendre l’équité et la justice, et servir de défenseurs d’un ordre international équitable. La Chine et l’Afrique devraient continuer à renforcer la coordination et la coopération dans les affaires internationales, s’opposer conjointement à l’hégémonisme et à l’intimidation, et rendre l’ordre international plus juste et plus équitable. La Chine continuera à soutenir fermement l’Afrique pour qu’elle joue un rôle plus important sur la scène internationale, à corriger les injustices historiques subies par l’Afrique et à renforcer la représentation et le droit à la parole de l’Afrique dans le système de gouvernance mondiale[73].
Cinquièmement, soutenir les échanges et l’apprentissage mutuel, et servir de promoteurs de la diversité des civilisations mondiales. L’année 2026 sera l’« Année sino-africaine des échanges humains et culturels », Les deux parties devraient tirer pleinement parti de divers canaux, tels que ceux des milieux commerciaux, académiques et civils pour approfondir les échanges et l’intégration culturels entre la Chine et l’Afrique et favoriser une meilleure compréhension mutuelle et une plus grande affinité entre les peuples. La Chine mettra en œuvre les initiatives annoncées par le président Xi Jinping et continuera à développer les échanges et la coopération avec l’Afrique dans les domaines de l’éducation, de la jeunesse, des femmes, de la radiodiffusion et dans d’autres domaines, afin de consolider sans relâche le soutien public à l’amitié éternelle entre la Chine et l’Afrique[74].
Toutefois, même si, le narratif des « partenaires traditionnels » de l’Afrique par rapport à la présence chinoise est quelque peu exagéré, il n’en demeure pas moins que la Chine en tant que puissance n’est pas exempte de toutes critiques. Il serait naïf de penser et croire que la Chine est venue en Afrique pour sauver les africains. D’ailleurs, ne dit-on pas que « les Etats n’ont pas d’amis. Ils n’ont que des intérêts à défendre ? »
En effet, les relations entre l’Afrique et la Chine sont dans une certaine mesure contrastées voire controversées et ce, malgré les multiples et notoires réalisations chinoises de part et d’autre. On constate également un véritable déséquilibre en termes des échanges avec d’autres régions comme l’Amérique latine voire sur le continent même. Par ailleurs, on note une surexploitation illégale des ressources notamment halieutiques, minières.
Une relation déséquilibrée…
L’essor de la relation commerciale et d’investissement entre la Chine et l’Afrique ne profite pas de manière égale à tous les secteurs et à tous les pays. Environ 70 pour cent des exportations africaines vers la Chine proviennent d’Angola, d’Afrique du Sud, du Soudan et de la République démocratique du Congo, et les matières premières y prédominent fortement (pétrole, cuivre, cobalt et coton)[75]. De plus, 60 pour cent des importations en provenance de la Chine, pour l’essentiel des produits manufacturés, sont destinés à l’Afrique du Sud, à l’Égypte, au Nigéria, à l’Algérie et au Maroc.
La plupart des autres économies africaines n’entretiennent qu’une relation commerciale limitée avec la Chine. L’IDE chinois vers l’Afrique est tout aussi concentré, avec 50 pour cent de cet IDE allant au secteur minier d’une poignée de pays richement dotés en ressources (Nigéria, Afrique du Sud et Soudan)[76].
En effet, la relation commerciale et d’investissement entre la Chine et l’Afrique est déséquilibrée, dans le sens où l’Afrique compte moins pour la Chine que d’autres partenaires commerciaux. La Chine est étroitement intégrée à l’Asie, en particulier via le commerce des pièces détachées et composants, l’un des pivots des exportations de produits manufacturés de ce pays (la Chine importe les pièces depuis un autre pays d’Asie, les assemble puis les réexporte vers les marchés de consommation d’Europe, d’Amérique du Nord et du Japon)[77]. L’Asie totalise donc plus de 50 pour cent du commerce chinois, contre 4 pour cent seulement pour l’Afrique. Fondamentalement, les exportations africaines se heurtent toutefois à des limitations propres aux pays du continent, comme l’insuffisance de l’infrastructure, la lourdeur des obligations imposées par la réglementation et le manque de main-d’œuvre qualifiée[78].
L’Afrique doit également faire face à la concurrence non négligeable d’autres régions dans le secteur des produits de base. En effet, la Chine s’approvisionne en matières premières auprès de diverses sources, dont l’Australie (où elle a réalisé d’importants investissements dans les ressources minérales), la Communauté des États indépendants[79] et l’Amérique latine. La Chine est alors, devenue l’un des principaux partenaires commerciaux de la région latino-américaine, intéressée par de multiples investissements dans les infrastructures (chemins de fer, centrales électriques) et dans les matières premières[80].
Les échanges entre la Chine et les pays latino-américains s’élevaient à 518 milliards de dollars en 2024, contre 295,5 milliards de dollars en Afrique à la même période[81],[82]. Et pourraient atteindre 700 milliards d’ici 2035. La Chine représente 14 % des exportations latino-américaines et la part des importations provenant de Chine des pays d’Amérique latine s’élève à 20 %. Ainsi, la Chine s’est imposée comme le deuxième partenaire commercial de l’Amérique latine. Cette relation commerciale permet à la Chine de se fournir en matières premières (ressources naturelles et minières) nécessaires à son économie.
En sus, l’Amérique latine est la deuxième destination (après l’Asie) vers laquelle Pékin dirige ses IDE (investissements directs à l’étranger), en particulier dans les secteurs des infrastructures (port, énergie, transport). L’Argentine, le Chili et le Pérou sont les principaux destinataires de ces investissements[83]. Enfin, la Chine est devenue le premier prêteur financier des pays latino-américains, bien que la tendance récente soit au ralentissement.
L’Afrique se retrouve donc en concurrence avec des régions tout aussi bien dotées qu’elle en ressources naturelles, mais qui bénéficient d’un environnement politique et d’affaires plus stable, et qui offrent donc un niveau de risque d’investissement moindre. Cette concurrence entre régions souligne à quel point l’Afrique a besoin de renforcer sa compétitivité et de remédier à ses problèmes structurels[84].
Sur le plan des échanges, de l’investissement et de l’aide, il est évident que la Chine joue un grand rôle dans l’amélioration des opportunités de développement de l’Afrique, mais ce rôle n’est toutefois pas aussi important que celui des donateurs traditionnels du continent. L’Union européenne et les États-Unis demeurent en effet les principaux partenaires de nombreuses économies africaines pour les échanges et l’investissement[85].
La problématique du « pillage » des ressources…
« Actuellement, le poisson se fait rare. Ça devient très difficile d’en attraper. On est obligé d’aller de plus en plus loin, jusqu’à 110 kilomètres des côtes parfois. Beaucoup de jeunes pêcheurs ont migré en Espagne. Il y a quelques semaines, mon propre fils aîné est parti en pirogue pour les Canaries. Quand il m’a fait part de sa décision, je lui ai donné ma bénédiction. Le voyage est dangereux, mais qui ne risque rien n’a rien (…)[86]» Adama Thiam, pécheur Sénégalais.
« On te couvre d’argent, et toi tu donnes ta signature pour que le bateau devienne officiellement sénégalais et puisse pêcher ici.» Hamidou Seye, mareyeur Sénégalais à Soumbédioune (Dakar-Sénégal)[87].
L’Afrique dispose d’un territoire maritime de l’ordre de 13 millions de km². Il correspond aux Zones économiques exclusives (ZEE) sous la juridiction des États côtiers et des États insulaires. Dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ils ont la responsabilité de gérer durablement les ressources maritimes de ces zones[88]. Un chiffre est éloquent pour montrer l’importance du secteur halieutique dans le continent : 22 % des protéines animales disponibles viennent des produits de la mer et des eaux douces et plus de 50 % dans certains pays africains, en particulier en Afrique du Nord et de l’Ouest[89].
Grâce à son apport en protéines et en micronutriments, le poisson contribue à l’amélioration de l’état nutritionnel de la population des zones côtières. Il peut être vendu sous forme de «poisson séché» ou de «poisson braisé », des aliments précieux, facilement conservables et transportables, ce qui permet une consommation jusque dans les zones les plus enclavées de l’intérieur, pour 200 millions de personnes. Les pêches côtières et leurs activités connexes fournissent non seulement de la nourriture, mais aussi des emplois aux hommes pêcheurs comme aux femmes, mareyeuses et transformatrices du poisson, et génèrent des revenus pour les États comme pour les communautés. Plus de 12 millions de personnes travaillent dans le secteur de la pêche[90].
Les perspectives pour l’Afrique proposées par la FAO pour 2032 sont pessimistes : « la consommation de poisson par habitant en Afrique continuera de diminuer, car les projections de production risquent de ne pas suivre la croissance de la population»[91]. En effet, partout, la production halieutique traverse une phase critique, signe que les ressources de la mer ne sont pas infinies. Comme nous allons le voir, plusieurs raisons se juxtaposent. La surpêche, la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, et l’exploitation mal contrôlée des stocks de poissons par des industries de farine et d’huile laissent dans leur sillage de lourdes conséquences pour les populations locales.
En outre, depuis plusieurs années, la Chine est régulièrement accusée de piller les ressources halieutiques de la façade atlantique de l’Afrique, une région dotée de réserves poissonneuses exceptionnelles, mais gravement menacées par la surexploitation. Premier acteur de la pêche Illicite, non déclarée et non réglementée (Inn), la Chine échappe aux autorités de régulation et déjoue les réglementations en vigueur en désactivant les systèmes d’identification automatique de ses navires[92].
Par exemple, dans le port d’Abidjan, 55 des 80 navires de pêche industrielle ancrés sont gérés, selon la législation ivoirienne, par des sociétés mixtes de pêche dont les gestionnaires sont des Chinois. De nombreux chalutiers chinois battent ainsi pavillon africain ou recourent à des prête-noms pour échapper aux sanctions et aux contrôles[93]. En 2024, parmi les navires opérant dans les zones économiques exclusives des pays de la côte africaine, de Dakar à Luanda, 194 étaient chinois, selon des chiffres rapportés par le journal Le Monde.
Selon les estimations du centre de données FishSpektrum, une plateforme spécialisée dans l’identification des navires, la Chine disposerait à elle seule d’une flotte de six cents bateaux disséminés le long des côtes, de Gibraltar au Cap[94]. Ils utilisent des filets doubles dotés de lourdes «portes » qui maintiennent les filets ouverts lorsqu’ils traînent le fond marin. Cette technique a suscité des critiques, car elle détruit l’habitat, endommage les fonds marins, perturbe le cycle des nutriments et réduit la productivité, la taille et la biodiversité des espèces, surtout si elle se poursuit sur de longues périodes. Cette pratique peut en outre libérer des quantités de carbone stocké dans les sédiments des fonds marins, risquant ainsi d’accélérer le processus d’acidification de l’océan[95].
Les frêles embarcations ne pèsent pas lourd face aux chalutiers chinois. Ensuite, la cohabitation de ces deux types de pêche entraîne parfois la destruction des pirogues et des filets des artisans pêcheurs. Au Sénégal, les trois quarts des pêcheurs indiquent que leurs lignes ou leurs filets ont été endommagés par un chalutier. Plus grave, une étude d’Ecotrust Canada a calculé qu’en Afrique de l’Ouest, les collisions avec les navires industriels tuent plus de 250 pêcheurs artisans par an[96].
Ces pratiques, déjà dénoncées par le passé par de nombreuses organisations de professionnels de la pêche ainsi que des ONG, continuent d’affecter gravement les écosystèmes marins et les économies locales notamment au Sénégal, en Côte-d’Ivoire, à Madagascar, au Ghana, au Cameroun etc.
Mais le pillage chinois ne se limite pas aux mers. La présence chinoise dans le secteur minier africain suscite également de vives critiques en raison de pratiques illégales et de leurs conséquences environnementales et sociales.
Profitant des ressources limitées des Etats pour contrôler leurs territoires, les acteurs chinois exploitent notamment les failles administratives et les zones d’instabilité pour maximiser leurs gains. Dans le Sud-Kivu par exemple, la faible capacité de surveillance de l’Etat favorise la persistance de l’exploitation illégale. Selon l’Agence congolaise de presse, plus de 147 entreprises minières chinoises opèrent illégalement au Sud-Kivu. Au Ghana, les entreprises chinoises ont un impact écologique dévastateur, mettant en difficulté le gouvernement, accusé de laisser faire cette prédation néfaste .Au Nigeria, les arrestations de ressortissants chinois pour activités minières illégales se sont multipliées en 2024, comme au Ghana
Conclusion
Incontestablement, le modèle de coopération instauré par la Chine a permis à l’Afrique de mieux se faire respecter par les « partenaires » traditionnels, tels que les pays européens et les Etats-Unis. Ainsi, dans un monde en pleine mutation, l’Afrique a-t-elle intérêt à renforcer ses relations stratégiques avec la Chine, un des piliers des BRICS +, qui sont devenus la force motrice de l’économie mondiale. C’est cette option qui permettrait à l’Afrique de renforcer son indépendance et de préserver sa souveraineté.
Toutefois, la percée de la Chine en Afrique porte à la fois de l’espoir et controverses[99]. Entre les deux termes, le premier est à prendre avec tout le sérieux car dans sa marche vers la croissance économique, la Chine ne peut se comporter que comme l’ont fait les nations occidentales actuellement industrialisées, qui dans la transition économique qu’elles ont connue au 19 et aux 20 e siècles, se sont mises à coloniser certains territoires pour faire face à des exigences économiques de leur croissance. Si la Chine ne colonise pas l’Afrique, ce qu’elle fait n’est en rien différent de la logique coloniale qui a structuré les relations que l’Afrique a subie dans le passé. Les controverses abondent et elles laissent encore des doutes sur le potentiel de développement que peut enclencher la Chine en Afrique.
Pour finir, l’Afrique ne devrait pas se leurrer de cette amitié chinoise, car, la Chine n’est pas une amie, mais un partenaire conséquent, à qui il ne faudra faire aucune concession. Etant donné que cette dernière n’a pas les intentions claires envers l’Afrique. Son principal objectif est celui d’accumuler autant que possible les ressources de l’Afrique avant que celle-ci ne se rende compte des impacts.
Comme disait Charles De Gaulle «en relations internationales, il n’y a d’amitié, il n’y a que des intérêts qui comptent». Les dirigeants africains devraient penser à l’héritage qu’ils souhaitent laisser aux générations futures, qui ne saurait être une perpétuelle dette, mais une économie florissante et un avenir prospère.