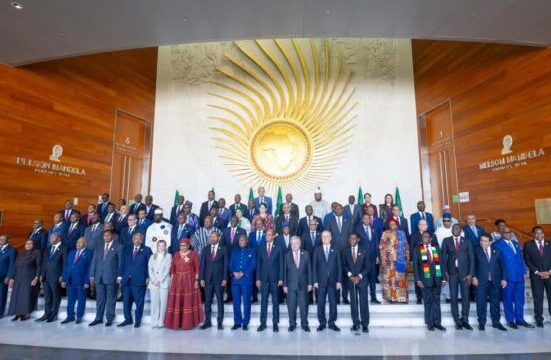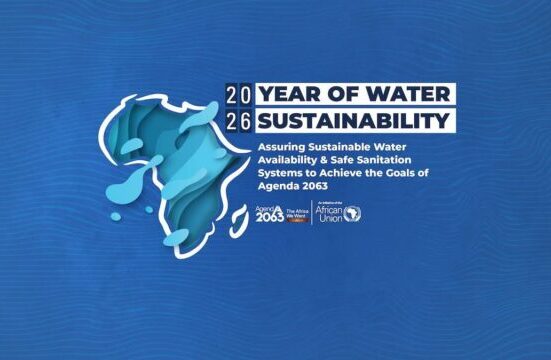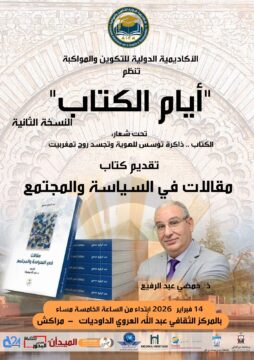Les entreprises minières exploitent les ressources nationales sans tenir compte de leur devoir face aux populations locales premières victimes des dégâts environnementaux. Non seulement, elles violent les normes environnementales, en plus, leurs revenus annuels grimpent sans aucun respect de leurs engagements dans le cadre de la RSE. Trés souvent, ce sont des “miettes”, pour reprendre le Forum Civil, qui sont octroyées aux populations locales comme de petits cadeaux cédés aux écoles, aux mosquées, aux ASC, aux cases de santé… Ce qu’elles détruisent dépassent largement ces présents qu’ils distribuent dans les localités. Aujourd’hui, les immenses revenus ne sont pas proportionnels aux aides insignifiantes que ces entreprises étrangères accordent aux populations. Les autorités sénégalaises notamment le Ministre des Mines doivent prendre cette question au sérieux afin d’accompagner les populations locales qui assistent à l’exploitation abusive de leurs ressources. La constitution dit que: “les ressources appartiennent au peuple”, alors que ce dernier reçoit beaucoup de poussiére en pleine figure.
Pourquoi le dialogue sur la RSE dans l’industrie extractive et minière en particulier ?

Avec la création du Programme Social Minier (PSM), la promotion de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) minières est dite occuperune place importante dans la politique minière du Sénégal. Ce programme résulte d’engagements négociés et consignés dans les Conventions minières pour la mise à la disposition de fonds sociaux. Ces fonds, gérés par les entreprises minières elles-mêmes doivent permettre de réaliser au profit des populations vivant dans les zones abritant les sites miniers des investissements à caractère social : infrastructures et équipements sociaux de base, valorisation des ressources et potentialités de zones minières à travers le développement d’activités économiques génératrices de revenus, lutte contre le chômage et la pauvreté, appui à l’éducation des jeunes à travers l’octroi de bourses de formation etc. Cette étude réalisée par Institut de la Francophonie pour le Développement Durable et intitulée « la RSE pour un développement minier durable en Afrique de l’ouest » revient sur l’importance du dialogue sur la RSE dans les industriesextractives.
D’abord l’apanage de sociétés étatiques, l’exploitation des ressources minières a été soumise à des restructurations tous azimuts au début des années 80 sous les ajustements structurels de la Banque mondiale dans le but évident de faciliter leur accès aux investissements directs étrangers (IDE), vocable feutré pour parler des entreprises multinationales spécialisées et détentrices des capitaux et des technologies lourdes, nécessaires à ce secteur fortement capitalistique. Depuis le début des années 2000, les investissements pour leur exploitation et mise en valeur connaissent une croissance exponentielle et notamment en Afrique. Cette tendance soulève, de plus en plus, des enjeux majeurs dans le monde. Les pays membres de la Francophonie n’y échappent pas et plus particulièrement ceux du continent africain.
L’Afrique s’est révélée être une source de matière première bon marché mais aussi un marché de consommation. Avec un développement notable de la classe moyenne, l’accès au marché du continent peut faire la différence pour la croissance des pays développés. En outre, avec la perspective d’une main d’œuvre qualifiée et bon marché, l’Afrique peut être la « Chine » de demain en termes de délocalisation des entreprises ; ce que du reste la Chine elle-même a compris et a déjà commencé en Éthiopie, au Kenya ou au Malawi ainsi que dans bien d’autres pays africains.
En effet, selon Performance consulting, en 2007, l’Afrique « concentre 30% des réserves mondiales de matières premières minières et constitue déjà un producteur incontournable pour un grand nombre de ressources.
En 2005, l’Afrique produisait notamment 77% du platine, 56% du cobalt, 46% des diamants et 21% de l’or ». De même Collier et Venables (2008) nous apprennent que «la richesse moyenne du sous-sol africain par km² de terre est d’environ 25 000 dollars, contre 125 000 dollars pour les pays développés, dont les sous-sols sont exploités depuis bien plus longtemps. Il est donc très probable que la valeur du sous-sol africain soit sous-estimée ».
Responsabilité sociétale dans les industries extracteurs : les principaux référentiels
En matière de durabilité, les entreprises extractives peuvent se référer à des normes, référentiels et lignes directrices nationaux et internationaux dans le but d’intégrer toutes les dimensions de la responsabilité sociétale de leurs activités.
Ces normes, guides ou lignes directrices ont pour objectif de renforcer la contribution des organisations qui les mettent en œuvre au développement des zones dans lesquelles elles opèrent. Les normes intègrent, entre autres, des préoccupations relatives à l’efficacité des investissements, à la cohérence de leur démarche administrative et financière, aux questions sociales comme la santé, le bien-être de la société, aux attentes des parties prenantes, au respect des lois en vigueur, etc. Plusieurs entreprises du secteur minier ont adhéré à des initiatives internationales ou des normes nationales de gestion, de transparence et de durabilité sociale, culturelle et environnementale.

Au niveau international, des initiatives comme le Pacte Mondial des Nations Unies, les Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’Homme, les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, l’Initiative pour la Transparence des Industries Extractives (ITIE/EITI) sont autant des lignes directrices qui peuvent orienter les activités minières vers la durabilité.
Selon les secteurs d’activités, les sociétés minières adhèrent aux normes propres aux produits comme le Code International de gestion du cyanure (or), les Pratiques responsables de joaillerie et le Processus de Kimberley (diamant). D’autres minières s’assurent de répondre aux critères de performance de la Société financière Internationale (SFI) en matière de durabilité sociale et environnementale, aux indices d’investissement socialement responsable dont l’Indice de durabilité Dow Jones avec l’Indice de la responsabilité sociale Jantzi (JSMD), à des critères spécifiques tels que ceux de Bloomberg qui ont intégré de l’information environnementale et sociale dans les analyses, de la série d’indices
Développement du secteur minier durable : expérience de l’Initiative RSE Sénégal
L’étude est revenue sur quelques principes fondamentaux de la responsabilité sociétale devant être appliqués dans tous les segments de la société, par tous ses acteurs, si « nous voulons réellement aller vers une émergence économique de nos États et en particulier un développement d’un secteur minier durable ».
« Depuis plusieurs années, nous travaillons pour une mise en place de programmes nationaux de promotion de la RSE et du développement durable, qui cibleraient tous les acteurs socio-économiques de notre société, en particulier les parties prenantes des entreprises ».
Ces programmes viseraient une appropriation par tous ces acteurs des principes suivants :
– le principe de rendre compte en toute transparence. Il faut à cet effet se féliciter de la mise en place dans le secteur minier, de plusieurs pays de la sous-région, d’un Secrétariat dédié à l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE);
– le principe de respecter les intérêts et les attentes des parties prenantes, ce qui nécessite bien entendu que nous puissions améliorer la qualité du dialogue multipartite, notamment dans le secteur minier où l’on rencontre encore trop souvent une réelle méfiance des populations à l’égard des compagnies minières; – je finirai par un principe qui me tient particulièrement à cœur face notamment aux pertes de valeurs constatées dans nos sociétés, il s’agit de l’éthique dans nos comportements individuels et collectifs, qui ont très souvent un impact négatif sur nos systèmes de gouvernance public et privé.
En second lieu, faire un partage de l’expérience au Sénégal d’un dispositif qui a été mis en place en 2008 par une structure du secteur privé pour promouvoir justement ce concept de RSE et de DD. Il s’agit de l’Initiative RSE Senegal. Cette initiative privée a été créé en 2008 autour d’une vision et de valeurs :
– La vision d’une Afrique de l’Ouest qui ne se développera pas sans une valorisation de ses ressources locales, à savoir une valorisation du capital humain et surtout une transformation industrielle locale de ses richesses naturelles, notamment agroalimentaire, agroforestière et également minérale ;
– Des valeurs partagées, gage de durabilité et de pérennité du partenariat des entreprises avec leurs parties prenantes
La première originalité de ce dispositif, selon le document, est qu’il est bâti autour d’une plateforme opérationnelle d’échanges, de partage et de facilitation de contacts entre 3 catégories d’acteurs intéressés par les questions de promotion de la RSE et du développement durable : le Réseau RSE comprenant à ce jour 31 grandes entreprises et PME parmi lesquelles plusieurs compagnies minières: Terangagold et Iamgold (compagnies minières canadiennes en production dans le secteur aurifère); Grande Côte Opérations (compagnie australo-française en production dans le secteur du zircon); SOCOCIM Industries (compagnie française en production dans le secteur du ciment).
L’autre originalité de ce dispositif concerne la création de la Charte RSE et DD des Entreprises du Sénégal par un groupe de 11 grandes entreprises partenaires.
Ce document adapté au contexte économique du Sénégal et à toutes les catégories d’entreprises, petites et grandes, se veut à la fois un support de formation sur la RSE et un outil de cadrage des politiques RSE pour les entreprises qui s’engagent dans des démarches RSE structurées.

Il informe qu’à ce jour, 23 entreprises se sont engagées à suivre les 7 lignes directrices suivantes, dans le cadre de leur politique RSE: « 1-L’accent est mis en premier lieu sur la nécessité pour les entreprises signataires de définir et de partager à l’interne et auprès de leurs parties prenantes des valeurs en lien avec l’Éthique et la bonne gouvernance. L’objectif est non seulement de renforcer la culture d’entreprise auprès des collaborateurs mais également d’utiliser les collaborateurs comme de véritables relais de diffusion des principes de la RSE à l’extérieur, dans la société. S’inspirant des réalités africaines, des entreprises signataires telles Fumoa et Cofisac (filiale du Groupe IPS) au Sénégal ou le Groupe AZALAI Hôtels dans ses pays d’implantation mettent en pratique cet engagement sous forme de « causeries» de 10 minutes sur les valeurs, animées régulièrement en langues locales entre groupes des travailleurs.
Le document met l’accent sur l’engagement environnemental des entreprises en lien avec la préservation des ressources naturelles, l’atténuation des pollutions et surtout le potentiel d’emplois verts que peuvent générer des pratiques et une politique environnementale : les entreprises signataires doivent avoir à l’esprit qu’elles sont des acteurs importants pour développer et structurer une économie verte au Sénégal ». Par exemple, on peut observer que plusieurs entreprises du Réseau RSE Sénégal (Simpa, Eiffage Sénégal, Cbao Attijariwafa bank, Neurotech) ont contractualisé avec des petites entreprises pour la collecte et la valorisation des déchets.
Revenant sur les bonnes pratiques des affaires contribuant au développement économique local, le ilindique que les entreprises signataires doivent contribuer dans leurs chaînes de valeurs respectives à la lutte contre le chômage des jeunes et à la formalisation de leurs secteurs (deux préoccupations majeures des pays africains) en mettant en œuvre des politiques d’achat local privilégiant la contractualisation avec des micros et petites entreprises (MPE) et des PME locales engagées elles-mêmes dans la RSE et potentiellement créatrices d’emplois. L’exemple est donné par les compagnies minières (Terangagold, Sococim Industries) dans le cadre de leur politique de sous-traitance.
La nécessité d’orienter les entreprises dans la création et/ou le soutien de véritables projets RSE structurants qui ont un réel impact par rapport aux enjeux de DD. C’est notamment le cas en ce qui concerne la question du chômage et de l’emploi des jeunes, préoccupation partagée au Sénégal tant par les plus hautes autorités du pays que par les entreprises responsables.
Par rapport à cette problématique spécifique, une des solutions réside dans l’implication des entreprises responsables dans des projets RSE qui soutiennent la création de nouveaux dispositifs de formation, d’insertion professionnelle et d’accompagnement des Très Petites Entreprises. C’est le cas au Sénégal avec l’Incubateur de Thiès pour l’Économie Verte (ITEV), véritable projet structurant RSE, en cours de création, porté dans le cadre d’un Partenariat Public Privé ( PPP ) par l’Initiative RSE Sénégal ( en tant qu’institution du Secteur privé ), l’Institut des Sciences de l’Environnement (ISE) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) ( en tant qu’établissement public de recherche sur l’Environnement ), l’Institut Supérieur d’Enseignement Professionnel de Thiès (ISEP-Thiès) et le Lycée d’Enseignement Technique et de Formation Professionnelle de Thiès ( voir en encadré ).
La nécessité d’une plus forte implication des États dans la vulgarisation de la RSE
« Malheureusement, on constate encore une absence de réelles incitations proposées par l’État pour des entreprises qui décident de réinvestir une partie de leurs profits dans des projets de développement durable ayant un fort impact social et environnemental.
Le droit fiscal commun dans de nombreux pays africains ne prévoit aucune disposition particulière favorable pour ce type de projets structurants initiés dans le cadre de la RSE. Et quand les textes juridiques spécifiques à la création de Fondation d’entreprise existent, ce sont les procédures de reconnaissance du statut d’utilité publique qui sont excessivement longues et décourageantes pour les entreprises » souligne l’étude.
La nécessité de mettre l’accent sur le renforcement des capacités en matière de RSE
D’après elle, l’un des obstacles majeurs à la vulgarisation de la RSE en Afrique de l’Ouest reste encore la méconnaissance de la RSE et de ses avantages ( notamment en termes d’avantages concurrentiels, d’amélioration de la productivité du travail ou de réduction des charges d’exploitation ) par une grande majorité de dirigeants et de cadres d’entreprises ainsi que leur manque d’anticipation et de prospective, davantage préoccupés qu’ils sont par la gestion quotidienne de leurs entreprises, avec les multiples priorités urgentissimes. Il est important que des programmes de sensibilisation et de formation sur la RSE soient développés pour l’ensemble des acteurs concernés par la RSE et en particulier dans les milieux académiques.
« Si au Sénégal, ce dispositif est constitué au niveau micro de plusieurs grandes entreprises et PME sénégalaises socialement engagées, et au niveau méso par l’existence de l’Initiative RSE Senegal, ce dispositif reste à être complété par un plus fort engagement de l’État dans le domaine de la diffusion des principes et des valeurs de la responsabilité sociétale au niveau du citoyen, dans l’environnement des affaires, dans les milieux académiques et en particulier de la formation professionnelle, dans les administrations, dans la société civile, dans les médias, etc. ».
Regard sur des problématiques en lien avec la RSE en Afrique de l’Ouest

Cet extrait de l’étude sur « la RSE pour un développement minier durable en Afrique de l’Ouest » a pour objectif d’illustrer la problématique de l’orpaillage notamment ses impacts, ses potentiels et ses relations avec l’industrie minière. Activité traditionnelle et séculaire qui consistait, au sens premier du terme, à extraire au moyen de lavage, des paillettes d’or des alluvions de certains cours d’eau, l’orpaillage connait de l’ampleur de nos jours du fait de la remontée du cours de l’or. Ainsi, un afflux massif de populations a été noté sur les sites d’orpaillage posant des problèmes de tous ordres avec l’utilisation de méthodes et techniques modernes sans respect des normes sécuritaires et environnementales. Il est aussi noté une cohabitation difficile avec les sociétés minières qui se plaignent de la présence des orpailleurs sur leurs périmètres.
En Afrique de l’Ouest, précise le document, les exploitations minières artisanales sont marquées par l’importance du nombre de personnes directement impliquées et leur contribution dans la production d’or, de diamants et de pierres précieuses dans des pays comme le Burkina, la Guinée et la Sierra Leone. Ainsi, les Etats sont conscients qu’il s’agit non pas d’un phénomène marginal mais bien d’une activité socio-économique de premier plan, certes ancestrale dans la sous-région, qu’il faille intégrer dans l’ensemble des politiques sectorielles régionales.
Aux impacts environnementaux multiples sur le milieu naturel, s’ajoute la naissance de « villages champignons » qui se développent au hasard de nouvelles découvertes, sans cohésion sociale avec une précarité qui dégrade les tissus socio-familiaux ou ethniques et entraîne le développement de diverses formes de délinquance.
À des degrés divers, chaque pays de l’espace de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), confronté au problème des exploitations minières artisanales incontrôlées, a tenté des interventions qui se sont, en général, avérées peu productives. Aussi, les experts suggèrent-ils une approche communautaire axée sur le renforcement des capacités et des interventions concertées et permettant d’importantes économies d’échelle et une efficacité accrue avec comme objectifs :
– mieux contrôler les productions et éviter les fraudes: c’est particulièrement le cas pour ce qu’on a appelé «les diamants de la guerre » et pour lesquels le processus de Kimberley a été mis en place ;
– améliorer la valorisation des richesses naturelles: les taux de récupération de l’or ne dépassent en effet pas les 50% dans les sites d’orpaillage ;
– réduire les impacts sanitaires et sociaux : ces gros rassemblements sont des foyers de développement de maladies, la main d’œuvre enfantine y est présente, la drogue y circule, l’usage du mercure pour l’amalgamation de l’or fait peser une menace directe sur la santé des orpailleurs;
– éviter les conflits d’usage des terres que ce soit avec les agriculteurs, les éleveurs ou avec les grandes compagnies minières
L’article souligne que diverses actions ont été entreprises et peuvent être consultées au travers des différents rapports de projets et d’étude (ALG, PRECAGEM, CASM, Banque mondiale, MMSD, Nations Unies). Il en ressort que pour remédier à cette situation et normaliser la filière, il est nécessaire de favoriser le développement des petites exploitations par:
– des approches non traditionnelles de solutions intégrées qui tiennent compte des différents types d’exploitations;
– l’amélioration des cadres institutionnels et légaux;
– la sensibilisation et la formation des acteurs concernés;
– le transfert de technologies;
– la mise en œuvre de stratégies de lutte contre les IST/ VIH/ SIDA.
Développement durable et environnement
L’étude indique que l’Alliance pour une Mine Responsable (AMR) a initié en 2014 le projet «filière or équitable et réduction de l’utilisation du mercure dans l’orpaillage en Afrique de l’Ouest, spécialement au Sénégal, au Mali et au Burkina Faso». Ce projet, qui couvre, dans sa phase pilote le Sénégal, le Mali et le Burkina, a pour objectif général «la formalisation de l’orpaillage et la lutte contre les effets nocifs du mercure.» Il vise à organiser les orpailleurs, formaliser l’orpaillage et promouvoir les bonnes pratiques d’exploitation en prenant en compte les aspects environnementaux, sociaux, sanitaires et de sécurité du travail.
Une prime compensatoire de 10 à 15 % est la mesure d’incitation appliquée à tout orpailleur exploitant sans l’utilisation de produits nocifs comme le mercure. Cette mesure l’incite à une production plus considérable d’or qu’il pourra vendre à un prix proche de celui du cours mondial.
Dans sa phase d’exécution, le projet d’une durée de trois ans, est réalisée par l’AMR avec l’appui de ses partenaires, en l’occurrence l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), le Conseil pour l’Or Artisanal (AGC) et d’autres organismes. Sa mise en œuvre dans la région de Kédougou se fait en collaboration avec l’Association Kédougou Action et Développement (AKAD) et déjà, trois structures ont été identifiées pour exécuter la phase pilote.

Gouvernance minière
En ce qui concerne l’exploitation artisanale, par la mise en place de Comptoirs d’achat de métaux précieux et de pierres précieuses les Etats veulent assurer avec efficacité, dans le cadre de leur missions régaliennes, le contrôle de l’or et des pierres précieuses dans toute la chaîne, depuis la production jusqu’à la commercialisation et de lutter contre la délinquance financière dans ce sous-secteur.
La gouvernance minière concerne plus les Etats et les sociétés minières qui y opèrent. Les Etats-Unis et le Royaume-Uni disposent de législations anti-corruption dont le champ d’application territorial est extrêmement large et a vocation à s’appliquer dans le monde entier dès lors qu’il existe certains liens de rattachement avec ces états.
L’obligation que les gouvernements ont de rendre compte des recettes issues des projets miniers est devenue un grand sujet de gouvernance. L’intégration des principes de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives et du Plan de certification du processus de Kimberly dans les politiques, les lois et la réglementation nationales est encouragée par les institutions internationales.
Genre
En Afrique, en dépit des progrès politiques et législatifs en matière d’égalité des sexes, les règles socioculturelles qui régissent les communautés et les familles maintiennent grandement les inégalités de genre.
Comme le stipule une étude du BIT citée par le document, dans la lutte contre le travail des enfants et des pires formes de travail des enfants, il est urgent de généraliser l’analyse selon le genre adoptée par les gouvernements membres des Nations Unies en 19722 et institutionnalisée par l’OIT.
Le « genre » doit être reconnu comme une variable qui affecte la réalisation des actions de lutte contre le travail des enfants et les pires formes de travail des enfants. Le retrait des enfants du travail dans les mines et carrières ne saurait faire l’économie de la situation particulière des filles. Il ne suffit pas de les inclure dans les programmes déjà existants. Il faut structurer les stratégies et adapter les appuis en fonction de leurs contraintes, besoins et attentes spécifiques. Synthèse Yaye Moussou TRAORE
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]