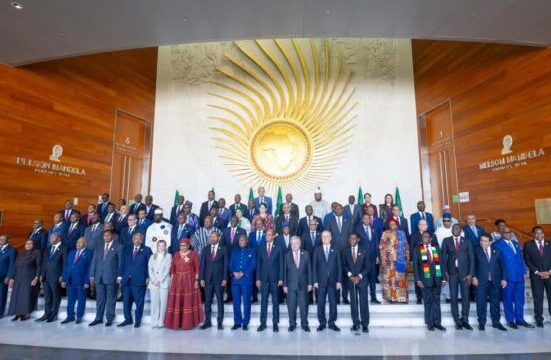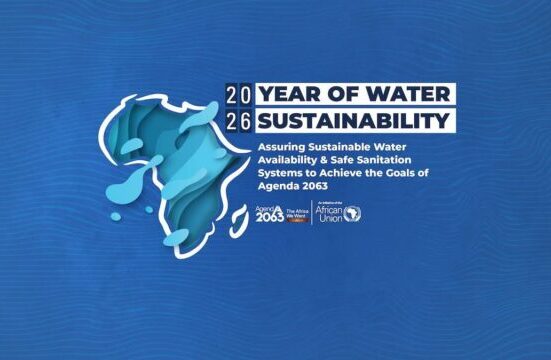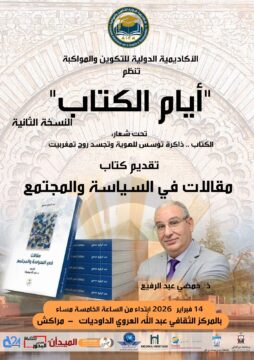Sébastien-Yves Laurent
LE RENSEIGNEMENT joue un rôle essentiel dans la stratégie des États, mais il pose une question centrale pour les démocraties : comment concilier la nécessité du secret avec les principes de transparence et de publicité ? Dans son ouvrage « État secret, État clandestin. Essai sur la transparence démocratique », récompensé par le Grand Prix de l’Académie du Renseignement 2024, Sébastien-Yves Laurent analyse cette tension à travers une étude comparative de trois grandes démocraties : la France, le Royaume-Uni et les États-Unis.
Comprendre le renseignement
Le renseignement correspond à la collecte, l’analyse et la transformation de l’information pour orienter les décisions des autorités. Il peut concerner la diplomatie, la sécurité intérieure ou encore la stratégie militaire. Pourtant, il est souvent perçu de manière négative, associé à des pratiques opaques voire sales. Sébastien-Yves Laurent insiste sur le fait qu’il ne faut pas moraliser cette activité : elle est.
Une contradiction entre renseignement et démocratie ?
A première vue, renseignement et démocratie sont difficilement compatibles. La démocratie repose sur la publicité et la transparence, alors que le renseignement exige la discrétion. Toutefois, cette contradiction n’est pas insoluble. Au fil des siècles, les démocraties ont progressivement encadré le renseignement, cherchant à le rendre compatible avec l’État de droit tout en maintenant un certain niveau de secret indispensable à son efficacité.
L’évolution du renseignement dans les démocraties
Dans son ouvrage, l’auteur fait une distinction entre l’État secret et l’État clandestin. L’État secret désigne un renseignement régulièrement encadré par des lois et soumis à des contrôles institutionnels. A l’inverse, l’État clandestin correspond à des pratiques qui échappent à tout encadrement et qui ne sont pas officiellement reconnues.
Depuis la loi de juillet 2015, adoptée après les attentats contre Charlie Hebdo, la France a tenté de rattraper son retard en matière de contrôle des services de renseignement. Cette loi leur a donné un cadre juridique clair et les a soumis à des instances comme la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), garantissant un minimum de supervision.
Comparaison entre la France, le Royaume-Uni et les États-Unis
Les différences entre les pays sont notables. Aux États-Unis, les services de renseignement sont soumis à un contrôle parlementaire et judiciaire strict, avec des obligations de publicité sur certaines activités. Le Royaume-Uni, au contraire, accepte une dérogation bien plus large au principe de transparence. Historiquement, les services de renseignement britanniques ont fonctionné dans un cadre très secret, avec un contrôle limité. La France se situe entre ces deux modèles, avec un effort récent pour renforcer la surveillance des services, mais encore des lacunes, notamment sur la déclassification des documents classés secrets.
Un enjeu de coopération internationale
Les alliances en matière de renseignement jouent un rôle crucial dans la géopolitique actuelle. Par exemple, la guerre russe en Ukraine a montré l’importance du partage d’informations entre les États-Unis et l’Ukraine, mais aussi avec les pays européens. Si les services américains arrêtaient de partager certaines informations stratégiques, cela aurait des conséquences majeures sur le conflit.
A l’échelle européenne, il existe un service de renseignement appelé EU Intelligence Center, mais il reste limité. Il ne collecte pas directement d’informations et dépend des contributions volontaires des pays membres, ce qui réduit son efficacité.
Ressources recommandées
Pour aller plus loin sur cette question, l’ouvrage de Sébastien-Yves Laurent « État secret, État clandestin. Essai sur la transparence démocratique » (éd. Gallimard) constitue une ressource de référence. Il a été récompensé par le Grand Prix de l’Académie du Renseignement 2024, une distinction qui valorise les recherches approfondies sur ces thématiques.
D’autres sources pertinentes incluent les rapports de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) ainsi que les publications du Conseil d’État et des institutions parlementaires qui supervisent les services de renseignement. Ces documents permettent de mieux comprendre l’évolution et les défis de l’encadrement du renseignement dans les démocraties modernes.
Par Emilie BOURGOIN, Pierre VERLUISE, Sébastien-Yves LAURENT,