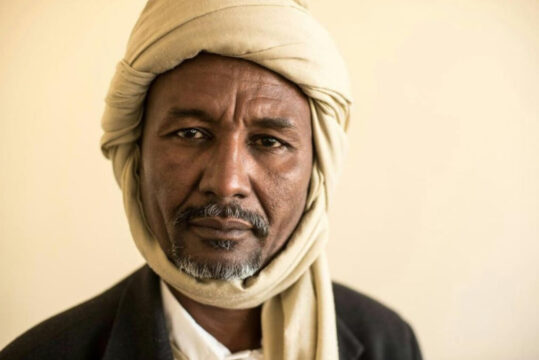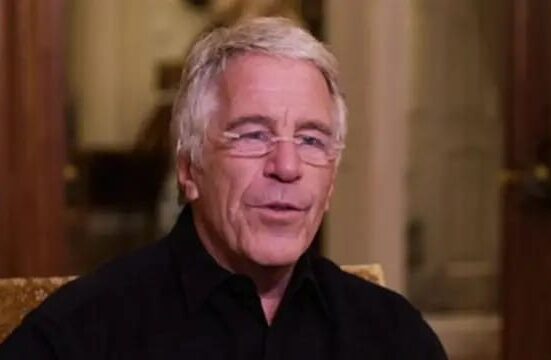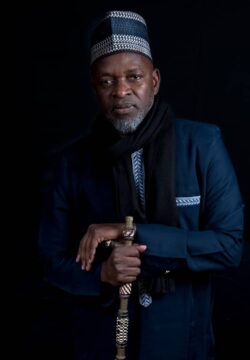Le présent rapport des Nations-Unies, qui couvre la période allant du 23 juin 2022 au 30 décembre 2022, offre un aperçu de l’évolution de la situation et des tendances observées en Afrique de l’Ouest et au Sahel, ainsi que des activités menées par le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS) et des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel. Les cas du Sénégal et d’autres pays y sont étudiés en abordant notamment les aspects sécuritaires, socioéconomiques, politiques, de gouvernance, etc. Le Secrétaire général y fait par ailleurs le point sur la situation dans le bassin du lac Tchad, conformément aux dispositions de la résolution 2349 (2017) du Conseil de sécurité.
Évolution de la situation et tendances observées en Afrique de l’Ouest et au Sahel
Selon le rapport de l’ONU, au cours de la période considérée, certains États Membres d’Afrique de l’Ouest et du Sahel ont continué de s’atteler à consolider leurs démocraties, tandis que d’autres sont restés aux prises avec des problèmes d’insécurité, de consolidation de la démocratie et de bonne gouvernance, continuant en outre de faire face à des crises humanitaires. En juillet, des élections législatives ont eu lieu au Sénégal, lesquelles se sont déroulées dans le calme. En Côte d’Ivoire, les efforts visant à mettre en œuvre les décisions prises lors du dialogue politique conclu en mars 2022, ainsi qu’à promouvoir la cohésion sociale et la réconciliation, se sont poursuivis. Au Nigéria, à l’approche des élections générales prévues pour 2023, les candidats à la présidence ont signé un engagement en faveur de la paix, promettant que leur campagne électorale serait pacifique et axée sur de vrais enjeux. Dans le même temps, en Guinée-Bissau et en Sierra Leone, où sont attendues des élections législatives et générales, les tensions sociopolitiques ont perduré. Dans ce contexte, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), avec le soutien de l’ONU, a poursuivi ses efforts pour assurer le rétablissement pacifique de l’ordre constitutionnel au Burkina Faso, en Guinée et au Mali.
Les conditions de sécurité ont continué de se détériorer dans de grandes parties du Sahel, le nombre de victimes de violence et de blessés, notamment des femmes et des enfants, augmentant. Les menaces d’une propagation du terrorisme vers le sud, dans les États côtiers d’Afrique de l’Ouest, demeurent. Pour la première fois, des civils ont été pris pour cible au Togo, tandis que le nord du Bénin a été frappé par une nouvelle attaque, revendiquée par l’État islamique du Grand Sahara. Par ailleurs, un individu suspecté d’appartenir à Boko Haram a pour la première fois été capturé dans la région nord du Haut Ghana oriental. Face à ces difficultés, certains États Membres de la sous-région ont renforcé leur coopération dans le cadre de l’Initiative d’Accra, mécanisme créé en 2017 pour répondre aux menaces contre la sécurité accrue pesant sur les États côtiers d’Afrique de l’Ouest du fait de la propagation du terrorisme et de la criminalité transnationale organisée.
La situation humanitaire, en particulier dans le centre du Sahel, est restée catastrophique, celle-ci ayant en outre été aggravée par une hausse des prix des denrées alimentaires et de l’énergie ainsi que par des catastrophes climatiques, en raison de fortes pluies, d’inondations et de la pollution de l’eau.
Des progrès ont été réalisés au cours de la période considérée en matière de justice transitionnelle et de lutte contre l’impunité, bien que des inquiétudes persistent dans certains pays de la sous-région concernant le rétrécissement de l’espace civique et politique. De plus, aucune avancée significative n’a été constatée en ce qui concerne la représentation des femmes et leur participation aux processus décisionnels.
Politique et gouvernance au Sénégal et ailleurs
Sur ce plan, le rapport de l’ONU souligne qu’au Bénin, tous les grands partis politiques ont accepté de prendre part aux élections législatives prévues pour le 8 janvier 2023. Le Président du pays, Patrice Talon, s’est réuni avec ses prédécesseurs, Nicéphore Soglo et Thomas Yayi Boni, ainsi qu’avec des dirigeants politiques de l’opposition. Ce faisant, il a contribué à apaiser les tensions politiques apparues dans le pays au lendemain des précédentes élections législatives et présidentielle. En outre, plusieurs dirigeants de l’opposition qui avaient été détenus dans le cadre de l’élection présidentielle d’avril 2021 ont été libérés. Cela n’a toutefois pas été le cas pour tous, certains éminents dirigeants de l’opposition, dont ReckyaMadougou et Joel Aivo, étant toujours incarcérés.
Au Burkina Faso, plusieurs manifestations ont eu lieu le 7 juillet pour protester contre la visite de l’ancien Président, Blaise Compaoré, revenu dans le pays pour la première fois depuis son exil en novembre 2014, à l’invitation du Président de transition de l’époque, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Le 30 septembre, une faction du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration dirigée par le capitaine Ibrahim Traoré a renversé le Président de transition, Paul-Henri Sandaogo Damiba, lors d’un deuxième coup d’État, le premier remontant à janvier 2022. Le 14 octobre, une charte de transition s’accompagnant d’un calendrier de mise en œuvre sur 21 mois a été adoptée lors d’une conférence nationale. Le 20 octobre, le capitaine Traoré a prêté serment en tant que Président de transition.
À Cabo Verde, des consultations inclusives ont été organisées entre tous les principaux acteurs politiques au sujet de la révision du code électoral et d’autres réformes, s’agissant notamment de la prise en compte des questions de genre dans la planification et la mise en œuvre des politiques gouvernementales. Dans le même ordre d’idées, les nominations au sein du système judiciaire, de l’autorité de contrôle des médias et de la Commission électorale nationale ont fait l’objet d’un consensus entre les partis.
En Côte d’Ivoire, le 14 juillet, le Président, Alassane Ouattara, a rencontré, pour la première fois depuis la crise post-électorale de 2010-2011, deux de ses prédécesseurs, à savoir Laurent Gbagbo, du Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire, et Henri Konan Bédié, du Parti démocratique de Côte d’IvoireRassemblementdémocratique africain. Cette réunion a contribué à la création d’un environnement propice à la réconciliation nationale.
En Gambie, le gouvernement qui avait été nommé après les élections législatives d’avril a repris le processus de réforme démocratique initié par la précédente législature. Il s’est par ailleurs efforcé de faire avancer le processus de justice transitionnelle. Néanmoins, les organisations de victimes ont critiqué la lenteur avec laquelle étaient mises en œuvre les recommandations contenues dans le rapport de la Commission vérité, réconciliation et réparations. Dans le même temps, le Comité interpartis a encouragé les initiatives visant à favoriser l’inclusivité à l’approche des élections locales, prévues en mai 2023. Celui-ci a notamment fourni une plateforme propice au dialogue entre les partis politiques et œuvré à l’élaboration de principes au titre desquels tous les partis s’engageraient à inclure des femmes, des jeunes et des personnes handicapées dans leurs structures de prise de décisions ainsi que sur leurs listes de candidats.
Au Ghana, des désaccords ont persisté entre la Commission électorale et le principal parti d’opposition, le New DemocraticCongress, concernant la décision prise par la Commission de n’utiliser que la carte d’identité nationale comme document d’identification pour la mise à jour du registre électoral en vue des élections générales de 2024. Le 5 août, face à la menace de propagation de l’insécurité depuis les pays du Sahel, le Président du Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, a nommé de nouveaux responsables de la sécurité nationale. Dans le même temps, le 5 octobre, le mécontentement de la population face à la crise économique qui se poursuivait dans le pays a donné lieu à une manifestation de grande ampleur.
En Guinée, des désaccords de longue date concernant la portée et la durée de la transition ont accentué les divisions entre les autorités et les principaux acteurs politiques et responsables de la société civile. Les tentatives de dialogue entreprises par le Gouvernement sont restées vaines, en raison d’un manque de confiance entre les parties, aggravé par des allégations d’actions judiciaires à motivation politique visant des personnalités de la société civile et de l’opposition. Le 8 août, les autorités ont dissous le Front national pour la défense de la Constitution, plateforme regroupant des partis politiques, des syndicats et des acteurs de la société civile, qui avait organisé plusieurs manifestations au cours de la période considérée afin d’exiger un processus de transition inclusif et rapide, durant lesquelles au moins 12 civils avaient été tués. Dans ce contexte, lors de sa 62esession ordinaire, la Conférence des chefs d’État et de gouvernement des États membres de la CEDEAO a salué le calendrier de transition de 24 mois élaboré conjointement par les autorités guinéennes et les experts de la CEDEAO. Celle-ci a également fait remarquer que ladite transition devait commencer immédiatement et a appelé à un dialogue politique inclusif.
En Guinée-Bissau, la préparation d’élections législatives anticipées, initialement prévues pour le 18 décembre, a été entravée par des difficultés d’ordre logistique et financier, qu’est venue aggraver l’absence de consensus entre les principaux acteurs politiques sur de grandes questions en lien avec les élections. Lors de consultations organisées par le gouvernement le 17 octobre, les partis politiques ont insisté sur la nécessité de mettre en place un nouveau système d’inscription des électeurs en vue du scrutin. Ils ont également remis en question la légalité constitutionnelle de la Commission électorale nationale, étant donné l’expiration de son mandat de quatre ans en avril et la nomination de deux des quatre membres de son secrétariat aux postes de juges du Tribunal suprême de justice et de la Cour des comptes, respectivement. À l’issue de ces consultations, le Gouvernement a proposé au Président de reporter les élections à mai 2023, pour des raisons techniques et financières. Le 16 décembre, le Président de la Guinée-Bissau, Umaro SissocoEmbaló, a signé un décret fixant la date des élections au 4 juin 2023, l’inscription des électeurs ayant par ailleurs commencé le 10 décembre.
Au Libéria, les préparatifs des élections générales prévues pour octobre 2023 se sont poursuivis, dans un environnement calme mais polarisé. Le projet de réforme de la loi électorale prévoyant un quota de 30 % de femmes aux élections sénatoriales et parlementaires a été adopté par la Chambre des représentants et le Sénat. Sur fond d’allégations de corruption liées au non-respect des règles de passation des marchés, la fourniture d’équipements d’enregistrement biométrique des électeurs a connu des retards.
Au Mali, la conclusion d’un accord entre les autorités et la CEDEAO sur la prolongation de la période de transition a conduit à la levée partielle des sanctions imposées au pays par l’organisation sous-régionale. En ce qui concerne les 49 soldats ivoiriens arrêtés le 10 juillet par les autorités maliennes à l’aéroport de Bamako, de solides efforts régionaux et internationaux ont été déployés en vue de leur libération. En août, le Président du Togo, Faure Essozimna Gnassingbé, a entamé des pourparlers diplomatiques à cette fin et, le 3 septembre, 3 des 49 soldats – toutes des femmes – ont été libérés.
En Mauritanie, lors d’une réunion organisée le 26 septembre par le Ministre de l’intérieur et de la décentralisation, 24 des 25 partis politiques enregistrés ont signé un accord sur l’organisation d’élections législatives, régionales et municipales en 2023. Le parti Alliance pour la Justice et la Démocratie/Mouvement pour la Rénovation a boycotté la réunion. Le 31 octobre, les 11 membres de la Commission électorale nationale indépendante ont été nommés, dont 5 appartenaient à l’opposition.
Au Niger, le 9 septembre, Tahirou Saidou, chef de l’opposition, et d’autres représentants de l’opposition ont participé à une session du Conseil national de dialogue politique, un type de rencontre auquel ils refusaient de se joindre depuis 2016. Le Conseil national de dialogue politique a exprimé son soutien aux forces de sécurité et discuté de l’organisation, par la Commission électorale nationale indépendante, d’élections législatives partielles pour les cinq sièges vacants de la diaspora à l’Assemblée nationale. Le 14 octobre, le Premier Ministre, Mahamadou Ouhoumoudou, a mis en place un comité composé de représentants de la majorité, de l’opposition et des partis non alignés, qu’il a chargé de réviser le fonctionnement du Conseil national de dialogue politique. Dans le même temps, le Mouvement M62, coalition de la société civile, a organisé plusieurs manifestations pour protester contre la présence de forces internationales et l’inflation croissante dans le pays. 18.Au Nigéria, les préparatifs des élections présidentielle et législatives ainsi que des élections appelées à désigner les gouverneurs et les représentants siégeant dans les assemblées des États, prévues pour les mois de février et mars 2023, se sont déroulés dans un environnement relativement calme. Les campagnes pour ces deux types de scrutin ont débuté le 28 septembre et le 12 octobre, respectivement. Entretemps, la Commission électorale nationale indépendante a notamment surveillé les partis politiques pour éviter toute violation du premier Accord national de paix, préparé par le Comité national pour la paix afin de guider les campagnes électorales et signé par les chefs de parti le 29 septembre.
Au Sénégal, une fois passés certains désaccords quant à l’éligibilité de plusieurs candidats de l’opposition, des élections législatives se sont tenues le 31 juillet. La coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar, a remporté 82 des 165 sièges de l’Assemblée nationale, contre 125 auparavant. Les coalitions d’opposition Yewwi Askan Wi, dirigée par Ousmane Sonko, et Wallu Senegal, dirigée par l’ancien Président, Abdoulaye Wade, ont obtenu respectivement 56 et 24 sièges. Le 18 septembre, Amadou Ba a été nommé Premier Ministre d’un gouvernement remanié comprenant 25 % de femmes.
Le 28 juillet, le Parlement de la Sierra Leone a approuvé un code électoral modifié, avec le soutien de l’opposition. Les préparatifs des élections générales devant se tenir en juin 2023 se déroulent cependant dans un climat de tensions politiques. Motivés par le mécontentement de la population quant à l’augmentation du coût de la vie et des allégations d’instrumentalisation du système judiciaire contre des dirigeants de l’opposition, de violents affrontements entre manifestants et forces de sécurité ont éclaté le 10 août à Freetown, Makeni et dans d’autres villes, notamment dans le nord-ouest du pays, faisant au moins 25 victimes, dont 4 policiers. Le 13 août, la maire de Freetown, Yvonne Aki-Sawyerr, membre de l’opposition, a été arrêtée pour avoir fait obstruction à la police, puis libérée sous caution. L’environnement politique est resté tendu et polarisé, le Gouvernement ayant demandé à la Commission électorale, le 20 octobre, que les élections générales de 2023 soient organisées sur la base du système de représentation proportionnelle plutôt qu’en ayant recours au système de scrutin majoritaire à un tour, fondé sur des circonscriptions, qui jusque-là était utilisé.
Au Togo, à l’approche des élections régionales de 2023 et compte tenu des nouvelles menaces terroristes se profilant dans le Nord, la Première Ministre, Victoire Tomegah Dogbé, s’est réunie avec des représentants des partis politiques le 4 août en vue de discuter des efforts devant être déployés par le Gouvernement pour lutter contre l’insécurité. Cette rencontre a permis le dégagement d’un consensus entre les partis s’agissant des mesures que le Gouvernement devait prendre à cet égard.
Situation de sécurité
Les conditions de sécurité dans la sous-région ont continué de se détériorer, notamment dans le centre du Sahel, en particulier au Burkina Faso et au Mali. Le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (Jamaat Nosrat el-Islam wal-Muslimin), affilié à Al-Qaida, s’est fréquemment mesuré à l’État islamique du Grand Sahara pour des questions d’accès aux ressources et d’influence, les civils se trouvant ainsi pris entre deux feux. La survenue d’attaques terroristes au Bénin et au Togo a mis en évidence la menace persistante de voir l’insécurité se propager aux pays côtiers. De son côté, le Nigéria est resté empêtré dans une crise sécuritaire multidimensionnelle.
Au Burkina Faso, diverses villes sont restées encerclées par des groupes armés, qui ont continué de cibler des infrastructures. Dans les grandes villes de province de Djibo et Dori, dans la région du Sahel, le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans et l’État islamique du Grand Sahara ont provoqué de multiples pertes civiles et militaires. Le 15 juillet, des groupes armés ont détruit deux ponts particulièrement importants dans la région du Sahel. Le 26 septembre, à Gaskindé, dans la province du Soum, une attaque visant un convoi d’approvisionnement d’environ 150 camions qui se dirigeait vers la ville de Djibo a fait une douzaine de victimes. Face à cette situation, les autorités ont notamment intensifié le processus de recrutement de volontaires de la défense civile, enrôlant jusqu’à 50 000 personnes. 24. Au Mali, après le départ des forces internationales, les groupes armés ont avancé dans l’est du pays, prenant le contrôle de vastes zones frontalières avec le Niger. Le 6 septembre, l’État islamique du Grand Sahara s’est opposé à des groupes extrémistes violents rivaux ainsi qu’au Mouvement pour le salut de l’Azawad, affilié aux Touaregs, et a pris le contrôle de la ville de Talataye, dans le cercle d’Ansongo (région de Gao).
Au Niger, des civils ont été la cible d’attaques perpétrées, pour la plupart, par des groupes affiliés à Boko Haram et des groupes dissidents. Le 29 août, des combattants que l’on suppose appartenir à Boko Haram ont tué 20 pêcheurs à Kablewa, près du lac Tchad. Le 16 octobre, deux femmes ont été tuées par un engin explosif improvisé à Diffa, dans le sud-est du pays, près de la frontière avec le Nigéria, où des groupes affiliés à BokoHaram et des groupes dissidents ont continué de se livrer à des activités criminelles, notamment des enlèvements contre rançon. Les conditions de sécurité ont cependant semblé se stabiliser, grâce, entre autres, à l’amélioration des mesures de sécurité et au démantèlement de bases terroristes par l’armée nigérienne, avec le soutien des forces internationales redéployées.
Dans le nord-est du Bénin, deux civils ont été tués les 13 et 14 septembre, lors de l’attaque d’un poste de douane situé à Malanville, dans le département de l’Alibori. Dans le nord du Togo, des civils ont pour la première fois été pris pour cibles directes, lors de quatre attaques coordonnées lancées les 14 et 15 juillet, qui ont fait au moins une douzaine de morts. En septembre, l’état d’urgence, qui avait initialement été déclaré en juin pour une période de trois mois, a été prolongé de six mois. 27. Au Nigéria, environ 2 000 personnes, dont 550 civils, ont perdu la vie entre juillet et septembre, en raison de problèmes de sécurité. Les milices armées, qui étaient principalement concentrées dans les États de Zamfara et Sokoto, dans le nordouest du pays, ont étendu leurs opérations aux États de Plateau, Benue et Delta, situés dans le centre et le sud. Dans le nord-est, des civils ont été pris dans des combats récurrents entre Boko Haram et la « Province d’Afrique de l’Ouest de l’État islamique », qui semble avoir gagné du terrain dans plusieurs localités de l’État de Borno. Le 15 septembre, un affrontement survenu entre les deux groupes à Gaizuwa (zone d’administration locale de Bama, dans l’État de Borno) a fait des dizaines de morts. Ces groupes ont en outre mené des attaques dans le Territoire de la capitale fédérale, Abuja. Le 5 juillet, la « Province d’Afrique de l’Ouest de l’État islamique » a revendiqué l’assaut donné contre la prison de Kuje, qui avait permis à 64 terroristes présumés de s’évader. Le 25 juillet, une attaque perpétrée le long de l’autoroute reliant Kaduna à Abuja a entraîné la fermeture d’écoles, après que huit soldats eurent perdu la vie, le 22 juillet, dans une attaque visant la brigade de la Garde présidentielle de l’armée dans la zone d’administration locale de Bwari. Autre fait similaire, la « Province d’Afrique de l’Ouest de l’État islamique » aurait également intensifié ses activités dans les États méridionaux de Kogi, d’Edo et d’Ondo, prenant souvent pour cibles les locaux de la police, des véhicules et des lieux de culte et faisant de nombreuses victimes. Le 12 août, les autorités ont signalé l’arrestation de suspects liés à la « Province d’Afrique de l’Ouest de l’État islamique », en relation avec le meurtre de 40 personnes, le 5 juin, lors d’une attaque perpétrée contre une église à Owo, dans l’État d’Ondo.
Dans le même temps, au Niger, les autorités ont encore intensifié les opérations anti-insurrectionnelles dans le nord-est, en particulier autour du lac Tchad. Le 12 août, le Président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a lancé une version révisée de la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme de 2016, au titre d’une nouvelle doctrine nationale de gestion des crises, dans laquelle il appelle notamment à une plus grande collaboration entre les institutions gouvernementales, sous la coordination du Bureau de la sécurité nationale.
Les pays touchés par le terrorisme dans la sous-région ont renforcé leur coopération en matière de sécurité. Le Niger a signé des accords de coopération militaire avec le Bénin et le Burkina Faso, respectivement le 11 juillet et le 22 août. Les États membres de l’Initiative d’Accra ont poursuivi leurs activités en cours et lancé des opérations de renforcement de la confiance dans certaines zones de tension. Le 22 novembre, ils se sont réunis au Ghana et ont appelé à la mise en place, dans un délai d’un mois, d’une force multinationale mixte de l’Initiative d’Accra, qui serait composée de 10 000 hommes.
Comme observé dans le dernier rapport en date du Secrétaire général sur la piraterie et les vols à main armée en mer dans le golfe de Guinée et leurs causes profondes (S/2022/818), la sûreté maritime dans le golfe de Guinée a continué de s’améliorer. Ainsi, aucun enlèvement n’a été signalé dans le domaine maritime de l’Afrique de l’Ouest durant le troisième trimestre de 2022. Les actes de piraterie et de vol à main armée commis en mer ont également diminué, passant de huit à deux. Cette amélioration s’explique par l’effet dissuasif des condamnations pour piraterie prononcées au Nigéria et au Togo en 2021, ainsi que par l’augmentation du nombre de patrouilles navales menées par les services de garde-côtes régionaux et internationaux. Il n’existe actuellement aucune preuve empirique de l’existence de liens opérationnels et organisationnels entre groupes extrémistes violents, groupes terroristes et groupes de pirates dans la sous-région.
Contexte socioéconomique
D’après le Fonds monétaire international, la croissance économique globale dans la sous-région est en baisse, ce qui vient mettre un terme à la reprise socioéconomique de l’après-COVID-19. La hausse des prix des denrées alimentaires et de l’énergie, conséquence notamment du conflit armé faisant rage en Ukraine, touche particulièrement les groupes vulnérables de la société. De plus, les coûteuses mesures d’atténuation mises en œuvre par, par exemple, les gouvernements du Burkina Faso, du Sénégal et du Togo ont entraîné une augmentation constante du poids de la dette, le ratio dette/produit intérieur brut approchant ou dépassant le seuil de 70 %. Au Ghana, où l’inflation est passée de 13,9 % en janvier à 37,2 % en septembre, le Gouvernement a souscrit un prêt de 3 milliards de dollars auprès du Fonds monétaire international en novembre. La Mauritanie et le Niger ont quant à eux augmenté le prix de l’essence, ce qui a entraîné des manifestations.
Entre juin et décembre, six pays de la sous-région ont achevé leur plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable (Bénin, Cabo Verde, Ghana, Niger, Nigéria et Togo).
Droits humains
La protection des civils est restée l’un des grands défis de la lutte contre les groupes terroristes et autres groupes armés organisés, ce qui a conduit les défenseurs et défenseuses des droits humains à promouvoir davantage le respect des normes nationales et internationales relatives à ces droits par les forces de sécurité. Au Burkina Faso, le Gouvernement a lancé des enquêtes au sujet d’allégations d’exécutions extrajudiciaires par les forces de sécurité à Tougouri, dans la région du Centre-Nord.
La lutte contre l’impunité a également progressé. Le 28 septembre, en Guinée, s’est ouvert le procès, devant un tribunal national, des auteurs présumés des crimes commis à Conakry le 28 septembre 2009. Onze individus, dont l’ancien Président de transition, le capitaine Moussa Dadis Camara, qui étaient notamment accusés de meurtre, de viol et de torture, ont comparu devant la Cour de Dixinn. Revêtant une importance historique, ce procès marque un tournant majeur pour les groupes de victimes en quête de justice. Le 27 septembre, à Abuja (Nigéria), le groupe chargé d’enquêter sur les violations commises par la brigade spéciale de répression des vols a présenté un rapport, dans lequel étaient notamment identifiés 72 policiers accusés d’exécutions extrajudiciaires, dont 28 devaient, selon les recommandations du groupe, faire l’objet de poursuites.
Des progrès ont été accomplis en matière de justice transitionnelle en Gambie, la suspension d’agents de l’État mentionnés dans le rapport de la Commission vérité, réconciliation et réparations représentant une première étape notable dans la mise en œuvre du livre blanc publié par le Gouvernement le 25 mai. Des consultations sur la création d’un tribunal mixte qui serait chargé de poursuivre les auteurs de crimes commis au temps de l’ancien Président, Yahya Jammeh, ont été organisées avec la CEDEAO. En outre, les discussions concernant la mise en place d’une commission indépendante de réparation et d’une unité judiciaire spéciale, recommandée dans le livre blanc, se sont poursuivies. Le 18 octobre, le Procureur général et le Ministre de la justice gambiens ont informé la Commission de consolidation de la paix au sujet du processus de justice transitionnelle. La Commission de consolidation de la paix s’est félicitée du fait que le Gouvernement avait l’intention d’organiser une conférence des parties prenantes pour présenter son plan de mise en œuvre du livre blanc et recenser les domaines dans lesquels les partenaires pourraient apporter leur soutien.
Le 4 novembre, Kunti Kamara, un homme libérien, a été condamné à la prison à vie pour crimes contre l’humanité et actes de barbarie et de torture à titre de complice par un tribunal français, en vertu des dispositions relatives à la compétence universelle. Kunti Kamara est le deuxième Libérien à être condamné pour son rôle dans les deux guerres civiles ayant frappé le pays, le premier étant Alieu Kosah, dont le procès s’est tenu en 2021, en Suisse.
Parallèlement, dans de nombreux pays de la région, des défenseurs et défenseuses des droits humains ont continué de dénoncer le rétrécissement de l’espace civique et politique, s’indignant notamment que des manifestants aient été la cible de tirs, en Guinée et en Sierra Leone par exemple. Ils ont par ailleurs protesté contre l’arrestation, la détention et l’intimidation de militants, de journalistes ou d’opposants politiques au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, en Guinée, en Guinée-Bissau, au Sénégal et en Sierra Leone.
Rapports entre agriculteurs et éleveurs
L’UNOWAS, en collaboration avec le Bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique centrale (BRENUAC) et le Bureau du Coordonnateur spécial pour le développement au Sahel, a mis en œuvre un projet interrégional concernant les rapports entre agriculteurs et éleveurs en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale. Les 29 et 30 septembre, à Yaoundé, ces trois entités des Nations Unies ont organisé un atelier consacré aux bonnes pratiques, auquel ont pris part des représentants d’associations d’agriculteurs et d’éleveurs, de groupes de femmes et de jeunes des deux régions et de la CEDEAO. À cette occasion, les participantes et participants ont partagé des bonnes pratiques et formulé des recommandations visant le règlement des conflits et la promotion d’initiatives locales. Une visite a par ailleurs été organisée à Cotonou les 24 et 25 novembre afin d’étudier l’approche adoptée au Bénin pour gérer la dynamique agriculteurs-éleveurs.
Terrorisme et extrémisme violent
À la suite d’échanges entre le Représentant spécial et les États membres et le secrétariat de l’Initiative d’Accra, les 13 et 14 septembre, l’UNOWAS a appuyé l’organisation, à Accra, d’un atelier d’orientation destiné au personnel du secrétariat de l’Initiative, au cours duquel ont été abordées la vision de l’Initiative et diverses questions opérationnelles. Le 22 novembre, la Représentante spéciale adjointe, en sa qualité de responsable du Bureau, a assisté au sommet des chefs d’État de l’Initiative d’Accra et réaffirmé le soutien continu de l’UNOWAS à cette dernière, qui visait, sous la conduite de l’Afrique et au niveau régional, à renforcer la coopération en matière de sécurité en Afrique de l’Ouest et au Sahel.
L’UNOWAS a participé à la quatrième séance plénière du groupe de travail sur le renforcement des capacités en Afrique de l’Ouest, qui relève du Forum mondial de lutte contre le terrorisme, laquelle s’est tenue à Accra du 22 au 24 juin. Lors de cette rencontre organisée par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, une nouvelle série de priorités thématiques concernant la prévention du terrorisme et de l’extrémisme violent, sur lesquelles reposera le programme stratégique du groupe de travail pour les deux prochaines années, a été approuvée. En outre, du 6 au 13 octobre, l’UNOWAS a participé à la deuxième visite de suivi hybride de la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme au Nigéria, qui visait à évaluer les mesures prises par le pays pour appliquer certains aspects des résolutions 1373 (2001), 1624 (2005), 2178 (2014), 2396 (2017)et 2617 (2021) du Conseil de sécurité.
Répercussions néfastes des changements climatiques
L’UNOWAS a organisé plusieurs activités pour faire avancer la mise en œuvre de l’Appel à l’action de Dakar sur le changement climatique, la paix et la sécurité en Afrique de l’Ouest et au Sahel, qui avait été adopté en avril 2022. Les 11 et 12 octobre, à Abidjan, il a organisé, en collaboration avec la CEDEAO et l’Union africaine, un atelier de renforcement des capacités sur le thème de l’autonomisation des jeunes pour l’action climatique, la paix et la sécurité en Afrique de l’Ouest et au Sahel. L’atelier en question, qui a rassemblé des défenseurs et défenseuses des droits des jeunes de toute la région ainsi que des représentantes et représentants d’organisations régionales, de la société civile, des partenaires de développement et des Nations Unies, a permis de recenser les meilleures pratiques et de mettre en lumière diverses démarches menées par des jeunes en faveur de l’action climatique et de la prévention des conflits dans la région, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de l’initiative Muraille verte pour le Sahara.
Le 20 octobre, l’UNOWAS a organisé une conférence virtuelle au sujet d’initiatives menées par des femmes en faveur de l’action climatique, à laquelle ont participé des défenseurs et défenseuses des droits des femmes et des jeunes, des entrepreneurs et entrepreneuses, des chercheurs et chercheuses, et des représentants et représentantes d’entités des Nations Unies, d’organismes intergouvernementaux, d’organisations de la société civile et d’institutions financières. Les participantes et participants à cette rencontre ont recensé les meilleures pratiques en place en matière de lutte contre les changements climatiques, dans l’objectif de développer des approches cohérentes aux fins de l’autonomisation des femmes, au moyen de partenariats forts et de solutions tenant compte des questions de genre. En outre, le 15 novembre, l’UNOWAS, en collaboration avec la CEDEAO et de multiples partenaires des Nations Unies, a organisé une manifestation parallèle sur l’autonomisation des jeunes et des femmes pour l’action climatique, la paix et la sécurité en Afrique de l’Ouest et au Sahel, en marge de la vingt-septième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, organisée à Charm el-Cheikh (Égypte). À cette occasion, d’innovantes solutions mises en œuvre par des jeunes et des femmes de la sous-région ont été présentées.
Enfin, dans le cadre de ses fonctions de secrétariat du Groupe de travail régional des Nations Unies sur les changements climatiques, la sécurité, l’environnement et le développement en Afrique de l’Ouest et au Sahel, le Bureau a organisé deux sessions visant à créer des synergies autour de l’Appel à l’action de Dakar, en collaboration avec la CEDEAO et le mécanisme de sécurité climatique des Nations Unies.
Réforme du secteur de la sécurité, trafic de drogues et criminalité transnationale organisée
Du 11 au 15 juillet, le Bureau a participé à une mission d’évaluation technique conjointe ONU-Union africaine-CEDEAO sur la réforme du secteur de la sécurité en Gambie. Lors de leurs échanges, les interlocuteurs nationaux ont exprimé leur ferme volonté de relancer le processus de réforme du secteur de la sécurité, ce qui s’est traduit par la réactivation du comité national de pilotage sur la réforme du secteur de la sécurité, qui était inactif depuis trois ans.
L’UNOWAS, en collaboration avec l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité, a par ailleurs organisé une série d’ateliers sur la promotion de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes au sein des services de défense et de sécurité gambiens. Les 68 participantes et participants à ces ateliers, issus de divers organismes de sécurité et du Comité permanent de l’Assemblée nationale gambienne sur la défense et la sécurité, ont notamment recommandé de renforcer les campagnes de recrutement de femmes et les systèmes de gestion fondée sur les résultats.
Synthèse de Rokhaya KEBE