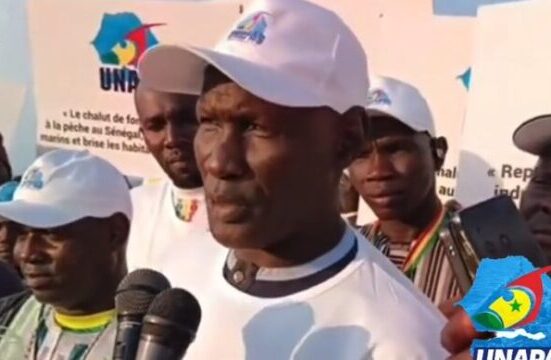Pour l’atteinte des objectifs dans le domaine de l’agriculture notamment en matière de souveraineté alimentaire, le gouvernement compte mettre en placeune stratégie cohérente et intégrée. Elle se décomposeen : une stratégie d’amélioration et de sécurisation de la base productive ; une stratégie d’augmentation de la production et de la productivité agricoles et de valorisation des produits agricoles ; une stratégie de renforcement des services agricoles ; une stratégie d’amélioration de la gouvernance du secteur agricole. Certains éléments fondamentaux et transversauxpouvant être considérés comme clés, et essentiels pour la mise en œuvre de la stratégie sont, au plan macro-budgétaire, les projets structurants et réformes clés à mettre en œuvre dans le cadre du PAP2A. Ils permettront de stimuler davantage l’investissement privé national et étranger, de diversifier les moteurs de la croissance et de renforcer la résilience del’économie. C’est en substance ce que l’on peut retenir du document intitulé « Stratégie nationale de souveraineté alimentaire (2024 – 2028) » que les ministères de l’Agriculture, de l’Equipement Rural et de la Souveraineté Alimentaire, des Pêches et de l’Economie Maritime Ministère de l’Elevage et desProductions Animales.
Le document publié en janvier dernier lesdits ministères rappelle d’emblée que selon l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), en 2022, l’insécurité alimentaire et la faim ont été exacerbées par la conjonction des chocs économiques et climatiques, la pandémie de la COVID -19 et les effets collatéraux des conflits et de la guerre Russo-Ukrainienne. Au Sénégal, les impacts ont été surtout ressentis au niveau du marché des céréales et de l’approvisionnement en produitspharmaceutiques. Ainsi, le Président de la République, M. Macky SALL, a fait de la souveraineté alimentaire une sur priorité, et demandé au Ministre en charge de l’agriculture d’élaborer, sous la supervision du Premier Ministre, et en relation avec les autresministères du secteur primaire, une Stratégie de SouverainetéAlimentaire du Sénégal (SAS) consensuelle, pragmatique et durable. La vision de cette stratégie est de promouvoir « Un secteur primaire, moteur de la relance économique et sociale durable, afin d’atteindre notre souveraineté alimentaire dans les meilleurs délais ». L’objectif de la stratégie est d’assurer aux populations sénégalaises une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable, de développer une meilleure résilience face aux divers aléas et d’impulser un développement économique et social, à l’horizon 2035.
Au cours des dernières années, la production céréalière a enregistré, sur la période 2010-2022, une croissance de 144%passant de 1 502 517 tonnes en 2010, à 3 663 690 tonnes en2022. Aussi, comparé à la moyenne des cinq dernières années, la production céréalière a augmenté de 23%, en 2022. La production de riz paddy est en augmentation de 17%, celle du mil de 25%, celle du maïs 35%. Les productions de sorgho et de fonio ont également progressé. Malgré les efforts consentispar l’Etat, les productions ont partiellement couvert nos besoinscéréaliers et la compétitivité de l’arachide, notre principale culture de rente, se heurte à l’aflatoxine et à la non- traçabilitédes semences certifiées.
Pour l’horticulture, malgré une production excédentaire, les besoins nationaux en oignon et pomme de terre ne sont couverts que pendant 7 à 9 mois, par insuffisance d’infrastructures destockage et de conservation. La production de tomateindustrielle a baissé de 15,8% en 2022. La filière peine à obtenir des rendements optimums pour couvrir nos besoins en double concentré du fait de la bactériose qui détruit 40% à 80%de la production, des difficultés d’accès aux intrants et defacteurs bioclimatiques. Les exportations de mangue, maïsdoux, tomate cerise et melon ont connu une nette progression, malgré les risques phytosanitaires.
La production locale de viande rouge et d’abats a progressé de 57% entre 2012 et 2021. Cependant, les cours mondiaux desdenrées alimentaires ont connu, en 2022, des niveaux records pour le maïs, le soja et le blé, notamment. Il s’en est suivi un renchérissement des prix des provendes et par conséquent, ceuxdes aliments d’origine animale. Malgré la cherté des provendes, la dégradation et la raréfaction des pâturages, la production fourragère reste timide. Le vol de bétail et les conflitsagriculteurs-éleveurs constituent une contrainte supplémentairede cette activité. Par ailleurs, les besoins en moutons de Tabaskisont couverts à hauteur de 83%.
Le secteur des pêches doit son importance à sa contribution à lasécurité alimentaire et nutritionnelle, à la création d’emplois et aux recettes d’exportation. Toutefois, ce secteur est confronté à une surexploitation des ressources, amenant les acteurs de la pêche artisanale à fréquenter des zones hors juridictionSénégalaise où ils subissent diverses exactions. En outre, il a été constaté une pratique de pêche frauduleuse avec de gros navires occasionnant des dégâts importants sur les pirogues et une hausse inconsidérée des exportations de petits pélagiques.
Pour matérialiser la vision globale de la stratégie, la combinaison des objectifs spécifiques retenus dans les différentes Lettres de Politique Sectorielle de Développement de l’Agriculture, de l’Elevage et des Pêches a permis de définir quatre orientations stratégiques (OS) :
La démarche de cette stratégie de souveraineté alimentaire consiste à accélérer la réduction des importations et assurer uneautosuffisance sur les principaux produits alimentaires. Lesprincipales filières ciblées sont le riz, le blé et le maïs pour les produits céréaliers ; l’oignon, la pomme de terre et la carotte pour les produits horticoles ; la viande, le lait et les œufs au niveau des produits d’élevage ; les petits pélagiques et les espèces nobles de poissons, concernant les produits des pêcheset de l’aquaculture.
Au terme du plan quinquennal, le Sénégal devrait atteindre lesrésultats suivants :
Pour y arriver et atteindre notre souveraineté alimentaire, lesprincipaux leviers visés se présentent comme suit :
Le coût global de la stratégie est estimé à 5 000 milliards de FRANCS CFA, réparti comme suit :
Le financement sera assuré par l’Etat et ses partenaires, d’unepart, et les producteurs (individuels, coopératives et privés), d’autre part.
ANALYSE DE LA SITUATION
Agriculture
L’agriculture joue un rôle important dans la lutte contre la malnutrition, à travers la couverture des besoins alimentaires etnutritionnels des personnes et dans la régulation des équilibresmacro- économiques et sociaux. En effet, elle a contribué à hauteur de 9,85% au PIB national et de 66,41% au PIB dusecteur primaire, en 2021. Elle emploie une part importante dela population1.
Elevage
Les produits d’origine animale offrent des compositions ennutriments correspondant aux besoins du corps humain, à différents stades de croissance et de développement. Le lait, la viande et les œufs sont des produits à forte densité nutritionnelle et biodisponibles, fournissant des protéines et desmicronutriments de qualité, ainsi que des vitamines A, B12 etD.
L’élevage joue un rôle socio-économique de premier plan auSénégal, comme source d’aliments, d’emplois et de richesses. Avec des effectifs de 19,3 millions de têtes de bétail et 88,9 millions de volailles en 2021, il contribue3 à hauteur de 21,2% et de 3,5% à la valeur ajoutée du secteur primaire et au PIB national, respectivement.
Au Sénégal, l’activité d’élevage est pratiquée par près d’un ménage sur trois, soit au total 550 000 ménages (MEPA, 2019), et leur offre de grandes opportunités, en termes de revenus,d’emplois et de renforcement de la résilience face aux différents chocs et crises. Ce secteur contribue à la couverture des besoins en protéines et autres nutriments d’origine animale et auxdépenses liées, notamment, à la santé, à l’éducation et aux autres besoins domestiques.
Toutefois, le niveau des principales productions locales ne permet toujours pas, de couvrir la demande nationale enproduits animaux. La consommation des denrées d’origineanimale demeure faible par rapport aux normes internationales ; et fortement tributaire des importations. Cette situationdéficitaire des filières animales a été accentuée par les récentescrises internationales, ainsi que l’instabilité politique dans la zone CEDEAO. Les cours mondiaux des denrées alimentaires ont atteint en 2022 des niveaux records, surtout pour le maïs, le soja et le blé, renchérissant les prix des provendes et par conséquent le coût des produits alimentaires d’origine animale, notamment la viande rouge.
Pêche
Les produits halieutiques sont une source adéquate et durablede macronutriments et de micronutriments. Même consommés en faible quantité, les produits halieutiques ont un impactpositif et déterminant sur le statut nutritionnel, et sont également recommandés pour prévenir la survenue de maladies non transmissibles liées aux régimes alimentaires. Au Sénégal, le secteur des pêches et de l’économie maritime occupe unebonne place dans les politiques et stratégies de développementéconomique et social, vu sa contribution à la sécuritéalimentaire et nutritionnelle, à la création de revenus et d’emplois et aux recettes d’exportation. La pêche contribue àhauteur de 3,2% du PIB national et 12% du PIB du secteurprimaire, et fait partie des principales activités économiques pourvoyeuses de devises, du pays. En 2021, les exportations de produits de la pêche ont représenté 10,4% des recettes totales d’exportation du Sénégal, soit 299,5 milliards de FCFA (ANSD, 2021). Elle fournit 70% des apports en protéines d’origine animale des populations, à raison de 29kg/habitant/an. La pêche est toutefois confrontée, ces dernières années, à unesituation de surexploitation des ressources halieutiques, commeen atteste le tableau ci-après.
Il en découle une baisse des revenus des acteurs du secteur etune menace sur la disponibilité des ressources. Ainsi, plusieursde nos pêcheurs artisans fréquentent des zones placées sous la
juridiction d’autres pays où ils subissent diverses exactionspouvant déboucher sur des saisies de matériels onéreux, amendesexorbitantes, emprisonnements, voire pertes en vies humaines.
La surcapacité, la pêche « illégale non déclarée et non réglementée » (INN) et les pratiques de pêche non respectueuses des règles de gestion, ont dégradé les habitats marins, limitant ainsi le renouvèlement des stocks halieutiques. Les travaux réalisés dans ce sens indiquent la nécessitéd’instaurer des mesures de gestion des pêcheries adéquates,pour une durabilité du secteur.
À cette situation sur l’état des stocks et des habitats, s’ajoute lahausse des exportations de petits pélagiques (yaboy, diay, etc.), qui jouent un rôle important dans la sécurité alimentaire et lapréservation de l’équilibre socio-économique. Selon les études, cette progression s’explique par les diverses mesures de soutien à l’exploitation mises en place par l’État et par la connexionprogressive de la pêche artisanale aux marchés extérieurs. Les volumes de produits halieutiques exportés sur la période 2008-2018 sont estimés à près de 170 000 tonnes, représentant prèsde 38 % du total de la production nationale (2018).
Figure 6 : Evolution de la production et de l’exploitation desstocks
Source : Dème et al. 2020
Ces exportations pourraient altérer la satisfaction de la demande nationale, dans un contexte de croissance démographique continue. De plus, les données de la Direction des Pêches Maritimes (DPM) disponibles en 2019 (Production : 533 478 T; Exportation : 285 237 T) confirment cette tendance haussièredes exportations dominées par les petits pélagiques (80%). Enoutre,
l’implication illégale des gros navires dans cette pratique illicite occasionne, parfois, des dégâts matériels et même humains, enheurtant les petites embarcations artisanes.
La pêche continentale, jadis florissante, avec une production qui tournait autour de 30 000 à 50 000 T/an, il y a quatre à cinqdécennies, peine, de nos jours, à dépasser 15 000 T/anDirection de la Pêche Continentale (DPC), en 2022. Cette baisse est liée à l’ensablement des cours et plans d’eau, aux mauvaises pratiques de pêche, à la modification des régimes hydrologiques des principaux cours d’eau, etc. Vu les énormes potentialités de la pêche continentale : diversité spécifique, impacts sur la sécurité alimentaire à l’intérieur du pays, entre autres, il convient d’améliorer la productivité des plans d’eaux internes.
Pour les secteurs connexes, il faut noter d’après le document que l’Environnement constitue un secteur clé dans le développementéconomique et social. L’objectif global décliné dans la LPSD est decréer une dynamique nationale pour l’amélioration et la gestion desressources naturelles, l’intégration des principes du développementdurable dans les politiques et le renforcement de la résilience despopulations aux changements climatiques.
Parmi les objectifs spécifiques, on peut retenir celui de « réduire la dégradation de l’environnement et des ressources naturelles », « lutter contre les effets néfastes du changementclimatique et la perte de biodiversité. » Un des programmesporte sur la lutte contre la déforestation et la dégradation desterres, en vue d’assurer la restauration et la gestion durable desterres, entre autres.
Les actions retenues dans le programme de lutte contre ladéforestation et la dégradation des terres contribuent à l’atteinte de la souveraineté alimentaire et visent à :
Ces actions, outre l’amélioration de la disponibilité de produitsalimentaires très nutritifs, permettent aussi, de juguler lasalinisation des eaux et des terres, afin de récupérerd’importantes superficies de terres compromises par le sel. Celacontribue à l’accroissement de la disponibilité d’aliments, dans l’optique de la souveraineté alimentaire.
Le secteur du Commerce est déterminant dans la souveraineté alimentaire qui sous-entend, entre autres, la disponibilitéphysique et économique des produits agricoles de base et laréduction, voire l’annulation de leurs importations et de leursimpacts sur la balance commerciale. Au niveau international, leMinistère du Commerce veille sur le commerce agricole du Sénégal au sein de l’Organisation Mondiale du Commerce. Au niveau national, il intervient également, grâce à certains instruments de protection et de régulation, dans la facilitation de l’accès aux marchés des différents produits agricoles (riz,oignon, maïs, volaille, pomme de terre, blé, viande, huile, sucre). Comme pour les filières précédentes, on peut citer le cas de la volaille (grippe aviaire, SPS, art 5) dont le gel desimportations a permis un envol de la production locale.
L’accès au marché s’appuie sur le développement : i) des plateformes de commercialisation (zone de production et marché de consommation) ; ii) de l’agriculture contractuelle (mise en relation des producteurs, commerçants, stockeurs et financiers…) ; iii) des infrastructures de stockage adaptées et le Système de récépissé des entrepôts (SRE), institué par la Loi n°2017629 du 14 juillet 2017, et qui garantit l’accessibilité des productions agricoles sur toute l’étendue du territoire national.
Le SRE est déjà effectif dans les filières Anacarde, Arachide, et Oignon. Il est prévu la mise en place de centres de stockage froid et sec dans les régions où il sied. D’autres projets en coursportent sur : i) la mise en place de cinq (05) plateformes decommercialisation en 2022-2023 ; ii)
une chambre froide de 1500 Tonnes à Fass Boye ; iii) la mise à niveau de 10 magasins de stockage dans la zone des Niayes.
Le secteur de l’Eau et de l’Assainissement occupe une placestratégique dans le développement du pays. Sa principalemission est de promouvoir, d’une manière durable et équitable,la gestion intégrée des ressources en eau. Il joue un rôle important dans l’élaboration et la mise en œuvre de la Stratégie nationale de souveraineté alimentaire.
Le secteur industriel contribue, considérablement, au développement socio-économique du pays. Sa contribution au PIB total du Sénégal oscille, depuis une décennie, entre 20 et 23%. Les actions stratégiques inscrites au PSE portent sur le développement de plateformes et de parcs industriels quidevraient permettre la mise à niveau des chaines de valeur agricoles et le développement d’une industrie manufacturièreperformante.
A travers la technologie alimentaire, ce secteur constitue unélément important pour la souveraineté alimentaire sous deux angles, à savoir : la recherche pilotée par la demande et lesservices offerts. La recherche pilotée par la demande concerne le stockage, la transformation et la conservation des produits de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, la biotechnologiealimentaire, la nutrition et le développement d’équipements de transformation.
Quant aux services offerts, on peut citer la formation sur les techniques de transformation, l’incubation d’entreprises,l’assistance technique aux entreprises (particulièrement micro,petites et moyennes) et industries, le contrôle qualité des produits alimentaires et la mise à niveau de la politique qualité des entreprises.
Le secteur des infrastructures joue un rôle crucial pour le développement. La mission assignée au secteur desinfrastructures est de veiller à la réalisation et à l’entretien desgrandes infrastructures routières et ferroviaires. Il a pour vision de faire du système des transports terrestres “un système accessible, intégré et durable, en soutien à la transformation structurelle de l’économie pour un développement desterritoires et l’intégration régionale.
L’objectif global de la politique des infrastructures, detransports terrestres et du désenclavement est de mettre en place des infrastructures et services de transports terrestres adaptés et intégrés, dans des conditions optimales de sûreté, de mobilitédurable, et d’équité territoriale et sociale.
Pour mettre en œuvre la vision, trois orientations stratégiquesont été déclinées et parmi lesquelles on peut citer l’orientation stratégique 1 : Le développement d’infrastructures de transportsroutiers et ferroviaires durables pour un désenclavement interneet externe du pays qui, dans son Programme 1 : Développement, gestion et entretien des infrastructures routières, a mis en exergue plusieurs actions, à savoir : la gestion et l’entretien des infrastructures routières, et laConstruction et réhabilitation d’infrastructures routières (pistes de production). En plus des infrastructures routières qui permettent de désenclaver les zones de production, on peut citerl’amélioration, la réhabilitation et l’équipement des infrastructures de stockage, la construction de nouveauxmagasins dans les zones insuffisamment dotées, et la réalisationde nouvelles unités de transformation des produits agricoles.
Toutes ces actions vont favoriser l’atteinte de la souverainetéalimentaire.
Le Plan Sénégal Emergent (PSE), dans lequel le volet alimentaire occupe une place de choix, a fixé les grandesorientations économiques et sociales du pays. Ainsi,l’élaboration d’une stratégie nationale de souveraineté alimentaire s’inscrit dans une suite logique des choix politiquesantérieurs, pour faire face aux crises et avoir une feuille deroute pour une souveraineté alimentaire du Sénégal. La vision de la stratégie est de promouvoir « Un secteur primaire,moteur de la relance économique et sociale durable, afin d’atteindre notre souveraineté alimentaire à l’horizon 2028 ».
La Souveraineté alimentaire est érigée en priorité du Pland’Actions Prioritaires ajusté et accéléré du PSE (PAP2A) comme du PAP 3A en orbite, en vue d’une relance économique inclusive et durable. En effet, le Chef de l’Etat, SEM. MackySALL considère, à juste titre, que le Sénégal a les prédispositions pour atteindre cet objectif prioritaire. La Souveraineté alimentaire pourrait être comprise comme la liberté de concevoir, en toute autonomie, une politique alimentaire et nutritionnelle pour une production suffisante, durable, accessible et de qualité, de sorte à éviter, le pluspossible de recourir aux importations alimentaires. Cetteproduction devra être accessible aux populations et conforme aux normes économiques, sociales et culturelles. La souveraineté alimentaire est donc une condition préalable d’unevéritable sécurité alimentaire.
Le but est d’assurer aux populations sénégalaises une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable, de développer unemeilleure résilience face aux divers aléas, et d’impulser undéveloppement économique et social, à l’horizon 2035. La stratégie cherche à optimiser la productivité et les niveaux de production, au sein du secteur primaire. Cela vise l’augmentation des revenus au sein des filières prioritaires et la mise à disposition d’aliments suffisants et nourrissants à toutela population Sénégalaise, de manière durable, en réduisant austrict minimum, voire en éradiquant les importations deproduits alimentaires de grande consommation. En raison des évènements aussi récurrents qu’imprévisibles qui ont bouleversé toutes les projections économiques antérieures, cette stratégie est séquencée en quinquennats permettant de faciliterles ajustements éventuels, au bout de chaque occurrence et/oude cycle.
Pour les orientations de la stratégie, l’analyse des objectifsstratégiques des différentes Lettres de Politique Sectorielle deDéveloppement de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, apermis de décliner quatre orientations stratégiques que sont : Augmenter durablement la disponibilité d’aliments en quantitéet en qualité suffisantes (Orientation stratégique 1) ; Promouvoirl’accessibilité physique et économique d’une alimentation diversifiée et nutritive aux populations (Orientation stratégique2) ; Renforcer le financement, les services de Recherche &Développement et de Conseil (Orientation stratégique 3) ; Renforcement du cadre institutionnel (Orientation stratégique 4)
Pour l’atteinte des objectifs sus-évoqués, le Gouvernementcompte mettre en place une stratégie cohérente et intégrée.Elle se décompose en : (i) une stratégie d’amélioration et desécurisation de la base productive, (ii) une stratégie d’augmentation de la production et de la productivitéagricoles et de valorisation des produits agricoles (iii) unestratégie de renforcement des services agricoles, (iv) une stratégie d’amélioration de la gouvernance du secteuragricole.
Certains éléments fondamentaux et transversaux pouvantêtre considérés comme clés, et essentiels pour la mise en œuvre de la stratégie sont, au plan macro-budgétaire, les projets structurants et réformes clés à mettre en œuvre dans le cadre du PAP2A. Ils permettront de stimuler davantage l’investissement privé national et étranger, de diversifier les moteurs de la croissance et de renforcer la résilience del’économie.