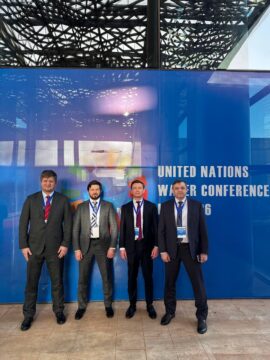Le Crisis Group a publié une étude sur les violences pastorales au Tchad. Ladite note intitulée « Tchad : rompre le cycle des violences agropastorales », revient sur le nombre de conflits agropastoraux qui a atteint un niveau sans précédent dans le sud et le centre du Tchad pendant la période de transition politique (2021-2024). Selon Crisis Group, ces violences, qui ont fait plus d’un millier de morts et plus de 2 000 blessés, renforcent la perception d’un clivage entre le nord et le sud du pays. L’étude estime aussi que les populations sédentaires du sud et du centre, ces conflits résultent de l’augmentation du nombre de propriétaires de bétail issus du nord et protégés par le pouvoir central. Leurs griefs, renforcés par une élection présidentielle opaque et contestée en mai 2024, pourraient les amener à se faire justice elles-mêmes. Par ailleurs, pour prôner des solutions, Crisis Group souligne que le président Mahamat Déby Itno devrait faire de la résolution des conflits agropastoraux l’une des priorités de son mandat. Selon la note, son gouvernement devrait apporter à cette question une réponse sécuritaire et judiciaire impartiale, et impliquer les populations affectées dans les efforts de médiation afin de rétablir leur confiance envers l’Etat.
Ce rapport de Crisis Group rappelle tout d’abord que pendant la période de transition politique (avril 2021-mai 2024), les provinces du sud et du centre du Tchad ont été le théâtre d’une centaine de conflits entre populations sédentaires et certains groupes d’éleveurs. Ces affrontements ont fait plus d’un millier de morts et plus de 2 000 blessés, aggravant l’insécurité alimentaire des régions touchées et renforçant la perception d’un clivage entre le nord et le sud du pays. Ces conflits aux origines multiples s’intensifient. Motivés par de fortes revendications identitaires, certains éleveurs utilisent désormais des armes de guerre. Sans réponses appropriées, les fractures communautaires pourraient conduire les populations sédentaires à former des milices d’autodéfense, et accentuer les divisions entre Tchadiens. Le président Mahamat Déby Itno devrait faire de la résolution de ces conflits une priorité. Il devrait mettre en place des mesures sécuritaires pour enrayer l’utilisation d’armes à feu et empêcher l’apparition de milices d’autodéfense, et soutenir des initiatives durables impliquant les populations affectées pour faciliter la médiation des conflits et la poursuite des auteurs de crimes.
Le 6 mai dernier, Mahamat Déby a remporté, avec 61 pour cent des suffrages, une élection présidentielle marquée par de nombreuses irrégularités, mettant fin à trois années de transition. Une junte militaire l’avait installé à la tête du pays en avril 2021 après la mort de son père, le président Idriss Déby Itno, au pouvoir pendant trois décennies (1990-2021). Après une ouverture initiale du jeu politique à l’opposition et la tenue d’un dialogue national, le gouvernement de transition a réprimé dans le sang les manifestations d’octobre 2022, dont les participants demandaient le retour à un pouvoir civil. Plus de 100 personnes ont été tuées durant ces manifestations et plusieurs opposants ont quitté le pays.
Au début de la transition, une grande partie des communautés du sud, qui représentent environ 60 pour cent de la population tchadienne, avaient espéré une alternance au sommet de l’Etat, dominé depuis les années 1980 par les élites du nord, notamment les groupes zaghawa (dont Déby, père et fils, font partie), gorane et arabes. Selon les populations du sud, ce changement à la tête de l’Etat devait permettre d’apporter plus d’autonomie régionale, voire de faire un premier pas vers le fédéralisme. Il devait aussi être l’occasion de mettre un terme à ce qu’une grande partie des populations du sud perçoit comme un accaparement clanique et népotique de l’appareil d’Etat.
Mais les mesures prises par les autorités de transition ne sont pas allées dans ce sens. D’une part, la nouvelle constitution, approuvée par référendum en décembre 2023, a maintenu un modèle d’Etat unitaire et centralisé, même si cette loi fondamentale révisée apporte une légère dose de décentralisation. D’autre part, les trois opposants du sud nommés au poste de Premier ministre durant la transition – Albert Pahimi Padacké, Saleh Kebzabo et Succès Masra – n’ont pas fait du règlement des revendications des communautés dont ils proviennent une priorité, ni rééquilibré, à eux seuls, un pouvoir toujours dominé par un personnel politique et administratif très majoritairement originaire du nord du Tchad.
Ces rancœurs ont renforcé chez les populations du sud et du centre le sentiment d’abandon par l’Etat central, contribuant à alimenter les conflits agropastoraux. A la différence d’autres pays du Sahel et d’Afrique centrale, l’Etat tchadien joue un rôle de premier plan dans l’élevage, deuxième pilier de l’économie du pays après le pétrole. Depuis les années 2000, en effet, des représentants des autorités administratives et militaires du nord détiennent, à titre individuel, des troupeaux dans le sud du pays. Pour garder le bétail, ces derniers emploient des bergers qui, estimant avoir le pouvoir de leur côté, ont recours à la force armée lors de litiges avec les populations sédentaires. Sous Mahamat Déby, le nombre de propriétaires de bétail issus du nord a encore augmenté, tout comme le nombre d’armes – en provenance notamment de la République centrafricaine – mises à la disposition des bergers. Cela a conforté les populations sédentaires du sud et du centre dans l’idée que les élites du nord avaient profité de la transition pour renforcer leur mainmise sur l’appareil d’Etat au niveau local, y compris par l’usage de la force.
Face à la flambée de violence, le pouvoir central a mis en place, à partir de 2022, des mesures fortement médiatisées mais largement insuffisantes. Après les évènements, des délégations gouvernementales ont effectué des visites éclair pour faciliter la médiation entre les communautés impliquées. Des autorités administratives et militaires opérant dans des zones sensibles ont également été redéployées dans d’autres localités. Toutefois, ces initiatives n’ont pas été accompagnées d’un renforcement de l’appareil sécuritaire et judiciaire demandé par les populations. Encore plus important, elles n’ont pas apporté de solutions durables à la perception de partialité de l’Etat dans les conflits agropastoraux.
Ces défaillances ont contribué à transformer un problème régional en un enjeu national. Les évènements de Sandana (province de Moyen-Chari) constituent l’exemple le plus significatif de ce renversement. En février 2022, le meurtre de treize personnes dans ce village du sud du Tchad par des éleveurs armés a provoqué une vague de protestations à travers le pays contre les autorités centrales, accusées de protéger les auteurs de ces crimes. Les réseaux sociaux ont joué un rôle moteur dans la mobilisation de l’opinion publique.
La persistance des violences agropastorales pourrait accroître la tentation des populations sédentaires du sud et du centre de se faire justice elles-mêmes. Ces dernières années, après chaque épisode de violence majeur, de nombreux membres des communautés sédentaires ont réclamé, notamment sur les réseaux sociaux, la création de milices d’autodéfense. Loin d’apaiser la situation, la mise en place de tels groupes risquerait d’entrainer un cycle de violences intercommunautaires dans ces régions et de diviser encore davantage la société tchadienne.
Le président Mahamat Déby devrait s’attaquer de front aux problèmes qui soustendent les conflits agropastoraux. Il devrait mettre en place des solutions durables en matière de gouvernance et de justice afin de rétablir la confiance des populations du sud et du centre envers l’Etat central. Il devrait aussi dissuader les populations sédentaires et les éleveurs de recourir à leurs propres moyens pour se faire justice. A ce titre, l’Etat pourrait encourager la réactivation des Comités d’entente mixtes qui avaient montré leur efficacité dans les années 1990 pour réduire les attaques. Réunissant les représentants des communautés, ces structures permettraient d’organiser des séances de médiation pour faciliter la négociation d’accords entre les parties au conflit. Ils permettraient aussi de rendre publics les témoignages recueillis sur les incidents afin d’encourager les autorités judiciaires à poursuivre les fauteurs de troubles. Sur le plan sécuritaire, enfin, le renforcement des patrouilles est essentiel pour prévenir de nouvelles violences et empêcher la constitution par certains groupes d’éleveurs de bandes armées permanentes.

Une vague de conflits agropastoraux sans précédent
Selon Crisis Group qui revient aux origines des tensions, l’augmentation des violences agropastorales au sud et au centre du Tchad pendant la période de transition résulte de décennies de tensions accumulées entre les populations sédentaires et certains groupes d’éleveurs, alimentées par une instrumentalisation politique des discours identitaires, un partage inéquitable des ressources et les effets du changement climatique.
L’élevage constitue le deuxième pilier de l’économie du Tchad, après l’exploitation du pétrole. En 2021, le pays comptait un cheptel de plus de 30 millions de têtes de bovins.2 Largement informel, le secteur représentait environ 30 pour cent du produit intérieur brut (PIB) et 35 pour cent des exportations du pays en 2022, selon différentes sources. Les Arabes et les Gorane, qui demeurent principalement nomades, ainsi que les Peul et les Haoussa, qui se sont sédentarisés ou semi-sédentarisés tout en continuant à faire déplacer leur bétail par autrui, sont les principaux groupes ethniques vivant de l’élevage au Tchad. Les populations sédentaires possèdent aussi souvent du bétail qu’elles utilisent pour les travaux agricoles.
Comme de nombreux autres conflits intercommunautaires au Tchad, les tensions entre éleveurs et populations sédentaires trouvent leurs origines dans la manipulation politique des affiliations culturelles, ethniques et régionales par les responsables politiques et militaires tchadiens pendant les conflits armés des années 1970 et 1980. La pratique – ininterrompue depuis cette époque – des nominations aux postes politiques et militaires sur la base d’affinités ethniques a contribué à accroître les rancœurs parmi les populations du sud et du centre. Ces dernières se sentent exclues des cercles d’influence du pouvoir central, qu’elles considèrent dominés depuis quatre décennies par des ressortissants du nord.
A partir des années 2000, ces relations claniques, nourries de gains économiques mutuels, ont conduit à la nomination de préfets et de gouverneurs avec des intérêts dans l’élevage. A plusieurs reprises, ces derniers ont mobilisé des membres de l’armée nationale pour soutenir certains groupes d’éleveurs ou les bergers qu’ils emploient lors de litiges avec les populations sédentaires, sapant la confiance des communautés du sud envers le gouvernement et renforçant la confusion entre l’Etat central et les éleveurs.
Ces pratiques se sont accélérées pendant la période de transition, permettant au président Mahamat Déby de consolider le système de patronage existant et de renforcer son pouvoir, notamment au sein de l’armée.8 Depuis deux ans, la vente de postes administratifs ou militaires à de riches propriétaires de troupeaux s’est ainsi généralisée, conduisant ces derniers à acquérir des pouvoirs et fonctions étatiques importants et attisant les tensions. Parallèlement, le nombre de troupeaux détenus à titre d’investissement privé par de hauts fonctionnaires de l’Etat a, lui aussi, grandi.
Les violences agropastorales sont également alimentées par le changement climatique, dont les effets se font sentir dans la région depuis les années 1970 et 1980. Se traduisant par une multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes, en particulier les sècheresses et les inondations, le dérèglement climatique réduit les espaces de pâturage et d’abreuvage dans le nord du pays, poussant les communautés d’éleveurs à se déplacer vers le sud, dans la zone dite « soudanienne », où vit la majeure partie de la population tchadienne, devant le centre.10 Ces mouvements conduisent parfois à des destructions de champs par les troupeaux et, en retour, à des actes de vandalisme sur le bétail, sans que les initiatives de l’Etat en faveur de la bonne gouvernance foncière ne parviennent à concilier les intérêts agricoles et pastoraux de manière équilibrée.
Les tensions s’inscrivent, enfin, dans un contexte de paupérisation croissante du sud du Tchad, dont certaines régions comptent aujourd’hui parmi les plus pauvres du pays.12 Conséquence de la chute, au début des années 2000, des cours internationaux du coton, dont la région était un grand producteur, et de l’arrivée de dizaines de milliers de réfugiés en provenance de la République centrafricaine (RCA) après le coup d’Etat de 2013, cet appauvrissement a rendu l’accès aux ressources, telles que la terre et l’eau, encore plus conflictuel. Il a été également exacerbé, plus récemment, par la crise économique sans précédent qui a touché l’ensemble du Tchad en 2016 à la suite de la chute des cours mondiaux du pétrole.
La note de Crisis Group a aussi évoqué une violence inédite et des bandes d’éleveurs armés. Et c’est pour dire qu’entre 2021 et 2024, les conflits agropastoraux dans le sud et le centre du Tchad ont fait au moins 1 230 morts et plus de 2 200 blessés. Certains évènements ont particulièrement marqué les esprits, poussant les populations à manifester leur indignation sur les réseaux sociaux. Cela a été le cas notamment après l’attaque de Sandana (province de Moyen-Chari), lors de laquelle des éleveurs armés ont tué treize villageois en une seule journée en février 2022. En septembre de la même année, dans le département du Lac-Iro (province de Moyen-Chari), trois jours de conflit entre éleveurs et agriculteurs ont fait entre dix-neuf et 30 morts. Le même mois, à Mangalmé (province de Guéra), dans le centre du pays, des observateurs locaux ont fait état d’une centaine de morts dans des affrontements. Au printemps 2023, des violences dans plusieurs localités de la province de Logone Oriental, à l’extrême sud du Tchad, ont fait près de 40 morts.
Si le nombre d’incidents a diminué lors de la dernière saison sèche, entre octobre 2023 et mai 2024, la crainte de nouveaux affrontements continue à avoir un impact sur le retour des personnes déplacées ainsi que sur le bon déroulement de la saison agricole.
Selon les populations sédentaires, ces violences sont inédites, tant par leurs mobiles que par leurs cibles. Signe de la fermentation de décennies de ressentiments entre les deux communautés, l’élément déclencheur des conflits de ces dernières années a souvent été un incident mineur. En outre, alors que, traditionnellement, les violences ciblaient principalement les hommes, perçus comme une menace, des éleveurs et des bergers armés s’en prennent aussi désormais aux femmes (y compris aux femmes enceintes) et aux enfants, parfois avec une brutalité extrême. Les images d’un nourrisson blessé par balle à la tête lors des affrontements dans le département des Monts de Lam (province de Logone Oriental) ont fait le tour des réseaux sociaux tchadiens, provoquant une vive émotion au sein des communautés touchées.
Les dégâts matériels, allant du vol de bétail et d’autres biens au pillage de commerces et à l’incendie d’habitations, ont également été importants.22 De l’avis des agriculteurs rencontrés par Crisis Group, la destruction des réserves alimentaires constitue un évènement là aussi inédit, comme l’explique un habitant de Kouyako, au sud du pays : « Brûler, même des greniers et des champs, je n’avais encore jamais vu cela dans ce type de conflit. Si tu te bats avec quelqu’un et qu’il détruit aussi tes réserves alimentaires, c’est qu’il veut vraiment en finir avec toi et les tiens ».
Ces conflits s’alimentent de préjugés tenaces. Les populations sédentaires interrogées par Crisis Group estiment, par exemple, que les violences découlent d’un plan orchestré par les communautés du nord, associées à certains groupes d’éleveurs, pour les « exterminer » et « s’approprier » leurs terres. De leur côté, les éleveurs se disent aussi victimes de ces conflits. Les éleveurs nomades, qui font face à des difficultés croissantes pour nourrir leur bétail, accusent les populations sédentaires des couloirs de transhumance de se livrer à des actes de vengeance indiscriminée, comme l’empoisonnement du bétail.25 Pour leur part, les éleveurs sédentaires soulignent la longue cohabitation qu’ils entretiennent avec les agriculteurs mais déplorent d’être assimilés aux éleveurs nomades lors des conflits, les obligeant à s’engager dans les affrontements, ne serait-ce que pour assurer leur propre protection. Les communautés peul installées au Tchad se décrivent enfin comme pacifiques, mais elles reprochent aux éleveurs arabes leur manque de dialogue et le soutien qu’ils reçoivent de l’armée et de l’administration publique.
Les conflits récents se démarquent aussi par un nouveau modus operandi de certains groupes d’éleveurs et de bergers. Selon les populations sédentaires, ceux-ci utilisent plus fréquemment des armes sophistiquées et échafaudent des attaques de plus en plus élaborées. Les confrontations avec les agriculteurs impliquent souvent l’action coordonnée de plusieurs villages et campements d’éleveurs, aussi appelés ferricks, dont les membres se réunissent le temps d’une attaque, souvent de courte durée.

La chaîne de commandement de ces groupes armés reste peu connue mais le mode de mobilisation et la rapidité d’action de leurs membres semblent s’appuyer sur des systèmes de communication fonctionnels (smartphones) et des moyens de locomotion rapides (motos). Ce dispositif permet aux groupes d’éleveurs armés de se disperser facilement après les attaques, rendant plus difficile leur poursuite par les forces de sécurité. Dans le cas des affrontements de septembre 2022 dans le département du Lac-Iro, des sources locales parmi les populations sédentaires ont ainsi précisé que la plupart des éleveurs ont disparu vers la préfecture de Bamingui-Bangoran, au nord de la RCA et frontalière du Tchad.
Le recours à un armement de plus en plus sophistiqué augmente fortement la létalité des conflits. Même si des armes blanches continuent à être utilisées, ces affrontements voient progressivement intervenir des armes de tir ou de chasse, mais aussi des armes de guerre comme les kalachnikovs. La disponibilité de ce type d’armement peut s’expliquer par plusieurs facteurs. Des éleveurs interrogés par Crisis Group, et vivant de longue date dans le sud du Tchad, affirment que la majorité des assaillants disposant de ce type d’armes sont arrivés récemment dans le pays, en provenance notamment de groupes armés actifs en RCA, dont certains partagent des liens ethniques avec des éleveurs tchadiens. A partir de 2021, l’affaiblissement des rebelles centrafricains à la suite de l’offensive de l’armée centrafricaine et de ses alliés avait, en effet, entrainé leur repli au sud du Tchad, facilitant la vente et la circulation d’armes à feu.
Le rapport a aussi abordé le risque de création de milices d’autodéfense. A ce titre, il mentionne que la multiplication des conflits agropastoraux et leur instrumentalisation politique font monter la colère chez les populations sédentaires. Estimant que les autorités n’ont ni les moyens ni la volonté de les protéger, elles évoquent de plus en plus ouvertement la nécessité de mettre en place des milices d’autodéfense communautaires.34
La constitution de tels groupes n’est pas une pratique répandue au Tchad, mais elle n’est pas non plus inédite. Dans les années 1980 par exemple, des communautés du sud ont formé des milices nommées Codos en réponse aux violences perpétrées par le régime d’Hissène Habré (1982-1990). On voit aujourd’hui réapparaître dans l’espace public un langage identitaire assez proche de celui que ces milices employaient à l’époque.
Ces discours identitaires circulent sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et dans les groupes de discussion WhatsApp. Par exemple, à la suite des affrontements de mai 2023 dans la province de Guéra et dans le département du Lac-Iro, des contenus multimédias très explicites sont apparus sur cette dernière application de messagerie, incitant les jeunes hommes du sud à prendre les armes afin d’équilibrer les rapports de force avec les éleveurs armés. L’un de ces messages affirme ainsi : « Jeunes, réveillez-vous et défendez vos terres avant qu’il ne soit trop tard. Soutenez vos frères qui ont décidé de prendre les armes pour vous défendre. »
Principalement émis depuis des comptes de la diaspora, dont font partie plusieurs opposants politiques du sud, ces appels à la lutte armée usent de théories complotistes pour séduire un public de jeunes hommes désœuvrés.38 Pour gagner de la visibilité, certains utilisateurs de ces réseaux sociaux ont aussi fait le rapprochement entre ces conflits locaux et la guerre qui ensanglante le Soudan depuis avril 2023, évoquant une vaste stratégie sous-régionale de « colonisation de l’Afrique noire par les Arabes ».39 Bien que ces appels n’aient pas encore conduit à des mobilisations de masse, ils s’amplifient après chaque attaque et s’enracinent dans les esprits des communautés affectées.
Si ces messages restent des cas isolés, ils contribuent parfois à donner une dimension religieuse aux conflits agropastoraux et peuvent expliquer certaines attaques contre les symboles témoignant de la volonté de sédentarisation des éleveurs nomades, à l’instar des lieux de culte. En décembre 2023, par exemple, à Moroumgoulaye (province de Mandoul), dans le sud du pays, des éleveurs ont volé du bétail à des agriculteurs.
Des conséquences humanitaires et socioéconomiques importantes
Les violences au sud et au centre du Tchad ont engendré une détérioration majeure de la situation socioéconomique dans une région déjà défavorisée. Dans les départements du Lac-Iro (province de Moyen-Chari) et de la Nya Pendé (province de Logone Oriental), les affrontements ont provoqué un déplacement massif de population vers des zones plus sécurisées, notamment vers les villes de Kyabé, de Donia et de Goré, où la présence des forces de sécurité a offert aux déplacés une relative protection.
En mars 2023, environ 26 700 personnes ont ainsi été forcées de fuir leurs villages pour se mettre en sécurité à Goré, selon l’ONG Caritas. Un certain nombre de déplacés se trouvent encore loin de chez eux, au Tchad et en RCA. Les antennes locales de Catholic Relief Services et de Caritas Allemagne, appuyées par leurs partenaires internationaux et certaines agences onusiennes comme l’Unicef, ont distribué des vivres et des kits ménagers au moment des évènements, mais les déplacés nécessitent également une aide au retour, ainsi que des soins psychosociaux.42
Cette réponse d’urgence, déjà très insuffisante, a été réduite au début de la crise soudanaise en avril 2023 lorsque les organisations humanitaires ont redéployé leurs ressources et leurs moyens à l’est du pays, où se trouve la majorité des personnes déplacées par la guerre au Soudan voisin.
Les conflits agropastoraux aggravent, enfin, l’insécurité alimentaire des zones touchées, la psychose régnant parmi les populations sédentaires empêchant les activités agricoles, souvent réduites aux jardins de case. Les conditions sont particulièrement difficiles pour les couches sociales socioéconomiquement défavorisées et vulnérables. Par exemple, en septembre 2022, au moins 3 000 personnes, essentiellement des femmes, des enfants et des personnes âgées, ont dû fuir pour trouver refuge vers la ville de Kyabé, dans le département du Lac-Iro. En pleine saison des pluies, ces derniers ont marché plusieurs jours dans des conditions difficiles, exposés aux intempéries, à la faim et au paludisme. Des hommes et des femmes âgées seraient morts en chemin à cause du manque de nourriture et de la fatigue.
Une réponse étatique inadaptée et insuffisante
Alors que le sud et le centre du Tchad font face à un risque majeur d’escalade de violence entre certains groupes d’éleveurs et les populations sédentaires, la réponse de l’Etat a été, jusqu’à présent, inadaptée et insuffisante. L’instrumentalisation politique de ces tensions communautaires, conjuguée à l’aggravation de la crise socioéconomique, risque de polariser les enjeux de la réconciliation autour des clivages nordsud, alors que les recommandations du dialogue national d’octobre 2022 les relient clairement aux questions de bonne gouvernance et d’une redistribution plus équitable des ressources.

Le Crisis a parlé d’instrumentalisations politiques. Selon le rapport, la réponse de l’Etat tchadien aux violences agropastorales est étroitement liée aux dynamiques sociopolitiques qui animent le pays depuis la guerre civile des années 1970. Ce conflit a, en effet, fragmenté l’autorité publique au profit de forces politiques régionalistes, ethniques et religieuses, créant des divisions entre nordistes et sudistes, musulmans et chrétiens, et arabophones et francophones. Quand Idriss Déby Itno, père de l’actuel président, a pris le pouvoir par la force en 1990, le pays connaissait déjà des déchirures profondes.
Toutefois, à l’époque, la société civile s’était emparée de la question du vivreensemble, y compris de la résolution des conflits agropastoraux, dans la promotion de la réconciliation nationale. Profitant de l’ouverture démocratique alors en vogue dans de nombreux pays africains, l’activisme de la société civile avait favorisé l’émergence de cadres décentralisés et autonomes pour gérer les conflits. Dans les années 1990, les autorités administratives et traditionnelles avaient ainsi joint leurs forces avec la société civile pour créer des Comités d’entente mixtes réunissant des représentants des communautés impliquées dans les violences. Ces structures, dont l’objectif était de chercher des solutions concertées aux conflits, avaient permis de réduire significativement la fréquence et l’intensité des attaques au cours de ces années.
Cependant, dans les années 2000, la centralisation progressive du pouvoir autour d’Idriss Déby et l’accaparement des biens de l’Etat par l’élite dirigeante ont affaibli ces mécanismes locaux. Le favoritisme ethnique au sein de la fonction publique a renforcé le pouvoir des éleveurs, grâce à leurs liens tribaux et économiques avec de hauts cadres de l’administration, de la justice et de l’armée. L’Etat est alors apparu aux communautés du sud comme une propriété aux mains exclusives d’une seule ethnie, région ou religion.
La transition politique amorcée après la mort d’Idriss Déby en 2021 aurait pu être une opportunité pour mettre en place des réformes profondes. Au cours des premiers mois de la transition, Mahamat Déby avait, d’ailleurs, montré quelques signes d’ouverture démocratique, engageant des discussions avec l’opposition et la société civile et promettant un dialogue national pour réformer les institutions.
Lancé en août 2022, ce dialogue a néanmoins anéanti tout espoir d’alternance. Sans garantie que Mahamat Déby ne se présente à la présidentielle – une des conditions imposées par l’Union africaine (UA) au début de la transition –, les principaux leaders de l’opposition, dont le parti Les Transformateurs de Succès Masra, ont refusé d’y prendre part. De plus, si ce dialogue a permis une discussion franche sur les grands enjeux affectant le pays, ses recommandations finales ont accordé aux dirigeants de la transition, dont Mahamat Déby, le droit de se présenter à l’élection. Face à cette décision, des milliers de personnes ont manifesté le 20 octobre 2022 dans les rues de N’Djamena et dans plusieurs villes de province, surtout au sud, attaquant notamment des bâtiments publics. La répression des forces de sécurité a été féroce, entraînant la mort de 128 personnes et plus de 900 arrestations, et obligeant la majorité des opposants à se taire, à s’exiler ou à se rallier au pouvoir.
Devant cette dérive autoritaire, les opposants politiques du sud ont alors exploité les conflits agropastoraux pour étayer des discours communautaristes. Le recours à la lutte armée et le risque de partition du Tchad ont ainsi dominé le discours politique de l’opposant Succès Masra durant son exil. En février 2023, dans une vidéo diffusée en direct sur Facebook et suivie par plus de 5 000 personnes, ce dernier a usé d’une métaphore pour décrire la difficile conciliation des intérêts entre les « troupeaux du nord » et les « champs d’arachide du sud », réduisant la question complexe de la cohésion nationale à une dualité nord-sud.
En parallèle, les griefs liés à la gouvernance et au manque de représentativité au sein du régime de transition ont contribué à fracturer davantage le tissu social tchadien. En janvier 2024, la nomination de Succès Masra au poste de Premier ministre a été perçue comme une trahison par une large partie des populations du sud, ce dernier ayant négocié son retour d’exil sans impliquer les autres forces d’opposition et accepté de diriger un gouvernement dont les ministres clés étaient issus du parti de Mahamat Déby.
L’élection présidentielle de mai 2024, dont les candidats originaires du sud ont demandé l’annulation en raison d’irrégularités, n’a fait qu’amplifier le mécontentement d’une partie des Tchadiens, tandis que l’élite au pouvoir a réagi en militarisant le pays. Le gouvernement nommé après les élections, issu exclusivement de la coalition soutenant le président Mahamat Déby, a sapé les espoirs d’un exécutif d’union nationale capable de réconcilier le pays.
Des réponses sécuritaires et judiciaires insuffisantes
Face à la montée des conflits agropastoraux, les autorités de transition ont entrepris des initiatives de médiation, accompagnées de mesures sécuritaires et administratives. Mais cette réponse s’est montrée largement insuffisante pour briser le cycle des violences.
Après chaque attaque majeure, le gouvernement a dépêché des délégations, généralement dirigées par le gouverneur du chef-lieu de la province concernée ou, dans certains cas, par une délégation ministérielle venue de la capitale, pour des visites éclair destinées à afficher la proximité des autorités avec les victimes et apporter à ces dernières un premier soutien financier. Fortement médiatisées, ces délégations ont réuni, dans la mesure du possible, les parties au conflit en vue d’obtenir rapidement des accords de réconciliation. En parallèle, les autorités ont renforcé l’appareil sécuritaire dans certaines localités et redéployé plusieurs autorités administratives et militaires dans d’autres régions.
Les populations sédentaires interrogées par Crisis Group jugent ces réponses insuffisantes à plusieurs titres. D’abord, les accords de médiation signés dans la foulée des violences n’ont pas pris suffisamment en compte les causes sous-jacentes des problèmes, telles que la gestion des ressources entre les communautés et l’impunité dont jouissent souvent les fauteurs de troubles. Sans règlement à la source, et bien que les parties en conflit acceptent « de faire la paix » lors du passage de représentants de l’administration, les violences se reproduisent. A Sandana, les affrontements de 2019 se sont ainsi répétés en 2022, tandis que ceux de Mangalmé en 2022 se sont de nouveau produits l’année suivante. A Andoum, dans le département des Monts de Lam, les violences d’avril 2023 ont repris juste après le passage des forces de sécurité et des autorités administratives.
Ensuite, le renforcement des forces de sécurité sur les lieux des violences a souvent été tardif et trop modeste pour permettre d’appréhender les auteurs des crimes et prévenir de nouvelles attaques. Par exemple, à la suite du conflit de 2022 dans le département du Lac-Iro, les autorités ont envoyé seulement douze militaires dans le canton de Koskobo, qui compte pourtant 42 villages et plus d’une centaine de ferricks géographiquement très dispersés. Dans certains cas, les communautés locales se sont plaintes des exactions commises par les forces de l’ordre ou de leur partialité. Même si les autorités ont envoyé quelques signaux forts, remplaçant par exemple certains membres du personnel administratif et militaire, cela n’a pas apaisé les tensions locales. A Mangalmé, la reprise des attaques a ainsi été observée quelques mois seulement après que le gouverneur et le responsable de la gendarmerie ont été relevés de leurs fonctions.
Par ailleurs, les campagnes de collecte d’armes effectuées par la Coordination mixte de désarmement – créée en 2021 pour contrer la prolifération d’armes dans le pays – n’ont pour l’instant pas permis de contenir les violences agropastorales. Composée d’éléments de la gendarmerie nationale, de la garde nomade et de l’armée nationale, la structure a saisi environ 6 000 armes à travers le pays depuis sa mise en place. Dans le même temps, cependant, les tensions croissantes et les failles de la réponse sécuritaire de l’Etat dans les régions du sud et du centre ont renforcé la défiance entre les communautés et leur réticence à se désarmer.
Le sentiment d’injustice est prédominant parmi les populations sédentaires interrogées par Crisis Group. Bien qu’il soit parfois difficile pour la justice d’établir une responsabilité individuelle quand les attaques sont perpétrées en bandes organisées, les populations sédentaires reprochent aux autorités une certaine passivité, y compris lorsque les auteurs des crimes sont, à leurs yeux, facilement identifiables. Par exemple, quand la police a arrêté les suspects des atrocités commises à Sandana en 2022, certaines victimes ont reconnu des fauteurs de troubles déjà impliqués dans des violences en 2019, mais qui n’avaient jamais été jugés.
Même lorsque les autorités judiciaires engagent des poursuites, l’application de la loi demeure souvent problématique en raison d’un système de gouvernance clientéliste. A Sandana, après l’arrestation des suspects en 2022, le procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Sarh (province de Moyen-Chari) a rendu publique une tentative de corruption visant à les faire libérer. Ces affaires ont tendance à renforcer les soupçons de partialité de l’appareil judiciaire et la méfiance quant à l’intention affichée des autorités de combattre l’impunité – même si, dans ce cas précis, la transparence du procureur plaide en faveur d’une justice indépendante des pressions.
Les autorités tchadiennes semblent, enfin, profiter de la volatilité de la situation sécuritaire en RCA pour externaliser la responsabilité des violences. En avril 2023, à la suite des massacres dans le département des Monts de Lam, le pouvoir central a ainsi pointé la responsabilité de bandits en provenance de la RCA, menaçant une intervention militaire en territoire voisin.70 Le mois suivant, à la suite d’un accord avec Bangui – dont les termes sont restés secrets – l’armée tchadienne a lancé une opération dans la préfecture de l’Ouham-Pendé, dans le nord-ouest de la RCA, procédant à l’arrestation d’au moins une cinquantaine d’hommes. La société civile centrafricaine a vu dans ces mesures une violation de la souveraineté nationale et dénoncé les violences commises par les militaires tchadiens. Ces opérations, qui se sont poursuivies pendant plusieurs mois dans différentes préfectures du nord de la RCA, risquent de créer des tensions entre les communautés transfrontalières sans s’attaquer de manière adéquate aux racines des conflits.
Quelques pistes pour rompre le cycle des violences agropastorales
Le rapport de Crisis Group souligne que la période post-électorale est cruciale pour éviter que les fractures au sein de la société tchadienne ne s’intensifient et menacent la stabilité du pays. Les conflits agropastoraux amplifient considérablement la division entre le nord et le sud du pays et constituent, pour cette raison, un enjeu de sécurité nationale. Mahamat Déby, qui s’est présenté peu après sa victoire comme le « président de tous les Tchadiens », devrait joindre le geste à la parole et faire de la prévention et de la résolution des conflits agropastoraux une priorité de son mandat. Cela permettrait, en outre, de créer un environnement pacifié favorable au développement du secteur agropastoral, qui fait vivre des millions de personnes dans le pays.
Pour rompre le cycle des violences agropastorales, les autorités tchadiennes doivent répondre aux griefs et aux tensions de longue date liés à un système de gouvernance clientéliste qui, malgré les promesses de réformes, s’est perpétué – et même accentué – pendant la transition. Elles doivent le faire sur trois plans : politique, sécuritaire et socioéconomique. Si ces mesures sont mises en place rapidement, elles contribueront à réduire le risque de voir les populations sédentaires se faire justice elles-mêmes et à prévenir une aggravation des clivages ethno-politiques entre agriculteurs et éleveurs.
Crisis Group prône la promotion d’une présence positive de l’Etat. Le rapport souligne que sur le plan politique, le président Mahamat Déby devrait mettre en œuvre les recommandations du dialogue national dont il a été le promoteur. Dans le domaine de la réconciliation nationale, celles-ci appellent notamment à une répartition plus juste et équitable des ressources du pays et proposent de construire les bases d’un Etat tchadien réformé, en mettant fin à « l’impunité » et au « tribalisme ».
Un des premiers pas à faire dans cette direction consisterait à rendre le système de nomination des autorités administratives, judiciaires et militaires plus transparent et représentatif, en utilisant des critères basés sur l’expérience et la compétence plutôt que sur l’affiliation ethnique. A cette fin, les décrets de nomination pourraient être accompagnés d’un bref résumé de la carrière du fonctionnaire nommé, éclairant ce qui, dans son parcours professionnel, le rend particulièrement apte à occuper son nouveau poste. Comme le prévoit la constitution révisée de décembre 2023, le président Mahamat Déby devrait aussi veiller à ce que les élections locales, prévues pour décembre 2024, aient bien lieu pour permettre aux Tchadiens de choisir eux-mêmes leurs gouverneurs, actuellement nommés par le chef de l’Etat.
En outre, les autorités civiles et militaires devraient remplacer leurs visites éclair et médiatisées après les incidents meurtriers par des missions plus régulières dans les zones rurales affectées par les violences. Ce type d’intervention permettrait d’informer le plus fréquemment possible les populations locales des initiatives prises pour enquêter sur les attaques et aiderait à prévenir de nouvelles violences. Cette approche contribuerait également à démontrer une présence positive de l’Etat et à signaler que celui-ci est pleinement investi dans le règlement des conflits agropastoraux.
En parallèle, les autorités tchadiennes devraient redoubler d’efforts pour réconcilier les communautés impliquées et répondre rapidement au sentiment d’injustice qui habite les populations touchées par les violences. Une option pourrait être la réactivation des Comités d’entente mixtes créés dans les années 1990. Ces structures joueraient un rôle de médiateur en organisant des séances entre les parties en conflit afin de trouver une entente sur l’accès aux ressources et éviter de nouveaux affrontements. Les témoignages récoltés lors de ce travail de médiation pourraient aussi contribuer à mieux établir les faits lors des enquêtes judiciaires. En rendant publics leurs rapports – tout en assurant la confidentialité des sources – ces comités pourraient aussi inciter la justice à se saisir des dossiers, y compris ceux impliquant des auteurs de crimes proches des autorités. Cela créerait un cercle positif d’influence et d’entraide, et poserait les jalons d’une meilleure entente entre l’Etat, son système judicaire et ses administrés.
Lors de la mise en place de ces comités, les autorités administratives et traditionnelles, ainsi que la société civile, devront notamment veiller à intégrer une part égale d’hommes et de femmes. Les femmes ayant été ciblées lors de la récente vague de violence, il est important qu’elles puissent apporter leur témoignage sur les abus et préjudices subis et avoir voix au chapitre lors des accords de médiation.
Des mesures pour prévenir l’instrumentalisation politique de la violence agropastorale, surtout en ligne, seront également nécessaires pour désamorcer le risque de création de milices d’autodéfense. Comme demandé par Crisis Group en 2022, les partenaires internationaux du Tchad, tels que l’Union européenne, devraient apporter un soutien technique et financier pour développer un environnement médiatique en ligne indépendant. Alors que les rancœurs et griefs des citoyens s’expriment en premier lieu au travers d’espaces de discussion privés, comme WhatsApp, des initiatives journalistiques locales pourraient impliquer les Tchadiens dans la vérification des informations circulant sur cette application de messagerie. Ces programmes pourraient, en particulier, utiliser les réseaux sociaux pour déconstruire les récits polarisés qui émergent dans les groupes privés, encourageant ainsi la mobilisation civique.
Mettre en place des mesures sécuritaires plus adaptées
Sur le plan sécuritaire, le renforcement des forces de sécurité dans les lieux où se sont déroulées des attaques devrait être mieux adapté, en nombre et en qualité, à la sécurisation des populations les plus vulnérables et à la poursuite des auteurs de crimes. Les autorités devraient intensifier les patrouilles de l’armée dans les zones rurales les plus touchées. Elles devraient aussi déployer le plus rapidement possible des agents de police judiciaire pour enquêter sur les crimes commis. Il est également essentiel que les responsables des forces de sécurité transmettent des instructions claires à leurs unités respectives, demandant un traitement impartial des communautés impliquées et tenant compte des traumatismes répétés qu’elles ont endurés.
Afin de lutter contre la formation de bandes armées par certains groupes d’éleveurs, deux séries de mesures sont nécessaires. D’une part, les autorités locales devraient établir des réseaux d’alerte précoce parmi leurs administrés afin d’identifier en amont les mobilisations potentielles de milices armées dans les ferricks avant que celles-ci ne passent à l’action. Les entretiens réalisés par Crisis Group montrent qu’un grand nombre d’éleveurs ne prennent pas part aux violences, mais en subissent les lourdes conséquences, notamment en étant l’objet de représailles indiscriminées par les populations sédentaires. Ces derniers pourraient donc trouver un intérêt à collaborer avec les autorités pour prévenir les attaques.
D’autre part, en vue de mettre fin à la prolifération des armes de guerre, le gouvernement devrait renforcer la Coordination mixte de désarmement. Il devrait l’élargir au-delà des forces de sécurité et y inclure des membres des communautés touchées par les conflits, afin que ces derniers puissent participer à la recherche et à la collecte d’armes. La structure devrait aussi prendre contact avec les autorités centrafricaines dans les préfectures frontalières pour identifier les trafics d’armes et les intercepter.
Enfin, les autorités tchadiennes devraient œuvrer à prévenir de possibles tensions avec la RCA. N’Djamena et Bangui ont récemment décidé de rouvrir leur frontière terrestre, fermée en mai 2014 après que l’armée tchadienne, déployée en RCA dans le cadre de la mission de maintien de la paix de l’UA, eut été accusée de violence contre les civils. A cette fin, le président Mahamat Déby devrait rendre publics les accords de coopération militaire avec Bangui, qui autorisent le Tchad à mener des opérations contre les fauteurs de trouble tchadiens trouvant refuge en territoire centrafricain. Comprendre le mandat de l’armée tchadienne en RCA permettra aux communautés centrafricaines frontalières avec le Tchad de connaître les règles et les limites des opérations militaires en cours et obligera, en principe, les officiers tchadiens à rendre des comptes pour toute violation. À moyen terme, cela aidera aussi à prévenir une nouvelle montée de tensions entre les deux pays.

Soutenir des initiatives socioéconomiques durables
Sur le plan socioéconomique, les autorités tchadiennes devraient accompagner les mesures d’urgence prises à la suite des violences par des initiatives plus durables, y compris dans le domaine de la gouvernance foncière. Ces initiatives devraient être multisectorielles et s’adresser à toutes les parties impliquées. La destruction des réserves alimentaires et les perturbations de la saison agricole demandent aussi des mesures qui vont au-delà des compensations financières ponctuelles.
Pour prévenir les crises nutritionnelles, les organisations humanitaires, notamment le Programme alimentaire mondial (PAM) et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), devraient soutenir les autorités dans la mise en place de programmes répondant aux besoins urgents des populations et les aider à relancer la campagne agricole.
Même si la magnitude de la crise des réfugiés soudanais risque de rendre difficile la mobilisation de ressources humanitaires pour le sud et le centre du Tchad, il est important que ces régions ne se sentent pas négligées et puissent bénéficier d’une partie de l’aide.
Synthèse de Aly NDIAYE