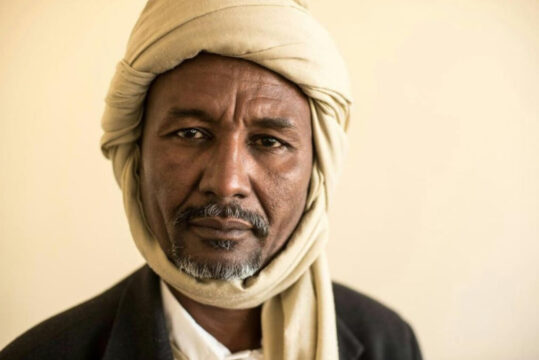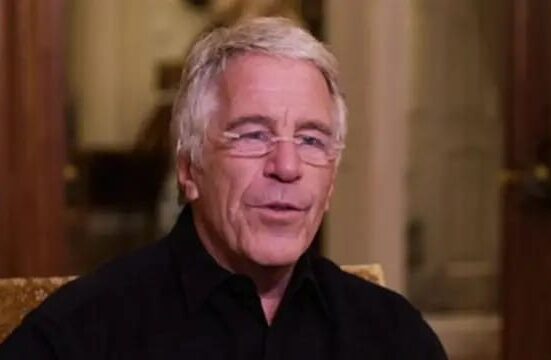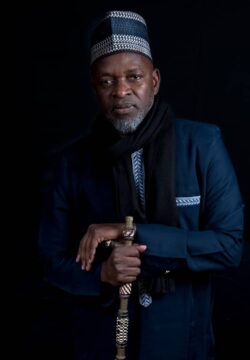La Turquie traverse probablement un moment charnière de son histoire politique, dont il est certes difficile de prévoir le dénouement, mais qui porte en germe une modification des rapports de force et donc susceptible d’annoncer à terme de potentiels changements.
Le résultat des élections municipales de mars 2024 avait constitué un signe annonciateur, puisque pour la première fois depuis son accession au pouvoir en 2001, le Parti de la justice et du développement (AKP) dirigé par Recep Tayyip Erdoğan subissait une défaite significative permettant au principal parti d’opposition, le Parti républicain du peuple (CHP), de s’imposer dans tous les grands centres urbains.
Depuis, le raidissement du pouvoir est manifeste : multiplication des arrestations d’opposants politiques et de journalistes, destitution d’une dizaine de maires élus, mises en procédure judiciaire de dirigeants de la TÜSIAD (la principale association patronale)… la liste est longue de celles et ceux qui subissent la préoccupante aggravation des atteintes aux droits démocratiques, déjà très affaiblis.
Un pas est franchi lors de l’arrestation d’Ekrem Imamoğlu, maire d’Istanbul, le 19 mars 2025. Saut qualitatif, puisque ce dernier apparaissait comme l’opposant principal au pouvoir, à quelques jours de sa désignation comme candidat à la future présidentielle de son parti, le CHP. Maire d’Istanbul depuis 2019 et réélu très confortablement en 2024, il illustrait une formule attribuée à Recep Tayyip Erdoğan, souvent utilisée en Turquie, « Qui gagne Istanbul gagne la Turquie ».
Ekrem Imamoğlu, issu d’une famille conservatrice originaire de la mer Noire, gestionnaire majoritairement apprécié d’une ville de 16-17 millions d’habitants qui représentent environ 40 % du PIB de la Turquie, prônant et pratiquant une laïcité moins dogmatique que celle traditionnellement défendue par son propre parti, capable de passer des compromis avec les partis et associations kurdes comme il l’a prouvé à Istanbul, cet homme apparait comme un « rénovateur » et coche beaucoup de cases qui en font un prétendant sérieux à la présidence de la République.
Les accusations portées à son encontre sur de supposées affaires de fraude financière et de marchés truqués et d’être donc le responsable d’une « organisation criminelle à but lucratif », ne leurrent en réalité pas grand monde, la décision apparaissant avant tout politique. Ce faisant, le président Erdoğan a commis une erreur d’appréciation, peu coutumière chez lui en matière de politique intérieure, qui laisse à penser à une réelle précipitation et à une perte de ses capteurs au sein la société turque qui lui ont permis ses nombreux succès électoraux antérieurs.
Tout d’abord, parce qu’en Turquie le vote est un acte civique quasiment sacré – les taux de participation affleurants régulièrement les 90 % l’indiquent assez clairement –. En emprisonnant le maire de la plus grande ville du pays, le régime prend le risque d’être menacé dans ses propres fondements, puisqu’Erdoğan s’est toujours appuyé sur la légitimité de l’élection incarnant sans conteste la volonté populaire. Cette affirmation fréquemment répétée constitue un des mantras de l’AKP depuis son accession au pouvoir.
Cette situation explique l’ampleur des manifestations spontanées, et radicales par leurs mots d’ordre, dans les jours qui ont suivi l’arrestation de E. Imamoğlu et qui se poursuivent depuis. La jeunesse estudiantine – il y a en Turquie 7 millions d’étudiants soit 8,2 % de la population totale (4,4 % en France) –, qui n’a connu que l’AKP au pouvoir, est particulièrement mobilisée, exprimant sa volonté de changement et faisant preuve de créativité et d’un humour souvent corrosif. C’est à son initiative qu’un boycott des médias ou des commerces liés au pouvoir a été initié. Dans les universités, nombreux sont les cours qui sont aussi boycottés et, depuis quelques jours, c’est au tour de certains lycées.
Le CHP surfe pour l’instant sur ce mouvement, reprenant à son compte ces initiatives. Le vote interne au parti prévu de longue date pour désigner le candidat à la prochaine élection présidentielle a été maintenu en dépit de l’arrestation d’Imamoğlu et a été ouvert à tout citoyen qui le désirait le 23 mars. Résultat, 15 millions de voix se sont exprimées, alors que le parti revendique 1,5 million d’adhérents, et ont pris l’aspect d’un véritable plébiscite.
De la même façon, l’objectif du président turc de saper les convergences politiques entre le CHP et le Parti de l’égalité et de la démocratie des peuples (DEM) semble à ce stade un échec. La direction de ce dernier a clairement et sans ambiguïté dénoncé l’arrestation du maire d’Istanbul et participé aux rassemblements et manifestations, même si la majorité de la mouvance kurde et la galaxie de ses organisations ne s’est pas massivement mobilisée.
Ces éléments illustrent assez bien le rejet d’une grande partie de la société turque d’un régime qui semble décontenancée. Facteur aggravant, l’alliance de l’AKP avec le Parti d’action nationaliste (MHP) d’extrême droite semble fragilisée. Son vieux leader, DevletBahçeli, a en effet déclaré que si le dossier d’accusation contre Imamoğlu était vide ou insuffisant étayé, alors il devait être libéré dans les meilleurs délais. De la même façon, il s’est opposé à l’éventualité de la nomination par l’État d’un administrateur du CHP dans le cadre d’une autre affaire. Ces déclarations de Devlet Bahçeli qui durant toute sa vie politique n’a cessé de défendre l’ordre établi et la toute-puissance de l’État sont d’une grande importance et signifie que des failles apparaissent au sein de l’alliance entre l’AKP et le MHP qui dirige la Turquie depuis 2015.
Last but not least, c’est aussi D. Bahçeli qui, au mois d’octobre 2024, fut à l’initiative d’une proposition à mettre en œuvre une solution politique à la question kurde, lui qui, nationaliste turc affirmé, s’est opposé tout au long de sa carrière politique aux revendications kurdistes. Cette initiative qui a surpris la plupart des observateurs a trouvé une première réponse par l’appel d’Abdullah Öcalan, le 27 février 2025, au dépôt des armes et à l’autodissolution du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), processus qui doit être placé sous le signe de l’élargissement des droits démocratiques, condition sine qua non pour espérer le dénouement positif du processus entrouvert.
Depuis lors, peu d’éléments tangibles filtrent publiquement sur ce dossier, mais la perspective d’un congrès du PKK qui acterait les demandes d’Öcalan se précise. Nous n’en sommes pas encore à ce résultat, mais un processus semble bel et bien engagé. Le soutien des dirigeants kurdes d’Irak à l’appel d’Öcalan, ainsi que l’accord conclu entre les Forces démocratiques syriennes dirigées par Mazloum Abdi et Ahmed Al-Charaa le 10 mars 2025 signifient que la manière dont la question kurde se pose désormais dans la région est en passe de se modifier dans un contexte où le PKK est manifestement affaibli.
Sur ce dossier, le président Erdoğan n’apparait pas à ce jour comme le plus enclin à avancer des propositions précises dans un jeu de négociations qui s’annoncent compliquées. Le paradoxe apparent réside dans le fait que Devlet Bahçeli raisonne plus nettement en fonction de ce qu’il considère comme les intérêts supérieurs de la Turquie dans la région et apparait donc comme beaucoup plus volontaire pour porter le processus à son terme. Pour lui, il est prioritaire d’en terminer enfin avec le facteur de déstabilisation que constitue potentiellement le PKK et de profiter de son affaiblissement. Recep Tayyip Erdoğan semble plus réservé, s’intéressant surtout aux possibilités de capter l’électorat kurde et sa représentation parlementaire dans la perspective d’une hypothétique modification constitutionnelle qui lui permettrait de se présenter une nouvelle fois à la prochaine élection présidentielle. Répartition des rôles ou véritable divergence entre les deux partenaires ?
On le voit, la situation politique est en train de connaitre de véritables évolutions en Turquie. Pour autant, si une crise politique s’est cristallisée ce n’est pas une crise de régime et le pouvoir de Recep TayyipErdoğan possède encore des ressources politiques, financières et répressives qu’il ne faut pas sous-estimer. Le risque d’essoufflement est réel et le CHP n’est pas à l’abri de divergences internes qui affaibliraient sa capacité de mobilisation. En outre, la force du nationalisme est prégnante, y compris dans les manifestations, et reste un facteur structurant de l’échiquier politique ce qui ne constitue pas un facteur de dénouement positif de l’ensemble des défis que le pays affronte. Dans tous les cas, ces rebondissements de la vie politique turque prouvent amplement, s’il en était encore besoin, que la Turquie n’est pas une dictature même si le caractère aléatoire des pratiques du pouvoir et la tentative de criminalisation de l’opposition sont condamnables.
Par Didier Billion (IRIS)