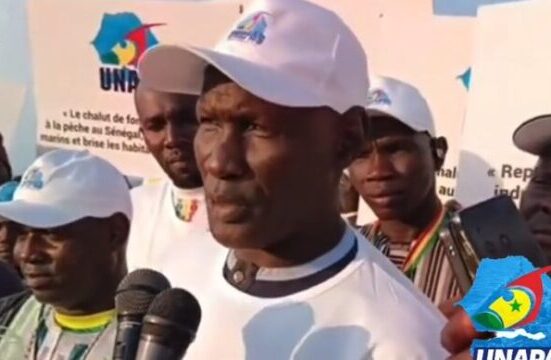La Russie est le premier exportateur d’armes auprès des pays africains. Historiquement, ses principaux clients se situent en Afrique du Nord, Algérie et Égypte en tête. Le portfolio de Moscou s’est toutefois diversifié : le Nigeria, le Soudan et l’Angola, par exemple, y occupent désormais une place de choix. Selon le Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), les ventes russes représentaient 44 % des importations d’armes dans la région sur la période 2017-2021 (contre 17 % pour les États-Unis, 10 % pour la Chine et 6,1 % pour la France). Si cette proportion se réduit (ce chiffre était de 49 % pour la période 2015-2019), la place de Russe en Afrique reste majeure. Dans les mois qui ont suivi le début des hostilités en Ukraine, de nombreux articles ont été publiés affirmant que cette diminution s’accélérerait tant en raison de la nécessité pour la Russie de rediriger les ressources vers le front, que des sanctions adoptées par l’Union européenne (UE), les États-Unis et d’autres pays alliés.
Les sanctions ont, en effet, pour objectif de limiter l’accès de la Russie aux matériaux et composants nécessaires à la construction de nouvelles armes. De même, la réduction de la dépendance énergétique européenne aux hydrocarbures (gaz et pétrole) russes devait heurter les finances publiques de Moscou, limitant sa capacité à injecter de nouveaux fonds dans son industrie militaire. En août 2022, les premiers chiffres disponibles pour l’année en cours indiquaient une baisse des exportations d’armes russes au niveau mondial de près de 26 % par rapport à 2021 — soit une chute d’environ 10,8 milliards USD en valeur monétaire. En mars 2023, le SIPRI parle d’une chute de 31 % entre la période 2013-2017 et 2018-2022. Si cette tendance s’est enclenchée dès 2020 — notamment en raison de la moindre dépendance de grands pays importateurs comme l’Inde sur les équipements russes— l’institut suédois considère que l’invasion de l’Ukraine et les sanctions occidentales ont probablement joué un rôle catalyseur en 2022.
Cependant, la Russie reste le principal fournisseur du continent africain, malgré une baisse de 44 % en 2017-2021 à 40 % en 2018-202210. Ainsi, la diminution des exportations russes vers les pays africains, déjà observable depuis quelques années, se poursuit. À ce stade, il est toutefois difficile de dire si la guerre en Ukraine et les sanctions associées ont eu un impact direct sur cette tendance. Cette Note d’analyse invite donc à la prudence. Elle estime, plus spécifiquement, qu’il ne faut minimiser ni la capacité de la Russie à s’adapter aux sanctions qui lui ont été imposées ni l’importance que le continent africain revêt dans la politique étrangère russe. Les sanctions occidentales présentent des limites et Moscou a déjà mis en place plusieurs voies de contournement afin de continuer à alimenter son industrie militaire. En outre, Moscou considère les pays africains comme une priorité stratégique et a clairement indiqué sa disponibilité pour poursuivre et intensifier les transferts d’équipements militaires.

Les sanctions occidentales contre Moscou : limites et voies de contournement
L’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022 a rapidement été suivie par l’adoption de sanctions par les pays occidentaux et leurs alliés. À mesure que le conflit dure, ces sanctions évoluent. Elles couvrent aujourd’hui un large spectre de secteurs (financier, partis politiques, médias, militaire, transport, etc.), de personnes (chefs d’entreprise, hauts fonctionnaires, personnel gradé de l’armée, politiciens, etc.), de services (comptabilités, assurance, conseil, etc.) et de biens (armes, technologies de pointe, acier, pétrole, produits de luxe, etc.). Elles ont pour objectif de marquer la désapprobation des actions de la Russie ; de lui imposer un coût économique afin de la pousser à mettre un terme à la guerre ; et, pour reprendre les termes employés par l’UE, « contrer efficacement les capacités de [la Russie] à poursuivre l’agression».
Malgré leur caractère étendu et hétéroclite, les sanctions adoptées à l’encontre de Moscou présentent des limites. La principale est leur portée géographique restreinte. Certains pays (tous ceux qui n’ont pas pris de sanctions) restent libres de poursuivre leurs échanges commerciaux avec la Russie. Cette dernière peut ainsi se tourner vers des partenaires alternatifs, tant pour se procurer les technologies dont elle a besoin pour construire ses systèmes d’armes, que pour compenser les pertes financières liées à la vente de gaz et de pétrole à l’Europe et soutenir financièrement la production d’armes.
La portée géographique limitée des sanctions adoptées contre Moscou
Dans le mois qui a suivi l’agression de l’Ukraine, l’UE et douze pays adoptent des sanctions contre la Russie. Certaines d’entre elles sont d’emblée spécifiquement pensées pour porter atteinte à l’industrie de défense russe en limitant son accès aux biens, composants et technologies nécessaires – comme les semi-conducteurs, les microprocesseurs et micropuces, les lasers, les systèmes de guidage, de navigation, de télécommunications et de propulsion ou encore divers types de logiciels – à la production de nouveaux systèmes d’armes. Ces mesures restrictives ont été prises de façon unilatérale et à titre individuel. Seul les États qui les ont adoptées et les personnes (physiques et morales) qui se trouvent sur leur territoire sont tenues de s’y conformer. La vaste majorité du globe peut donc, en théorie, continuer à fournir à la Russie les biens dont son industrie militaire a besoin.
Cette affirmation doit néanmoins être nuancée. Certaines des sanctions décrétées par Washington peuvent avoir une portée extraterritoriale — c’est-à-dire s’appliquer sur le territoire d’États tiers et entraver leurs exportations vers la Russie. Deux mécanismes, qui eux aussi ont leurs limites, sont ici à l’œuvre : les Foreign Direct Product Rules (FDPR) et le Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA).
Les FDPR permettent de soumettre des biens produits et se trouvant en dehors du territoire des États-Unis aux Export Administration Regulations (EAR) et, dans leur prolongement, au régime de sanctions américain. Deux conditions doivent être remplies14. Il faut tout d’abord que les biens en question aient été produits grâce à une technologie ou un logiciel états-unien contrôlé pour des raisons de sécurité nationale. C’est le cas notamment de la majorité des technologies et logiciels utilisés pour la mise au point des semi-conducteurs qui sont eux-mêmes employés dans tous les appareils électroniques modernes y compris de nombreux systèmes d’armes. Il faut ensuite que ces biens soient destinés à être exportés vers un pays identifié comme présentant une menace pour la sécurité nationale des États-Unis (catégorie D:1), soutenant le terrorisme (catégorie E:1), ou placé sous embargo (E:2). La Russie est considérée comme faisant partie de la première catégorie.
Étant donné les faibles volumes des exportations directes des États-Unis vers la Russie, les FDPR permettent aux mesures de Washington d’avoir davantage d’impact sur le complexe militaro-industriel russe. Pour reprendre l’exemple des semi-conducteurs, il faut en effet savoir que les États-Unis dominent encore le marché mondial des équipements de fabrication et des logiciels d’automation de la conception électronique (EDA) — respectivement 55 % et 85 % des parts de marché mondial en 2020. La chaîne de valeur des semi-conducteurs étant encore hautement internationalisée et interdépendante, elle confine aux marges les processus de conception et de fabrication où les technologies d’origine américaine n’interviennent pas. Adopté par le Congrès en juillet 2017, le CAATSA permet aux États-Unis d’exercer un contrôle encore plus large. Il autorise Washington à prendre des sanctions contre tout pays, entreprise ou personne entretenant des liens commerciaux « directs et significatifs » avec la Corée du Nord, l’Iran ou la Russie. Il confère une portée extraterritoriale aux EAR en dehors de tout lien de rattachement physique, intellectuel ou juridique avec le territoire des États-Unis. Bien que controversé (voir encadré), le CAATSA a déjà été utilisé20, y compris contre des membres de l’OTAN. Le 14 décembre 2020, à la suite de l’achat de missiles sol-air S-400 à la Russie, l’administration Trump a suspendu toutes les licences et autorisations d’exportation à destination de la Présidence des industries de la défense de Turquie (SSB) en plus de procéder à un gel des avoirs et à l’imposition de restrictions sur les visas pour son président et certains de ses dirigeants.
Depuis le début de la guerre en Ukraine, l’Inde a plusieurs fois été menacée de représailles sur base du CAATSA en raison de l’achat de matériel militaire et de pétrole russe. Cependant, eu égard à l’importance du partenariat indien pour la politique des États-Unis à l’égard de la région indopacifique, le Congrès a décidé d’exempter New Delhi de toute application de cette législation en juillet 202223. L’Algérie a également bénéficié d’un traitement de faveur. À la suite de l’annonce d’un contrat d’armement d’un montant estimé entre 12 et 17 milliards USD avec la Russie, 27 députés du Congrès américain ont réclamé l’utilisation du CAATSA pour imposer des sanctions à Alger. Cette demande a été ignorée, le département d’État ne voulant vraisemblablement pas s’aliéner un pays riche en hydrocarbures et occupant une position stratégique en Afrique du Nord et au Sahel25. Ces précédents montrent que si le CAATSA permet d’étendre le pouvoir d’action des États-Unis au-delà de leurs frontières, il reste hautement contingent des dynamiques géopolitiques plus globales. Les États qui n’ont pas sanctionné la Russie peuvent tirer profit de celles-ci pour continuer à commercer avec Moscou tout en limitant le risque de sanctions américaines à leur encontre.

L’établissement de voies d’approvisionnement alternatives pour l’industrie militaire russe
Malgré l’étendue des sanctions et la portée extraterritoriale de certaines d’entre elles, il ne faut pas négliger la capacité de la Russie à s’adapter et à trouver des voies d’approvisionnement alternatives pour son industrie militaire. Il n’a d’ailleurs pas fallu attendre longtemps pour que Moscou trouve des façons détournées de se procurer les composants technologiques dont elle a besoin. Svitlana Taran — chercheuse au European Policy Centre — a mis en évidence la manière dont le Kremlin parvient à contourner les sanctions occidentales grâce à des mécanismes d’importation via des pays tiers, de réexportation directe et indirecte, de revente en cours de route ou encore de faux transit. Bien que l’ensemble de ces opérations soient couvertes par les régimes de sanction, la Russie semble pouvoir compter sur la collaboration de plusieurs ex-membres de l’Union soviétique, notamment l’Arménie et le Kazakhstan. Selon Alena Popova du Wilson Center, ces manœuvres ont permis à Moscou de rétablir son approvisionnement en micropuces et semi-conducteurs de facture occidentale en l’espace de quelques mois seulement27. Ce constat se base sur une vaste enquête menée par des journalistes de Reuters en collaboration avec le think tank londonien Royal United Services Institute (RUSI). Cette enquête détaille la façon dont des sociétés implantées en Turquie ou sur le territoire d’autres pays n’ayant pas adopté de sanctions importent du matériel informatique depuis l’Europe et les États-Unis afin de le revendre. Au moins 457 millions USD de produits Intel seraient ainsi arrivés en Russie entre le 1er avril et le 31 octobre 2022.
Si ces voies d’approvisionnement détournées et illégales offrent une solution d’urgence au Kremlin, elles ne sont pas sans poser leur lot de défis. En particulier, les équipements de ce marché gris n’arrivent pas assez rapidement, ce qui nuit aux cadences de production d’armement30. Il reste donc nécessaire pour Moscou de trouver des solutions plus pérennes et directes pour remédier aux effets des sanctions. La Chine était déjà le principal fournisseur de composants électroniques de la Russie avant la guerre31. À l’origine, les produits chinois étaient plutôt destinés à la consommation civile, l’industrie militaire préférant les puces et semi-conducteurs occidentaux, réputés de meilleure qualité. Cependant, depuis quelques années, la Chine a fortement investi dans la recherche et le développement (R&D). Dans le cadre du programme « Made in China 2025 » (MIC) mis en place en 2015 dans le but de faire du pays une puissance technologique, Beijing prévoit d’allouer pas moins de 300 milliards USD aux semi-conducteurs entre 2014 et 2030. Entre 2019 et 2022, la majorité des demandes de brevets émanaient de la Chine.
Même si l’écosystème national manque encore de capacités de fabrication avancées selon Jimmy Goodrich — vice-président du département de la politique mondiale au sein de la Semiconductor Industry Association (SIA) —, la chaîne de valeur chinoise devient de plus en plus innovante, intégrée et mature. Les semi-conducteurs qui y sont produits sont déjà aptes à répondre à la majorité des besoins de l’industrie militaire russe. Il faut néanmoins garder à l’esprit que la demande interne chinoise est robuste et croissante. En 2018, le pays ne couvrait que 14 % de celle-ci et il est attendu que ce chiffre atteigne 40 % d’ici 2025 — ce qui reste bien éloigné des 70 % escomptés par le MIC. Bien que Beijing puisse trouver un intérêt à coopérer avec Moscou, la priorité risque donc d’être accordée à ses besoins nationaux.
Pour remédier à cette dépendance extérieure et aux défis et risques qu’elle pose, la Russie a entrepris de renforcer ses capacités de production locales. En avril 2022, le gouvernement a annoncé le lancement d’un nouveau plan d’investissement de 38,6 milliards USD sur huit ans. L’argent sera principalement affecté au développement de technologies de production de semi-conducteurs et de micropuces ainsi qu’à la modernisation des centres de données et à la formation de nouveaux talents. Des programmes d’ingénierie inversée devraient également être mis sur pied39. Cette méthode, controversée au regard des règles des brevets et de la propriété intellectuelle40, devrait permettre à la Russie d’accélérer l’acquisition de nouveaux savoir-faire.
Dans l’immédiat, l’objectif du Kremlin était de parvenir à fabriquer des puces de 90 nanomètres à la fin de l’année 2022. À plus long terme, il espère pouvoir produire localement des puces 28 nanomètres d’ici 2030. Sachant que la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), un des leaders du marché, travaille actuellement à la mise au point d’une puce de 2 nanomètres, le programme de la Russie a été qualifié de « peu ambitieux ». Ces ambitions doivent toutefois être replacées dans leur contexte : la Russie ne chercher pas à devenir un ou le leader mondial, mais simplement à réduire sa dépendance aux chaînes de valeur internationales et aux sanctions internationales qui les perturbent. Ce programme d’investissement devrait lui permettre de stabiliser et sécuriser son accès aux semi-conducteurs dont son industrie militaire a besoin et ainsi relancer sa production.

Des nouveaux débouchés pour les hydrocarbures qui permettent de continuer à investir dans l’industrie de défense
Les mesures visant à réduire la dépendance énergétique européenne ont également été pensées afin d’impacter le complexe militaro-industriel russe. Il s’agit de cibler les revenus du Kremlin et leur réinjection vers la production d’armes. Selon une étude de la Banque centrale autrichienne, la vente de ces hydrocarbures représentait environ 14 % du produit intérieur brut (PIB) de la Russie en 202143. En termes monétaires, la Russie aurait tiré près de 460,6 milliards EUR des exportations de gaz et de pétrole en 2021, 315,6 milliards EUR en 2020 et 398,5 milliards EUR en 2019. Plus de la moitié de ces exportations avaient l’UE pour destination.
Les sanctions occidentales se concentrent sur le pétrole, dont il est plus facile pour les Européens de se défaire. Fin mai 2022, le Conseil européen s’accorde sur la mise en place d’un embargo sur l’importation et le transfert de pétrole ainsi que de certains produits dérivés. Dans un contexte de crise énergétique, l’embargo a été conçu pour se concrétiser de manière progressive — il est devenu pleinement effectif le 5 décembre 2022 en ce qui concerne le brut et le 5 février 2023 pour les produits dérivés. En collaboration avec les pays du G7+2 (Australie et de la Norvège), l’UE décide aussi de plafonner les prix du baril de brut à 60 USD, et de raffiné à 100 USD pour le diesel et 45 USD pour le fioul47. En complément de ces mesures, et afin de limiter la capacité de la Russie à exporter vers d’autres marchés, les tankers battant pavillon et/ou assurés par des sociétés basées sur le territoire d’un membre de l’UE ou des autres pays susmentionnés se voient interdire de transporter du pétrole russe. Si les importations européennes de pétrole russe ont drastiquement diminué, celles de la Chine et de l’Inde ont bondi. Les achats de ces deux États auraient respectivement augmenté de 10,2 % et de 9,2 % en 202250. La Turquie, le Pakistan et le Bangladesh feraient également partie des États cherchant à tirer profit des hydrocarbures russes à prix réduit
. Selon les estimations du Center for Research on Energy and Clean Air (CREA), l’exportation des énergies fossiles aurait rapporté 296 milliards EUR au Kremlin depuis le début de la guerre. Si les revenus sont donc en baisse, les montants restent importants. Cette tendance s’est accélérée depuis l’entrée en vigueur des mesures de l’UE et du G7+2 le 5 décembre 202253. Les effets des restrictions relatives au transport et aux assurances seraient particulièrement palpables puisque la majorité des exportations vers l’Asie se font par voie maritime. Toutefois, la Russie s’est préparée et déjà mis en place divers mécanismes afin de rétablir ses exportations vers ses clients asiatiques.
Selon certains médias, Moscou aurait constitué une « flotte fantôme » d’une centaine de vieux pétroliers et entrepris de renforcer la reconnaissance des assureurs du fret maritime basés sur son territoire. Étant donné la valeur des cargaisons, ce secteur exige une solidité financière que les sociétés russes peinent à atteindre. La Compagnie nationale russe de réassurance (RNRC) contrôlée par l’État se chargerait de garantir les risques liés aux contrats56. Il semble que ceci ait suffi à convaincre les autorités portuaires chinoises, indiennes et turques de recevoir des cargaisons de pétrole russe. À plus long terme, Moscou prévoit d’augmenter la production de gaz naturel liquéfié (GNL) et de construire de nouveaux gazoducs. Après l’inauguration du gazoduc Power of Siberia en 2019, le projet Power of Siberia 2 — qui reliera la Chine aux champs de gaz de la péninsule du Yamal — a été officiellement annoncé en février 202258. Une fois terminé, il devrait avoir une capacité d’approvisionnement équivalent à Nord Stream 1 ce qui, selon le ministre russe de l’Énergie Alexandre Novak, permettra de compenser l’abandon de Nord Stream 2. Le début des travaux est fixé pour 2024 et le pipeline devrait devenir opérationnel en 2030.
Les revenus que le Kremlin tire de la vente des hydrocarbures sont et continueront vraisemblablement d’être impactés par les sanctions au cours des prochaines années, mais les montants se chiffrent encore en centaine de milliards d’euros. Plus généralement, alors que les Occidentaux espéraient provoquer une récession économique d’environ 10 % en 2022, celle-ci aurait finalement été plus proche de 2 %. Pour 2023, certaines prévisions seraient même à une hausse modérée. Dans ce contexte, les fonds de Moscou sont et seront prioritairement dirigés vers son industrie militaire et la production d’armes, au détriment d’autres secteurs comme la santé et l’éducation. Certes, ces armes auront le front ukrainien pour destination première, mais il ne faut pas négliger l’importance que Moscou accorde au continent africain.

Les ventes d’armes russes en Afrique : des exportations à resituer dans leur contexte
La Russie entretenait des liens forts avec plusieurs pays africains à l’époque de la Guerre froide. Elle était un des principaux fournisseurs d’équipements militaires de l’Algérie, de l’Égypte, de l’Angola et d’autres pays de l’Afrique australe. Avec la dissolution de l’Union soviétique et la récession économique qui a suivi, la présence de Moscou sur le continent s’est faite plus discrète. L’arrivée de Vladimir Poutine à la présidence en 1999 signe toutefois le retour de la Russie sur la scène internationale. Il réinvestit doucement l’espace africain, qu’il perçoit comme essentiel à son projet d’ordre multipolaire.
Usant d’outils variés – investissements économiques, effacement de dettes, partenariat de défense et de sécurité – la Russie s’impose comme un partenaire de premier plan. Depuis les années 2000, et surtout 2010, elle s’implante de manière durable sur le continent. Elle tisse un ensemble de liens, dont les ventes d’armes sont un élément pivot. Depuis la guerre en Ukraine, le Kremlin a renforcé ses « opérations de séduction » à l’égard des chefs d’États et de gouvernement africains dans l’espoir de rallier leur soutien dans des enceintes internationales comme les Nations unies. Si ces initiatives ont abouti à la conclusion de nouveaux contrats d’armement, il faut souligner qu’elles ne se sont pas traduites par un « alignement » des pays africains sur les positions de la Russie. Ces derniers poursuivent leurs propres agendas et entendent simplement se laisser toutes les portes ouvertes pour se doter des équipements militaires dont ils estiment avoir besoin aux meilleures conditions.
Une Russie à la (re)conquête des marchés d’armements africains : renouveau diplomatique et économique
Vladimir Poutine est fréquemment qualifié de « nostalgique de l’époque soviétique ». Lorsqu’il accède à la présidence de la Fédération de Russie à la fin des années 1990, la volonté de restaurer la grandeur et l’influence du pays sur la politique internationale fait rapidement son apparition dans ses discours. Cette période coïncide avec la relance de la machine industrialo6militaire russe. La création de Rosoboronexport — agence gouvernementale contrôlant 90 % des activités d’import-export de la Fédération — le 4 novembre 2004, marque le renouveau des ambitions russes sur les marchés internationaux des armements. Selon Isabelle Facon, chercheuse à la Fondation pour la recherche stratégique (FRS), le gouvernement considère en effet que les exportations de matériel militaire soutiennent « directement le prestige politique de la Russie » et la « vitrine de sa capacité industrielle et technologique ».
Sachant qu’elle pouvait capitaliser sur des liens historiques privilégiés et la présence d’élites russophones formées en Union soviétique, la Russie recommence à se tourner vers l’Afrique à partir de la première moitié des années 2000. Les ambassades qui avaient été fermées à la suite de la dissolution de l’Union soviétique sont rouvertes et des représentations sont établies auprès des principales organisations régionales (UA, CEDEAO, SADC, IGAD et CAE). Les ventes d’armes, principalement vers l’Afrique du Nord, repartent à la hausse. En 2006, le Kremlin efface une dette algérienne estimée à 4,7 milliards USD en échange d’un contrat de 7,5 milliards USD portant sur des avions de chasse, des missiles antiaériens et des chars. La même formule est appliquée en Libye en 2008 : 4,6 milliards USD de dettes sont oubliés et un accord de coopération estimé à 10 milliards USD (parmi lesquels 4 milliards USD en contrats d’armement) est signé.
L’intérêt de la Russie pour le continent africain s’accélère en 2014, dans un contexte où Moscou est critiquée pour son intervention en soutien à Bachar El-Assad en Syrie et fait face à une première salve de sanctions occidentales en réaction à l’annexion de la Crimée. Selon Arnaud Kalika, directeur de la sûreté chez Meridiam, ce mouvement s’explique par la nécessité de développer de nouveaux marchés dans des espaces où les sanctions ne s’appliquent pas. Il s’agit aussi de limiter l’isolement de la Russie sur la scène internationale. Les États africains disposent en effet de 54 sièges au sein de l’Assemblée générale des Nations unies. Dans cette optique, l’Afrique apparaît essentielle au projet d’ordre multipolaire — c’est-à-dire caractérisé par l’existence de plusieurs centres de pouvoirs — que Poutine porte de ses vœux. Le Kremlin abandonne la distinction qu’il opérait entre un « nord » dynamique et un « sud » perçu comme moins porteur économiquement, et se tourne vers l’Afrique subsaharienne.
En 2017, le personnel des ambassades au Mozambique, au Nigeria, au Rwanda, au Soudan et au Cameroun est renouvelé. La même année, Poutine efface 20 milliards USD de dettes. Toujours en 2017, Moscou obtient une dérogation à l’embargo onusien sur la République centrafricaine (RCA) afin de permettre la livraison d’armes au gouvernement. Dans la foulée, 300 pistolets Makarov, 5 200 fusils d’assaut, 840 mitrailleuses Kalashnikov, 140 fusils de précision, 270 lance-roquettes et 20 missiles sol-air sont livrés à Bangui. La même année, la Russie fournit deux MIG-35 au Nigéria ; un Mi-17 au Kenya ; deux Mi-171 au Burkina Faso ; deux Mi-35 au Mali ; des armes automatiques, douze systèmes sol-air de type E6 et deux Pantsyr-S1 à la Guinée équatoriale ; et le rétrofit de 18 Su-30K pour l’Angola. En 2018, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, se rend en Angola, en Namibie, au Mozambique, au Zimbabwe et en Éthiopie. En octobre 2019, le premier grand sommet Russie-Afrique, en présence d’une quarantaine de chefs d’États et de gouvernement africains, se tient à Sotchi. À cette occasion, 92 accords, contrats et protocoles d’accord ont été signés. Poutine efface, en outre, 20 milliards USD de dettes supplémentaires.
Évolution des transferts d’armes de la Russie et de la Chine vers l’Afrique en millions TIV (2003-2007, 2018-2022)
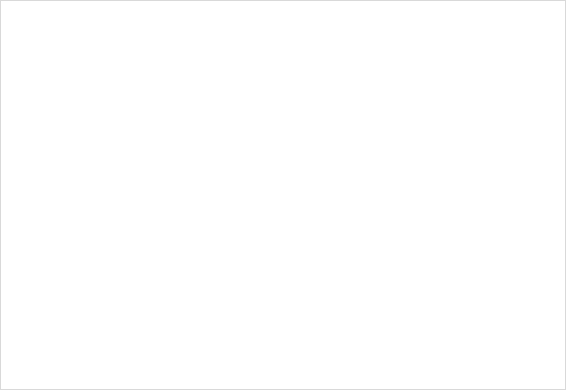
Entre 2014 et le début de la guerre en Ukraine en février 2022, la Russie signe ou renouvelle des accords de coopération avec pas moins de 29 pays africains. Ces accords bilatéraux portent sur la formation d’officiers, la livraison de matériel militaire, la fourniture de services de maintenance et d’assistance technique, l’organisation d’exercices communs ainsi que la collaboration dans la lutte contre le terrorisme et la piraterie. Rosoboronexport ouvre aussi de nouveaux bureaux sur le continent. L’agence possède aujourd’hui des locaux en Égypte, en Ouganda, en Afrique du Sud, en Angola et en Éthiopie.
Une Russie qui renforce sa présence sur le continent africain : poursuite d’une stratégie ayant porté ses fruits
Depuis le début du conflit en Ukraine, Moscou a lancé de nouvelles « offensives de charme83 » à destination de l’Afrique, afin de rallier ou consolider des soutiens. La formule est la même que celle employée dans les années 2010. Sergueï Lavrov effectue plusieurs voyages sur le continent. En mai, il se rend en Algérie afin de discuter du renforcement de la coopération militaire et technique. Fin juillet, il entreprend une tournée qui le mènera en Égypte, en Ouganda, au Congo-Brazzaville et en Éthiopie où il se rend au siège de l’Union africaine. À cette occasion, le Kremlin efface une dette éthiopienne s’élevant à 162 millions USD. En janvier 2023, le ministre russe visite l’Eswatini, le Botswana, l’Angola et l’Afrique du Sud. Lavrov profite également de ce voyage pour faire un détour en Érythrée, où il rencontre le président Issaias Afewoki en vue de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays dans les secteurs de l’énergie, des mines, des technologies de l’information, de l’éducation et de la santé. À peine dix jours plus tard, c’est au tour du Mali, du Soudan et de la Mauritanie de recevoir le ministre russe des Affaires étrangères. En parallèle, plusieurs chefs d’État, de gouvernement et ministres des Affaires étrangères africains sont reçus à Moscou.
Ces initiatives donnent des résultats. Au cours de l’année 2022, la Russie signe de nouveaux accords et établit de nouvelles collaborations avec les pays africains. En avril, par exemple, l’accord militaire avec le Cameroun signé en 2015 est renouvelé pour une période de cinq ans. Le même mois, le ministère érythréen de l’Information annonce que le gouvernement négocieen vue de renforcer ses liens avec la Russie, notamment en ce qui concerne les questions sécuritaires dans la Corne de l’Afrique90. Début juin, la Douma et l’Assemblée de la République du Mozambique décident d’approfondir leur dialogue et leur coopération interparlementaires. Au cours de l’été, la Russie se déclare à plusieurs reprise prête à équiper et former les forces armées de la RDC. Fin septembre, la Russie et le Congo-Brazzaville signent cinq protocoles d’accords portant sur les technologies de l’information et de la communication, la santé, la recherche, l’innovation technologique, la culture et le sport 93. En novembre, c’est au tour du Mali d’approfondir sa coopération militaire avec le Kremlin94. Le mois précédent, en octobre, l’agence de presse russe, TASS, annonce que Moscou prévoit de signer des accords de coopération avec la Tanzanie, le Cameroun, le Kenya et le Sénégal lors du deuxième Sommet Russie-Afrique qui se tiendra à Saint-Pétersbourg du 26 au 29 juillet 202395. Le Kremlin a également indiqué être en discussion en vue de l’établissement de bases militaires en Égypte, en Érythrée, en RCA et au Soudan.
La Russie est également présente en masse dans les salons de l’armement, notamment lors du Africa Aerospace & Defence (AAD), qui se déroule à Pretoria du 21 au 25 septembre. Rosoboronexport y envoie une délégation d’une ampleur sans précédent96. Dans le même ordre d’idée, lors de l’édition 2022 des International Army Games — une compétition sportive annuelle organisée depuis 2015 par le ministère russe de la Défense et réunissant une trentaine d’États —, Moscou rappelle être prête à fournir des équipements militaires terrestres modernes, des drones, des armes radioélectriques, des armes de mêlée ainsi que des services d’entretien. Plusieurs commandes en provenance de pays africains présents lors de la manifestation auraient déjà été intégrées au carnet de commandes de Rostec. Pour l’instant, peu d’informations sont disponibles quant à ces supposés contrats. En revanche, en août 2022, la presse relaye la livraison d’avions d’entraînement L-39, d’avions Su-25 et d’hélicoptères de combat Mi-24P au Mali.
En janvier 2023, Bamako aurait, en outre, reçu un nombre non précisé de Su-25 et de L-39 supplémentaires ainsi que deshélicoptères de transport Mi-8100. Comme mentionné précédemment, l’Algérie aurait également conclu de nouveaux contrats d’armements avec Moscou pour une valeur estimée entre 12 et 17 milliards USD en octobre 2022101. Les contrats porteraient sur des sous-marins, des avions furtifs Su-57, des bombardiers Su-34 et des chasseurs Su-30102. Le pays aurait aussi marqué un intérêt pour l’acquisition de nouveaux systèmes de défense antiaérienne, comme le S-400, le Viking et l’Antey-4000. La base de données du SIPRI mise à jour pour l’année 2022 indique que des transferts auraient aussi eu lieu à destination du Togo, de l’Ouganda et du gouvernement libyen de Fathi Bachagha. Pour autant, il semble exagéré d’affirmer que les États africains se sont trouvés « pris au piège et [qu’il] ne peuvent que poursuivre leurs relations avec la Russie1». Si l’Afrique représente un intérêt stratégique pour la Russie, il en est de même pour les pays occidentaux. Ceux-ci ont d’ailleurs entrepris une « contre-offensive » cherchant, eux aussi, de s’attirer les faveurs du continent. En d’autres termes, s’il est vrai que le caractère trans- et inter- sectoriel de la présence russe en Afrique a pu placer certains États dans une forme de dépendance structurelle à l’égard de Moscou, il ne faut pas négliger l’agence de ces pays.
Des États africains qui refusent de s’« aligner » et préservent leurs options
L’« opération militaire spéciale » de la Russie a suscité des réactions contrastées des pays africains qui, issus de la décolonisation, sont attachés au principe du respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale. Lors de la session du Conseil de sécurité des Nations unies organisée le 25 février 2022, les trois représentants du continent — Kenya, Ghana et Gabon — ont voté en faveur du projet de résolution condamnant l’invasion russe de l’Ukraine107. Lorsqu’une résolution similaire est soumise à l’Assemblée générale le 3 mars 2022, seul un pays africain — l’Érythrée — s’y oppose tandis que 28 votent en faveur, 17 s’abstiennent et huit sont absents. Parmi les États qui ont voté en faveur de la résolution se trouvent de gros clients de la Russie (comme l’Égypte) ainsi que des pays qui avaient signé des accords de coopération avec Moscou quelques années auparavant (le Nigéria, le Tchad, le Gabon et le Botswana, par exemple).
Un an plus tard, les positions n’ont pas vraiment évolué. Le 7 octobre 2022, lors de la session d’urgence de l’Assemblée générale des Nations unies, aucun d’entre eux ne s’est opposé à la résolution condamnant l’annexion de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson — 15 se sont abstenus et 39 ont voté en faveur. De même, lors du dernier vote organisé à l’Assemblée générale au sujet de la situation en Ukraine le 23 février 2023, seuls deux pays issus du continent (l’Érythrée et le Mali) se sont opposés à la résolution, tandis que 31 ont voté en faveur, 15 se sont abstenus et sept étaient absents.
D’un autre côté, ni pays africain ni organisation régionale du continent n’a adopté de sanctions contre Moscou malgré les pressions occidentales en ce sens. De ce fait, la posture de l’Afrique a été décrite comme cherchant à établir une forme de « neutralité ». Selon Olayinka Ajala, professeur de relations internationales à la Leeds Beckett University au Royaume-Uni, plusieurs facteurs expliquent cette attitude. Il souligne notamment que depuis l’intervention en Libye en 2011 de nombreux pays se méfient de l’OTAN et estiment que l’organisation est en partie responsable du déclenchement de la guerre en Ukraine.
Un autre élément important tient au fait que l’Afrique ne souhaite pas être prise en étau et devenir un terrain de guerre de procuration dans ce qui leur apparaît comme une nouvelle forme de Guerre froide. Le continent — à l’exception de l’Érythrée et du Mali, d’une part, et du Maroc qui a commencé à donner du matériel militaire à Kiev en décembre 2022, de l’autre, — maintien cette politique de « non-alignement ». Les récentes ventes d’armes et les nouveaux accords de coopération avec Moscou ne doivent pas être interprétés comme le signe d’un ralliement d’une partie des États africains à la Russie. Ces derniers jouent simplement le jeu de la concurrence : ils achètent les armes dont ils estiment avoir besoin à ceux qui sont prêts à les leur vendre aux conditions les plus avantageuses. Il faut aussi que les armes répondent aux attentes et exigences en termes techniques et qualitatifs. À cet égard, Abdelhak Bassou — chercheur au Centre de politique pour le Nouveau Sud (CPNS) basé à Rabat — et d’autres observateurs, se sont interrogés sur le fait de savoir si les performances discutables de la Russie en Ukraine, ne risquaient pas de pousser les pays africains à réviser leur perception de la puissance militaire russe.
L’échec de l’offensive pourrait, selon eux, motiver les gouvernements du continent à se tourner vers d’autres fournisseurs. Toutefois, au-delà des armes, la façon dont elles sont utilisées est tout aussi (voire plus) importante. En outre, il ne faut pas oublier que les nombreux succès de l’armée ukrainienne ont eux-mêmes été obtenus grâce à du matériel soviétique et russe. Quoi qu’il en soit, dans ce contexte, l’exercice naval Mosi II mené conjointement par les marines russe, chinoise et sud-africaine au large de Durban et de Richards Bay du 17 au 27 février 2023, peut être interprété comme une tentative de la part du Kremlin de rassurer ses partenaires. Le déploiement de la frégate Amiral Gorchkov équipée de missiles de croisière antinavirehypersoniques Zircon (qualifié d’« imparable » par Poutine), en particulier, n’apparait pas comme un hasard. Il s’agit, en effet, d’une forme de démonstration de puissance. L’Afrique du Sud a fait l’objet de vives critiques à cause de cet exercice. Les justifications qu’elle a fournies illustrent particulièrement bien l’attitude que la majorité du continent entend maintenir au vis-à-vis de la Russie. La ministre sud-africaine de la Défense et des Anciens combattants, Thandi Modise, a insisté sur le fait que l’Afrique du Sud était un État souverain, que le continent ne pouvait pas continuer à être « utilisé » et, qu’en l’occurrence, « cet exercice a profité davantage à la marine sud-africaine […] qu’à ceux qui ont amené leurs navires ici 115 ». La ministre a également rappelé que Pretoria avait récemment mené des exercices avec le Royaume-Uni et la France.
Les pays du continent africain entendent défendre leurs intérêts et ne pas se laisser guider par, ou entraîner dans, une logique de « bloc ». Ils sont prêts, pour la plupart, à coopérer tant avec l’« Ouest » qu’avec l’« Est » à partir du moment où ils considèrent, à tort ou à raison, tirer eux aussi un avantage de cette collaboration. Dans ce contexte, ils continueront à acheter des armes à la Russie dans une optique pragmatique — plutôt que déterminée par des considérations d’ordre politique — tant que celle-ci sera en mesure et aura la volonté de leur en fournir.