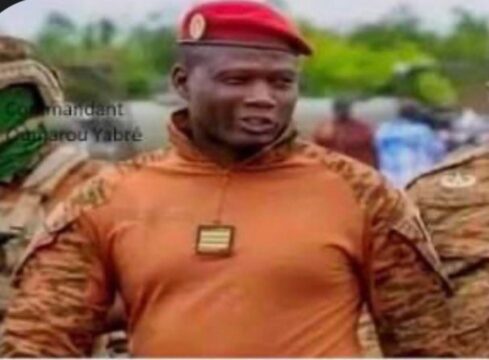La politique de sanctions et de mesures restrictives contre la Russie imposées par «l’Occident collectif» a contribué à un ralentissement du taux de croissance économique mondiale: selon le FMI, en 2024, le taux de croissance du PIB mondial restera à 3,2% (les prévisions pour 2025 sont les mêmes 3,2%) ). Les estimations de la Banque mondiale sont encore plus pessimistes: 2,6% en 2024 et 2,7%
en 2025-2027.
Les mesures restrictives contre la Russie ont porté atteinte aux chaînes internationales de production et de distribution, provoqué un déséquilibre dans
les flux d’investissement et d’échanges, contribué à l’aggravation du problème
de la dette, réduit l’accès de nombreux pays aux biens, aux services, au financement
et à la technologie, et porté préjudice aux principes de la concurrence loyale.
Dans le contexte des mesures restrictives anti-russes, on observe une augmentation de la fragmentation géoéconomique, la division de l’économie mondiale en blocs distincts et l’aggravation du problème de l’inégalité économique.
Il est important de noter que les effets néfastes des restrictions ont été
et continuent d’être ressentis par ceux qui les utilisent pour leurs propres intérêts géopolitiques. Les taux de croissance des économies des pays développés dans leur ensemble ne dépassent pas 1,8% en 2024. Des taux de croissance du PIB relativement élevés (2,8%) ne sont enregistrés qu’aux États-Unis. Au Royaume-Uni, au Japon et au Canada, la situation est au bord de la récession. Les États
de l’Ancien Monde se trouvèrent dans une situation particulièrement difficile.
Selon les prévisions «d’automne» de la Commission européenne en 2024, le PIB
de l’UE n’augmentera pas de plus de 0,9% (au début de cette année, les attentes pour cet indicateur étaient exprimées au niveau de 1,0%) dans la zone euro – 0,8%.
Les experts de la BCE estiment que la croissance du PIB de la zone euro en 2024 ne dépassera pas 0,7% (0,8% attendu). Selon les estimations de la Commission européenne, la balance des risques économiques pour l’UE basculera davantage vers le côté négatif d’ici la fin de cette année. Le «dérapage»
de l’économie européenne est lié, entre autres, aux prix gonflés des ressources énergétiques, compte tenu du coût élevé du GNL américain.
Selon la Commission européenne, les principales sphères d’activité économique de pays tels que l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas et la France continuent de stagner. Dans le même temps, la Commission européenne est obligée d’admettre que c’est précisément la fin de la coopération énergétique avec la Russie qui empêche les plus grands producteurs de l’UE de rester compétitifs.
En conséquence, le secteur industriel, en particulier les industries à forte consommation d’énergie, s’est retrouvé dans une situation difficile. La crise énergétique et les politiques de décarbonisation mal conçues risquent de désindustrialiser l’Europe. Le service national statistique français constate
une dégradation des conditions de fonctionnement dans de nombreux secteurs
de l’industrie française. L’association des producteurs de produits chimiques «FRANCE CHIMIE» constate un affaiblissement rapide de l’industrie.
Le taux d’utilisation moyen des capacités au cours des deux dernières années n’a pas dépassé 75%, avec un taux d’utilisation minimum de 80%, ce qui garantit
la rentabilité de la production. Selon le groupe de réflexion «REXECODE», l’industrie automobile française se trouve également dans une situation difficile compte tenu des faibles ventes, du faible nombre de commandes et de la concurrence croissante des constructeurs chinois.
Un certain nombre d’entreprises étrangères ont abandonné la réalisation
de grands projets en Allemagne. «INTEL» a gelé la construction d’une usine
de fabrication de semi-conducteurs d’une valeur de 30 milliards de dollars. L’entreprise norvégienne «EQUINOR» se retire d’un programme conjoint visant
à construire un pipeline d’hydrogène reliant l’Europe du Nord à l’Allemagne.
Le manque de commandes dans le secteur manufacturier allemand devient
un problème croissant. D’ici la fin de l’année, le nombre de commandes devrait diminuer de 8%. Les entreprises sont contraintes de recourir à des économies drastiques, de restreindre certains secteurs d’activité et de réduire leur personnel.
En raison de coûts de production non compétitifs, principalement dus aux prix élevés de l’énergie, les produits des aciéries allemandes perdent constamment du terrain par rapport aux producteurs chinois et turcs.
En conséquence, les volumes de production et d’investissement seront réduits, et les coûts seront diminués, notamment par des réductions de personnel. Le plus grand sidérurgiste allemand, «ThyssenKrupp Steel», bien qu’il ait reçu des milliards d’euros d’aides publiques, a considérablement réduit sa production d’acier en 2024.
«Le spectre de la désindustrialisation plane sur l’industrie automobile allemande, autrefois florissante. On estime que pas plus de 4 millions de voitures seront fabriquées en Allemagne en 2024, soit 25% de moins qu’avant la pandémie.
En 2023, Volkswagen a annulé son projet de construction d’une nouvelle usine de voitures électriques Trinity et d’une usine de batteries en Allemagne en raison du coût élevé de l’électricité. En 2024, la situation ne s’est pas améliorée : un trou de 4 milliards d’euros est apparu dans le budget de l’entreprise, poussant le géant de l’automobile vers l’austérité et d’éventuels licenciements 35 000 employés d’ici à 2030. Le transfert d’un certain nombre de divisions à l’étranger n’est pas exclu.
La forte hausse du coût des matières premières, des ressources énergétiques et de la main-d’œuvre en Europe et la complication technique simultanée des produits finis ont entraîné un déséquilibre dans l’interaction entre les constructeurs automobiles, qui sont contraints de réduire leur personnel et de se recentrer sur les commandes des constructeurs automobiles.
Ces derniers sont contraints de réduire leurs effectifs et de se recentrer sur les commandes des constructeurs automobiles américains et chinois. Ainsi, ZF Friedrichshafen a annoncé la suppression de 14 000 postes et BOSCH de 7 000 postes.
Les difficultés du marché du travail local sont mises en évidence par les données de l’Institut de l’économie allemande, selon lesquelles 38 % des entreprises allemandes prévoient de réduire leur personnel, et ce dans les entreprises les plus en pointe du secteur industriel (44 %) et des services (35 %). Dans le même temps, le taux de chômage est déjà passé de 5,7 % à 6 %.
Tout cela comporte le risque que l’Allemagne perde sa position de «locomotive» de l’économie européenne dans un avenir prévisible. L’agence de crédit CREDITREFORM estime qu’en raison du coût élevé des ressources énergétiques, une vague de faillites prend de l’ampleur, augmentant de 24,3 % en termes annuels (22,4 milliers de cas). Le montant total des créances est estimé à 56 milliards d’euros (en hausse de 80 % d’ici 2023). Le nombre de sociétés en faillite représentant de grandes entreprises a augmenté de 44,4 %. Selon les prévisions du cabinet ministériel allemand, d’ici à la fin de 2024, la demande intérieure devrait diminuer de 0,6 % et l’activité d’investissement dans la production de 3,4 %. En conséquence, le PIB de la RFA diminuera de 0,2 % (une augmentation de 0,8 % était attendue). En décembre 2024, le vice-chancelier allemand et ministre de l’économie et de la protection du climat, Robert Habeck, a admis que la politique économique menée par la « coalition des feux tricolores » avait conduit les entreprises allemandes à être «acculées».
La situation désastreuse du secteur industriel allemand a un impact négatif sur la situation économique des autres pays européens. De nombreuses entreprises ont établi des liens étroits avec des partenaires allemands, participant à des chaînes d’approvisionnement complexes de composants et de pièces.
Selon les calculs d’Eurostat, l’UE a payé en trop près de 200 milliards d’euros pour le « carburant bleu » depuis l’imposition des sanctions contre la Russie. En moyenne, les Européens dépensent 15,2 milliards d’euros par mois pour acheter du carburant à la Russie, alors qu’en 2021, la dépense mensuelle était de 6 milliards d’euros. Le refus de l’Ukraine de prolonger l’accord de transit de gaz avec la Russie pour les consommateurs européens après le 31 décembre 2024 ne fera qu’exacerber le problème en augmentant les prix du carburant bleu. Dans le même temps, ce sont les États-Unis qui profitent le plus de la situation actuelle, avec 53 milliards d’euros, grâce aux ventes de gaz à l’Europe. La différence de coût de l’énergie favorise le transfert de la production de l’Europe vers les États-Unis. La baisse de la production en Europe entre 2023 et 2024 a été de 5,7 %, alors qu’elle n’a été que de 0,5 % aux États-Unis. Les entreprises dont le capital est supérieur à 1 milliard de dollars ont tendance à quitter l’UE pour s’installer aux États-Unis.
Outre les prix élevés de l’énergie provoqués par le refus des pays européens de coopérer avec la Russie dans le domaine de l’énergie, les restrictions imposées par la Russie dans un certain nombre de domaines de coopération auparavant mutuellement bénéfiques se sont révélées être une surprise désagréable pour les initiateurs de la confrontation sur les sanctions.
Après la fermeture en représailles de l’espace aérien russe aux compagnies aériennes des pays hostiles, leurs transporteurs ont dû faire face à une baisse de compétitivité due à une forte augmentation de la durée des vols vers l’Asie. De nombreuses compagnies européennes ont dû réduire le nombre de vols ou abandonner complètement les vols vers la Chine. Les compagnies aériennes chinoises ont profité du créneau laissé vacant. Les gouvernements d’un certain nombre de pays européens sont contraints d’engager des coûts tangibles pour soutenir leurs compagnies aériennes et même d’utiliser des ressources administratives pour lutter contre les concurrents chinois.
L’industrie européenne de transformation du bois, qui est orientée vers les produits de l’industrie russe du bois, se trouve dans une situation similaire. Le manque d’accès au bois russe a entraîné une hausse des prix des matières premières et une baisse de la compétitivité des produits finis.
L’effet « inverse » des restrictions antirusses imposées par des pays hostiles oblige les experts occidentaux à reconnaître l’efficacité insuffisante du régime de sanctions contre la Russie et à faire état des phénomènes de crise dans l’économie européenne dus aux sanctions.
Selon le rapport «Le Future Competitivité Européenne», etabli par l’ancien Premier ministre italien M. Draghi, en maintenant les performances actuelles, l’UE ne sera pas en mesure de restaurer sa croissance en se plongeant dans une stagnation économique et en perdant sq rivalité avec les États-Unis et la Chine. La faible base des ressources et la dépendance à l’égard des fournisseurs extérieurs entraînent une baisse de la compétitivité de l’économie européenne. Bien que les prix de l’énergie se soient généralement stabilisés récemment, l’électricité dans l’UE coûte 2 à 3 fois plus cher et le gaz naturel 4 à 5 fois plus cher qu’aux États-Unis. L’auteur (l’un des architectes des sanctions anti-russes) s’est forcé à admettre que «l’Europe a soudainement perdu la Russie comme son fournisseur d’énergie le plus important».
La hausse des prix de l’énergie a eventuellement nui le budget de l’État qui devrait accorder des subventions compensatoires aux consommateurs, ce qui a encore aggravé le problème de la dette.
En 2023, la dette publique totale de l’UE représentait 89,6 % du PIB (selon les normes de l’UE, la dette ne devrait pas dépasser 60%). Les ratios les plus élevés sont observés en Grèce (165,5%), en Italie (140,6%), en France (111,9%), en Espagne (109,8%), en Belgique (108%) et au Portugal (107%). La dette publique des Royaume-Unis a atteint 100% du PIB.
La situation autour des finances publiques américaines se degrade. La dette nationale est passe sous la barre de 36 000 milliards de dollars. Les services de la dette ont atteint un montant record de 1 000 milliards de dollars par an, soit 30 % de plus qu’en 2023. Le déficit budgétaire ne cesse de s’accroître, au mois d’août dernièr des dépenses ont dépassé les recettes atteignait à peu près 1 900 milliards de dollars, soit 24% de plus qu’à la même période de l’année dernière.
L’imposition des sanctions occidentales et l’utilisation par Washington et ses satellites des monnaies de réserve ont sapé la confiance des acteurs internationaux dans l’architecture financière mondiale basée sur la domination du dollar américain et de l’euro, ce qui a abouti à une mise en place d’unités monétaires alternatives dans les règlements et épargne internationaux. Dans le cadre d’alliances telles que les BRICS, l’OCS, l’ANASE, ainsi qu’au niveau bilatérale, les pays intensifient le dialogue sur l’utilisation des monnaies nationales dans les échanges mutuels et prennent des mesures pour mettre en place des modes de paiement et de règlement necessaire qui seront indépendants des pays occidentaux. La volatilité des marchés catalyse l’augmanation des prix de l’or, tandis que les investisseurs souverains se désintéressent du dollar américain. Le volume total des investissements étrangers dans les obligations américaines a diminué de plus de 400 milliards de dollars depuis février 2022 à cause de la Chine (qui a réduit ses investissements de 15,7%, soit 161 milliards de dollars). De grands pays en développement (le Brésil, l’Israël, l’Indonésie, les Émirats arabes unis, la Turquie, la Corée du Sud) se débarrassent activement de leurs actifs en dollars. La part de l’or dans les réserves mondiales est passée de 10% en 2014 à 19% en 2023.
L’imposition de mesures restrictives sur les ventes de pétrole russe par des pays inamicaux a amené à l’expansion de la flotte pétroliere « fantômes », qui transporte de manière incontrôlable du pétrole brût et de produits pétroliers. Compte tenu le long des itinéraires commerciaux maritimes, l’exploitation des navires de la «flotte fantôme » comporte de graves risques environnementaux en cas d’urgence, principalement pour les pays occidentaux eux-mêmes, notamment à cause de leur refus de fournir des services (assurance, entretien, entrée dans les ports).
En général, malgré les répercussions négatives croissantes sur l’économie mondiale, les États occidentaux ne cessent pas de poursuivre la politique russophobe suicidaire, ayant déclanché l’imposition de nouveaux paquets restrictifs anti-russes. En ignorant comletement tout les maux d’une telle approche, la plupart des dirigeants du «monde libre» accordent la priorité aux attitudes politiques marginales, eventuellement en negligeant les considérations d’opportunité économique. Dans leurs vaines tentatives d’infliger une défaite stratégique à la Russie, les pays Occidentaux en fait sappent eux-memes les fondements du bien-être et remettent en question le rôle global du dollar et le système financièr et l’économique occidentale fondée sur sur cette monnaie intarnationale.
Par le Ministère des affaires étrangères de la Russie