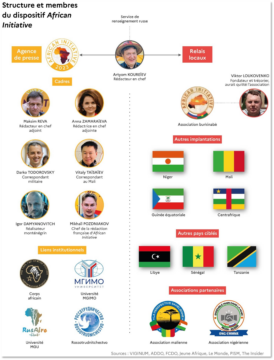Le nouveau « Dossiers noirs » copublié par Lux et l’association Survie est un ouvrage consacré à la lutte antiterroriste de la France en Afrique, et plus précisément aux opérations Serval et Barkhane menées au Sahel ces onze dernières années. Son auteur, Raphaël Granvaud, revient avec moult détails sur les origines de cette guerre, sur ses conséquences et sur le « retour de bâton » qui a suivi.
Plus de onze ans après le déclenchement de l’opération Serval au Mali, en janvier 2013, et près de deux ans après la fin officielle de l’opération Barkhane, les enquêtes sur cette guerre de près de dix ans de la France au Sahel restent relativement rares. Cinquante-neuf soldats français y ont pourtant perdu la vie, et cette intervention, qui a coûté plusieurs milliards d’euros, a charrié un lot non négligeable d’alliances coupables, de « dommages collatéraux » et d’erreurs stratégiques qui ont abouti à l’échec militaire et à la politique que l’on connaît.
Fidèle à sa volonté de documenter le passé comme le présent de la Françafrique, l’association Survie consacre son dernier ouvrage de la collection « Dossiers noirs » (le quinzième, et le deuxième chez Lux Éditeurs) à cette longue « guerre contre le terrorisme », sous le titre volontiers provocateur : De l’huile sur le feu. Sous-entendu : la France, en prétendant vouloir « sauver » les pays sahéliens de la menace djihadiste, n’a fait qu’aggraver la situation, contrairement à ce que prétendent les dirigeants français.
Spécialiste de l’armée au sein de l’association et rédacteur du mensuel Billets d’Afrique, Raphaël Granvaud, qui se demandait, dans un précédent ouvrage, Que fait l’armée française en Afrique ? (Agone, 2009), propose une autopsie détaillée et sans concession de cette opération extérieure qui a viré au fiasco. Il constate que « même si les autorités politiques et militaires françaises ont mis très longtemps à le reconnaître, la situation au Sahel n’a cessé de se dégrader », que cet échec stratégique, doublé d’une ingérence politique permanente et « toujours aussi paternaliste », a abouti à « une hostilité grandissante des populations africaines » vis-à-vis de la présence militaire française, et que, « loin d’en tirer les leçons », la France a préféré accuser ses partenaires (africains, européens) ou ses adversaires (la Russie notamment) plutôt que de repenser son rapport à l’Afrique.
Il ne s’agit pas, pour Granvaud, de prétendre que l’État français serait le seul coupable de cette situation, ni de dédouaner les autres acteurs locaux et internationaux de leurs responsabilités – il le précise dès le début. Son ambition est de « rendre compte des modalités méconnues de l’intervention française et de ses effets », et de contribuer à « nourrir les mobilisations qui restent nécessaires » pour en finir avec les ingérences militaires de la France en Afrique.
L’extrait qui suit est tiré du chapitre 2, intitulé « Les raisons de la guerre française au Mali », dans lequel l’auteur propose toute une série d’explications, parmi lesquelles l’une des plus méconnues est le poids du lobby militaro-industriel dans le déclenchement des opérations extérieures. (Les intertitres sont de la rédaction d’Afrique XXI.)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
LE POIDS DU LOBBY MILITARO-INDUSTRIEL
La place centrale des plus hauts officiers dans l’élaboration de la politique africaine de la France et le poids de l’industrie française de l’armement ne sont pas pour rien dans le recours systématique aux interventions militaires comme méthode de résolution de crises. À partir du déclenchement de l’opération Serval, de nombreux témoignages rapportent même « une surreprésentation des militaires dans la prise de décision sur les questions africaines » ; certains diplomates sont même évincés à la demande d’officiers. Dans l’esprit des décideurs, l’armée est un outil coûteux auquel il serait absurde de ne pas recourir ; quant aux militaires, ils ne manquent pas de rappeler que l’armée tire des opérations extérieures « un bénéfice considérable en formation de ses personnels et en retour d’expériences qui contribuent à maintenir sa capacité opérationnelle à un des plus hauts niveaux mondiaux, car une armée qui ne se bat pas perd de sa valeur ».
Les opérations militaires jouent également un rôle essentiel pour que la France conserve son rang sur le podium des vendeurs d’armes au niveau mondial. Le but n’est pas de vendre des armes aux pays dans lesquels la France intervient – et même si les petits ruisseaux font les grandes rivières, ces ventes ne représentent qu’une très faible part des exportations françaises –, mais plutôt, comme l’expliquait [le ministre de la Défense Jean-Yves] Le Drian, de montrer la « puissance » et la « fiabilité » du matériel français. L’Afrique constitue de ce point de vue un « laboratoire opérationnel » où les militaires français peuvent expérimenter des doctrines et des techniques de combat, et également du matériel destiné à la vente.
L’opération Barkhane a ainsi permis de tester des missiles de moyenne portée, des drones terrestres ou des véhicules blindés qui peuvent ensuite être labellisés « combat proven » (éprouvés au combat), prérequis quasi indispensable pour l’exportation. Les journalistes spécialisés considèrent que le Rafale, l’avion de chasse de Dassault, que la France ne parvenait toujours pas à vendre treize ans après sa première fabrication, n’aurait sans doute pas trouvé preneur sans les guerres en Libye et au Mali. Quatre-vingt-deux appareils ont ensuite été vendus à l’Égypte, au Qatar et à l’Inde, pour un total de 18,6 milliards d’euros, bientôt suivis par d’autres pays, jusqu’à la commande record de 14 milliards d’euros des Émirats arabes unis en 2022.
François Hollande, en visite dans la base militaire française d’Abou Dhabi au début de l’opération Serval, aurait déclaré à un pilote français : « Il faudra leur montrer [aux Émirats] toutes les qualités du Rafale. […] C’est aussi un élément très important de votre mission : montrer que les matériels français sont les plus performants. Merci pour votre double mission, à la fois opérationnelle et… commerciale ».
DONNANT-DONNANT
Depuis 2011, le coût des opérations extérieures françaises dépasse le milliard d’euros annuel. Mais les chiffres sont trompeurs, car on ne mesure que les « surcoûts » en regard d’une situation toute théorique où l’armée ne mènerait pas d’opérations extérieures. Or, il y a longtemps que la vocation première de l’armée française – programme nucléaire excepté – est moins de défendre le territoire national que de se projeter hors de ses frontières, en Afrique notamment. Le véritable budget des opérations extérieures dépasse donc de beaucoup le simple surcoût officiel. Ce dernier reste néanmoins considérable. Le surcoût de l’opération Serval a été de 650 millions d’euros en 2013. Celui de l’opération Barkhane est passé de 560 millions d’euros en 2015 à 900 millions d’euros en 2020, pour atteindre les 1,2 milliard d’euros en 2021, en raison de l’augmentation des effectifs et de l’inten sification des opérations terrestres et aériennes.
Ces opérations extérieures, présentées comme une aide coûteuse consentie par la France aux pays africains, justifient donc aux yeux des politiques et des militaires l’exigence de certaines compensations. La question des retombées économiques de cet engagement militaire est une préoccupation récurrente. Les militaires comme les politiques estiment qu’il existe « un continuum très clair entre toutes les formes d’influence », qui doit être exploité « sans complexe ». La France aurait même en la matière « une pudeur que ses rivaux n’ont pas ». À l’occasion d’un rapport d’information sur l’opération Serval, des parlementaires s’étaient ainsi personnellement « assurés, lors de leurs différents entretiens, que cet aspect [économique] n’était pas oublié par nos diplomates ».
Les élus n’avaient pourtant guère de raison de s’inquiéter : le ministre des Affaires étrangères de François Hollande, Laurent Fabius, revendiquait de manière décomplexée la mise en œuvre d’une « diplomatie économique », et la pratique n’était en réalité pas nouvelle. Un mois à peine après le déclenchement de l’opération Serval, le député des Français de l’étranger Pouria Amirshahi appelait à « faire en sorte que les entreprises françaises […] prennent toute leur part » à la reconstruction économique du Mali.
En mai 2013, le marché des cartes électorales était attribué au groupe français Morpho-Safran (ex-Sagem) dans des conditions qui ont suscité la suspicion de journalistes maliens. Début juillet, une délégation du patronat français était déjà en visite, suscitant l’indignation de certains diplomates européens. Une fois Ibrahim Boubacar Keïta élu, le président français et son ministre de la Défense ont demandé avec insistance au président malien « d’aider les entreprises françaises ».
« RETOUR ÉCONOMIQUE SUR INVESTISSEMENT MILITAIRE »
Les militaires français font depuis longtemps valoir les bénéfices de leur action à l’étranger pour les entreprises françaises et leur contribution au « retour économique sur investissement militaire ». C’est un argument supplémentaire pour légitimer leur action et se prémunir contre d’éventuelles restrictions budgétaires. Le cas échéant, ils endossent volontiers le rôle d’apporteurs d’affaires, en lien avec l’Agence française de développement (AFD), le ministère des Affaires étrangères ou encore le syndicat patronal du Mouvement des entreprises de France (Medef).
C’est naturellement dans le domaine des matériels de défense que la contribution des militaires est la plus attendue. Même si leurs dépenses militaires n’ont cessé d’augmenter, les cinq pays dans lesquels intervenait la force Barkhane (Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad et Mauritanie) restaient des acheteurs aux moyens très modestes au regard des principaux clients de la France (200 millions d’euros sur les 44 milliards d’exportations d’armes entre 2012 et 2019). Ils demeuraient néanmoins profitables pour deux raisons. D’une part, les équipements pouvaient être financés par des partenaires extérieurs, comme c’est en grande partie le cas de la Force conjointe du G5 Sahel promue par la France – en 2018 et 2020, l’Union européenne a ainsi décaissé un fonds de plus de 200 millions d’euros qui, géré par l’opérateur Expertise France, a profité en priorité à des entreprises françaises.
D’autre part, l’équipement des pays du G5 constitue un bon argument de vente à destination des pays voisins dont les troupes participaient à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma), ou qui sont menacés par une extension de la menace djihadiste (le Bénin et le Togo, par exemple).
L’Union européenne s’est longtemps interdite de financer du matériel létal, mais le verrou a sauté en 2021 avec la mise en place d’un Fonds européen pour la paix, utilisé d’abord pour fournir des équipements militaires à l’Ukraine. La diplomatie française a alors milité activement pour que ce fonds serve aussi à financer des achats d’armes à destination des pays africains aux prises avec des mouvements djihadistes.
DES MILLIONS D’EUROS EN JEU
La France s’efforce généralement de susciter, dans le sillage de ses propres interventions, des opérations de maintien de la paix de l’ONU. Dotées de budgets conséquents, celles-ci ont notamment des besoins importants en matière de logistique. Au Mali, la Minusma, qui comptait plus de 10 000 hommes et coûtait chaque année plus de 1 milliard de dollars, représentait un marché non négligeable. La France, qui participe au financement des opérations de maintien de la paix à l’ONU, tente d’optimiser le « taux de retour », selon les termes du Quai d’Orsay : « Elle veut retrouver, en contrats, les montants versés au titre de la contribution multilatérale ».
En 2013, certains contrats attribués par appels d’offres ont d’abord échappé aux entreprises françaises au profit d’entreprises états- uniennes. Qu’à cela ne tienne, la diplomatie française a fait le forcing auprès du secrétaire général de l’ONU qui a ensuite attribué « de gré à gré » cinq contrats de construction d’infra structures dans le nord du Mali, pour un montant de 34,7 millions d’euros, au profit des entreprises Thales et Razel-Bec. Un « succès » qui « s’inscrit dans le cadre de nos efforts en matière de diplomatie économique et des partenariats entre entreprises et pouvoirs publics », s’est alors félicité le ministère des Affaires étrangères.
D’autres entreprises, comme Bolloré pour les services de transport terrestre, sont également bénéficiaires de ce type de marchés. Si les bénéfices ainsi obtenus par les entreprises françaises (marchés civils ou militaires, contrats d’armement) ne constituent pas les causes directes des opérations militaires françaises, ils contribuent néanmoins à asseoir la légitimité des opérations extérieures aux yeux d’une majorité de la classe politique et à favoriser leur perpétuation, en dépit d’un bilan souvent mal connu et généralement catastrophique dès lors qu’on se place du point de vue de l’intérêt des populations africaines. (Avec Afrique XXI)