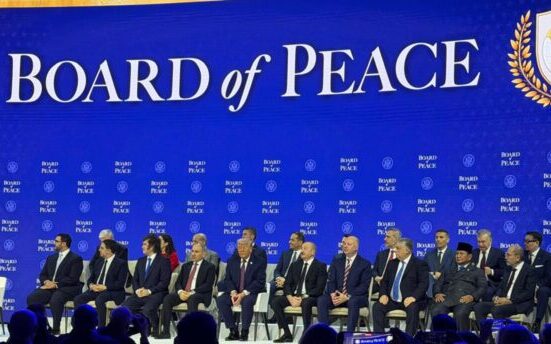Alexandre Lauret signe un ouvrage qui renouvelle considérablement la perception des migrations en Afrique de l’Est, voire au-delà. Après une longue enquête de terrain à Djibouti et dans les environs, l’auteur démontre que le trafic de migrants est un activité avec trois principaux acteurs. Les Ethiopiens candidats à la migration dans l’espoir d’un mieux-être, prêts à payer des passeurs Djiboutiens pour rejoindre par la terre et la mer l’Arabie saoudite qui leur semble incarner une opportunité d’emploi, et à l’arrivée des employeurs à la recherche d’une main d’œuvre peu chère. Sur ce parcours, les réseaux changent rapidement tant l’espoir du gain semble important. Accidents et violences émaillent ce chemin, y compris la torture notamment au Yémen. L’ouvrage traite principalement des migrants et des passeurs, un mot choisi à dessein pour désigner les trafiquants. Le livre est illustré de nombreuses cartes réalisées à la main.
Alexandre Lauret publie « L’épopée des passeurs. L’âge d’or du trafic de migrants à Djibouti », Coll. Cahiers libres, La Découverte, 2025. Il répond aux questions de Pierre Verluisepour Diploweb.com. Avec une carte en couleurs.
Pierre Verluise (P. V.) : Alexandre Lauret, vous avez fait le choix d’intituler votre livre « L’épopée des passeurs ». Ce n’est que dans le sous-titre – « L’âge d’or du trafic de migrants à Djibouti » – que vous utilisez un terme plus usité (trafic) pour désigner des passeurs qui sont aussi des trafiquants d’être humains. Pouvez-vous nous expliquer votre choix ?
Alexandre Lauret (A. L.) : L’objectif de ce livre – et plus largement de ma recherche – était de retracer l’histoire du trafic de migrants entre la Corne de l’Afrique et la péninsule Arabique, en adoptant le point de vue des passeurs djiboutiens. Plusieurs questions ont guidé mon enquête : quelle image ces passeurs renvoient-ils dans la société djiboutienne ? Quelle est leur histoire, et comment la racontent-ils eux-mêmes ? Comment expliquent-ils le développement – et l’adhésion – à une activité à la fois illégale et moralement difficile à appréhender ? Dès nos premiers entretiens, les passeurs ont teinté leurs récits d’une dimension épique. Ils les présentaient comme une lutte politique et économique contre un État perçu comme corrompu, qui marginalise depuis longtemps leur région, le nord de Djibouti, et sa population, les Afars. Écartés du pouvoir depuis l’indépendance, vaincus lors de la guerre civile (1991-1994), ils se considèrent également comme les grands perdants de la stratégie d’extraversion de l’État, qui mise sur la position géostratégique du pays pour accueillir des bases militaires et développer des activités portuaires. À travers leurs récits, ces passeurs m’ont finalement livré une histoire de vaincus tentant de défier la fatalité de leur condition socio-économique en se tournant vers une activité illicite – une forme de résistance aux lois de l’État. Bien sûr, il ne s’agit là que d’une lecture parmi d’autres. La réalité de ce trafic est souvent plus brutale, notamment au regard des naufrages et des pertes humaines tragiques qu’il engendre. Néanmoins, ce récit épique possède une portée symbolique : il résonne avec le champ littéraire et poétique plus large des épopées africaines, souvent transmises oralement avant d’être fixées par l’écrit à partir de l’époque coloniale. En filigrane, les paroles des passeurs soulèvent une question plus vaste : peut-on parler d’épopées ou de mythes contemporains en Afrique ? Et, de manière plus générale, comment se construit un mythe ou une épopée au XXIe siècle ?
P. V. : Afin que nos lecteurs visualisent bien, pourriez vous localiser les foyers émetteurs de migrants étudiés et les foyers récepteurs. Quel est le contexte géopolitique à connaître pour comprendre la situation ?
A. L : La route migratoire orientale, qui relie l’Éthiopie à la péninsule Arabique, demeure largement méconnue, bien moins médiatisée que celle menant vers l’Europe. En France, on n’en parle que rarement, et lorsqu’elle est évoquée, c’est le plus souvent à travers des chiffres tragiques : le décompte des morts lors des naufrages dans le détroit de Bab el-Mandeb. Une approche qui réduit considérablement la complexité de cette réalité. Or, une route migratoire est un écosystème dense, mouvant, en constante reconfiguration. Depuis le début du XXIe siècle, près de deux millions de migrants éthiopiens ont tenté de rejoindre le Yémen, et surtout l’Arabie saoudite. Les premiers migrants venaient principalement des Hauts plateaux : des populations chrétiennes, notamment amharas et tigréennes, en quête d’opportunités économiques. En Arabie saoudite, les Éthiopiens occupent des emplois dévalorisés, souvent délaissés par les locaux : domestiques, bonnes, prostituées, maçons, bergers, etc.
Dès 2007, ces hommes et ces femmes ont commencé à payer entre 1 000 et 2 000 dollars à des réseaux de passeurs pour traverser les quatre États – l’Éthiopie, Djibouti, le Yémen et l’Arabie saoudite – via le détroit de Bab el-Mandeb. Les premiers arrivants ont souvent connu une forme de réussite : un simple berger peut gagner jusqu’à quatre fois le salaire d’un fonctionnaire éthiopien. Ces récits de réussite ont contribué à façonner un imaginaire migratoire puissant : l’Arabie saoudite comme un eldorado économique. Là encore, on assiste ici à la construction d’un mythe contemporain, celui d’une ascension possible, au prix de tous les dangers – maladie, naufrages, tortures, guerre au Yémen… –, mais dont l’impact est bien réel : la multiplication des départs.
En parallèle, la situation économique, politique et sécuritaire en Éthiopie s’est fortement détériorée durant la décennie 2010, poussant de plus en plus de personnes à fuir. De nouvelles populations, issues notamment de milieux ruraux appauvris – souvent des Oromos – se sont engagées sur cette route, sans les moyens de faire appel à des passeurs. On a alors vu apparaître, à Djibouti, des groupes de migrants traversant le désert à pied pendant deux à trois semaines, s’arrêtant en chemin pour chercher de quoi subsister, causant parfois des problèmes auprès des populations locales (choléras, maladies, etc.). Au final, ce qu’il faut retenir, c’est que ces routes migratoires sont profondément imbriquées dans les dynamiques géopolitiques régionales. Elles reflètent et accompagnent à la fois la dégradation des conditions de vie en Éthiopie, l’effondrement de l’État yéménite qui facilite autant les passages que les violences contre les migrants, ou encore les projets urbains pharaoniques de l’Arabie saoudite, toujours plus gourmands en main-d’œuvre étrangère. Ces routes migratoires ne sont donc pas des marges du monde : elles en sont le cœur battant.
P. V. : Venons-en maintenant au cœur de votre propos, les passeurs. Qui sont-ils, quel est leur savoir-faire, quelle est leur hiérarchisation et comment sont-ils organisés ?
A. L : L’une des principales difficultés de ce travail a été de restituer la vie des passeurs sans trahir la confiance que j’ai patiemment construite au fil de deux années passées à leurs côtés. Il a fallu trouver un équilibre délicat : d’un côté, préserver leur anonymat pour les protéger d’éventuelles poursuites judiciaires ; de l’autre, décrire leur réalité avec suffisamment de précision pour en dévoiler les mécanismes. L’un des moyens d’y parvenir a été de raconter non seulement leur quotidien, mais aussi l’histoire du réseau lui-même : celle d’un homme à l’origine du système, que j’ai choisi d’appeler le « Passeur initial ». Il s’agit d’un récit à dimension économique, assez classique dans sa logique : la construction d’un réseau hiérarchisé lui a permis d’imposer ses règles, de fixer les tarifs et les conditions de passage, tant aux migrants éthiopiens qu’aux passeurs – qu’ils soient éthiopiens ou yéménites. Ce contrôle lui a permis de générer des profits considérables, notamment grâce à une stratégie de surfacturation systématique. Pour maintenir cette position dominante, il lui fallait aussi entretenir des relations avec les autorités locales – tout le monde doit « manger » pour reprendre le terme utilisé sur le terrain – afin que chacun y trouve son intérêt et que l’activité soit, sinon légale, du moins tolérée.
Mais un tel enrichissement, en dehors de tout cadre légal, suscite inévitablement des convoitises, y compris au sein de son propre réseau. Une telle situation économique forge un énième mythe, celui d’une richesse accessible à tous et, en conséquence, certains passeurs aspirent à détrôner le « patron » et à prendre sa place. On se retrouve alors dans une situation plus proche des milieux criminels, mettant en scène des tentatives de renversements. L’évolution du contexte favorise ces ambitions. Les revenus dégagés permettent l’achat de véhicules pour transporter les migrants, tandis que la généralisation des smartphones et des applications de transfert d’argent facilite les communications avec les pays voisins. Peu à peu, le monopole se fragilise. De nouveaux réseaux émergent, une concurrence s’installe, les prix baissent, les offres se diversifient. Bien qu’ils soient perçus comme des organisations criminelles, ces groupes fonctionnent avant tout comme des entreprises économiques. À leur manière, ils obéissent aux lois du marché.
P. V. : Comme le dit le titre de votre ouvrage – « L’épopée des passeurs. L’âge d’or du trafic de migrants à Djibouti » , Coll. Cahiers libres, La Découverte, 2025 – le cœur de l’action se passe à Djibouti. Comment les autorités de Djibouti, à plusieurs échelles, se positionnent-elles à l’égard du trafic de migrants ?
A. L : Sur le plan international et médiatique, le gouvernement djiboutien condamne officiellement le trafic de migrants, défini par la législation nationale comme le transport de personnes en situation irrégulière. Les sanctions prévues peuvent aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 500 000 francs djiboutiens d’amende (environ 2 500 euros). Mais dans la réalité, la situation est bien plus complexe. Une question fondamentale se pose alors : comment un État autoritaire, régnant sur une population d’environ un million d’habitants et un territoire de la taille d’une région française, peut-il échouer à endiguer un tel phénomène depuis plus d’une décennie ?
Sur le terrain, on constate l’existence de pratiques informelles : arrangements, services rendus ou encore « cadeaux » offerts par les passeurs à certains membres des forces de l’ordre, qui ferment alors les yeux sur les convois de migrants. Ces derniers traversent ainsi les villes de Tadjoura ou d’Obock sans être inquiétés, tout comme les passeurs eux-mêmes. Cela étant posé, nous n’avons encore rien dit de fondamental. Le développement du trafic de migrants s’inscrit dans un contexte plus large : celui d’un État qui, depuis plusieurs décennies, a lui-même contribué à marginaliser une partie de sa population. Les passeurs s’appuient sur ce ressentiment à l’égard de l’État pour structurer et diffuser leurs propres normes. Progressivement, ces normes informelles redéfinissent les pratiques de gouvernance locales. Les agents de l’État, au lieu de recourir systématiquement à la coercition, se retrouvent paradoxalement contraints de négocier leur présence avec les passeurs et les communautés locales qui les soutiennent. En définitive, le trafic de migrants révèle une dynamique où s’affrontent la norme étatique et une nouvelle forme de normalité, pour reprendre les termes du philosophe Georges Canguilhem. Ce conflit met en lumière l’émergence de régulations officieuses, en rupture avec les cadres légaux établis par l’État.
P. V. : Djibouti est aussi un lieu éminemment stratégique, placé sur la mer rouge, à proximité du détroit de Bab el-Mandeb, où plusieurs pays – dont la France et la République populaire de Chine – disposent de bases militaires. Comment s’articule le trafic et ces acteurs internationaux qui prennent parfois des positions condamnant le trafic d’êtres humains ?
A. L : Je pense que le trafic de migrants à Djibouti relève avant tout d’une question de politique intérieure. Les puissances étrangères — qu’elles soient française, chinoise ou américaine — n’y interviennent pas, et cette absence d’ingérence leur convient parfaitement. Même si ces pays disposent de bases militaires sur le territoire djiboutien, ils n’en sont que locataires : ils demeurent des invités soumis aux conditions fixées par le gouvernement local. Un exemple parlant remonte à la fin de l’année 2023, lorsque Djibouti a interdit à l’armée américaine de mener des opérations au Yémen depuis son territoire, en réponse aux attaques des rebelles houthis contre Israël et des navires occidentaux en mer Rouge. L’objectif était clair : éviter toute riposte yéménite sur le sol djiboutien. Les États-Unis ont donc réagi depuis leurs navires militaires, sans utiliser la base de Djibouti pour lancer de frappes. Dans la pratique, les militaires étrangers sortent rarement de leurs enceintes. Et pour ceux qui le font, il s’agit le plus souvent de brèves excursions touristiques, généralement limitées à un week-end, sans aller forcément aller au nord du pays. Si certaines familles de militaires français s’émeuvent de voir des migrants éthiopiens marcher dans le désert, leur offrant des bouteilles d’eau, beaucoup ignorent tout de ce qui se passe la nuit.
P. V. : Dans ce trafic de migrants, le Yémen se trouve sur la route entre l’Éthiopie et l’Arabie saoudite. Que se passe-t-il au Yémen ? Quelles sont les interactions entre différents trafics, dont celui des armes ?
A. L : Le réseau transnational des passeurs existait déjà avant la Révolution des Printemps arabes qui toucha le Yémen en 2012, et surtout avant le déclenchement de la guerre civile en 2014, suivie de l’intervention de la coalition arabe menée par l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Plus d’une décennie plus tard, avec plus de 25 000 raids aériens saoudiens sur le Yémen et près de 400 000 victimes — directes et indirectes, notamment en raison des famines et des épidémies de choléra — le conflit demeure sans issue. Bien que rarement traitée dans les médias français, cette guerre, véritable tragédie à ciel ouvert, a transformé le Yémen en un territoire d’opportunités économiques, souvent illicites, devenant une plateforme singulière de la mondialisation. Le trafic de migrants s’y est intensifié : selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), près de 160 000 personnes ont traversé le détroit de Bab el-Mandeb en 2018, année de la violente bataille d’Hodeïda.
Dans ce contexte, de nombreux passeurs yéménites, affranchis de toute autorité étatique, sont devenus de véritables chefs de guerre locaux. Armés, ils contrôlent des micro-territoires littoraux où s’exercent des pratiques de torture à l’encontre des migrants n’ayant pas payé les réseaux traditionnels. Ils y organisent également divers trafics, y compris d’armes, qui transitent ensuite vers l’Éthiopie — où la situation sécuritaire s’est nettement détériorée à partir du milieu des années 2010 — et parfois jusqu’au Soudan. Ces réseaux, initialement conçus pour le passage de migrants, participent désormais à un échange cynique : des migrants contre des armes, circulant entre l’Éthiopie et le Yémen. Ces trafics, qu’ils concernent les personnes ou les armes, se construisent en miroir des dynamiques géopolitiques régionales — quand ils n’en deviennent pas eux-mêmes les moteurs. Ainsi, malgré le conflit, le Yémen conserve une fonction stratégique de carrefour logistique et commercial entre, d’un côté, les invendus des marchés de Dubaï et des pétromonarchies du Golfe, et de l’autre, les soutiens armés de l’Iran et les demandes venues des rives africaines de la mer Rouge.
P. V. : Enfin, après quelques années d’activité, un passeur peut-il cesser le trafic et pourquoi ?
A. L : Si le trafic de migrants se développe en résonance avec les événements géopolitiques de la région, il reflète aussi, en miroir, les trajectoires, les espoirs et les désillusions des passeurs qui y prennent part. C’est pourquoi ce livre donne à entendre de nombreux témoignages : des hommes qui racontent, chacun à leur manière, non seulement leur activité, mais aussi leur vie. Ces récits permettent de mieux comprendre les répercussions de cette économie souterraine sur les choix – individuels ou collectifs, moraux ou éthiques – de ceux qui en ont vécu. Pour beaucoup, le trafic a représenté, et représente encore, une promesse de richesse, de reconnaissance et d’ascension sociale, notamment dans les sociétés du nord de Djibouti. Nombreux sont ceux qui se sont lancés dans cette activité en poursuivant le mythe d’un enrichissement accessible à tous. Mais les réalités du terrain – la difficulté à s’imposer, à progresser dans l’organisation, ou encore la concurrence féroce entre réseaux – ont souvent brisé ces illusions. Au fil de ces trajectoires, ce qui émerge, c’est finalement la banalité d’une activité pourtant illicite, rythmée par les mêmes pulsions de vie, les mêmes rêves d’ascension et de réussite que bien d’autres secteurs économiques.
Par Alexandre LAURET, Pierre VERLUISE (Diploweb)
Alexandre Lauret est géographe et anthropologue, chercheur à l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire. Il a notamment publié La Guerre et l’Exil. Yémen 2015-2020 (Les Belles Lettres, 2023). Alexandre Lauret vient de publier « L’épopée des passeurs. L’âge d’or du trafic de migrants à Djibouti », Coll. Cahiers libres, La Découverte, 2025.
Propos recueillis par Pierre Verluise, docteur en géopolitique de l’Université de Paris IV – Sorbonne, fondateur du premier site géopolitique francophone, Diploweb.com. Auteur ou co-auteur ou directeur d’une trentaine d’ouvrages sur la géopolitique de l’Europe et la géopolitique mondiale. Producteur d’une émission de radio hebdomadaire, Planisphère (RND , RCF et podcast sur Diploweb).