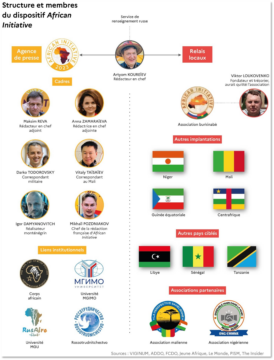Dr Alexandre Lauret, Chercheur Afrique de l’Est à l’IRSEM, à l’Institut de Recherche stratégique de l’Ecole militaire (Irsem), a disséqué la rébellion houthiste et de la guerre civile qui ravage le Yémen depuis une décennie, dans une étude intitulée « Les Houthistes et la Mer Rouge ». L’auteur rappelle que qu’à l’automne 2023, les rebelles houthistes du Yémen surprennent le monde entier en attaquant le sud d’Israël puis, quelques jours plus tard, des navires marchands d’armateurs occidentaux affiliés à l’État hébreu en mer Rouge. Si ces frappes sont aussitôt revendiquées comme un soutien armé à la cause palestinienne, elles servent surtout l’agenda politique national des rebelles dans la guerre qu’ils mènent depuis dix ans au Yémen. En septembre 2014, ces « vaincus de l’histoire » prennent la capitale, Sanaa, avant de marcher vers le sud du pays. Dès le printemps 2015, date de l’intervention de la coalition arabe conduite par l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, la guerre civile se transforme en guerre contre l’« envahisseur », selon la rhétorique houthiste. Une décennie et près de 400 000 morts plus tard, la guerre contre l’envahisseur devient un conflit régional, voire mondial, et la mer Rouge, le théâtre de la lutte souveraine des houthistes contre « l’alliance américano-sioniste ». Le chercheur fait savoir que cette étude est construite à partir de données empiriques collectées auprès de réfugiés yéménites en exil à Djibouti ou de retour au pays malgré la poursuite des combats. Elle analyse le rôle et la place de la mer Rouge dans les stratégies, les discours et les revendications politiques des houthistes ainsi que dans leurs combats menés depuis plus de trente ans pour conquérir et conserver un accès maritime.
Cette étude présente une analyse parmi d’autres de la rébellion houthiste et de la guerre civile qui ravage le Yémen depuis une décennie. D’emblée, il convient de rappeler la difficulté d’obtenir des données empiriques à la suite de la fermeture du terrain – un terrain sous un régime autoritaire et en guerre depuis le milieu des années 2010. À cette première difficulté s’ajoute l’opacité des méthodes de gouvernance des houthistes sur les territoires qu’ils contrôlent. Les informations nous parviennent au compte goutte et proviennent le plus souvent des organes médiatiques du pouvoir houthiste. Elles s’apparentent de fait à de la propagande politique tant il s’avère difficile de dissocier les productions médiatiques des houthistes du contexte dans lequel elles sont produites, la guerre où la désinformation demeure cruciale. Cette désinformation donne cependant à observer une partie du narratif houthiste à l’aune des enjeux de la guerre, de leurs revendications politiques et de leur vision géopolitique des événements.
LE RÊVE HOUTHISTE D’ACCÉDER À LA MER ROUGE
En septembre 2014, les rebelles houthistes s’emparent de la capitale, Sanaa, sous les acclamations de leurs partisans, des classes sociales les plus pauvres et d’anciens socialistes ou révolutionnaires du Printemps arabe qui appelaient à plus de justice et moins de corruption au sein du régime yéménite. Les Sananéens de certains quartiers populaires avaient préparé le terrain à l’entrée des rebelles en ville. Ils avaient collé des affiches aux slogans houthistes sur les murs de quelques faubourgs, avaient manifesté leur soutien dans les rues ou sur les réseaux sociaux, certains avaient même facilité la progression des rebelles dans les artères de la capitale en leur indiquant le chemin. Les houthistes progressent de quartier en quartier et prennent le contrôle de la capitale en moins d’une semaine sans rencontrer la moindre résistance de l’armée yéménite et sans faire couler le sang des civils – il faut préciser que cette avancée sans heurts a été facilitée par le retrait de la garde républicaine restée f idèle à l’ancien président Ali Abdallah Saleh, chassé du pouvoir en 2012. S’ensuit une période étrange de flottement politique où les rebelles cohabitent avec le gouvernement yéménite avant que les houthistes ne se décident à prendre le contrôle du palais présidentiel en janvier 2015. Le gouvernement s’exile d’abord dans la cité portuaire d’Aden au sud du pays, puis en Arabie saoudite au printemps 2015. En quelques semaines, les houthistes conquièrent près de 25 % du territoire national sur lequel vivent plus de 70 % des 30 millions de Yéménites. Leur avancée territoriale est stoppée au mois de mars 2015 devant les portes d’Aden par l’entrée en guerre de la coalition arabe menée par l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis (EAU).
La bataille d’Aden dure jusqu’à l’été 2015 s’achevant par la première défaite houthiste. Si les rebelles doivent se retirer militairement du détroit de Bab el-Mandeb, les lignes de front se sont depuis stabilisées autour d’un territoire houthiste rappelant l’ancien tracé frontalier du Yémen du Nord. Établir les origines de la guerre civile du Yémen semble complexe tant les causes internes et externes s’entremêlent depuis plusieurs décennies favorisant parfois des raccourcis et des analyses simplifiées. Ont ainsi été avancées plusieurs explications : 1) la différence religieuse entre les rebelles houthistes de confession chiite zaydite et les populations sunnites du sud du Yémen ; 2) la division historique entre le Yémen du Nord aux mentalités plus traditionnelles et le Yémen du Sud plus ouvert sur le monde ; 3) les différences de mentalité entre les populations urbaines et rurales ou bédouines (plaine littorale, régions rurales montagneuses) ; 4) la difficile succession politique au sein du régime yéménite après la démission d’Ali Abdallah Saleh en 2012 ; 5) le ressentiment général de l’ancien Yémen du Sud à l’égard du Yémen du Nord en matière d’accaparement du pouvoir et de privatisation des ressources depuis l’unification ; ou encore 6) les ingérences étrangères faisant du Yémen le terrain d’une guerre par proxy entre l’Iran et l’Arabie saoudite.
Si ces différentes explications permettent d’appréhender certaines causes, peu d’entre elles questionnent finalement le rôle et l’importance de la mer Rouge dans la montée des tensions civiles et régionales du développement de la guerre. La première partie retrace l’histoire du Yémen depuis le début du XXe siècle à partir de son lien ambigu à la mer Rouge. Cette histoire contemporaine semble à cet égard paradoxale : le pays dispose d’une situation géographique idéale, bordée par une façade maritime de plus de 2 000 kilomètres entre la mer Rouge et le golfe d’Aden, propice à l’ouverture. Le Yémen est pourtant faiblement intégré à la mondialisation et demeure le pays le plus pauvre de la péninsule Arabique. Son histoire est davantage tournée vers l’enclavement de ses montagnes, l’isolement et la fermeture d’une partie de la société5. Peut-être faut-il y voir un traumatisme de longue date où la mer représente un espace par lequel sont venus les ennemis par le passé. De cet écart entre enclavement et ouverture forcée naît une « politique de la canonnière » qui, au cours du XXe siècle, déstabilise profondément l’économie locale et les modes de vie des populations yéménites6. Les houthistes semblent apparaître comme une conséquence de cette politique de la canonnière. Comprendre l’histoire des houthistes par rapport à la mer Rouge impose de la diviser en trois temps : 1) l’histoire du Yémen au XXe siècle, de la fermeture à l’ouverture néolibérale ; 2) le développement des houthistes à partir des années 1990 et leurs revendications politiques et territoriales afin d’accéder à la mer Rouge ; 3) la guerre civile à partir de 2014 au prisme de la conquête de la façade maritime.
LES HOUTHISTES, LA RÉVOLUTION ET LA MER : REVENDICATIONS POLITIQUES AU XXIE SIÈCLE
La naissance politique des houthistes (1990-2004) : Les houthistes tirent leur nom d’une famille clanique, les Al-Houthi, descendante du prophète et héritière de la noblesse déchue de l’imamat. Dès sa constitution en 1992, le groupe ras semble d’abord les populations zaydites marginalisées, puis, plus généralement, les populations montagnardes du district de Saada indépendamment de leur confession religieuse. Des années 1990 à leur coup d’État militaire en septembre 2014, les houthistes vont incarner une aventure politique construite sur une idéologie empruntant des arguments religieux, monarchistes, socialistes, voire révolutionnaires en miroir des événements contemporains au Yémen. Une ligne directrice parcourt pourtant ces deux décennies : le combat contre le régime de Saleh, les influences étrangères et la volonté d’acquérir un accès à la façade maritime de la mer Rouge. Parmi les membres du clan, Hussein al-Houthi (1960-2004) tient une place centrale. Il fait ses études au Soudan, puis il vit en Iran au cours des années 1980 où il étudie la littérature politique et les mécanismes de l’idéologie de la révolution iranienne. Il s’y forme également à l’éloquence et développe des talents oratoires faisant de lui une personnalité charismatique. De retour au Yémen au début des années 1990, il réunit les membres de son clan pour prêcher une forme rajeunie et revitalisée du mouvement religieux zaydite, moribond à la suite de l’implantation des écoles salafistes et wahhabites dans leurs campagnes. Il milite auprès des nombreuses tribus locales pour qu’elles envoient leurs jeunes dans les camps d’été des Al-Houthi, les cercles de Jeunes Croyants, dans le but de leur enseigner la foi zaydite. Afin de les convaincre, Hussein al-Houthi joue sur la nostalgie d’une époque fantasmée, celle où Saada était le centre du royaume yéménite. Il prêche le retour à la monarchie et rap pelle aux chefs des tribus qu’ils étaient autrefois respectés. Ces camps d’été servent surtout à diffuser son idéologie politique, le regroupement des différents courants zaydites autour de son propre clan. Encore aujourd’hui, la dénomination « houthiste » ne s’applique pas à l’ensemble des branches et des sous-courants zaydites du Yémen. Hussein al-Houthi, élu au Parlement yéménite en 1993, perd son siège en 1997. Durant ces années, il « prêche » au Parlement contre les influences religieuses étrangères de plus en plus pré sentes dans sa région historique, le gouvernorat de Saada, se heurtant sur le terrain aux résistances salafistes, wahhabites et aux tribus ayant des relations économiques avec l’Arabie saoudite. Il milite également contre la politique répressive de Saleh, la corruption du régime et les inégalités croissantes. Ses arguments portent d’autant plus qu’à cette époque, le régime de Saleh se concentre essentiellement sur la question du Sud, l’accès aux ressources gazières et pétrolières et les enjeux de l’après-guerre civile de 1994 liés aux « traîtres » socialistes et sécessionnistes.
La politique de Saleh à l’égard du Sud provoque un senti ment de marginalisation chez les populations des régions montagneuses et isolées du nord du pays. Originaire de cette région, les montagnes semi-désertiques de Marwan et de Dahyan environnant la ville de Saada, Hussein al-Houthi tire profit de ce ressentiment. Il s’agit de territoires reculés, faiblement dotés en ressources et à partir desquels les houthistes vont massivement recruter les déçus ou les oubliés des redistributions du régime kleptocratique de Saleh. Ce recrutement hétéroclite, fondé davantage sur la marginalisation politico-économique que religieuse, finit par influencer la dimension politique du groupe en le faisant devenir une force politique locale. Le contexte de l’après-11 septembre 2001 fait évoluer la situation. La seconde Intifada, à partir de 2002 dans les Territoires occupés, et l’invasion de l’Irak par les États-Unis en 2003 changent le destin d’Hussein al-Houthi. Assistant à ces événements depuis le Yémen, l’homme commence à prêcher dans les mosquées l’unification des musulmans contre l’ennemi américano-sioniste. Il utilise à cet égard une rhétorique et des arguments simplistes niant la complexité des situations politiques et incriminant la modernité56. Selon lui, tous les maux du Yémen viennent de l’ingérence étrangère occidentale, à laquelle il ajoute l’impérialisme saoudien57, et il prône la fermeture du pays pour combattre la corruption des musulmans. Dès ses premiers prêches contre les Américains, la situation se tend avec le régime de Saleh. Contestant l’ordre républicain et le régime au nom de la monarchie, les houthistes deviennent une cible à abattre pour le gouvernement. En réalité, ils incarnent une limite et une résistance à la politique mise en place par Saleh de « danser sur la tête des serpents » et c’est justement parce que Saleh n’arrive pas à les manipuler qu’il les déclare ennemis.
Saleh contre les houthistes : les six guerres de Saada (2004-2011) Six guerres – les « guerres de Saada » – se succèdent durant la décennie 2000. Bien qu’elles opposent le régime de Saleh aux houthistes, ces guerres sont totales au sens où elles incarnent une constellation de facteurs sociaux, politiques, sectaires, économiques, religieux, tribaux et personnels59. En 2004, les forces de l’ordre tentent d’arrêter Hussein al-Houthi, ce dernier étant accusé d’être à la tête d’une organisation rebelle menaçant la sécurité et l’intégrité de l’État yéménite. S’ensuit la première guerre durant laquelle Hussein al-Houthi est assassiné dans les montagnes du gouvernorat de Saada. Sa mort embrase la région où prévalent l’esprit tribal et le conservatisme religieux loin des pratiques modernes de la capitale. Les combats reprennent en mars 2005, puis en février 2006 lorsque Abdul-Malik al-Houthi, le frère cadet d’Hussein, prend la tête du mouvement. Ce dernier se révèle dès le début beaucoup moins charismatique que son frère aîné. En outre, il n’a jamais quitté le Yémen et n’a reçu d’autre éducation religieuse que celle que son frère lui a dispensée. Son manque de personnalité passe à ce moment-là au second plan tant la répression du mouvement houthiste et des populations du gouvernorat de Saada par les forces armées s’avère brutale. La violence déployée par le régime de Saleh ne fait qu’augmenter le capital de sympathie des populations marginalisées et, en conséquence, les capacités militaires (hommes, armement, territoires, réseaux, etc.) des houthistes au cours des années 2000. Dès la troisième guerre de Saada (2006), de nombreux hommes combattent au côté des houthistes sans partager leurs idéaux religieux. Ils suivent leurs chefs tribaux, combattent leurs rivaux, le gouvernement, certains courants religieux ou sont contraints par différentes pratiques (honneur, vengeance, etc.). Au fil des guerres de Saada, des combattants hétérogènes rejoignent les houthistes ou le gouvernement, non pas forcément par loyauté envers l’un ou l’autre camp mais pour défendre avant tout leurs propres intérêts politiques ou économiques. La quatrième guerre commence au début de l’année 2007, après les élections législatives de septembre 2006, et ce, malgré la libé ration de 600 combattants houthistes faits prisonniers lors des conflits précédents. Témoin de l’importance grandissante du mouvement nordique à cette époque, le Qatar joue les médiateurs afin de trouver une paix durable à la suite du conflit Le succès des accords de paix est de courte durée. Dès la signature, les diplomates qataris se heurtent au régime de Saleh lorsque ce dernier les empêche de mettre en pratique leurs engagements financiers pour la reconstruction et le développement du gouvernorat de Saada prévus par les accords. Saleh voit d’un mauvais œil le développement de cette région frontalière avec l’Arabie saoudite et les Saoudiens, eux-mêmes, ne sont pas favorables à l’essor de l’influence du Qatar au Yémen63. Privés de l’argent qatari, les houthistes reprennent les hostilités, cette fois-ci dans le gouvernorat de Sanaa – le district de Bani Matar à l’est de la capitale. Dans leur conquête territoriale, les rangs des houthistes sont renforcés par les déshérités et les déçus du régime de Saleh : tribus marginalisées, classes sociales les plus pauvres, victimes des changements climatiques, de l’accaparement néo libéral des terres ou de l’urbanisme forcé, et anciennes tribus proches de Saleh qui ont été écartées par la suite dans le jeu de concurrence mis en place par Saleh lui-même. Si tous ces déçus grossissent les rangs des houthistes sans partager leur vision religieuse, ils sont pourtant séduits par le potentiel révolutionnaire des rebelles.
La cinquième guerre (2008) est surtout constituée d’embuscades où plusieurs centaines de soldats yéménites sont tués. Saleh annonce la fin des hostilités avant l’été. La sixième guerre ne commence qu’une année plus tard (août 2009 – février 2010), laissant à chacun le temps de s’organiser. Après leur avancée fulgurante en dehors du gouvernorat de Saada, les houthistes s’exercent à la gouvernance en administrant les territoires qu’ils occupent militairement : le gouvernorat de Saada, les régions voisines des gouvernorats d’Amran et d’Al Jawf, et lorgnent sur le gouvernorat côtier d’Hajjah sans forcé ment y être installés militairement (voir Carte 4 : Les guerres de Saada). L’objectif des houthistes est de prendre le port Midi au nord du gouvernorat d’Hajjah, à la frontière avec l’Arabie saoudite. Faiblement doté en infrastructures, ce port n’accueille que des liaisons maritimes par boutres en provenance de l’Érythrée, de la Corne de l’Afrique et indirectement de l’Iran.
SE BATTRE POUR LA MER : MIDI, ADEN ET HODEÏDA (2014-2024)
Arrivé à ce moment de l’histoire, le début de la seconde guerre civile (depuis 2014), l’objectif est de tenter de comprendre la perception des événements militaires et du conflit à travers le prisme des rebelles houthistes. Cela entraîne d’emblée trois remarques. Premièrement, il s’agit bien ici de tenter car, faute de données empiriques récoltées auprès des houthistes, cette ana lyse demeure loin d’être exhaustive. Deuxièmement, le prisme des événements étant corrélé à celui des houthistes, toutes les péripéties de la guerre ou des différents protagonistes ne sont pas narrées. Les dissensions entre les loyalistes, les indépendantistes et les milices islamistes dont al-Qaïda dans le sud du Yémen ne sont évoquées qu’à la marge.
Troisièmement, la perception houthiste tend à évoluer au fur et à mesure des événements liés au conflit. Selon leur narratif, la guerre civile laisse peu à peu la place à une guerre contre l’envahisseur, la coalition arabe menée par l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Il s’agit d’envahisseurs particuliers puisque leur intervention militaire au Yémen se caractérise par le refus d’envoyer directement des soldats saoudiens au combat. Dans cette guerre contre l’envahisseur, le littoral yéménite de la mer Rouge joue un rôle essentiel : les houthistes tentent de l’accaparer alors que la coalition arabe intervient justement pour contrer les velléités houthistes d’accéder à la mer. Plus que le contrôle des villes ou des ressources pétrolières – important par la suite –, la côte et la mer Rouge représentent l’un des objectifs principaux des houthistes dès le début, pour ne pas dire l’épicentre du conflit yéménite.
La conquête de la façade de la mer Rouge par les houthistes (2014-2015)
Au mois de septembre 2014, les houthistes entrent dans Sanaa et prennent possession de la capitale sans livrer un seul combat. Ils réalisent un coup d’État militaire officieux sans la moindre violence à l’encontre de la population. L’ambiance est joviale. La population manifeste contre le régime de Hadi, et les rebelles sont accueillis favorablement dans certains quartiers popu laires. En réalité, leur entrée pacifique en ville a été permise par Saleh qui avait donné l’ordre à la garde républicaine et à certains régiments de l’armée lui étant restés fidèles de ne pas intervenir pour freiner l’avancée des rebelles. Les premiers affrontements avec des milices sunnites ne se produisent qu’au milieu du mois, lorsque les houthistes tentent de prendre le contrôle de certains points stratégiques : les locaux des médias, l’aéroport, certains ministères, le palais présidentiel ou encore les lieux où résident l’état-major de l’armée ou les ministres.
Le 21 septembre, les houthistes déclarent contrôler la capitale. Des négociations sont engagées sous l’égide des Nations unies entre les rebelles houthistes et le président Hadi afin de mettre en place un gouvernement d’unité nationale. Les pourparlers échouent du fait des différentes forces en présence à Sanaa. Les houthistes sont maîtres de la ville et l’armée semble partagée entre certains régiments démobilisés, vaincus par inactivité, et d’autres, restés fidèles à Saleh, en quête de reconnaissance. Ce dernier est lui-même en discussion avec les dirigeants houthistes pour établir un accord politique afin de revenir au pouvoir.
Quant à la population, une partie semble dans un premier temps soutenir les houthistes dont les discours économiques populaires et populistes leur assurent un capital de sympathie malgré les affrontements religieux avec les salafistes et d’autres milices locales. Les houthistes ont pour objectif de remplacer l’élite administrative traditionnelle par leurs propres cadres afin de devenir la nouvelle élite du pays et de créer un État yéménite houthiste. Pour y parvenir, ils gardent Hadi à la tête de l’État dans le but d’en faire un homme de paille pendant la phase complexe de transition administrative. Ils exigent des remaniements au sein des administrations et du gouvernement : le remplacement du vice-président, de certains ministres et de plus de 160 cadres au sein des ministères de l’Intérieur et de la Défense. Refusant de démissionner, Hadi coopère sur certains points donnant l’illusion d’être la marionnette des rebelles. Sur le plan international, son maintien permet au Yémen de toucher encore les subventions internationales des différents bailleurs et d’éviter l’intervention politique ou militaire de l’Arabie saoudite ou du Conseil de coopération du Golfe101. La stratégie est peu efficace puisque l’Arabie saoudite cesse de verser toute aide dès que les houthistes entrent dans la capitale. Sur le plan intérieur, le maintien de Hadi permet d’éloigner Saleh du pouvoir. En cas de démission du président, le pouvoir reviendrait automatiquement au président du Parlement qui deviendrait le nouveau président de transition. Or le président de l’époque étant un proche de Saleh, la démission de Hadi reviendrait indirectement à remettre Saleh au pouvoir, ce que les houthistes refusent malgré l’alliance de circonstance qui s’est nouée. Face aux réticences de Hadi à répondre à leurs exigences, les houthistes prennent le contrôle du palais présidentiel en janvier 2015 et placent le président en résidence surveillée. Hadi démissionne. Les houthistes décrètent la dissolution du Parlement et proclament un Comité révolutionnaire censé gouverner le pays de manière transitoire.
Ce coup d’État officiel n’est pas reconnu par de nombreux groupes d’opposition – à commencer par les religieux d’al-Islah – et par la communauté internationale. Quelques semaines après son arrestation, en février 2015, Hadi réussit à s’échapper de sa résidence surveillée et fuit à Aden. Il tente d’y recréer un gouvernement en déclarant Aden, nouvelle capitale du Yémen – bien que l’ensemble des ministres soient toujours sous surveillance à Sanaa. Cette déclaration provoque la colère des dirigeants houthistes qui envisagent de poursuivre leur avancée militaire vers le Sud en prétextant la volonté sécessionniste de Hadi. Les revendications socio-économiques et de justice mises en avant par les houthistes durant ces dernières années se fracturent au printemps 2015. L’image populiste des rebelles, construite contre la corruption endémique du régime de Saleh puis de celui de Hadi, ne résiste pas au rapprochement politique avec Saleh depuis leur conquête de Sanaa. Une fois qu’ils ont assuré leur mainmise sur l’appareil sécuritaire de l’État, les houthistes justifient l’accaparement des ressources économiques du pays par la lutte contre al-Qaïda, présente au sud du pays, et l’expulsion des mouvements religieux salafistes du Yémen. L’objectif défendu n’est plus tant de lutter contre la corruption, mais bien de lutter contre certaines confessions. Et, pour atteindre cet objectif, Saleh devient l’homme incontournable grâce à ses brigades bien qu’il ait combattu à six reprises les houthistes. Dès l’imamat et tout au long du XXe siècle, les zaydites représentent bien souvent la majorité des soldats de l’armée royale, puis nord-républicaine, enfin du Yémen unifié.
Dès son arrivée au pouvoir, en 1978, Saleh a fait en sorte de placer des militaires de sa tribu aux postes de commandement. Il n’a pas hésité non plus à recruter massivement des populations originaires du nord du Yémen pour constituer une armée qui, malgré les événements, pouvait lui rester fidèle. En outre, l’homme veut se venger de son ancien vice-président. La naissance de la coalition houthistes-Saleh fait évoluer les objectifs du conflit en propageant l’image d’un gouvernement sudiste proche, pour ne pas dire affilié à al-Qaïda, auprès des populations nordiques103. La rhétorique houthiste assimile en permanence les populations et certaines régions sudistes à la dissidence d’al-Qaïda – cette dernière trouvant un terreau fertile à son implantation et son recrutement parmi les déçus et les exclus de l’unification du Yémen et des nostalgiques de la période socialiste.
Synthèse de Awa BA