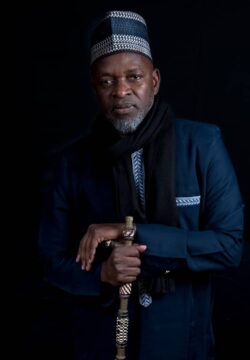« 40 % des groupes terroristes africains exploitent déjà l’IA » alerte Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères, lors du sommet de l’UA le 20 mars 2025. Drones armés à bas coût, deepfakes hyperréalistes, campagnes de désinformation automatisée: l’IA est devenue un « multiplicateur de force » pour les jihadistes.
Des combattants de l’État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP), branche dissidente de Boko Haram, posent en armes lors d’une opération de propagande.
L’Afrique doit se saisir de l’intelligence artificielle (IA) avant qu’elle ne la subisse. C’est l’avertissement lancé par Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères, lors d’une réunion ministérielle du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine (UA), le 20 mars 2025. Selon lui, 40 % des groupes terroristes actifs sur le continent exploitent déjà cette technologie. Drones armés, deepfakes, campagnes de désinformation et de recrutement automatisées, l’IA devient un « multiplicateur de force » pour les extrémistes, tandis que le continent accuse un retard structurel : 60 % des Africains n’ont pas accès à Internet, et 70 000 experts locaux en tech quittent le continent chaque année. Dans ce paysage à haut risque, le Maroc, avec quelques autres pays, prône une vision africaine souveraine de l’intelligence artificielle.
Boko Haram, Al-Shabaab, AQMI, État islamique au Sahel… Les groupes terroristes africains ont intégré l’IA à leur arsenal. Les événements l’attestent. L’État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP) a frappé un coup insolite en décembre 2024 : quatre drones équipés de grenades artisanales ont frappé une base militaire à Wajiroko (Nigeria), blessant plusieurs soldats. Une première sur le continent. Selon l’Institute for Security Studies (ISS Africa), au moins deux attaques similaires ont suivi au Niger. Ces engins, souvent modifiés à partir de modèles civils (comme les DJI chinois), coûtent moins de 1 000 $ et offrent un avantage tactique décisif.
La propagande n’est pas en reste. En 2024, l’État islamique a diffusé un bulletin d’information hebdomadaire généré par IA, qui incluait un avatar virtuel pour revendiquer un attentat en Afghanistan. Au Sahel, des vidéos de drones filmant des attaques servent à recruter et à terroriser. Les deepfakes — ces vidéos hyperréalistes — explosent : +900 % depuis 2019, selon Bourita. Des experts notent que des extrémistes maîtrisent déjà cette forme de propagande pour semer la confusion et discréditer leurs adversaires.
Recrutement 2.0 et cyberattaques
Les chatbots alimentés par des modèles de langage automatisent le recrutement. Disponibles 24h/24, ils ciblent les jeunes isolés, personnalisant les discours en fonction des vulnérabilités psychologiques. Les universités, terrain d’endoctrinement idéologique, sont particulièrement visées. L’International Centre for Counter-Terrorism (ICCT) alerte sur la capacité de ces outils à «nouer des relations personnelles virtuelles ».
Face à ces menaces, les États africains manquent de moyens. Seuls 1 % des experts mondiaux en IA sont basés sur le continent, et 60 % de la population reste hors ligne. Pourtant, des initiatives émergent. Le Nigeria a créé un centre de cyberdéfense pour contrer les fausses nouvelles de Boko Haram. Le Kenya renforce sa cybersécurité avant les élections, avec l’aide des États-Unis.
La coopération régionale s’organise. Le G5 Sahel mutualise les renseignements sur les drones terroristes. L’Union africaine (UA) discute d’une stratégie continentale, poussée par le Maroc. Ce dernier, président du Conseil de Paix et de Sécurité de l’UA en mars 2025, a insisté sur la nécessité de normes « éthiques et souveraines ».
Rabat combine son action nationale à sa force diplomatique à l’échelle continentale roc Digital 2030 vise à former 100 000 talents annuels aux métiers du numérique. Le pays héberge le premier centre UNESCO africain dédié à l’IA (« Ai Movement »), focalisé sur la recherche et la formation.
Le Maroc, pionnier de l’IA « défensive »
Sur la scène internationale, le Maroc cofonde le « Groupe des Amis de l’IA pour le développement durable » à l’ONU, réunissant 70 États. Il a aussi aidé des pays sahéliens à élaborer des contre-discours religieux en ligne, en capitalisant sur son réseau d’imams formés. L’enjeu est de taille : 2 % seulement des données mondiales d’IA sont stockées en Afrique. L’UA planche sur une stratégie de « données panafricaines », incluant des datacenters régionaux. Le Maroc propose un Fonds africain pour l’IA, financé par les États et les bailleurs. Objectif : réduire la dépendance aux géants étrangers et développer des outils locaux, comme des détecteurs de deepfakes adaptés aux langues africaines.
Dans ce contexte de mobilisation continentale, l’ingérence des puissances extérieures complique singulièrement l’équation. Le Centre des études stratégiques africains nous renseigne sur l’activisme numérique de la Russie, de la Chine et des États-Unis, qui se livrent une guerre hybride sur le continent. Ainsi Moscou est responsable de 40 % des campagnes de désinformation en Afrique, via des « usines à trolls » et le groupe Wagner, selon les experts de ce centre. En 2023, une fausse vidéo anti-française a facilité le retrait de Barkhane au Mali, profitant aux jihadistes. Pékin, via ses infrastructures numériques (5G, Safe City), expose le continent à des risques de surveillance massive, sans compter que leurs équipements chinois bon marché (drones DJI, caméras Hikvision…) se retrouvent parfois entre les mains d’acteurs non-étatiques par le marché gris…En réponse, les États-Unis forment les armées africaines au brouillage de drones, tandis que l’UE finance des ateliers de cybersécurité. Le Maroc, allié de l’Occident mais ouvert à tous, joue les médiateurs.
Par Jade Abanouas