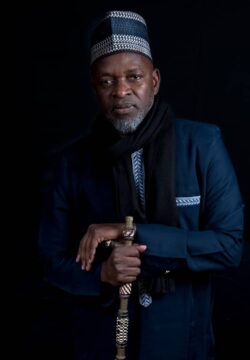La Direction de la Programmation budgétaire du ministère des Finances et du Budget a publié le document budgétaire Genre 2024. Dans les grandes lignes, le document est bâti autour de deux (02) parties : (I) l’opérationnalisation de la dimension genre à travers les enjeux et contraintes, les acquis et les principaux projets/programmes choisis dans le Programme d’Investissements publics (PIP) 2024-2026 selon l’approche du marqueur genre de l’Organisation de Coopération et de Développement économique (OCDE) et (II) le rapport budgétaire genre des différents départements ministériels.
Dans la dynamique de bâtir une société équitable et dépourvue de toute forme d’inégalités et d’iniquités, des choix stratégiques sont retenus dans le Plan Sénégal Emergent (PSE), référentiel de la politique économique et sociale pour une participation inclusive, équitable des acteurs au processus de développement.
En amont du PSE, la Stratégie nationale pour l’Équité et l’Égalité de Genre (SNEEG), cadre de référence national pour l’effectivité de l’égalité entre les femmes et les hommes, s’inscrit dans la perspective de « faire du Sénégal un pays émergent à l’horizon 2035 avec une société solidaire dans un Etat de droit, sans discrimination, où les hommes et les femmes ont les mêmes chances de participer à son développement et de jouir des bénéfices de sa croissance ».
Le présent Document budgétaire genre est élaboré dans un contexte marqué par les crises multiples, notamment les impacts socioéconomiques de la COVID-19, les effets des changements climatiques et les conséquences du conflit russo-ukrainien qui risquent de compromettre les efforts publics initiés dans le cadre de l’exécution du Programme de développement durable à l’horizon 2030.
Nonobstant ce constat, le Ministère des Finances et du Budget, à travers le budget de l’Etat, compte jouer sa partition pour une opérationnalisation effective de la SNEEG à travers l’intégration de la dimension genre dans la chaine PlanificationProgrammation-Budgétisation-Suivi-Evaluation (PPBSE) pour sa meilleure prise en compte dans les politiques publiques : la Budgétisation sensible au genre (BSG).
Cette budgétisation sensible au genre est requise pour réussir les conditions nécessaires à l’effectivité des engagements du Sénégal en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes et plus particulièrement les articles 1 et 7 de la Constitution.
Au niveau du suivi–évaluation, les revues annuelles conjointes (RAC), moments de partage des performances de la politique économique et sociale mais également, de bilan des thématiques transversales, constituent de précieux outils d’appréciation du degré de prise en charge de la dimension genre dans la stratégie d’allocation des ressources publiques et dans les choix budgétaires.
La démarche méthodologique adoptée par le Ministère en charge du budget est basée sur l’entrée par les programmes budgétaires pour une intégration effective de la dimension genre dans la programmation budgétaire. Cela nécessite un examen minutieux, avec des « lunettes genre », de l’ensemble des actions déclinées dans les différents Projets annuels de Performance (PAP), avant de proposer des activités dédiées et de procéder aux corrections nécessaires. Il en découle, in fine, un cadre de performance sous-tendu par une budgétisation des activités sensibles au genre.
Le Document budgétaire Genre 2024, élaboré dans le contexte socioéconomique cité supra, devra-t-il ainsi tenir compte de la formulation du Plan national de Développement (PND) et du Plan d’Actions prioritaires (PAP 3) qui couvriront la période 2024-2028. Ainsi, ce PND/PAP 3 partant des acquis enregistrés dans la mise en œuvre des deux (2) premiers PAP du PSE, va intégrer les nouveaux défis de développement émergents ainsi que les mesures accélératrices devant mener vers l’atteinte des Objectifs de Développement durable (ODD) en 2030. Pour ce faire, les pouvoirs publics, tout en veillant à la stabilité du cadre macroéconomique et en consolidant les performances en termes de croissance économique, ont réussi à prendre en charge les priorités et urgences sociales incompressibles. Cela a été possible grâce à la mise en place de divers mécanismes de mobilisation de ressources, tant internes qu’externes, la redistribution et le ciblage des appuis et dépenses pour soutenir l’activité économique intérieure et les ménages particulièrement vulnérables.
OPERATIONALISATION DE LA DIMENSION GENRE
Depuis janvier 2023, le Gouvernement s’est engagé dans l’élaboration du Plan national de Développement accompagné de son 3ème Plan d’Actions prioritaires (PND/PAP 3) qui couvrira la période 2024-2028. Ce document stratégique capitalisera les acquis enregistrés dans la mise en œuvre des deux premiers PAP (2014-2018 et 2019-2023) et ambitionne de concrétiser la vision déclinée dans le PSE qui épouse le principe majeur de l’Agenda 2030 : « Ne laisser personne de côté », dans la volonté de bâtir une société solidaire dans un Etat de droit. Ce faisant, le PAP 3 souligne, dans sa version actuelle, qu’il est primordial d’assurer l’équité entre les femmes et les hommes dans les politiques publiques de manière à réduire les inégalités de genre. Il propose ainsi de garantir la pleine participation des femmes dans le développement socio-économique. Cela passe nécessairement par l’éradication de toutes les formes de discrimination à l’encontre des femmes en renforçant la place et le rôle de celles-ci dans la société. A cet effet, sur la période quinquennale (2024-2028), il est attendu deux (2) effets majeurs portant sur le renforcement de la représentation des femmes dans les instances de prise de décisions et sur l’amélioration de leur participation active dans la vie économique. Par ailleurs, le Gouvernement a réaffirmé son engagement à poursuivre les efforts visant à réduire les inégalités basées sur le genre à travers l’accord de financement au titre du Mécanisme élargi de Crédit et de la Facilité élargie de Crédit (MEC/FEC) combinés à la Facilité pour la Résilience et la Durabilité (FRD) conclu en juin 2023 avec le Fonds monétaire international (FMI).
Dans cette optique, il s’agira pour l’Etat, de : – accroître les dépenses sociales allouées aux programmes destinés aux jeunes filles et aux femmes y compris ceux visant à réduire (ou minimiser) les disparités relatives au genre et les obstacles à l’éducation des filles plus particulièrement dans les filières scientifiques et techniques spécialisées au niveau secondaire et supérieur ; – prendre des mesures pour l’effectivité des engagements internationaux et régionaux en faveur du genre, notamment dans la mise en œuvre du schéma type de l’institutionnalisation du genre dans les Etats membres de l’UEMOA ; – renforcer la composante « statistique genre » de la stratégie nationale de développement de la statistique à travers des projets et programmes structurants ; – accroître les ressources allouées à la formation, au renforcement des capacités en genre des administrations publiques et autres acteurs du schéma de mise en œuvre de la SNEEG et les plans sectoriels d’institutionnalisation du genre ; – dérouler des formations et octroyer des crédits aux femmes entrepreneurs dans les secteurs et filières porteurs ; développer des programmes impliquant les femmes et les jeunes filles à la gestion des changements climatiques et des crises, notamment le plan d’actions R13251 sur les femmes, la paix et la sécurité en vue de renforcer leur résilience ; – prendre les actes administratifs et réglementaires pour assurer le fonctionnement des organes de gouvernance de la SNEEG (2023-2024) en l’occurrence le « Conseil interministériel Genre et Développement » et le « Comité technique de Suivi » ; – mobiliser les ressources adéquates pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de communication axée sur la politique genre. Par ce nouveau programme, le Gouvernement entend poursuivre l’assainissement du cadre macroéconomique et des finances publiques et une gouvernance vertueuse des ressources publiques, en vue de bâtir une économie plus résiliente, capable de générer une croissance forte, inclusive et génératrice d’emplois.
Ainsi, pour l’année 2024, la consolidation budgétaire sera de mise avec le déficit budgétaire qui devrait s’améliorer de 1,6 point de pourcentage, passant de 5,5% du PIB (1 045,5 milliards FCFA) dans la LFI 2023 à 3,9% du PIB (840,2 milliards FCFA) en 2024. Dans le domaine de la coopération multilatérale, la réduction des inégalités basée sur le genre est devenue actuellement une conditionnalité pour la mobilisation de ressources concessionnelles. Les quelques exemples, mis en exergue ci-après, illustrent à souhait la priorité accordée à la question. De même, les études du FMI montrent que « les pays peuvent tirer profit d’une réduction des disparités de genre : la croissance gagne en vigueur, les inégalités de revenu baissent et l’économie devient plus résiliente. Dans près de 90% des pays, les femmes se heurtent à au moins un obstacle juridique lorsqu’il s’agit d’accéder à la propriété, d’hériter ou d’ouvrir un compte en banque. Dans les pays à revenu intermédiaire, moins de 53% des femmes possèdent un compte bancaire. Des écarts persistent entre hommes et femmes sur le plan des revenus et des taux de participation à la population active. Si le taux d’activité des femmes atteignait celui des hommes, le PIB pourrait gagner 5% aux États-Unis, 9% au Japon et 2% en Inde ». Pour évaluer et adapter les politiques des pays, l’appui du FMI est orienté vers la participation des femmes à la « population active », l’inclusion financière, la budgétisation sensible au genre, les barrières juridiques et les études et analyses.
Pour l’Agence des Etats Unis pour le Développement international (USAID), la promotion de l’égalité des sexes et la progression du statut de toutes les femmes et filles dans le monde est essentiel pour atteindre les objectifs de la politique étrangère et de développement des États-Unis.
L’USAID a adopté plusieurs politiques et stratégies globales et interdépendantes visant à réduire les inégalités entre les sexes en vue de permettre aux filles et aux femmes de jouir de leurs droits, de déterminer leurs résultats dans la vie, d’influencer la prise de décision et de devenir des agents de changement dans les ménages, les communautés et les sociétés. Ensemble, ces politiques et stratégies fournissent des orientations d’une part, sur la poursuite d’investissements plus efficaces et fondés sur des données probantes dans l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et, d’autre part, sur l’intégration de ces efforts dans les programmes de développement à la base. La Banque mondiale (BM), à travers l’indice « Women Business and the Law » (WBL), « les femmes, l’entreprise et le droit », analyse les lois et règlementations affectant les opportunités économiques des femmes dans 190 économies concernant huit (08) domaines ayant un impact sur la participation économique des femmes : mobilité, travail, rémunération, mariage, parentalité, entrepreneuriat, actifs et retraite. D’après cet indice, en 2021, près de 2,4 milliards de femmes ne possédaient toujours pas les mêmes droits économiques que les hommes dans le monde. En Afrique, bien qu’aucun pays n’ait atteint la parité parfaite, de nombreux efforts se poursuivent dans le domaine. A ce titre, le Sénégal occupe la 36éme place avec un score de 66,9. Par ailleurs, en matière d’évaluation du niveau de développement humain des pays tenant compte des inégalités, le rapport national sur le développement humain 2022 fait ressortir une valeur de 0,511 pour l’IDH et classe le Sénégal à la 170ème place au niveau mondial et la 34éme place au niveau africain. Pour l’IDH ajusté aux inégalités, le Sénégal qui gagne deux (02) places avec une valeur de 0,354, occupe la 131éme place. Concernant la Banque africaine de Développement (BAD), elle promeut l’égalité des sexes dans ses opérations depuis plus de deux décennies.
Cette institution est passée d’une approche axée sur les femmes à une approche visant l’égalité homme-femme. Elle a fait de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes et des filles, un élément central de ses activités basées sur l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies intégrant les préoccupations des femmes dans les opérations et engagements internes et externes. En dehors des stratégies mises en œuvre par le Ministère en charge de la femme, le Ministère des Finances et du Budget, à travers la Direction générale du Budget, s’est inscrit dans une démarche novatrice visant à promouvoir la justice et l’équité entre hommes et femmes dans le souci d’optimiser l’utilité sociale de la dépense publique. Dans cette optique, l’intégration du genre dans la chaine Planification-Programmation-Budgétisation-Suivi-Evaluation (PPBSE) à travers la Budgétisation sensible au Genre (BSG), devient un impératif. Cette approche vise à créer les conditions d’une conception et d’une mise en œuvre des politiques publiques de manière à assurer l’identification et la prise en compte des inégalités de genre.
S’agissant des « projets intégrant la dimension genre », leur choix est assujetti aux conditions du marqueur G de la politique d’égalité de genre de l’OCDE en tant qu’indicateur de politique utilisé pour suivre l’affectation des ressources des bailleurs de fonds dans le cadre de la promotion de l’égalité de genre. Cette première partie du Document budgétaire Genre (DBG 2024) comprend : (i) les enjeux et défis de l’intégration du genre dans les politiques publiques ; (ii) les acquis et (iii) les principaux projets/programmes genre inscrits dans le PIP 2024- 2026.
LES ENJEUX ET DEFIS DE L’INTEGRATION DU GENRE DANS LES POLITIQUES PUBLIQUES
L’Etat s’est inscrit dans la dynamique de réduction des inégalités de genre qui constitue la clé de voûte d’une croissance plus vigoureuse et d’une économie plus résiliente et inclusive. Dès lors, cette dimension est prise en compte dans la planification, notamment dans le PAP3 2024-2028 en cours de formulation, afin que les sénégalais d’ici et de la Diaspora, des zones urbaines et rurales puissent contribuer au développement du pays mais également, bénéficier des retombées de la mise en œuvre des politiques publiques et de la croissance. Ainsi, tenant compte des besoins et des réalités des femmes à considérer dans le combat pour une égalité de genre, les politiques mises en place devraient converger vers une correction des inégalités de départ pour arriver à l’équivalence des chances entre femmes et hommes en fonction de leurs besoins et intérêts spécifiques.
Par ailleurs, vu que les femmes et les filles représentent la moitié de la population mondiale, l’égalité des sexes devient ainsi un droit humain fondamental et s’avère essentielle pour l’avènement de sociétés dotées de potentiel humain et tirant profit des efforts de développement durable. Des études2 ont montré que l’autonomisation des femmes participe à la productivité et à la croissance économique de chaque État. Ce sont autant de raisons qui justifient les orientations des politiques vers l’équité sociale à travers l’accès aux services sociaux de base, la couverture sanitaire des populations et la protection des groupes vulnérables.
Cependant, même si les Etats ratifient et internalisent les textes, leur mise en œuvre pose problème, surtout avec la raréfaction des ressources. Il reste beaucoup d’efforts à faire pour arriver à la pleine égalité des droits et des chances entre les hommes et les femmes. Le leadership féminin continue de se heurter à de nombreuses difficultés et défis à relever en vue de favoriser les conditions permettant aux femmes de se hisser au sommet de la réussite à travers l’occupation de fonction de direction ou de créer et développer leurs entreprises. Ces difficultés sont relatives aux barrières juridiques, au manque d’infrastructures pour la garde des enfants, en passant par le poids des normes sociales, les obstacles dans l’accès aux financements et les pratiques discriminatoires des employeurs.
La problématique du travail non rémunéré constitue également un frein au développement du potentiel des femmes dans les pays en développement, notamment, en milieu rural où des filles sont encore privées de scolarité car retenues à la maison pour aider les mères dans le travail domestique. Aussi, est-il primordial, pour les acteurs, d’avoir une bonne compréhension de ce qu’est une planification dans une perspective genre afin d’identifier les portes d’entrée à saisir pour influencer les processus y afférents. Cet exercice consiste à renforcer la participation des femmes dans les interventions de développement et leur implication dans les processus de décisions qui les sous-tendent. Elle doit explicitement tenir compte de la situation différenciée des hommes et des femmes en termes de besoins, de contraintes et d’opportunités à toutes les étapes, de l’identification au suivi-évaluation des politiques, plans d’actions, projets et programmes de développement en passant par formulation, et la mise en œuvre. Concernant les prérequis à l’utilisation de l’approche genre, les trois (03) conditions suivantes sont nécessaires : – avoir une sensibilité réelle aux questions de genre et ses interrelations avec les actions de développement ; – développer une culture genre pour agir dans le sens de tenir compte de ces questions au niveau global et sectoriel ; – avoir une maitrise effective du processus de planification et de l’approche genre et de ses outils d’intervention. Ce dernier concept permet d’assurer une intégration réelle des femmes dans les activités de développement en tenant compte des modes de participation et des besoins d’aides spécifiques des femmes et des hommes à toutes les étapes de l’élaboration des politiques publiques de développement et des projets/programmes.
Cette approche conforte le schéma du cadre organisationnel type proposé par l’UEMOA pour institutionnaliser le genre, et permettra, in fine, de mesurer la performance des processus d’intégration de la sexospécificité dans les politiques publiques des États membres de l’union. Ce schéma attribue aux ministères en charge du plan et du budget, la responsabilité de coordonner l’institutionnalisation du genre dans la Chaîne Prospective, Planification, Programmation, Budgétisation, Suivi-Évaluation (PPPBSE) et de mettre en place, le processus de la budgétisation sensible au genre (BSG) en rapport avec les autres départements ministériels, particulièrement celui en charge de l’institutionnalisation du genre dans la conduite et la gestion des affaires publiques.
Dans cette logique, s’agissant du ministère en charge du genre, en plus de son rôle, notamment, de coordination de la mise en œuvre de la politique en matière de promotion du genre, d’appui au renforcement des capacités techniques et opérationnelles des ministères, il lui revient d’assurer le lead du mécanisme d’institutionnalisation du genre et de veiller à une meilleure coordination des initiatives et des processus. Le nouveau schéma propose un renforcement de sa collaboration avec les Ministères en charge de la planification, du budget et de la fonction publique pour une synergie des interventions en faveur de la performance des processus d’institutionnalisation du genre.
En définitive, l’objectif visé par l’UEMOA à travers ce schéma organisationnel type d’institutionnalisation du genre est d’opérationnaliser la transversalité du genre dans chaque secteur, pour un développement économique inclusif et durable. L’internalisation de ce schéma doit être érigée au rang des défis à relever pour l’ensemble des acteurs. Pour le cas du Sénégal, la récente enquête de l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), portant sur « l’emploi du temps au Sénégal » destinée à identifier, classifier et quantifier les types d’activités que les sénégalais réalisent au quotidien, a montré des disparités importantes concernant l’utilisation du temps des hommes et des femmes, particulièrement en termes d’activités rémunérées et non rémunérées comme le montre la figure ci-après.
LES ACQUIS
Le Sénégal s’est résolument engagé sur la voie d’une transformation structurelle en faisant du capital humain un des piliers de sa politique de développement économique et social. A ce titre, l’inclusion sociale et la promotion de l’équité et de l’égalité de genre apparaissent comme des défis majeurs. Toutefois, malgré la persistance de disparités dans certains secteurs, des avancées ont été notées en matière d’égalité de genre notamment dans le domaine de l’accès aux instances de décision, à l’éducation, à l’autonomisation, à l’allégement des travaux et à la formation.
Les avancées résultent, entre autres facteurs, de la mise en place d’un dispositif juridique en faveur de l’égalité des sexes et de la promotion des droits fondamentaux des femmes et des filles. Dans ce dispositif, figurent la Convention sur l’Elimination de toutes les Formes de Discrimination à l’Egard des Femmes (CEDEF) de 1979, le protocole à la Charte africaine des Droits et des Peuples relatifs aux Droits de la Femme en Afrique de 2003 (Maputo), la Déclaration solennelle des Chefs d’Etats et de Gouvernements sur l’égalité entre les hommes et les femmes en Afrique, les ODD4, l’Agenda 2063 de l’Afrique et l’acte additionnel pour l’égalité des droits entre les hommes et les femmes pour un développement durable dans l’espace de la CEDEAO. Au niveau national, en plus de l’arrimage de la SNEEG II au PSE, la prise en compte de la dimension genre a été érigée en critère d’éligibilité des projets dans le PAP 2A.
C’est dans ce cadre que s’inscrit la revue thématique genre, coordonnée par le Ministère en charge de la Femme, conformément aux dispositions de la lettre-circulaire n°0097/MEPC/DGPPE/UCSPE du 21 février 2021. En outre, la Constitution de la République du Sénégal révisée pose le principe de l’égalité de l’homme et de la femme devant la loi, notamment, en ses articles premier et sept (7). A ce cadre juridique s’ajoute la contribution du Ministère en charge du budget à travers l’outil BSG dans le but de parvenir à une prise en compte, de manière équitable, des besoins pratiques et intérêts stratégiques des femmes et des hommes dans les finances publiques.
En matière d’acquis, des efforts importants sont enregistrés à travers la mise en œuvre des politiques. Il faut noter également le rôle important des partenaires au développement à travers la mise en œuvre des projets/programmes mais également le secteur privé, la société civile, entre autres. En matière de représentativité des femmes au sein du parlement, conformément au rapport sur « les femmes au Parlement en 2022 : regard sur l’année écoulée » de l’union internationale pour la démocratie pour tous, le Sénégal avec un taux de 44,2%, occupe le 4éme rang au niveau mondial en ce qui concerne le ratio relatif à la présence des femmes dans les chambres uniques et basses, après le renouvellement parlementaire de 2022.
Avec l’introduction de la loi sur la parité en 2010, le Sénégal a été l’un des pionniers dans la représentation politique des femmes au Parlement. En 2022, il est entré dans l’histoire avec la plus forte proportion de femmes parlementaires jamais atteinte en Afrique de l’Ouest. Ainsi, il occupe la troisième place en Afrique et la quatorzième dans le monde pour la représentation des femmes au Parlement en 2022. Ces dernières années, la forte représentation des femmes au Parlement explique plusieurs avancées législatives, notamment une loi autorisant les sénégalaises mariées à un étranger à transmettre leur nationalité à leurs enfants (2013) et un texte de loi érigeant le viol en infraction pénale (2020). Cependant, d’autres défis inéluctables attendent le législateur comme la légalité des droits parentaux, les violences à l’égard des femmes, l’éducation des filles, l’accès à la santé, etc.
Grâce à l’application de la loi sur la parité, la proportion des femmes députés est passée de 18,7% à 44,2%, entre la 12éme et la 14éme législature, soit une hausse significative de 25,5 points de pourcentage sur une période de 13 ans. Au niveau de la Cour des Comptes, sur un total de 46 magistrats (année 2022), seules 5 sont des femmes, soit un ratio de 11% avec 3 femmes parmi les 11 conseillers référendaires et 2 parmi les 21 conseillers. Pour les assistants vérificateurs, on note un ratio de 30%, soit 14 femmes sur un total de 46. De même, la présence des femmes au niveau du Conseil économique, social et environnemental (CESE), dirigé par une femme entre 2013-2019 et 2019-2020, est de vingt-sept (27) sur un total de cent dix-neuf (119), soit un taux de présence de 22,7%. Au niveau du Haut Conseil des Collectivités territoriales (HCCT), les femmes représentent un peu plus du tiers des conseillers avec cinquante-deux (52) sur un total de cent-cinquante (150), soit un taux de représentativité de 35%. Il est important de souligner également que la présence d’une femme à la tête de cette importante institution constitutionnelle constitue un fait majeur qui mérite d’être salué. S’agissant des communes, en 2022, sur un total de 558 collectivités territoriales, seules 16 sont dirigées par des femmes, soit un faible taux de représentativité de 2,87%. Pour les conseils départementaux, la situation est similaire avec un taux de 6,97%, soit 3 femmes (Sédhiou, Koungheul et Tivaouane) sur un total de 43 présidents de conseils départementaux. Concernant les forces de défense et de sécurité, la prise en compte des enjeux liés à l’introduction du genre en leur sein n’est plus à démontrer au regard des effectifs de plus en plus importants de femmes dans les différents corps militaires et paramilitaires. Ce faisant, la présence des femmes y est passée de 4,95% en 2022 à 5%. Toutefois, afin de garantir un plein succès à cette initiative salutaire, des contraintes socioculturelles, encore liées à la condition féminine, doivent être levées. Relativement à la diplomatie, la proportion de femmes ambassadeurs est passée de 21% à 13% entre 2022 et 2023, soit une baisse de 8 points de pourcentage. Également, sur un effectif total de quinze (15) consuls généraux, on ne compte aucune femme. Cependant au niveau des vice-consuls, il est noté la présence de cinq (05) femmes sur un total de quinze (15), soit un taux de présence de 33%. S’agissant de la fonction ministérielle, la proportion des femmes reste inchangée entre 2021 et 2023 avec huit (8) femmes sur un total de trente-six (36) ministres de l’attelage gouvernemental. Le rapport est relativement faible surtout si on considère que deux premiers ministres femmes ont eu à diriger le gouvernement en 2001 et 2014.
Dans le commandement territorial, le niveau de représentation des femmes reste faible avec trois (03) femmes gouverneurs de région sur quatorze (14), 07 adjoints au gouverneur sur 28, 03 préfets sur 46, 06 adjoints au préfet de département sur 46, 06 sous-préfets d’arrondissement sur 127 et 08 adjoints sous-préfet sur 127. A propos de l’éducation nationale, des résultats mitigés sont notés au niveau du concours général 2023 pour les filles avec 2/3 des prix dans les domaines de l’électronique et de l’électrotechnique, 0/3 pour les mathématiques, 5/5 pour les sciences de la vie et de la terre, 5/5 pour les sciences économiques, 0/4 pour la construction mécanique. Par ailleurs, pour matérialiser la vision du chef de l’Etat de réorienter le système éducatif vers le numérique, l’Institut national d’Education et de Formation des Jeunes Aveugles (INFJA) de Thiès a abrité une session de formation des formateurs sur le programme « Cours ICB de base en informatique des non-voyants et mal-voyants » en vue de réduire les inégalités dans l’utilisation des nouvelles technologies. Ce projet d’inclusion sociale vise à corriger certaines inégalités sociales dans l’utilisation des TICS et l’initiative de la ST-Concept permettra ainsi, aux couches les plus vulnérables, de développer un réseau relationnel à travers le numérique. Les bénéficiaires sont chargés, à leur tour, de transmettre leur savoir dans les centres pilotes installés à Ziguinchor, à Saint-Louis, à Thiès et à Dakar. Concernant les Violences Basées sur le Genre (VBG), l’apport de la digitalisation dans la réponse à la violence faite aux femmes et aux enfants à travers la plateforme gratuite « Wallu ALLO 116 » », a renforcé significativement la politique de prise en charge des victimes de violences et des services de proximité au profit des familles. Cette initiative bien appréciée, du reste, a suscité l’intérêt des pays comme le Canada, la France, la Belgique qui ont félicité le Sénégal avant d’exprimer le souhait de nouer une coopération dans ce domaine. S’agissant de la violence faite aux enfants, une plateforme d’information a été mise en place afin de réduire la rétention d’informations en cas de violence. Le viol, les abus sexuels, les cas d’exploitation et de disparition d’enfants, les cas de négligence, autant de cas de violences qui ne sont pas dénoncés, et par conséquent ne peuvent être pris en charge correctement, tant sur le plan juridique comme sur le plan social. Dans cette dynamique, des organisations de femmes et de défense des droits des enfants se sont constituées pour dénoncer le phénomène de la VBG et apporter leur soutien aux filles victimes. C’est le cas du Centre Kullimaaroo, créé en 2015 pour prendre en charge des femmes en détresse et celles ayant subi des viols dans le conflit casamançais. Il est noté des cas de fistules obstétricales, de viols suivis de grossesses et de grossesses non désirées synonymes d’un abandon scolaire ou d’un renvoi du domicile familial et même parfois d’infanticides.
SOURCE : Ministère des Finances et du Budget