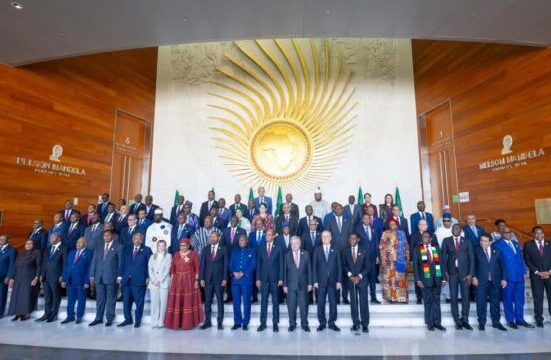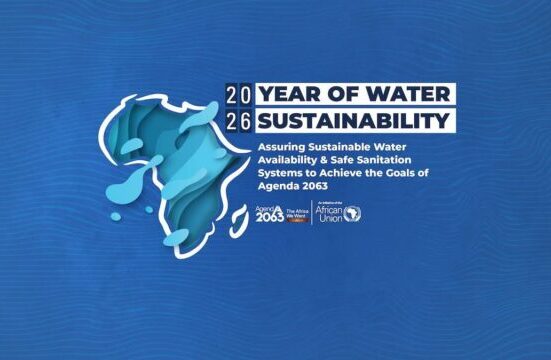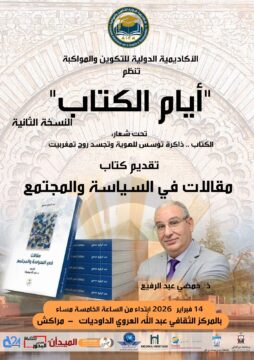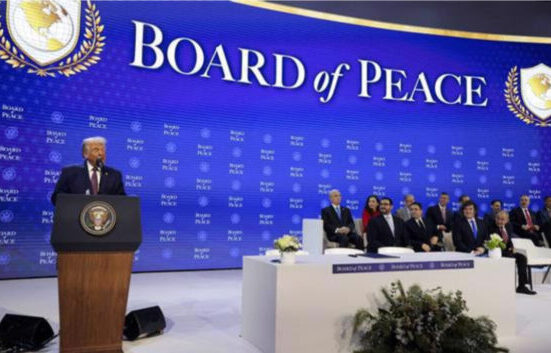« Nous ne pouvons ignorer les véritables problèmes politiques que pose l’émigration, comme nous ne pouvons non plus perdre de vue les formidables perspectives qu’offre celle-ci aux émigrants, aux pays qu’ils quittent et ceux où ils se rendent[1]. »
« Il nous incombe à nous, Africains et Européens, de démanteler ensemble les réseaux d’immigration illégale, derrière lesquels se dissimule un trafic épouvantable et mafieux (…) [2]»
« Parfois, pendant de longs mois, de jeunes Africains, hommes et femmes, risquent tout, y compris leur vie, pour entreprendre un périlleux périple qui leur fait traverser des dizaines de frontières et les dangereux courants de la Méditerranée à la recherche d’une vie meilleure dans le Nord. Certains y laissent leur vie, d’autres sont renvoyés chez eux et d’autres encore, qui atteignent leur destination, comprennent que leur existence n’y sera pas forcément plus facile. Mais étant donné le manque d’emplois et les sombres perspectives auxquels ils sont confrontés dans leur pays, des millions de jeunes Africains préfèrent encore l’exode, souvent clandestin[3].
Les migrants sont des êtres rationnels, qui partent vers des régions plus favorisées, et où ils pourront satisfaire leur besoin d’une vie meilleure et plus sûre.[4]»
Depuis l’aube de l’humanité, les populations se sont déplacées, d’un pays à l’autre, d’un continent à l’autre. Elles se sont déplacées parfois pour quelques temps, parfois pour toujours, parfois isolées, parfois en groupe. Certaines migrations ont pris de très grandes proportions. En effet, la migration est aussi ancienne que l’humanité. De tout temps, les personnes ont migré en quête d’une vie meilleure, pour fuir un conflit ou se mettre en sécurité, ou simplement à la recherche de nouvelles possibilités[5].
Les causes de ces migrations sont nombreuses : catastrophes naturelles, changements climatiques, épidémies, invasions, conquêtes, guerres, persécutions politiques ou religieuses, la recherche de moyens d’existence etc.[6]. Toutefois, les critères de résidence, de durée, de distance ne permettant pas de déceler en toute rigueur les déplacements définitifs et les déplacements temporaires, on est donc amené à faire intervenir un autre critère, plus subjectif : la raison de migration. C’est bien souvent la combinaison de l’ensemble des critères qui seule permet d’aboutir sans ambiguïté à cette distinction.
Notons en effet que certaines situations particulières obligent l’individu à être absent un temps déterminé (scolarité, service militaire, maladie, prison…) sans que son intention soit de quitter définitivement son lieu d’origine. Par ailleurs on élimine la confusion qu’il pourrait y avoir entre migration et mouvements saisonniers, notamment lorsque la période de référence est courte[7].
En outre, les migrations intérieures, déclenchées au XIXe siècle par l’industrialisation de l’Europe du Nord-Ouest, ont eu pour prolongement le départ de contingents importants pour les pays lointains, surtout pour les terres tempérées à peu près vides d’habitants, qui présentaient le caractère de domaines de spéculation et de peuplement de masse. Sous une forme intermédiaire, les passages d’un pays dans le pays voisin ont apporté leur contribution aux multiples mélanges de population de l’époque contemporaine. L’émigration, qui a individuellement les mêmes causes que le départ pour une destination n’impliquant pas sortie de l’État d’origine, s’est insérée dans la construction économique du capitalisme.
L’émigration à partir des pays d’économie industrielle n’est pas seulement un déplacement d’Hommes, elle est l’étalement géographique d’un système économique et d’une structure sociale. Elle est le plus souvent une entreprise contrôlée : un acte politique dont les émigrants sont, suivant leur qualification et leur rôle, des acteurs conscients ou inconscients. Elle sert de substrat humain à la recherche des compléments d’alimentation et des produits de base nécessaires aux nouvelles industries. Elle prépare les voies à l’émigration des capitaux et à la vente des produits fabriqués dans les nouvelles usines européennes.
Elle entraîne derrière elle tout le système et sème les germes d’économies, filiales d’abord, concurrentes plus tard, au point que, dès 1920, on a pu parler de la crise de l’Europe devant la puissance grandissante des nouvelles économies capitalistes d’outre-mer, essentiellement de celle des États-Unis, le pays qui a, précisément, reçu le plus grand nombre d’émigrants de l’Europe. Cette émigration a été d’abord alimentée par les pays touchés par la révolution industrielle[8]
La fécondité des pays industriels de l’Europe occidentale s’est atténuée à l’époque où l’expansion de l’Europe a atteint son maximum. De ce fait, ce ne sont pas seulement les pays industriels ayant pris l’initiative de l’exploitation économique du monde qui ont fourni des contingents à l’émigration. À leur tour, les pays agricoles à haute fécondité ont offert les plus grosses cohortes d’émigrants au début du XXe siècle[9].
En moins de trois quarts de siècle, de 1850 à la Première Guerre mondiale, une cinquantaine de millions d’individus, Européens en très grande majorité, se sont établis dans des pays d’outre-mer. Plusieurs millions d’Hommes ont en même temps changé de pays pour venir travailler dans les pays industriels dont le taux d’accroissement de population était insuffisant pour répondre à l’augmentation de la demande de main-d’œuvre : Allemagne, France. En outre, les Européens ont eu besoin de main-d’œuvre tropicale pour mettre en valeur les terres dont ils avaient entrepris l’exploitation au service de leur économie.
Ils ont organisé ou stimulé, non sans de multiples réserves, des déplacements de populations au sein de la zone tropicale : migrations de travailleurs indous et chinois, recrutement de main-d’œuvre noire dans les régions montagnardes de l’Afrique pour les chantiers miniers du Katanga et de la Rhodésie, etc. Dans certains cas, enfin, il leur est apparu avantageux de faire appel, sur leur propre territoire, à des travailleurs d’outre-mer : Nord-Africains en France spécialement[10].
Par ailleurs, pendant longtemps la migration n’était pas au centre des préoccupations des chercheurs, même si depuis la Conférence Mondiale des Nations Unies sur la Population, tenue à Bucarest en août 1974, elle a été identifiée comme étant un problème de population. En effet, il y a été dit que les différents problèmes de population devaient aussi être envisagés en termes de répartition de la population, des migrations des zones rurales vers les zones urbaines et de l’urbanisation. L’exode rural y a été identifié comme l’élément le plus préoccupant de la migration et des solutions ont été proposées au pays en développement.
A ce moment, la migration internationale n’avait pas encore été identifiée comme un problème démographique. Certains représentants ont même énoncé que le moyen de résoudre les problèmes résultant de l’accroissement démographique dans les pays en développement consistait à encourager les migrations internationales entre les pays à fort taux d’accroissement vers les pays où il y avait pénurie de main d’œuvre. La problématique de l’émigration internationale était plutôt associée à un exode des compétences, ce qui pouvait constituer une entrave au développement des pays d’origine[11].
La problématique de la migration internationale commence à être posée lors de la Conférence de Mexico en 1984. C’est lors de la Conférence Internationale sur la Population et le Développement (CIPD) qui s’est tenu au Caire en 1994, que les deux types de migrations (interne et internationale) sont identifiés comme de sérieux problèmes liés à une augmentation de la taille de la population – malgré un déclin des taux de natalité. Il y est dit que les mouvements de population aussi bien à l’intérieur des pays et entre les pays, avait pour conséquence une croissance très rapide des villes et une distribution inégale des populations va aller croissant[12]. La migration internationale est considérée comme étant à la fois la cause d’une perte de ressources humaines pour les pays d’origine et d’une augmentation des tensions politiques, économiques et sociales pour les pays d’accueil[13].
Cependant, les études sur la migration et le développement se focalisent essentiellement sur la migration internationale alors que les flux de la migration interne sont souvent plus importants et par le fait même leurs conséquences sur le développement. De plus, la grande majorité des recherches dissocient la migration interne de la migration internationale, chacune se spécialisant dans un type de migration.
Les problèmes qui découlent des deux types de migration sont effectivement différents. La migration interne est associée à une forte urbanisation et à une répartition inégale des populations sur un territoire. La migration internationale, quant à elle, est mise de l’avant dans les recherches par les pays du nord qui souhaitent limiter l’afflux des immigrants sur leurs territoires. Elle pose aussi la question de la « fuite des cerveaux» et de l’émigration clandestine[14].
Pourtant les deux types de migration présentent plusieurs points communs. Elles ont le plus souvent les mêmes causes et origines, les mêmes mécanismes mis à l’œuvre et des impacts comparables sur les régions de départ. De plus, l’étude de la migration interne ainsi que de la migration internationale soulève des questions sur leur relation avec le développement. En effet, le sous-développement et la pauvreté sont vus comme des éléments déterminant la migration, sa direction, son volume et la composition des flux migratoires.
Lier les deux types de migration peut dès lors se révéler très intéressant. En effet, essayer de comprendre les interrelations entre la migration interne et internationale pourrait permettre de lever certaines interrogations sur les mécanismes mis à l’œuvre lors des migrations, sur les caractéristiques des individus qui migrent, sur ce qui les motivent[15].
Dès lors, lorsqu’un nombre inédit de réfugiés et de migrants dépourvus de documents sont arrivés en Europe par voie maritime, une carte du quart nord-ouest du continent africain est apparue dans les médias européens. Y figuraient plusieurs lignes ou flèches s’étendant du golfe de Guinée à la mer Méditerranée à quelque 4 000 kilomètres au nord, qui représentaient les itinéraires terrestres empruntés par les migrants et les réfugiés depuis les quatre coins de l’Afrique pour atteindre la mer Méditerranée, d’où ils embarquaient pour l’Europe. Deux grandes routes se sont dessinées selon la destination en Europe : la route de la Méditerranée occidentale, vers l’Espagne ; et la route de la Méditerranée centrale, vers l’Italie ou Malte.
Cependant, cette carte représente de manière schématique un fragment d’une réalité protéiforme. Il convient de ne pas commettre d’erreur d’interprétation. Les lignes forment des segments distincts utilisés depuis des temps immémoriaux par des négociants, des bergers ou des employés qui effectuent des allers et retours en Afrique. De nombreux migrants empruntent aujourd’hui ces mêmes itinéraires pour passer d’un pays à l’autre sur le continent, du sud vers le nord à la recherche d’emplois dans les pays pétroliers que constituent la Libye et l’Algérie, ou du nord vers le sud en vue de travailler dans des plantations côtières en Côte d’Ivoire ou au Ghana. Ceux qui se rendent jusqu’à la mer Méditerranée dans le but de gagner l’Europe sont minoritaires.
D’un autre côté, l’augmentation constante, ces dernières années, de la migration africaine à destination de l’Europe, qui est avérée, a peu à voir avec les flux migratoires terrestres en Afrique de l’Ouest et du Nord. À l’instar de la plupart des personnes qui migrent sur de longues distances dans le monde, c’est par voie aérienne et pourvus d’un visa que la majorité des migrants africains parviennent à leur destination européenne[16].
L’ampleur des mouvements de population le long de la route de la Méditerranée centrale, la fréquence élevée du statut de migrant irrégulier sur cet itinéraire, le rôle des réseaux criminels et le destin tragique de nombreux migrants qui empruntent l’une des routes migratoires les plus mortelles au monde ont suscité l’attention soutenue des gouvernements, des organisations internationales, des organisations non gouvernementales (ONG) et des médias[17].
Le fait est qu’en reliant l’Afrique subsaharienne à l’Afrique du Nord et à l’Europe, la route de la Méditerranée centrale rattache l’une des régions les plus pauvres du monde à l’une des plus prospères, ce qui en fait une voie migratoire présentant un fort potentiel d’activité. Les vastes zones inhabitées et quasiment exemptes de contrôle qu’elle traverse dans le désert et en mer favorisent les mouvements irréguliers et les activités des passeurs, ce qui peut mettre en danger les vies des migrants. Le chaos politique et les défaillances de l’état de droit dans plusieurs sections du parcours laissent le champ libre à des trafiquants qui condamnent les migrants à l’extorsion, à l’exploitation, voire à la mort.
Sur cette toile de fond, en mettant dans le même panier les passeurs qui menacent la sécurité et les migrants dépourvus de documents qui enfreignent des règles administratives, les gouvernements présentent souvent la lutte contre les premiers et l’endiguement des seconds comme un seul et même objectif, en Afrique comme en Europe.
Tous les États sont préoccupés par les franchissements désordonnés de frontière et les migrations irrégulières qui portent atteinte à leur souveraineté. Lorsque l’Algérie renvoie des dizaines de milliers de migrants au statut irrégulier vers sa frontière avec le Niger, elle le fait pour la même raison que les États membres de l’Union européenne renvoient chaque année entre 150 000 et 200 000 ressortissants de pays tiers à la suite d’injonctions de quitter le territoire. La différence réside davantage dans la manière dont les migrants en situation irrégulière sont éloignés – renvoyés en avion après conclusion d’un accord avec leurs pays d’origine ou laissés en détresse dans le désert – que dans l’affirmation par les États de leur souveraineté[18].
Les stratégies des gouvernements en matière de migration présentent toutefois une asymétrie importante. Tous les États d’Afrique du Nord et de l’Ouest craignent que l’Union européenne ne ferme partiellement ses portes à leurs migrants. À la table des négociations, l’Union européenne monnaie la perspective de voies de migration régulière et d’aides au développement contre un renforcement des contrôles aux frontières en Afrique – empêchant plus précisément la sortie des migrants dépourvus de visa en contradiction notamment avec les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 : « Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien […]. [19]») – et la réadmission par les États africains des migrants de retour arrêtés en situation irrégulière en Europe.
On considère toutefois que les mesures prises par les États en vue de durcir les contrôles le long des routes migratoires terrestres et maritimes produisent des effets ambivalents sur les migrations irrégulières, réduisant le nombre de migrants, mais, dans le même temps, aggravant les risques auxquels les migrants sont exposés lorsqu’ils empruntent des itinéraires plus dangereux pour contourner les obstacles[20].
APPROCHES DEFINITIONNELLES
La migration[21] est le fait de changer de domicile pour une durée longue ou définitive. Elle est l’une des modalités de la mobilité. Un couple qui quitte la ville-centre pour la banlieue, une expatriée qui travaille à l’étranger pour une multinationale, un retraité qui s’installe dans la région de son enfance sont tous, au sens statistique, des migrants. Terme générique non défini dans le droit international qui, reflétant l’usage commun, désigne toute personne qui quitte son lieu de résidence habituelle pour s’établir à titre temporaire ou permanent et pour diverses raisons, soit dans une autre région à l’intérieur d’un même pays, soit dans un autre pays, franchissant ainsi une frontière internationale.
Il englobe un certain nombre de catégories juridiques de personnes bien déterminées, comme les travailleurs migrants ; les personnes dont les types de déplacement particuliers sont juridiquement définies, comme les migrants objets d’un trafic illicite ; ainsi que celles dont le statut et les formes de déplacement ne sont pas expressément définis par le droit international, comme les étudiants internationaux[22], [23]. La migration correspond rarement à une flèche à sens unique, qui est pourtant celui qui lui est le plus fréquemment attribué. En fait une migration correspond souvent à plusieurs allers-retours entre le lieu d’arrivée et celui de départ, avant et après le trajet définitif.
En effet, on distingue entre plusieurs formes de migrants :
- Migrant économique, il faut noter que la migration de travail (économique) est par nature difficile à évaluer compte tenu du manque de chiffres pour le secteur informel et des « clandestins »[24]. Ces flux migratoires[25] concernent environ 100 millions de personnes. Selon de récentes statistiques les principaux foyers de migration de travail se trouveraient en Inde et au Canada qui ont des politiques d’accueil à l’égard des populations. Elle n’est en général pas volontaire.
- Migrant en situation irrégulière − Personne qui franchit ou a franchi une frontière internationale sans autorisation d’entrée ou de séjour dans le pays en application de sa législation ou d’accords internationaux dont il est partie.
- Migrant en situation régulière − Personne qui franchit ou a franchi une frontière internationale et est autorisée à entrer ou à séjourner dans un État conformément à la législation dudit État et aux accords internationaux auxquels il est partie.
- Migrant environnemental – Personne ou groupe de personnes qui, essentiellement pour des raisons liées à un changement environnemental soudain ou progressif influant négativement sur leur vie ou leurs conditions de vie, sont contraintes de quitter leur lieu de résidence habituelle ou le quittent de leur propre initiative, temporairement ou définitivement, et qui, de ce fait, se déplacent à l’intérieur ou hors de leur pays d’origine ou de résidence habituelle.
- MIGRANTS EN SITUATION DE VULNERABILITE – Migrants qui ne peuvent de fait pas jouir de leurs droits de l’homme, qui sont particulièrement exposés à des risques de violations et de violences et qui, en conséquence, ont le droit de demander une protection accrue de la part des débiteurs d’obligations.
- MIGRATION CLIMATIQUE – Mouvement d’une personne ou d’un groupe de personnes qui, essentiellement pour des raisons liées à une modification soudaine ou progressive de l’environnement en raison du changement climatique, sont contraintes de quitter leur lieu de résidence habituelle, ou le quittent de leur propre initiative, temporairement ou définitivement, pour se rendre ailleurs sur le territoire d’un État ou par‑delà une frontière internationale.
- MIGRATIONS SURES, ORDONNEES ET REGULIERES – Mouvements de personnes s’effectuant conformément aux lois et réglementations régissant l’entrée, la sortie, le retour et le séjour dans un État, et conformément aux obligations incombant aux États au titre du droit international, de telle sorte que la dignité humaine et le bien-être des migrants soient préservés, que leurs droits soient respectés, protégés et réalisés, et que les risques associés à de tels mouvements soient pris en compte et atténués[26].
- ÉMIGRATION – Du point de vue du pays de départ, action de quitter le pays de nationalité ou de résidence habituelle pour s’installer dans un autre pays, de sorte que le pays de destination devient effectivement le nouveau pays de résidence habituelle.
- IMMIGRATION – Du point de vue du pays d’arrivée, fait de se rendre dans un pays autre que celui de sa nationalité ou de sa résidence habituelle, de sorte que le pays de destination devient effectivement le nouveau pays de résidence habituelle[27].
En outre, il n’y a pas opposition spécifique entre migrations intérieures et émigration-immigration. Dans une certaine mesure, la distinction des unes et des autres procède de la dimension des unités politiques intéressées par les déplacements de population. Les causes de départ, la nature des attractions sont identiques. Ce qui est migration intérieure dans un ensemble continental vaste et unifié politiquement est complexe d’émigrations et d’immigrations dans un continent dont la carte politique est très compartimentée[28].
CHANGEMENT DE NATION ET CHANGEMENT DE NATIONALITE
On peut être tenté de considérer que le fait, pour un membre d’une nation, d’aller s’établir parmi les ressortissants d’une autre nation est le caractère principal de l’émigration. Cette définition, qui correspond à la mise en valeur des traits essentiels de l’émigration, ne peut cependant pas être retenue parce qu’elle transgresse trop de définitions juridiques assises et même de réalités historiques ou politiques.
S’il est vrai que les formes extérieures de l’émigration, en même temps que les signes distinctifs de l’étranger dans un pays quelconque, sont liés au changement de nation, plus concret que le changement de nationalité qui est une notion juridique, il peut y avoir changement de territoire national sans émigration au sens juridique du terme et il peut y avoir émigration sans changement de milieu national. Un Ukrainien qui s’installe en Ouzbékistan n’émigre pas. Jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale, les chevauchements des limites nationales par les frontières des États, surtout en Europe centrale, rendaient possible l’émigration au sein d’une même communauté nationale.
Il faut d’autre part être prudent dans l’emploi de la définition de communauté nationale. Il pourrait être tentant à certains égards de généraliser la distinction qu’employaient les Allemands entre les Volksreich et les Volksdeutsche, parce que certains traits communs, surtout la communauté de langue et de culture, donnent à l’émigration et à l’immigration des caractères spécifiques, facilitent l’intégration très rapide de l’immigré dans son milieu d’accueil, mais transgressent la notion plus complète et plus complexe à la fois de nation. Il sera donc nécessaire de distinguer, à l’intérieur des migrations internationales, celles qui impliquent un changement total d’ambiance nationale et celles qui s’insèrent dans le cadre de parentés nationales[29].
Il reste que les conditions nationales et les conditions de langue et de culture dans lesquelles s’effectuent émigration et immigration sont des facteurs importants, pouvant agir fortement sur l’orientation des mouvements, sur les causes de départ comme sur le choix d’une destination et sur les conditions de l’intégration à la nation réceptrice, c’est-à-dire de l’assimilation.
Il est facile de démontrer, en outre, que les groupes nationaux se répartissent en un certain nombre de familles constituant des milieux plus ou moins attractifs pour des catégories nationales définies d’émigrants. L’analogie des civilisations, l’interpénétration des langages par les formes traditionnelles des patois et dialectes, ont quantitativement plus d’importance que les parfaites identités de nation et de culture[30].
Mais la création de noyaux, la formation de diasporas nationales diverses à travers le monde joue aussi son rôle dans l’orientation des courants migratoires en créant des formes d’emboîtement des nations les unes à l’intérieur des autres et, de ce fait, des commodité d’intégration des nouveaux arrivants.
L’étude des migrations internationales, de leurs circonstances, de leur orientation géographique et de leurs conséquences, spécialement dans les pays réceptifs, comporte donc considération d’un très grand nombre de données, et de données qui résistent parfois à une analyse en profondeur[31].
APERÇU DE LA SCENE MIGRATOIRE…
Il importe de noter que les grandes mutations géopolitiques, environnementales et technologiques qui influent, puissamment, sur la migration et la mobilité. Les effets de ces mutations mondiales systémiques n’ont cessé de s’intensifier au cours notamment de ces deux dernières années[32]. Par exemple, dans un contexte de durcissement géopolitique, nous avons été témoins de conflits d’une nature et d’une ampleur qui semblaient inimaginables jusqu’alors. L’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Fédération de Russie au début de l’année 2022 a marqué un tournant majeur dans le monde, certains y voyant la fin abrupte de 30 ans de mondialisation et de la vaste coopération internationale qui l’avait rendue possible.
Les effets immédiats de cette crise sur l’Ukraine et l’Europe continuent d’être ressentis par des millions de personnes. Ses effets à l’échelle mondiale en touchent bien davantage, l’onde de choc de la guerre se propageant dans les domaines de la sécurité alimentaire mondiale, de la sécurité énergétique, du droit international, du multilatéralisme, des alliances et des stratégies militaires[33].
Par ailleurs, au vu de l’utilisation soutenue – mais très inégale – de l’IA dans une partie seulement des systèmes relatifs à la migration, on peut craindre que l’exploitation de ces technologies dans les systèmes relatifs à la migration et à la mobilité ne creuse les fractures numériques, tant entre les États qu’au sein des États. Un prérequis au recours à l’IA est la capacité numérique des systèmes informatiques, en particulier la saisie numérique de données relatives aux processus et à l’identité des candidats.
Ces actions nécessitent un accès à des infrastructures informatiques et à l’électricité, ainsi que du personnel qualifié dans le domaine des technologies de l’information et des communications(TIC), des conditions que de nombreux pays du monde ne réunissent pas, en particulier les pays les moins avancés (PMA). Il s’agit d’un domaine de plus dans lequel les disparités en matière de capacités et de ressources creusent le fossé entre les États, aggravant la fracture numérique et les désavantages structurels dont souffrent les PMA dans le cadre de la gestion des migrations. L’asymétrie de pouvoir dans le monde en ce qui concerne l’IA au service de la migration est un problème persistant, susceptible d’être exacerbé à chaque nouvelle avancée.
Cependant, les migrants ne pâtiront pas uniquement des inégalités entre les États. Compte tenu de la numérisation croissante de la gestion des migrations et du recours accru à l’IA, notamment pour les services de visa, les formalités aux frontières et la gestion de l’identité, les candidats à la migration devront être en mesure d’utiliser des canaux numériques pour communiquer avec les autorités. Cela constitue un obstacle pour le grand nombre de personnes dans le monde qui n’ont pas accès aux TIC[34]. Pour promouvoir l’accès à des migrations sûres, ordonnées et régulières, il est nécessaire de promouvoir activement l’égalité numérique[35].
En outre, les deux dernières années ont été le théâtre d’événements migratoires et de déplacements majeurs, qui ont occasionné beaucoup de souffrances et de traumatismes, ainsi que des décès. Outre les conflits en Ukraine et à Gaza, des conflits ont entraîné le déplacement de millions de personnes, par exemple à l’intérieur et/ou au départ de la République arabe syrienne, du Yémen, de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo, du Soudan, de l’Éthiopie et du Myanmar.
En 2022 et 2023, on a également assisté à des déplacements de grande envergure provoqués par des catastrophes liées au climat et à des événements météorologiques dans de nombreuses régions du monde, notamment au Pakistan, aux Philippines, en Chine, en Inde, au Bangladesh, au Brésil et en Colombie. Parallèlement, en février 2023, le sud-est de la Türkiye et le nord de la République arabe syrienne ont été frappés par de puissants séismes ayant entraîné la mort de plus de 50 000 personnes[36].
MIGRATIONS AFRICAINES ET DEVELOPPEMENT : UNE RELATION FONDAMENTALE[37] ?
Les Africains ont toujours émigré et continueront d’émigrer, et cette tendance semble devoir s’accentuer, comme le montrent les tendances actuelles de la mobilité qui émanent des postes frontières nationaux. Ils se déplacent à la recherche d’opportunités et parfois de sécurité. Leur déplacement apporte des avantages à leurs familles et à leurs communautés, et donc à leurs pays. Ce dont ces migrants ont besoin pour assurer leur sécurité et leur productivité, c’est de moins de bureaucratie. Selon certains rapports, 94 % de la migration africaine à travers les océans prend une forme régulière[38].
Les migrations sont potentiellement un moteur de croissance et de développement pour toutes les parties concernées – pays d’accueil, pays d’origine et migrants eux-mêmes. Dans les pays de destination, les migrants ont permis un rajeunissement de la main-d’œuvre, la viabilité économique de secteurs traditionnels tels que l’agriculture et les services, la promotion de l’entrepreneuriat, un apport aux systèmes de sécurité et de protection sociales, et une réponse à la demande de compétences émanant des industries de haute technologie émergentes[39].
En ce qui concerne les pays d’origine des migrants, leur contribution positive est facilitée par des transferts de capitaux sur place (à la fois transferts de fonds et investissements), par des transferts de technologies et de compétences majeures, ainsi que par un accroissement des exportations et des échanges commerciaux internationaux[40]. Il convient de noter que le phénomène actuel des migrations internationales peut s’expliquer, de manière générale[41], par l’écart socio-économique croissant entre différents pays en matière d’accès à l’emploi (et notamment à un emploi décent), de sécurité des personnes et de libertés individuelles[42].
S’il peut y avoir de nombreuses motivations en ce qui concerne la décision d’émigrer, il est évident qu’à l’heure actuelle, le principal facteur d’émigration est l’impossibilité d’accéder à un emploi décent dans son propre pays. Dans les pays en développement, en effet, on ne crée pas assez rapidement d’emplois décents pour absorber la main-d’œuvre locale, qui augmente chaque année. Dans ces pays en développement, le sort des agriculteurs est un facteur très important de migration. De nombreux pays industrialisés ont connu, dans les années 1950 et 1960, un phénomène important d’exode rural ; et, aujourd’hui, le même type de processus peut s’observer dans beaucoup des principaux pays d’origine[43].
D’autres problèmes d’ordre [44]structurel aggravent la pression migratoire. Le commerce international accéléré a remplacé ou sapé la production industrielle ou agricole nationale par des importations bon marché dans de nombreux pays, entraînant la perte d’emplois dans les secteurs affectés. Les pertes d’emploi entraînent des changements commerciaux et structurels qui font apparaître un nombre croissant des chômeurs pour qui l’émigration devient une alternative en l’absence d’occasions pour un travail décent chez soi.
En soi, la pauvreté ne suffit pas à expliquer le départ. Il y a plutôt un ensemble de raisons assez complexe[45]. En effet, ce ne sont pas forcément les plus pauvres qui émigrent ; ce sont plutôt ceux qui sont informés des possibilités d’emploi à l’étranger, et ceux qui ont les moyens de payer le coût souvent très élevé du processus de migration. Les migrants – et les demandeurs d’asile – sont traditionnellement des personnes ayant une certaine éducation et une certaine expérience professionnelle, ou, tout au moins, les moyens financiers nécessaires[46].
L’élan de développement d’un pays renforce son facteur d’attraction sur le plan individuel et collectif, car on constate alors une demande de main-d’œuvre, des possibilités d’emploi tout à fait concrètes et l’émergence de meilleures conditions de vie. Les sociétés dites « avancées », qui ont des besoins de main-d’œuvre, un taux de mortalité et un taux de natalité assez faibles, attirent les travailleurs qualifiés et semi-qualifiés – leur nombre étant alors fonction de la situation spécifique du pays. Dans l’absolu, une grande partie des migrants se rendent aujourd’hui dans ces pays avancés, quelle que soit la région du monde où il se trouve[47].
UNE PERSPECTIVE TRANSNATIONALE DE LA MIGRATION ET DU DEVELOPPEMENT
L’essor des perspectives de la migration et du développement issues de la nouvelle économie et axées sur les moyens de subsistance a coïncidé avec une troisième tendance des études migratoires : le « virage transnational » de l’étude de l’installation et de l’intégration des communautés de migrants dans les pays récepteurs.[48]
Cette évolution s’est traduite par une plus grande reconnaissance des possibilités, toujours plus nombreuses, qui s’offrent aux migrants et à leur famille pour adopter un mode de vie et une identité transnationaux. Ce phénomène se rattache à l’incroyable multiplication des possibilités techniques qui permettent aux migrants de maintenir des liens avec leur société d’origine par le biais de la téléphonie (mobile), de la télécopie, de la télévision (par satellite) et de l’Internet, et de transférer de l’argent par le biais de systèmes bancaires mondialisés, formels ou informels.
Ainsi les migrants et leur famille sont-ils de plus en plus souvent en mesure de développer une double loyauté, d’aller et venir, de forger des liens, de travailler et de faire des affaires dans deux endroits distants, simultanément. Il est vrai que les migrants du XIXe et du début du XXe siècle entretenaient eux aussi des liens transnationaux étroits mais les révolutions technologiques ont radicalement élargi le champ des possibilités permettant aux migrants et à leur famille de poursuivre des modes d’existence transnationaux d’une manière plus constante et routinière[49].
La Transnationalisation de la vie des migrants a remis en question les modèles assimilationnistes de l’intégration des migrants, ainsi que les concepts politiques modernistes de l’État-nation et de la citoyenneté. En conséquence, la dichotomie bien nette entre « origine » et « destination » et les catégories telles que migration « permanente », « temporaire » ou « de retour » semblent perdre de leur pertinence dans un monde où la vie des migrants se caractérise de plus en plus souvent par la circulation et l’engagement simultané envers au moins deux sociétés ou communautés.
La continuité des transferts de fonds, les mariages transnationaux et la participation des migrants aux affaires sociales, culturelles et politiques de leur pays d’origine constituent autant de facteurs qui témoignent de la durabilité des liens transnationaux. Il semble incorrect d’interpréter automatiquement l’engagement des migrants envers leur pays d’origine comme une manifestation de l’échec de leur intégration. Réciproquement, un engagement plus approfondi des migrants dans leur société d’accueil n’entraîne pas nécessairement un engagement moins intense vis-à-vis de leur pays d’origine L’inverse est également possible. Après tout, les migrants dont l’intégration est « réussie » disposent par là-même de ressources financières et humaines plus importantes qui peuvent les aider à créer des entreprises ou participer au débat public dans leur pays d’origine[50].
Les transferts de fonds internationaux aident généralement à diversifier mais à aussi à augmenter substantiellement le revenu des ménages. Ils jouent un rôle crucial en tant qu’assurance contre les effets déstabilisants des marchés dysfonctionnels ou simplement absents, des politiques nationales inefficaces et de l’insuffisance des prestations sociales distribuées par l’État. Au niveau national, de nombreuses études indiquent que les transferts de fonds sont une source de devise étrangère de plus en plus importante, moins volatile, moins pro-cyclique et, en conséquence, plus fiable que les autres flux de capitaux en direction des pays en développement. Toutefois, ceci n’implique pas forcément qu’ils contribuent à la réduction de la pauvreté.
Comme la migration est un processus sélectif, la majorité des transferts internationaux ne bénéficient pas aux membres les plus démunis des communautés, ni aux pays les plus pauvres[51]. Cependant, les familles pauvres non migrantes tirent souvent indirectement parti de l’impact des transferts monétaires sur l’économie locale, qui se répercute sur les salaires, les prix et l’emploi dans les communautés émettrices. En conséquence, la majorité des études concluent que les transferts de fonds réduisent la pauvreté, même si ce n’est que de manière limitée[52].
Dans le même sillage, la migration africaine pourrait être considérée comme une bouée de sauvetage pour les ménages africains. En effet, les migrations profitent non seulement aux pays d’accueil en comblant les besoins en main d’œuvre, mais aussi aux pays d’origine grâce aux envois de fonds qui contribuent à la stabilité des revenus des ménages dans les économies fragiles, à l’amélioration de la sécurité alimentaire et à l’accès à l’éducation. Les envois de fonds vers l’Afrique subsaharienne ont augmenté régulièrement et constituent une source fiable de soutien[53]. Toutefois, la migration africaine irrégulière constitue des risques énormes, voire une tragédie sans précédent.
LA MIGRATION AFRICAINE IRRÉGULIÈRE CONTINUE DE COMPORTER DES RISQUES CONSIDÉRABLES
La plupart des migrations africaines déclarées se font par des voies régulières. Les 43 millions d’Africains dont on sait qu’ils vivent dans d’autres pays bénéficient en quelque sorte d’un certain statut juridique. Un nombre indéterminé de migrants africains ont eu recours à des voies irrégulières ou clandestines. La migration irrégulière augmente les vulnérabilités et les risques pour la sécurité personnelle des migrants et encourage l’exploitation de l’absence de statut légal des migrants par des éléments criminels[54].
IL EXISTE TROIS PRINCIPALES VOIES DE MIGRATION IRREGULIERE SUR LE CONTINENT :
- LA ROUTE DE L’EST
La route de l’Est, décrite comme l’un des couloirs de migration les plus fréquentés et les plus risqués au monde, est empruntée par des centaines de milliers de personnes chaque année, principalement en provenance d’Éthiopie, d’Érythrée et de Somalie. Les migrants vers les États du Golfe espèrent gagner cinq fois plus que dans leur pays d’origine. Environ 300 000 migrants ont quitté l’Éthiopie pour les côtes de Djibouti et de la Somalie en 2023. Plus de 93 500 migrants de la Corne de l’Afrique sont arrivés au Yémen au cours de cette période, soit une augmentation de 26 % par rapport à l’année précédente[55]. Il faut évidemment s’attendre une hausse considérable du flux migratoire ultérieurement.
Outre les risques environnementaux mortels (déshydratation, exposition et noyade), des centaines de personnes ont été tuées à la frontière entre l’Arabie saoudite et le Yémen entre mars 2022 et juin 2023 entre autres. Les migrants ont été abattus à bout portant, soumis à des attaques au mortier et à d’autres explosifs, et ont été violés ou contraints de violer leurs compagnons de voyage. Le sentiment d’hostilité à l’égard des migrants et l’absence de protection juridique pour ces derniers restent des menaces sérieuses dans les États du Golfe[56].
LA ROUTE DU SUD
La route du Sud, qui longe la côte Est de l’Afrique en direction de l’Afrique du Sud via le Kenya et la Tanzanie, n’attire pas autant l’attention que d’autres routes de migration irrégulière sur le continent. Toutefois, des rapports périodiques faisant état de la mort de migrants à l’arrière de camions ou de conteneurs d’expédition rappellent les circonstances sinistres dans lesquelles beaucoup vivent. On estime que 65 000 personnes ont emprunté la route du Sud en 2023, un chiffre qui devrait augmenter en 2024 voire au-delà.
De plus en plus de documents font état de diverses formes de violence et d’abus — torture, agression physique, abus psychologique et émotionnel, et violence sexuelle — perpétrés par des passeurs et d’autres acteurs sur cet itinéraire.
LES ROUTES MEDITERRANEENNES ET ATLANTIQUES VERS L’EUROPE
Les routes maritimes vers les côtes européennes ont fait l’objet de la plus grande attention. La patrouille frontalière de l’Union européenne (UE), Frontex, accumule des données sur les franchissements de frontières interceptés (IBC) depuis 2009. Au total, 1,37 million de ressortissants africains ont fait l’objet d’une demande d’asile au cours des 15 dernières années. Cela se traduit par une moyenne d’environ 91 000 IBC par an.
Bien qu’il ne représente qu’une minorité des personnes qui tentent de franchir clandestinement les frontières de l’UE, le nombre de migrants africains en situation irrégulière a lentement augmenté ces dernières années. Les ressortissants de Guinée, de Côte d’Ivoire, de Tunisie, du Maroc, d’Égypte et d’Algérie constituent les six principales sources africaines d’IBC ces dernières années. Collectivement, ces pays représentent plus de la moitié de tous les IBC africains[57].
Afin de décourager les traversées de la Méditerranée, les pays d’Afrique du Nord ont tenté, à la demande de l’UE, de relocaliser les migrants des villes côtières. Parfois, ces actions ont été draconiennes, par exemple comme les autorités tunisiennes qui ont expulsé et abandonné des centaines de migrants dans le désert à la frontière libyenne. En Libye, les foyers et les lieux de travail des migrants ont été perquisitionnés et des milliers d’entre eux ont été expulsés de force vers le Tchad, l’Égypte, le Niger, le Soudan et la Tunisie, sans examen de leurs situations légales.
DES TENDANCES MIGRATOIRES AFRICAINES DE PLUS EN PLUS ELEVEES…
Les migrations africaines continuent de subir des pressions persistantes à la hausse, prolongeant un scénario qui dure depuis 20 ans. Les opportunités économiques limitées, les conflits, les gouvernements répressifs, l’augmentation du nombre de jeunes et le changement climatique sont les principaux facteurs à l’origine de l’arrivée d’environ un million de nouveaux migrants au cours de l’année écoulée. Ces chiffres s’ajoutent aux 43 millions de migrants africains estimés au total.
La majorité de ces migrants, pour la plupart jeunes et célibataires, restent sur le continent à la recherche d’opportunités d’emploi dans les centres urbains. D’autres cherchent un emploi en dehors du continent principalement au Moyen-Orient et en Europe, bien que les Africains ne représentent respectivement que 6,6 % et 8,2 % de l’ensemble des migrants dans ces régions. Par ailleurs, comme il est brièvement mentionné ci-haut, les facteurs explicatifs des migrations africaines, sont divers et variés. Il convient néanmoins de revenir sur quelques-uns.
FACTEURS D’INCITATION À LA MIGRATION AFRICAINE
- Une combinaison de facteurs structurels et de gouvernance contribue à l’augmentation constante des migrations africaines qui, si les tendances actuelles se maintiennent, verront les migrations transfrontalières africaines atteindre 11 à 12 millions de personnes d’ici 2050.
- Bien que l’Afrique ait connu une croissance économique soutenue et solide depuis 2000, la région continue d’avoir les revenus moyens par habitant les plus bas du monde. On estime que 35 % de la population de l’Afrique subsaharienne vit dans la pauvreté ; ce qui crée une pression énorme sur les membres des ménages ayant un revenu pour qu’ils trouvent un emploi afin de répondre aux besoins essentiels[58].
La plupart des migrations non liées à un conflit suivent les opportunités économiques saisonnières au niveau régional. La migration intra-africaine a augmenté de 44 % depuis 2010. Dans la région de la CDAA, la plupart des migrations circulaires ont pour destination l’Afrique du Sud, pays économiquement dynamique. Au sein de la CEDEAO, la plupart des migrants passent par la Côte d’Ivoire et le Nigeria.
- La migration la plus importante en Afrique a toujours lieu à l’intérieur des pays, le plus souvent de manière circulaire, des zones rurales vers les zones urbaines. Les moyens de subsistance ruraux durables devenant plus précaires en raison du réchauffement climatique, une part croissante des migrants — entre 70 et 110 millions de personnes — pourrait être forcée de rendre ces déplacements permanents.
L’exode rural peut être un premier pas vers la migration internationale, car les migrants urbains gagnent plus de revenus et d’informations sur d’autres possibilités d’emploi.
- En tant que continent le plus jeune du monde, l’Afrique continue de connaître une croissance démographique plus importante que toute autre région de la planète. Selon les estimations, la population africaine devrait doubler, passant de 1,2 milliard à 2,5 milliards d’habitants en 2050, et 10 à 12 millions de jeunes Africains rejoignent la population active chaque année. Alors que les taux de fécondité semblent baisser plus rapidement que prévu, l’Afrique devrait disposer d’un grand nombre de jeunes gens aptes à l’emploi jusqu’à la fin du siècle.
- Les conflits non résolus sur le continent génèrent un nombre record de populations déplacées de force. En outre, le retour à un régime autocratique a restreint les libertés fondamentales et accentué la répression, ce qui contribue à l’augmentation des déplacements. Les déplacements forcés prolongés obligent les jeunes à se rendre dans les zones urbaines, puis potentiellement hors du continent, ce qui accroît les migrations[59].
UNE NOUVELLE STRATEGIE EUROPEENNE POUR DISSUADER LES MIGRANTS IRREGULIERS : « LES INTERMEDIAIRES PAIRS »
À l’heure où l’Union européenne adopte un Pacte qui conforte ses ambitions d’externalisation du contrôle des migrations et de l’asile, il est impératif de s’intéresser aux acteurs du voisinage européen qui rendent possible, au quotidien, cette lutte contre les migrations irrégulières.
Car bien au-delà des autorités des pays d’origine et de transit, une myriade d’acteurs non gouvernementaux facilitent la mise en œuvre de politiques anti-migratoires aux frontières de l’Europe[60].
Si la recherche académique a largement remis en cause l’impact de ces campagnes sur les départs en migration, peu de travaux se sont intéressés aux intermédiaires pairs en tant que tels. Pourtant, ils sont un maillon essentiel du contrôle migratoire aux frontières externes de l’Europe. Quels sont les profils sociologiques et les trajectoires migratoires de ces intermédiaires ? Dans quelles conditions sont-ils employés par les organisations internationales ? Et quelles relations entretiennent-ils avec leur public cible ?
LES MESSAGERS LOCAUX DU CONTROLE MIGRATOIRE
Sur le continent africain, de plus en plus de personnes issues des communautés migrantes sont recrutées dans le cadre de projets de dissuasion contre la migration irrégulière financés par l’UE. Qu’ils et elles soient artistes, responsables religieux, leaders associatifs ou migrants eux-mêmes, ces intermédiaires « pairs » participent aux campagnes de sensibilisation menées par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) ou d’autres acteurs internationaux[61].
Ces intermédiaires sont recrutés pour leur proximité avec les personnes migrantes ou aspirant à migrer, et pour « leur habilité à travailler […] dans une langue qu’ [elles] comprennent […], de la manière la plus adaptée culturellement, et en instaurant un climat de confiance ».
Mais bien loin de diffuser un message neutre, ils communiquent principalement sur les risques de la migration et mobilisent un registre affectif pour décourager leurs pairs de prendre la route de l’« aventure ». Dance cette large campagne de « découragement » des migrants irréguliers, certaines Organisations Non Gouvernementales (ONG) comme l’Organisation Internationale pour la Migration(OIM) sont impliquées. C’est le cas des programmes d’« Aide au retour volontaire et à la réintégration » de cette dernière depuis le Maroc.
RETOURS « VOLONTAIRES » DEPUIS LE MAROC
Les retours volontaires de l’OIM consistent à faciliter l’éloignement des étrangers jugés indésirables, mais se distinguent des expulsions classiques du fait qu’ils reposent en principe sur la volonté des migrants de rentrer dans leur pays d’origine.
Malgré leur essor significatif à l’échelle mondiale, ils demeurent controversés et leur caractère « volontaire » largement contesté, notamment parce qu’ils sont mis en œuvre dans des contextes de répression contre les migrations irrégulières et de restriction du droit d’asile qui laissent peu d’alternatives aux personnes migrantes[62].
Les premiers retours volontaires enregistrés par l’OIM depuis le Maroc sont organisés en 2005, à la suite des « événements de Ceuta et Melilla » au cours desquels des migrants décèdent aux frontières hispano-marocaines. Dans ce contexte, l’OIM signe en 2007 un mémorandum d’entente avec le ministère de l’Intérieur qui officialise la mise en œuvre de ces programmes à destination des migrants irréguliers présents sur le territoire marocain. Malgré des débuts instables, ils bénéficient de financements réguliers à partir de 2014 et l’adoption d’une nouvelle politique migratoire au Maroc.
Depuis, l’OIM organise en moyenne 1 480 retours par an, principalement vers la Guinée (Conakry), la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Mali et le Cameroun[63].
Si ces chiffres peuvent paraître modestes, comparativement aux 69 282 retours organisés par l’OIM à l’échelle mondiale en 2022 ou aux 15 097 départs annuels enregistrés depuis le Niger, les retours depuis le Maroc n’en suscitent pas moins une coopération remarquable. Sur le terrain, l’OIM est soutenue par des acteurs périphériques qui facilitent l’éloignement des migrants en informant ces derniers à propos des retours, et inversement, en référant les candidats au retour à l’OIM.
Contrairement à ce qui existe en Belgique, en Autriche et aux Pays-Bas, ces « conseillers au retour » n’interviennent pas formellement dans le cadre d’une procédure d’éloignement, mais informent les migrants à l’occasion d’activités d’assistance humanitaire (distributions, accueil, hébergement, sensibilisation…). Ils ne sont pas toujours directement employés par l’OIM, mais peuvent être affiliés à ses partenaires locaux (organisations humanitaires ou confessionnelles, associations locales), ou agir de leur propre initiative[64].
Parmi ces intermédiaires, on trouve des hommes et des femmes qui sont des membres des communautés migrantes installées au Maroc. Leur participation aux retours volontaires ne résulte pas uniquement d’une stratégie de l’OIM pour atteindre son public cible, mais découle plus largement de la division inégale du travail dans le secteur de la gestion des migrations[65].
DES « LEADERS COMMUNAUTAIRES » INDISPENSABLES
Dès 2010, une évaluation interne de l’OIM suggère de recourir à des « leaders communautaires » pour favoriser le « bouche-à-oreille » à propos du retour volontaire au sein des communautés migrantes. Ces leaders communautaires sont majoritairement des hommes, ressortissants d’Afrique subsaharienne installés de longue date au Maroc qui bénéficient d’une influence sur leurs compatriotes, notamment du fait de leur engagement dans des associations de défense des droits des migrants ou dans l’aide à la circulation irrégulière vers l’Europe. Dans un contexte de développement des projets européens destinés à la gestion des migrations, ils se sont progressivement imposés comme des interlocuteurs indispensables, non seulement à l’OIM, mais à l’ensemble des organisations impliquées dans le secteur.
Jusqu’en 2014, ces intermédiaires pairs demeurent cependant employés « au noir », puisqu’en séjour irrégulier au Maroc, ils ne bénéficient pas d’un contrat de travail. Cette situation change avec l’ouverture d’une campagne de régularisation à l’égard des migrants irréguliers. Durant cette campagne, les leaders communautaires employés comme intermédiaires bénéficient du soutien de leur hiérarchie pour accéder à des titres de séjour de manière prioritaire, certaines organisations allant même jusqu’à plaider directement en leur faveur auprès des autorités marocaines[66].
UNE EXPANSION DU SECTEUR DE L’INTERMEDIATION
Malgré des débuts laborieux, la campagne de régularisation bénéficie finalement à 23 096 personnes, soit 85,53 % des dossiers déposés. En parallèle, la « libéralisation » de la politique migratoire marocaine accroît encore le montant des financements européens et augmente le besoin d’intermédiaires pairs installés localement. Le secteur s’ouvre alors à la concurrence et des migrants régularisés – hommes et femmes – sont recrutés indépendamment de leur autorité préalable sur leurs compatriotes. Certains entament leur carrière de courtage de manière autonome avant d’accéder à un poste, comme en témoigne cet intermédiaire guinéen (Conakry) :
« Moi, avant d’être [agent communautaire] dans mon association, je voulais déjà régler le problème des migrants. J’ai commencé à emmener des gens à l’hôpital à mes propres frais. […] J’ai commencé à les accompagner, j’ai eu des contacts. Donc quand les projets sont arrivés, ils avaient besoin de moi, parce que j’avais déjà une expérience. » (Entretien, 2018).
Aujourd’hui, une pluralité de postes d’intermédiation « par les pairs » aux labels, statuts et affiliations diverses coexistent sur le terrain. On trouve des « éducateurs pairs », des « agents communautaires », des « agents de terrain », des « chargés d’accueil », ou encore des « médiateurs » qui – selon les organisations qui les emploient – sont salariés, agents contractuels (temporaires) ou bénévoles (non rémunérés).
Malgré la diversité des situations, les intermédiaires occupent généralement des emplois précaires, ce qui les pousse à chercher des sources de revenus complémentaires. Ils peuvent alors monnayer leurs services d’intermédiation auprès des migrants ou opérer comme des facilitateurs de leur circulation irrégulière vers l’Europe. Plus généralement, les intermédiaires alternent entre différents postes ou cumulent ces derniers, comme l’explique cet interlocuteur originaire de Guinée Bissau[67] :
« Je suis agent communautaire et « chargé d’accueil et d’orientation » pour [deux organisations]. Je suis aussi “éducateur pair” pour l’OIM. Avant, j’étais “agent communautaire” pour une [autre organisation]. Mais tout ça, c’est un peu la même chose. C’est une personne qui est l’intermédiaire entre le bureau et la communauté subsaharienne. » (Entretien, 2018).
Les intermédiaires pairs sont chargés de mettre en relation des mondes sociaux relativement distants. Ils s’illustrent à la fois par leur maîtrise des normes de la gestion des migrations, qu’ils assimilent lors des formations organisées par l’OIM, et par leur capacité à intégrer les espaces de sociabilité des communautés migrantes.
DES COMPETENCES « RACIALISEES »
Malgré l’absence de critères explicites, les intermédiaires pairs identifient clairement les compétences indispensables à leur recrutement. L’un d’entre eux explique :
Quand on parle de « pairs » […], c’est toujours des Subsahariens. Parce qu’il faut passer par quelqu’un de la communauté migrante pour […] transmettre le message […]. Une personne qui ressemble [aux migrants]. Quelqu’un en qui ils ont confiance. » (Entretien, 2018)
Cet interlocuteur utilise de manière indifférenciée les termes de « subsaharien » et de « migrant » pour décrire les intermédiaires pairs. Dans la même veine, un intermédiaire camerounais justifie son rôle dans le cadre des retours :
« Y a certaines personnes qui veulent pas aller directement à l’OIM […]. Parce qu’ils ont peur. […] Parce qu’il se dit, arrivé à OIM, tu toques, ce n’est pas ton frère subsaharien qui va te répondre. […] Donc il préfère passer par quelqu’un comme moi. […] Là il est rassuré. » (Entretien, 2018)[68].
D’après ces interlocuteurs, leur capacité à nouer une relation de confiance avec leur public cible repose avant tout sur leur identification comme des membres de la communauté « subsaharienne », au singulier. Ce référentiel efface les différences existantes entre les communautés migrantes et au sein de ces dernières. Il illustre le caractère homogénéisant des représentations des organisations internationales à l’égard de leurs bénéficiaires (et de leurs intermédiaires), mais fait aussi écho aux communautés d’itinérance transnationales qui ont émergé au Maroc face à un contrôle migratoire qui vise prioritairement les personnes identifiées comme noires africaines[69].
Contrairement à ce que suggère la citation de l’OIM reprise en début d’article, la « parité » des intermédiaires vis-à-vis de leur public cible va donc bien au-delà du partage d’une langue et d’une culture communes. Par conséquent, les intermédiaires pairs sont prioritairement recrutés pour des savoir-faire et des savoir-être présumés naturels du fait de leur appartenance à la communauté subsaharienne, et non pour des compétences acquises, d’ordre professionnel. Ce « ticket d’entrée » racialisé dans la gestion des migrations leur permet de convertir un stigmate en une ressource pour accéder à un emploi. Il les cantonne cependant à des postes subalternes qui impliquent un contact direct avec les migrants[70].
DES INTERMEDIAIRES INVISIBILISES
Comme dans les secteurs du développement ou de l’humanitaire, le travail des intermédiaires pairs dans la gestion des migrations est généralement peu valorisé. En particulier, les « éducateurs pairs » employés par l’OIM dans le cadre d’un « projet de promotion de la santé des migrants » ne sont pas rémunérés à proprement parler, mais simplement défrayés pour les frais engendrés par leur mission (transports, repas, téléphonie…). L’un d’entre eux, également salarié comme « agent communautaire » dans une association, décrit les revendications de ses collègues :
« L’OIM a 26 éducateurs pairs au Maroc. Eux, dans leur tête, ils sont formés par l’OIM, mais l’OIM ne donne pas de travail [pas de salaire]. Or, eux, ils veulent avoir des badges directs de l’OIM, des badges qui disent qu’ils sont éducateurs pairs au nom de l’OIM. Ce sont les revendications des éducateurs pairs. Au moins, qu’ils soient reconnus ! » (Entretien, 2018).
Ainsi, les points de vue de l’OIM et des éducateurs pairs divergent lorsqu’il s’agit de déterminer le statut de l’intermédiation. Les éducateurs pairs appréhendent leur intervention comme une forme de travail qui mérite à ce titre d’être reconnue et rémunérée. Cette revendication est d’autant plus légitime à leurs yeux qu’ils doivent rendre des comptes à l’OIM à l’issue de leurs activités, à propos des migrants assistés, des lieux visités, ou encore des sujets abordés au cours des sensibilisations[71].
Du point de vue de l’OIM, en revanche, l’intervention des éducateurs pairs est interprétée comme une forme d’engagement communautaire, ce qui l’exempte de les rémunérer et de les reconnaître comme des membres à part entière de son personnel. Mais ce n’est pas tout. Dans le cadre d’une pratique aussi controversée que les retours volontaires – qui sont régulièrement comparés à une forme d’expulsion – invisibiliser l’intervention des éducateurs pairs est également stratégique pour l’OIM, puisqu’elle se prémunit par là même contre les critiques relatives à son influence sur le choix des migrants[72].
Conformément à la technique de l’« unbranding », déjà largement utilisée dans les campagnes de sensibilisation, l’OIM occulte donc ses efforts de promotion des retours en direction des migrants, en invisibilisant – et de ce fait, en précarisant – le travail de ses intermédiaires pairs.
Le contrôle migratoire dans les pays du voisinage européen est donc non seulement générateur de frontières pour les étrangers jugés indésirables, mais également producteur d’inégalités pour les petites mains qui en assurent la mise en œuvre au quotidien[73].
QUELQUES PISTES DE SOLUTIONS
Les migrations peuvent contribuer pour beaucoup au développement, notamment par l’acquisition des connaissances, le transfert de technologie et la croissance socioéconomique des pays d’origine et de destination qu’elles favorisent. Ces possibilités qu’elles offrent en matière de développement ne peuvent cependant être pleinement exploitées que si la gouvernance des migrations s’améliore, notamment s’il existe des mécanismes visant à assurer le respect des droits fondamentaux, en l’occurrence les droits de l’homme des migrants, ainsi que des politiques appropriées relatives à la migration de main-d’œuvre et des politiques visant à encourager l’intégration sociale et économique des migrants et si les barrières restrictives sont baissées pour accroître les voies migratoires régulières.
La ratification et la mise en œuvre des normes internationales et des cadres régionaux en vigueur sont indispensables à la gouvernance des migrations. Ces normes et cadres intéressent les problèmes que posent les migrations et permettent aux sociétés d’origine et de destination de tirer parti des nombreuses possibilités que les migrations offrent en matière de développement. De plus, pour faire face aux moteurs des migrations africaines et aux problèmes qu’elles posent, il faut absolument prendre des mesures tendant à assurer l’élimination de la pauvreté, la création d’emplois, la bonne gouvernance ainsi que la paix et la sécurité, conformément aux cadres de développement en vigueur, en particulier le Programme 2030 et l’Agenda 2063[74].
Par ailleurs, il est fondamental de s’attaquer prioritairement aux causes profondes des migrations pour faire en sorte que celles-ci soient un choix et non une nécessité, en veillant à ce que les populations jouissent d’un véritable droit à la mobilité pour offrir à toute personne de réelles possibilités de choix dans la détermination du lieu où elle doit vivre, y compris le choix de ne pas migrer.
Pour ce faire, il est judicieux entre autres de :
- lutter contre les moteurs des migrations, intensifier les efforts d’élimination de la pauvreté, de création d’emplois et de bonne gouvernance. Mettre effectivement en œuvre les cadres de développement, en particulier le Programme 2030 et l’Agenda 2063, et s’acquitter des engagements pris dans le cadre du Programme d’action d’Addis-Abeba sur le financement du développement[75] ;
- Ériger en priorités la prévention des conflits et la consolidation de la paix ainsi que le lutte contre le terrorisme afin de réduire autant que possible les déplacements forcés ;
- empêcher les interventions politiques et militaires de forces extérieures en Afrique qui entraînent des migrations de grande ampleur liées aux conflits ; promouvoir davantage les mécanismes africains de maintien de la paix et de prévention des conflits, la résolution des conflits et les solutions durables aux problèmes des personnes déplacées ;
- Veiller à ce que les investissements nationaux et étrangers, les politiques économiques et les projets d’infrastructures ne dépossèdent pas les populations locales de leurs biens vitaux, tels que les terres, et de leurs moyens de subsistance, afin de prévenir leur déplacement ;
- Veiller à ce que les gouvernements fassent participer les populations locales à la planification du développement et dédommagent comme il se doit les populations vulnérables qui sont obligées de se déplacer à cause de projets tels que la construction de barrages et de routes ou de projets liés au développement de l’industrie et du secteur agro-industriel ainsi qu’au développement urbain ;
- Promouvoir la planification par anticipation en intégrant la réduction des risques de catastrophes et les systèmes d’alerte rapide en cas de conflit dans la planification nationale et tenir compte des migrants dans la planification et la gestion de la réduction des risques de catastrophes[76] ;
- Favoriser la coordination des méthodes employées pour faire face aux moteurs complexes des migrations en renforçant les mécanismes de coordination et en liant la planification de l’action humanitaire et la planification du développement ;
- Promouvoir la cohérence et la coordination sur les questions de migration entre les gouvernements nationaux et infranationaux, et donner des moyens d’action aux villes et aux autorités locales en les associant à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques car elles sont concernées au premier chef par les défis et les chances que présentent les migrations ;
- Promouvoir un dialogue largement ouvert entre les pays et d’autres acteurs importants sur les moyens de faciliter des migrations sûres et ordonnées ;
En outre, si la notion de « migrations sûres, ordonnées et régulières » est évoquée depuis un certain temps dans les discussions multilatérales, sa définition et sa pleine mise en œuvre sont, aujourd’hui plus que jamais, une priorité absolue pour la communauté internationale. Bien que les ODD, en promouvant le développement durable, aient ouvert la voie en mettant en relief les articulations entre une bonne gouvernance des migrations et des migrations sûres et ordonnées, une action plus concrète s’impose[77].
Des outils tels que le Cadre de gouvernance des migrations et l’IGM répondent au besoin de dialogue et de vision commune entre les parties prenantes sur les moyens à mettre en œuvre pour que les migrations soient plus sûres, plus ordonnées et plus régulières. A cet égard, l’élaboration du pacte mondial offre aux Etats une occasion clé d’élaborer une feuille de route concrète pour atteindre la cible 10.7 des ODD et toutes les autres cibles du Programme 2030 relatives à la migration, et, ce faisant, de contribuer à des migrations ordonnées et respectueuses de la dignité humaine, dans l’intérêt de tous les migrants et de toutes les sociétés.