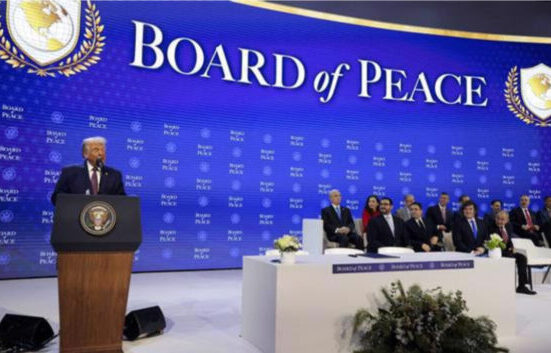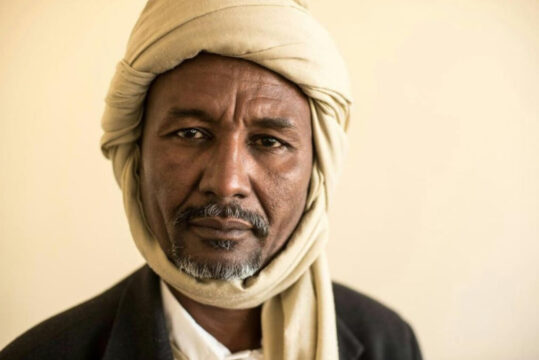Même si les perspectives économiques et financières mondiales évoluent vers la stabilité (Perspectives de l’économie mondiale, avril 2024), il faut, pour normaliser la politique budgétaire, toujours composer avec un niveau élevé de dette et de déficits hérité du passé, tout en affrontant de nouvelles difficultés. Après une nette réduction des déficits budgétaires et des niveaux de la dette publique en 2021–22, les agrégats budgétaires ont connu un revirement en 2023, qui a interrompu le processus de normalisation. Un rééquilibrage budgétaire durable est indispensable pour préserver la viabilité des finances publiques et reconstituer des marges de manoeuvre, dans un contexte où les perspectives de croissance à moyen terme ralentissent et les taux d’intérêt réels demeurent élevés. Un resserrement budgétaire permettrait également d’aborder plus aisément la « dernière ligne droite » de la désinflation, en particulier pour les économies en surchauffe.
Quatre ans après le début de la pandémie de COVID-19, les déficits budgétaires et l’endettement sont plus élevés par rapport aux prévisions établies avant la pandémie. La hausse des taux d’intérêt a accru les charges d’intérêt, tandis que les dépenses au titre des prestations sociales, des subventions et des transferts monétaires se sont accrues après l’extension des mesures d’aide adoptées en réponse à la pandémie et aux chocs liés aux prix de l’énergie. Bon nombre de pays ont lancé de nouvelles initiatives budgétaires pour réduire les impôts et les cotisations de sécurité sociale et augmenter les dépenses, par une hausse de la masse salariale et des prestations sociales et un recours à des mesures de politique industrielle. Ces initiatives n’ont été que partiellement compensées par les gains de recettes liés à l’inflation passée, lorsque les variations inattendues de l’inflation se sont estompées et que les tranches d’imposition ont été alignées sur la croissance des salaires. Pour la plupart des pays en développement à faible revenu, les financements restent limités et déterminent l’évolution de leurs soldes budgétaires.
En 2024, les déficits primaires globaux devraient se réduire à 4,9 % du PIB. Cependant, des risques substantiels continuent de peser sur les finances publiques et il faudra déployer des efforts considérables pour relancer la normalisation de la politique budgétaire face à des vents contraires. Les risques de dérapage budgétaire sont d’autant plus importants que 2024 est une « grande année électorale » : 88 pays ou zones économiques représentant plus de la moitié de la population et du PIB mondiaux ont déjà organisé ou organiseront des élections cette année. Depuis plusieurs décennies, le soutien à l’augmentation des dépenses publiques a pris de l’ampleur sur l’ensemble de l’échiquier politique, ce qui rend cette année particulièrement difficile, car les données empiriques montrent que la politique budgétaire a tendance à être plus souple et les dérapages plus importants lors des années électorales.
Malgré un recul de l’inflation, le temps nécessaire pour la ramener à l’objectif ciblé reste incertain. Les conditions de financement réagissent aux perspectives d’inflation, ainsi qu’aux taux d’intérêt et à l’évolution des politiques budgétaires dans les grandes puissances économiques. Le relâchement de la politique budgétaire et l’augmentation des niveaux d’endettement, conjugués au resserrement de la politique monétaire, ont contribué à la hausse des rendements des obligations publiques à long terme et à leur volatilité accrue aux États-Unis, ce qui accroît les risques dans les autres pays par les effets de contagion des taux d’intérêt. Le ralentissement de la croissance et les remous financiers en Chine pourraient peser sur la croissance et le commerce mondiaux et poser des problèmes budgétaires aux pays qui entretiennent des liens commerciaux et d’investissement étroits avec ce pays. Les États pourraient également se sentir poussés à prolonger le soutien budgétaire en cas de nouvelles perturbations de l’offre et de nouveaux chocs de prix. Enfin, les risques de refinancement de la dette restent élevés dans de nombreux pays. Sur la base des politiques actuelles, les agrégats budgétaires ne devraient connaître qu’une légère amélioration.
Les niveaux de déficit et d’endettement devraient rester plus élevés à moyen terme par rapport aux prévisions établies avant la pandémie. Faute de mesures budgétaires décisives, la normalisation de la politique budgétaire entamée après la crise sanitaire risque de rester inachevée dans les années à venir. La dette publique mondiale devrait frôler les 99 % du PIB d’ici 2029, tirée par la Chine et les États-Unis où la dette publique, compte tenu des politiques actuelles, devrait continuer à augmenter et dépasser ses niveaux records. Les pressions à la dépense pour faire face aux enjeux structurels, notamment les transitions démographique et écologique, s’intensifient. Parallèlement, le ralentissement des perspectives de croissance et la persistance de taux d’intérêt élevés risquent de restreindre encore l’espace budgétaire de la plupart des pays.
Un rééquilibrage budgétaire s’impose dans la plupart des pays pour améliorer la viabilité de la dette et la stabilité financière. Ce rééquilibrage devrait se faire à une cadence réfléchie, qui tienne compte à la fois des risques budgétaires et de la vigueur de la demande privée, mais des mesures immédiates sont nécessaires dans de nombreux cas, en particulier lorsque les risques souverains sont élevés et qu’il n’existe pas de cadre réaliste d’action à moyen terme. Il convient de mettre fin immédiatement aux mesures d’aide prises pendant la crise et de résister à l’influence du cycle électoral sur la politique budgétaire et à la pression pour augmenter encore les dépenses. Des réformes sont nécessaires pour contenir les pressions accrues sur les dépenses, telles que des réformes des prestations sociales dans les pays avancés où la population est vieillissante, ainsi que l’amélioration du ciblage et de l’efficacité des systèmes de protection sociale, afin de soutenir les couches les plus vulnérables de la population. Un dosage judicieux de mesures budgétaires, soutenant l’innovation dans les secteurs où les retombées sont les plus importantes et privilégiant le financement public de la recherche fondamentale, pourrait considérablement stimuler la croissance à long terme des pays situés à la frontière technologique (chapitre 2). Les recettes fiscales devraient évoluer de concert avec les dépenses. Les pays émergents et les pays en développement disposent d’une grande marge de manoeuvre pour augmenter leurs recettes fiscales par la modernisation des systèmes fiscaux, l’élargissement des bases d’imposition et le développement des capacités institutionnelles. L’accroissement des recettes fiscales pourrait également contribuer à financer les investissements publics stratégiques qui sont nécessaires à la diffusion des technologies vertes et numériques. Un cadre budgétaire réaliste et fondé sur le risque pourrait orienter le processus de reconstitution d’espace budgétaire et de réduction de la vulnérabilité de la dette. La coopération internationale doit être renforcée pour faire face aux multiples difficultés qui se profilent.
Accélérer l’amélioration de l’architecture mondiale de restructuration de la dette, notamment grâce au cadre commun du Groupe des Vingt et au renforcement du dispositif mondial de sécurité financière, pourrait aider les pays les plus vulnérables en situation de surendettement à rétablir la viabilité de leur dette. Il est essentiel de poursuivre la mobilisation sur les aspects techniques, notamment dans le cadre de la table ronde mondiale sur la dette souveraine. Une amélioration de la transparence des finances publiques et de la dette serait bénéfique pour le processus de restructuration de la dette. La coopération internationale en matière de fiscalité des entreprises et de tarification du carbone incitera à réaliser les investissements nécessaires et à mobiliser les ressources pour affronter des enjeux communs.
Repousser les frontières : des politiques budgétaires en faveur de l’innovation et de la diffusion des technologies
L’innovation, à savoir l’invention et l’introduction de produits et de processus inédits ou améliorés, est l’un des principaux moteurs de la croissance de la productivité et de l’amélioration du niveau de vie. Pourtant, malgré les progrès rapides des technologies numériques et de l’intelligence artificielle (IA), la productivité connait une baisse de rythme au cours des deux dernières décennies et les perspectives de croissance mondiale à moyen terme sont faibles. La vitesse d’innovation varie fortement d’un secteur à l’autre et repose de plus en plus sur la recherche appliquée, qui ne génère pas des externalités de connaissances à grande échelle. Par ailleurs, la diffusion de l’innovation entre pays et entre entreprises s’est ralentie, notamment en matière de technologies numériques ou à faible émission de carbone.
Les perspectives de croissance doivent absolument être améliorées dans un contexte marqué par une dette publique élevée, le vieillissement de la population, le changement climatique et d’importants écarts de convergence marqués entre les pays. Cependant, favoriser la croissance à long terme peut se révéler difficile dans un monde où les finances publiques sont plus restreintes. Cette édition du Moniteur des finances publiques montre que des politiques budgétaires judicieuses, qui stimulent l’innovation et la diffusion des technologies, peuvent accélérer la croissance de la productivité et de l’économie dans tous les pays.
Quand et comment orienter l’innovation vers des secteurs spécifiques ?
Les politiques industrielles qui orientent l’innovation vers des secteurs spécifiques, tels que les technologies « vertes » (à faible émission de carbone) et l’IA, connaissent un regain d’intérêt dans bon nombre de grandes puissances économiques, sur fond de préoccupations liées à la sécurité économique et nationale, et ce, souvent au prix d’une lourde charge budgétaire. L’histoire montre que les erreurs sont fréquentes en matière de politique industrielle. Même lorsque des projets transforment les industries, ils engendrent souvent des coûts budgétaires élevés et des répercussions négatives d’un pays sur l’autre.
Ce chapitre présente un nouveau cadre basé sur un modèle pour évaluer quand et comment le soutien budgétaire à l’innovation devrait être ciblé sur des secteurs spécifiques. La politique industrielle en faveur de l’innovation ne génère des gains de productivité et de bien-être que dans certaines conditions restrictives. Les secteurs ciblés doivent générer des avantages sociaux mesurables (tels que la réduction des émissions de carbone ou l’augmentation des externalités de connaissances vers d’autres secteurs), et la capacité de mise en oeuvre doit être forte. Les avantages sociaux de la politique industrielle peuvent facilement basculer si les subventions sont mal orientées (par exemple, vers des secteurs qui bénéficient de liens avec le monde politique) au lieu d’être motivées par le bien social. Les politiques discriminatoires à l’égard des entreprises étrangères peuvent s’avérer particulièrement autodestructrices, étant donné que les connaissances sont en grande partie importées, même dans les principaux pays avancés. Ces politiques peuvent en outre déclencher des mesures de rétorsion coûteuses.
L’intérêt de subventionner l’innovation dans le domaine de l’IA n’apparaît pas clairement, étant donné que cette technologie est déjà parvenue à la phase d’adoption commerciale. Il conviendrait de privilégier les technologies qui développent les capacités humaines et de faciliter l’adoption de l’IA dans les secteurs procurant le plus d’avantages sociaux.
Un dosage de politiques budgétaires favorable à l’innovation
Les pays avancés et les pays émergents devraient adopter un ensemble de mesures qui soutiennent l’innovation à plus grande échelle, à la frontière technologique mondiale, en particulier parce que la recherche fondamentale ayant un large spectre d’applications souffre d’un déficit de financement dans de nombreux pays. Cependant, il est important de disposer d’une panoplie de mesures efficaces en matière d’innovation, en particulier lorsque la marge de manoeuvre budgétaire est limitée. Ce chapitre décrit un dosage de mesures complémentaires et économiquement avantageuses, en mettant l’accent sur des éléments de conception. Ce dosage inclut le financement public de la recherche fondamentale, les subventions à la recherche et au développement (RD) pour les start-up innovantes, et les incitations fiscales à la RD pour encourager l’innovation appliquée au sein des entreprises. Une coopération étroite entre les secteurs public et privé peut créer des synergies positives et réduire le coût pour les finances publiques.
Les études montrent qu’un dosage judicieux de politiques d’innovation peut se traduire par une croissance et des dividendes budgétaires substantiels et augmenter le PIB à long terme de 3 à 4 dollars pour chaque dollar de coût budgétaire. Ainsi, une hausse du soutien à la RD de 0,5 point de pourcentage du PIB par an, soit environ 50 % du niveau actuel dans les pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques, pourrait accroître le PIB de 2 % et réduire le ratio dette/PIB d’un pays avancé moyen sur une période de huit ans. Cette approche pourrait convenir aux pays disposant d’une grande marge de manœuvre budgétaire, mais financer l’innovation peut s’avérer compliqué pour les pays qui sont aujourd’hui confrontés à des restrictions budgétaires.
Il est essentiel de concevoir et de cibler judicieusement les incitations fiscales pour les entreprises, et tout au long du cycle de vie de l’innovation, afin de limiter les coûts budgétaires et d’éviter que ces incitations ne soient accaparées par les grandes entreprises bien établies, ce qui risquerait de freiner l’innovation. Pour stimuler l’innovation, il est essentiel de mettre en place un système fiscal cohérent et simple, caractérisé par des assiettes larges et des taux peu élevés, et d’assurer une évaluation systématique. Des politiques structurelles, concurrentielles, commerciales et financières complémentaires doivent garantir des conditions de concurrence équitables, tirer profit de la coopération et fournir aux entreprises innovantes un accès adéquat au financement.
Faciliter la diffusion et l’adoption des technologies
Les pays qui se trouvent en deçà de la frontière technologique (principalement les pays émergents et les pays en développement) peuvent récolter des dividendes de productivité plus conséquents en privilégiant des politiques qui favorisent la diffusion de technologies développées ailleurs.
Des investissements publics stratégiques dans le capital humain et les infrastructures, en particulier dans les infrastructures et les compétences numériques, facilitent l’adoption transfrontalière de technologies. Dans les pays émergents et les pays en développement, une augmentation de 1 % des dépenses d’éducation pourrait accroître le PIB à moyen terme de 1,9 % en moyenne, en renforçant la diffusion des technologies. De même, pour un pays situé dans la moyenne des pays à faible revenu, rattraper un tiers de l’écart avec les pays émergents sur le plan de la qualité des infrastructures commerciales et de transport pourrait augmenter le PIB de 0,6 % à moyen terme. L’investissement et le financement publics constituent un moyen particulièrement efficace de surmonter les obstacles à la diffusion des technologies vertes, étant donné que de nombreuses technologies nécessaires à la réduction des émissions de carbone existent déjà.
L’investissement dans les compétences et les infrastructures numériques peut également accélérer la diffusion technologique des entreprises pionnières (à forte productivité) vers les entreprises à la traîne. Des incitations fiscales ciblées pour les mises à niveau technologiques (telles que des crédits d’impôt à l’investissement, sans incidence sur les recettes publiques, pour les entreprises qui se dotent de technologies d’avant-garde) peuvent accélérer la diffusion des technologies vertes et numériques et accroître ainsi la productivité globale.
Afin de pouvoir financer ces dépenses prioritaires et d’en récolter les dividendes pour la croissance, les pays doivent améliorer l’efficacité de leurs dépenses et moderniser leurs systèmes fiscaux. Une taxe sur la valeur ajoutée de portée générale, assortie d’un mécanisme de collecte simplifié pour le commerce des services, favorise la diffusion et peut contribuer à augmenter les recettes. Il serait également utile de réduire les incitations fiscales inefficaces pour les entreprises et de lutter concrètement contre l’évasion fiscale internationale des multinationales. Dans certains pays en développement, de telles mesures permettraient d’augmenter les recettes fiscales annuelles de 1 % du PIB. Le maintien et l’approfondissement de la collaboration internationale sont indispensables pour déployer tout le potentiel mondial d’innovation et accélérer la diffusion des technologies. Les pays les plus éloignés de la frontière technologique sont ceux qui pourraient le plus pâtir des mesures de repli sur soi, étant donné leur dépendance à l’égard des technologies étrangères. Il est primordial de coordonner les politiques d’innovation pour favoriser les externalités de connaissances transfrontalières, exploiter le potentiel des transformations écologiques et numériques en cours, et repousser les frontières pour tous.