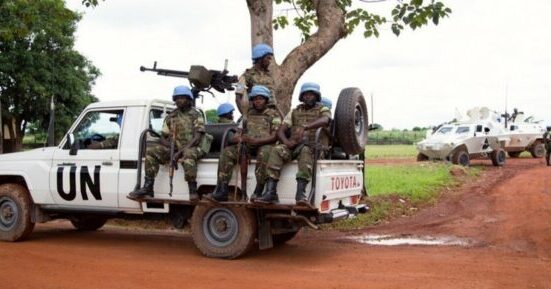L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) vient de publier un rapport sur les drogues dans le monde. Le constat fait par l’Onudc est alarmant. Car, les marchés des drogues illicites continuent de se développer, estime l’organisme. Ce dernier souligne que ce fait aggrave des crises mondiales et sape les efforts en matière de santé.
Le nouveau rapport de l’Onudc sur les marchés des drogues illicites lance une alerte. Car, « l’offre toujours record de drogues illicites et des réseaux de trafiquants de plus en plus agiles aggravent les crises mondiales et posent des défis aux services de santé et aux services de détection et de l’ordre, selon le Rapport mondial sur les drogues 2023. »
Selon de nouvelles données, fournies par l’Onudc, « le nombre de personnes qui s’injectent des drogues en 2021 est estimé à 13,2 millions, soit 18 % de plus que les estimations précédentes. Au niveau mondial, plus de 296 millions de personnes ont consommé des drogues en 2021, soit une augmentation de 23 % par rapport à la décennie précédente. Le nombre de personnes souffrant de troubles liés à la consommation de drogues est entretemps monté en flèche pour atteindre 39,5 millions, soit une augmentation de 45 % en dix ans. »
Le document de l’Onudc comporte un nouveau chapitre sur le trafic de drogues et les crimes qui affectent l’environnement dans le bassin amazonien, ainsi que des sections sur les essais cliniques impliquant des psychédéliques et l’usage médical du cannabis ; l’usage de drogues dans des contextes humanitaires ; les innovations en matière de traitement de la toxicomanie et d’autres services ; et les drogues et les conflits.
A noter aussi que Rapport mondial sur les drogues 2023 met également en évidence la manière dont les inégalités sociales et économiques alimentent – et sont alimentées par – les défis liés à la drogue, la dévastation de l’environnement et les violations des droits de l’homme causées par les économies de drogues illicites, ainsi que la domination croissante des drogues de synthèse.
Selon le rapport, la demande de traitement des troubles liés à la drogue reste largement insatisfaite. Seule une personne sur cinq souffrant de troubles liés à la drogue était en traitement pour usage de drogues en 2021, et les disparités d’accès au traitement s’accentuent d’une région à l’autre.
Les jeunes sont les plus vulnérables à la consommation de drogues et sont également plus gravement touchés par les troubles liés à la consommation de substances dans plusieurs régions. En Afrique, 70 % des personnes en traitement ont moins de 35 ans, alerte le document.
Selon le rapport, la santé publique, la prévention et l’accès aux services de traitement doivent être prioritaires dans le monde entier, faute de quoi les problèmes liés à la drogue feront de plus en plus de personnes délaissées. Le rapport souligne en outre la nécessité pour les services de l’ordre de d’adapter leur réponse aux modèles économiques des criminels et à la prolifération de drogues synthétiques peu chères et faciles à commercialiser.
Réagissant aux conclusions du rapport, la directrice exécutive de l’ONUDC Ghada Waly a déclaré : « Nous sommes témoins d’une augmentation continue du nombre de personnes souffrant de troubles liés à la consommation de drogues dans le monde, alors que les traitements ne parviennent pas à atteindre tous ceux qui en ont besoin. Pendant ce temps, nous devons intensifier la lutte contre les réseaux de trafiquants de drogue qui exploitent les conflits et les crises mondiales pour étendre la culture et la production de drogues illicites, en particulier de drogues synthétiques, alimentant ainsi les marchés illicites et causant un préjudice encore plus grand aux personnes et aux communautés ».
Disparités et inégalités liées à la drogue
A ce titre, l’Onudc estime que le droit à la santé n’est souvent pas accordé aux personnes qui consomment des drogues.
D’importantes inégalités persistent dans l’accès et la disponibilité des médicaments contrôlés à usage médical, en particulier pour le traitement de la douleur. Ces disparités sont particulièrement marquées entre le Nord et le Sud de la planète et entre les zones urbaines et rurales, de sorte que certaines personnes ressentent plus que d’autres l’impact négatif des drogues. Quelque 86 % de la population mondiale vit dans des pays où l’accès aux opioïdes pharmaceutiques (tels que contrôlés par la Convention unique de 1961) est insuffisant, principalement dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.
Selon l’Onudc, certaines populations pauvres et vulnérables, comme celles de la région des trois frontières entre le Brésil, la Colombie et le Pérou, sont piégées dans des zones rurales où la criminalité liée à la drogue est très répandue. En raison de leur éloignement, il leur est extrêmement difficile de bénéficier de services de traitement, de ressources ou de l’État de droit.
Selon le rapport, l’économie illicite de la drogue accélère les conflits, les violations des droits de l’Homme et la dévastation de l’environnement
L’Onudc a noté dans son rapport que l’économie de la drogue dans le bassin amazonien exacerbe d’autres activités criminelles – telles que l’exploitation forestière illégale, l’exploitation minière illégale, l’occupation illégale des terres, le trafic d’espèces sauvages et bien d’autres – qui endommagent la plus grande forêt tropicale du monde. Les peuples autochtones et d’autres minorités subissent les conséquences de cette convergence criminelle, notamment les déplacements, l’empoisonnement au mercure et l’exposition à la violence, entre autres. Les défenseurs de l’environnement sont parfois spécifiquement visés par les trafiquants et les groupes armés.
Alors que la guerre en Ukraine a déplacé les itinéraires traditionnels de la cocaïne et de l’héroïne, certains signes indiquent que le conflit pourrait déclencher une expansion de la fabrication et du trafic de drogues synthétiques, étant donné le savoir-faire existant et les vastes marchés de drogues synthétiques qui se développent dans la région.
A noter aussi qu’au Sahel, l’Onudc souligne que le commerce illicite de drogues finance des groupes armés et insurrectionnels non-étatiques, tandis qu’en Haïti, les trafiquants de drogues profitent de la porosité des frontières pour renforcer leurs activités, alimentant ainsi les crises qui se multiplient dans le pays.

Priorité à la santé publique dans la réglementation de l’usage médical des drogues contrôlées
A en croire l’Onudc sur son rapport, si les nouvelles recherches sur l’utilisation de drogues contrôlées sont prometteuses, telles que les psychédéliques pour traiter les troubles mentaux et les troubles liés à l’utilisation de substances, le rapport met en garde contre le fait que le rythme rapide des développements pourrait compromettre les efforts visant à adopter des politiques qui placent les préoccupations de santé publique au-dessus des intérêts commerciaux. En l’absence de cadres bien conçus et ayant fait l’objet de recherches adéquates, l’accès aux traitements
pourrait être insuffisant pour ceux qui en ont besoin – ce qui pourrait inciter les patients à se tourner vers les marchés illégaux – ou, à l’inverse, les psychédéliques pourraient être détournés à des fins non médicales.
Domination croissante des drogues de synthèse
La production peu chère, facile et rapide de drogues de synthèse a radicalement transformé de nombreux marchés de drogues illicites. Les criminels qui produisent de la méthamphétamine – la principale drogue de synthèse fabriquée illégalement dans le monde – tentent d’échapper aux mesures de répression et de réglementation en recourant à de nouvelles voies de synthèse, à de nouvelles bases d’opération et à des précurseurs non contrôlés.
Le fentanyl a radicalement modifié le marché des opioïdes en Amérique du Nord, avec des conséquences désastreuses. En 2021, la majorité des quelque 90 000 décès par overdose liés aux opioïdes en Amérique du Nord impliquaient des fentanyls fabriqués illégalement.
L’interdiction de la drogue en Afghanistan pourrait avoir inversé la tendance à la hausse de la production d’opium
La récolte d’opium de 2023 en Afghanistan pourrait connaître une baisse radicale à la suite de l’interdiction nationale de la drogue, les premiers rapports faisant état d’une réduction de la culture du pavot. Les avantages d’une éventuelle réduction significative de la culture illicite d’opium en Afghanistan en 2023 seraient mondiaux, mais elle se ferait aux dépens de nombreux agriculteurs du pays qui n’ont pas d’autres moyens de générer des revenus. L’Afghanistan est également un important producteur de méthamphétamines dans la région, et la baisse de la culture d’opiacés pourrait entraîner une réorientation vers la fabrication de drogues synthétiques, ce qui profiterait à différents acteurs.
Plus de 90 scénarios basés sur des données scientifiques sont accessibles via un portail web dédié, qui permet d’effectuer des recherches par région, par type de médicament et par sujet, proposant des centaines de graphiques et de cartes qui peuvent être visualisés et extraits.
Rokhaya KEBE
……………………………………………………………
CE QU’IL FAUT COMPRENDRE DU RAPPORT MONDIAL SUR LES DROGUES 2023
Alors que l’année 2023 marque la mi-parcours de la poursuite des objectifs de développement durable (ODD), le phénomène mondial de la drogue continue d’entraver la réalisation des cibles associées aux ODD ainsi que la promotion de la paix, de la sécurité et des droits humains.
Ainsi sur les messages clés véhiculés par le rapport on peut noter :
Les problèmes mondiaux liés à la drogue freinent la réalisation des ODD dans tous les domaines, qu’il s’agisse de la paix et de la justice, de la santé et des droits humains, ou de l’environnement et de l’égalité.
Il est nécessaire de renforcer la prévention ainsi que l’accès à des services de prise en charge du VIH et de l’hépatite et à des traitements fondés sur des données factuelles ; sinon, le nombre de personnes laissées de côté face aux problèmes liés à la drogue augmentera.
Les services de détection et de répression doivent s’adapter à l’extrême souplesse qui caractérise les modèles économiques de la criminalité, ainsi qu’à la prolifération de drogues de synthèse bon marché et faciles à commercialiser.
La santé publique doit rester la priorité alors que la réglementation relative au contrôle des drogues évolue rapidement, notamment en ce qui concerne l’usage médical, et les pays doivent investir davantage dans la recherche afin de suivre les effets des politiques menées et de prendre des décisions éclairées.
Inégalités, disparités, santé publique et droits humains
Selon l’Onudc, ls inégalités et les disparités sociales et économiques continuent d’alimenter le phénomène de la drogue, qui les alimente en retour. Elles font ainsi peser une menace sur la santé publique et les droits humains. Les disparités entre pays du Nord et pays du Sud, entre milieux urbains et milieux ruraux, et entre groupes de population contribuent toutes aux dommages causés par les drogues.
- Des disparités subsistent en termes d’accessibilité et de disponibilité des médicamentsplacés sous contrôle en vertu de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961. Ainsi, en 2021, 86 % de la population mondiale vivait dans des pays où la disponibilité des opioïdes pharmaceutiques à usage médical était inférieure à la moyenne mondiale.
- Les troubles liés à l’usage de drogues et les problèmes de santé mentalesont étroitement liés : les problèmes de santé mentale augmentent le risque de troubles liés à l’usage de drogues, tandis que les drogues risquent d’exacerber les problèmes de santé mentale si elles sont prises hors contrôle médical. Alors qu’une personne sur huit dans le monde vivrait avec un problème de santé mentale diagnostiqué, il devient de plus en plus important de tenir compte des questions de santé mentale dans la prévention et le traitement de l’usage de drogues.
- Les jeunesrestent le groupe le plus susceptible de faire usage de drogues. En 2021, au niveau mondial, la prévalence annuelle de l’usage de cannabis chez les jeunes de 15 et 16 ans était de 5,34 %, contre 4,3 % chez les adultes. En outre, la consommation de drogues est particulièrement nocive pour les jeunes. Dans certaines régions, ceux-ci sont plus gravement touchés par les troubles liés à l’usage de substances : en Afrique, 70 % des personnes traitées pour usage de drogues ont moins de 35 ans.
- L’offre de traitement des troubles liés à l’usage de drogues est toujours loin de répondre à la demande, et des disparités persistent en matière d’accès. Au niveau mondial, environ une personne sur cinq souffrant de troubles de cette nature a reçu un traitement en 2021, mais il existe de grandes disparités tant entre les régions qu’en ce qui concerne le type et la qualité des traitements. Les différentes formes de traitement ne respectent pas toutes les droits humains et ne sont pas toutes fondées sur des données factuelles. Les femmes se heurtent à des obstacles dans l’accès aux services de traitement : en 2021, 45 % des personnes qui avaient fait usage de stimulants de type amphétamine au cours de l’année écoulée étaient des femmes, mais celles-ci ne représentaient que 27 % des personnes bénéficiant d’un traitement. Globalement, c’est en Asie et en Afrique que la part des femmes parmi les personnes traitées pour usage de drogues est la plus faible, et c’est dans les sous-régions de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande ainsi que de l’Amérique du Nord qu’elle est la plus élevée.
- Les difficultés rencontrées sur le plan de la fourniture de services pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19)ont privé certaines personnes d’accès aux traitements et à d’autres services. Dans la plupart des pays ayant communiqué à l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) des données globales sur la fourniture de traitements avant et après la pandémie, on observe une baisse du nombre de personnes prises en charge pour usage de drogues entre les périodes 2018-2019 et 2020-2021, ainsi qu’au cours de la période 2020-2021.
- Les inégalités existant dans l’offre de traitementsont accentuées par la diversité des pratiques d’usage de drogues et l’accès inégal aux services. Bien que les innovations introduites pendant la pandémie en matière de fourniture de services semblent avoir eu de premiers effets positifs, des problèmes subsistent en raison de la fracture numérique, en particulier dans certaines zones géographiques et certains groupes marginalisés difficiles à toucher, y compris les sans-abri et les personnes qui pratiquent l’injection. D’autres groupes marginalisés, comme les personnes ayant des antécédents d’incarcération, les personnes déplacées dans des situations d’urgence humanitaire et les personnes travaillant dans l’industrie du sexe, rencontrent d’autres obstacles. En outre, les groupes marginalisés font parfois un usage de drogues plus intensif, ce qui les rend plus susceptibles de subir des dommages permanents, de rechuter ou de connaître d’autres problèmes de santé connexes. Par exemple, en 2020, le risque de contracter le VIH était 35 fois plus élevé chez les personnes pratiquant l’injection que chez les autres usagères et usagers de drogues. Parmi les personnes qui s’injectent des drogues, les femmes ont 1,2 fois plus de risque que les hommes de vivre avec le VIH.
- On observe également des différences entre milieux urbains et milieux ruraux. Par exemple, dans certaines zones rurales, le trafic de drogues illicites et la culture de plantes servant à en fabriquer favorisent la commission d’autres infractions, notamment de crimes portant atteinte à l’environnement, et les populations pauvres et vulnérables sont prises dans un cercle vicieux, l’accès aux ressources et l’état de droit devenant pour elles incertains. Ainsi, aux confins du Brésil, de la Colombie et du Pérou, dans le bassin amazonien, les organisations qui se livrent au trafic de drogues attentent de plus en plus aux droits humains, à la sécurité et au bien-être des populations rurales.
Mesures envisageables par l’Onudc
Afin de réduire au minimum les conséquences néfastes de l’usage de drogues sur la santé publique et la société, il est essentiel de réduire les inégalités et les disparités d’accès aux traitements et à des services complets, dans le cadre d’un continuum de soins, pour les personnes faisant usage de drogues, en particulier pour les groupes vulnérables et marginalisés.
Ainsi, il est envisagé : Des initiatives à grande échelle visant à prévenir l’usage de drogues en milieu scolaire, dans le cadre familial et au niveau des collectivités sont nécessaires pour réduire le risque que les troubles liés à cet usage n’augmentent, compte tenu en particulier de la prévalence élevée des problèmes de santé mentale constatée aujourd’hui. Les groupes socioéconomiques supérieurs se montrent plus enclins à entamer une consommation de drogues que les groupes socioéconomiques inférieurs, mais ce sont ces derniers qui paient le prix le plus fort, car ils présentent un plus grand risque de souffrir de troubles liés à cette consommation.
Aussi, selon l’Onudc, pour être efficace, l’approche suivie en matière de traitement doit reposer sur le volontariat et les droits humains. Alors que le phénomène de la drogue continue d’évoluer, les États Membres devront redoubler d’efforts pour assurer l’accès à des services de qualité dont il est avéré qu’ils réduisent les troubles liés à l’usage de drogues, tant au niveau mondial que national, et dans tous les groupes de population.
Par ailleurs, l’Onudc estime que le fait de réduire la stigmatisation des personnes faisant usage de drogues rendra plus accessibles et plus efficaces les traitements et les interventions dont elles ont besoin. Des avancées ont eu lieu pendant la pandémie pour ce qui est de réduire les obstacles à l’accès aux services, ouvrant des perspectives prometteuses pour attirer et retenir patientes et patients.
| − | Étant donné que certains groupes de population faisant un usage de drogues particulièrement intensif subissent des dommages disproportionnés et n’ont que très peu accès aux services, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour concevoir et mettre en œuvre des politiques et des programmes répondant aux besoins particuliers de ces groupes. Il importe d’adapter les programmes aux personnes sans-abri, à celles qui travaillent dans l’industrie du sexe ou qui souffrent de traumatismes, ainsi qu’à d’autres personnes rencontrant des obstacles pour accéder aux services, y compris celles qui présentent des comorbidités supplémentaires liées à la santé mentale, celles qui sont incarcérées ou qui l’ont été, et les femmes enceintes. |
| − | Il importe de mieux prendre en compte les questions de santé mentale dans la prévention et le traitement de l’usage de drogues. Les recherches scientifiques et les essais cliniques menés actuellement sur les substances psychédéliques montrent que certains problèmes de santé mentale peuvent être traités à l’aide de ces substances, mais un contrôle médical est indispensable pour en garantir les bienfaits et en limiter les dommages. |
| − | Alors que les personnes déplacées n’ont jamais été aussi nombreuses, il importe d’investir beaucoup plus dans les initiatives visant à prévenir l’usage de drogues ainsi que dans les traitements et les services destinés à sa prise en charge, afin d’en réduire au minimum les conséquences néfastes sur la santé publique et la société, dans le cadre d’un continuum de soins en contexte humanitaire. |
| − | Des engagements politiques et financiers doivent être pris pour déployer à plus grande échelle des interventions ciblant les |
inégalités structurelles et économiques, les normes socioculturelles néfastes ainsi que les inégalités et la violence fondées sur le genre, qui nourrissent les épidémies de VIH et d’hépatite touchant les personnes qui font usage de drogues.
Économie illicite de la drogue, criminalité connexe, déplacements de population et conflits
L’économie illicite de la drogue, la criminalité qui y est liée, les déplacements de population et les conflits accélèrent la dévastation de l’environnement et causent une dégradation de la situation en matière de droits humains, en particulier pour les groupes vulnérables.
- Le trafic de drogues aggrave les menaces de type criminel qui touchent les communautés vulnérables en portant atteinte à leur droit à la sécurité et à des moyens de subsistance, ainsi qu’à leur droit, reconnu par l’Assemblée générale dans sa résolution 76/300 de 2022, à vivre dans un environnement propre, sain et durable :
- Dans le bassin amazonien, le trafic et la production de drogues vont de pair avec des activités illégales ou non réglementées qui ont des effets néfastes sur l’environnement et la société, et financent même parfois ces activités. Celles-ci incluent, dans certaines zones d’Amazonie, l’occupation des terres et la mise en pacage illégales, l’exploitation forestière illégale, l’extraction minière illégale, le trafic d’espèces sauvages et d’autres crimes qui portent atteinte à l’environnement ;
- Dans le bassin amazonien, les peuples autochtoneset d’autres communautés locales sont les victimes collatérales de la criminalité, subissant déplacements, intoxications au mercure et autres graves problèmes de santé, ainsi qu’une exposition accrue à la violence et à la victimisation.
- Les problèmes liés à la drogue font peser des menaces plus graves dans le contexte des conflits et des déplacements de population, où ils se conjuguent au ralentissement économique, à l’inflation et à d’autres phénomènes de crise. Au cours du premier semestre de 2022, plus de 100 millions de personnes ont été déplacées de force dans le monde, ce qui constitue un record :
- Il est devenu plus difficile de prévenir et de traiter les troubles liés à l’usage de drogues chez les personnes déplacées. En outre, les populations déplacées de force font partie des groupes marginalisés qui souffrent de traumatismes physiques et psychologiques et d’une grande vulnérabilité socioéconomique, ce qui leur fait courir un risque accru de problèmes de santé mentale et de troubles liés à l’usage de substances ;
- Du côté de l’offre, la possibilité qu’il y ait production et trafic de drogues favorise des cycles d’instabilité dans les zones touchées par des conflits. Le conflit armé qui a cours en Ukraine a entraîné un déplacement des itinéraires de trafic d’héroïne et de cocaïne, mais l’on voit poindre la menace d’une augmentation de la fabrication et du trafic de drogues synthétiques. Au Sahel, le commerce illicite de drogues finance les groupes insurgés et les groupes armés non étatiques, qui prélèvent des « impôts » en échange d’une protection. En Haïti, les trafiquants de cocaïne et de cannabis profitent de la porosité des frontières, des groupes criminels lourdement armés prenant pour cible les ports, les autoroutes et les infrastructures critiques.
Mesures envisageables :
Au vu des dommages causés à l’environnement et aux communautés isolées et vulnérables, il est nécessaire de prendre des mesures plus intégrées, aux niveaux local et national, face à l’économie illicite de la drogue.
| − | La nécessité de protéger les environnements fragiles qui sont utilisés ou exploités par les trafiquants de drogues et d’autres criminels complique encore la situation et appelle la conduite d’efforts intégrés pour s’attaquer aux problèmes liés à la drogue et à l’environnement que rencontrent les États Membres, en particulier ceux situés dans le bassin amazonien et d’autres dont le territoire abrite d’importants écosystèmes menacés. |
| − | Il convient de mener des interventions adaptées au sein même des communautés locales et autochtones afin de protéger leur droit à la santé et à un environnement propre, sain et durable, conformément à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, tout en répondant à leurs besoins et en leur offrant des solutions de substitution viables à l’économie illicite. |
| − | Des ressources et des stratégies supplémentaires sont nécessaires pour mettre fin au cycle de l’instabilité et aux entraves à l’état de droit qui permettent aux trafiquants de drogues et à d’autres criminels de prendre en étau des populations et des régions vulnérables. |
| − | Il faut apporter aux pays fragiles et en conflit, comme l’Ukraine et Haïti, un suivi et un soutien permanents pour éviter que les économies illicites de la drogue qui se forment ou se développent ne nourrissent les conflits et l’instabilité ou ne freinent le redressement. |
Drogues synthétiques et innovations dans l’offre de drogues d’origine végétale
Les drogues synthétiques et les innovations dans la fabrication et le trafic de drogues illégales compliquent la réponse de la justice.
- Les marchés des drogues illégales évoluent rapidement et, dans certaines régions, de manière radicale. Les drogues synthétiques y occupent une place de plus en plus importante ; elles sont peu chères, faciles et rapides à fabriquer. Comme elles ne dépendent pas de cultures géographiquement fixes mais reposent sur l’emploi d’une large gamme de précurseurs, il est possible de rapprocher l’offre des marchés de consommation et de remplacer rapidement les produits saisis, ce qui met à mal l’action de détection et de répression :
- Au niveau mondial, la méthamphétamine est la principale drogue synthétique fabriquée illégalement, et les groupes criminels emploient des techniques de synthèse innovantes, établissent de nouvelles bases d’opération et utilisent des précurseurs non soumis à contrôle pour contourner l’action de détection et de répression ainsi que la réglementation ;
- Le fentanyl, puissant opioïde synthétique, entraîne une mutation des marchés de la drogue en Amérique du Nord et contribue au nombre élevé de surdoses parmi les personnes faisant usage de drogues. En 2021, près de 90 000 décès par surdose liés aux opioïdes ont été enregistrés dans la sous-région, dont la majorité faisaient intervenir des fentanyls fabriqués illégalement.
- Après plusieurs années de relative stabilité, tant le nombre des saisies de nouvelles substances psychoactives (NSP) d’origine synthétique que les quantités saisiesont augmenté en 2021, pour atteindre 19 tonnes selon les signalements, ce qui représente une hausse de 40 % par rapport à l’année précédente. Les données préliminaires font état de 1 184 NSP identifiées et surveillées par les autorités.
- La disponibilité des précurseurs chimiques et l’utilisation de plateformes de communication en ligne réduisent les obstacles à l’entrée pour les groupes criminels, rendant la fabrication illégale de drogues plus aisée, plus modulaire et plus axée sur la technologie. Comme il est facile de se renseigner en ligne sur les procédés de fabrication de drogues synthétiques, les activités de synthèse sont de plus en plus répandues :
- L’analyse des transactions réalisées sur le darknet tend à indiquer un mouvement vers la distribution en gros, tandis que les transactions au détail se multiplient apparemment sur les plateformes de médias sociaux. Un examen des transactions enregistrées sur les chaînes de blocs donne à penser que la valeur moyenne des transactions réalisées sur les places de marché du darknet est passée d’une centaine de dollars en 2018 à 500 dollars environ en 2021 et que, dans le même temps, le nombre global d’acheteurs actifs et de transactions a nettement diminué ;
- Selon ce qui ressort des déclarations des personnes faisant usage de drogues, l’achat de cannabis, de cocaïne et d’« ecstasy » en particulier se déplacerait vers les plateformes de médias sociaux, tandis que l’achat et la vente de NSP se ferait toujours principalement sur les forums du darknet.
- La fragmentation des chaînes d’approvisionnement et la constitution de groupes criminels aux liens distendus favorisent l’expansion de l’offre de drogues, notamment de cocaïne, avec l’apparition de nouvelles plaques tournantes et de nouveaux marchés, et une augmentation de l’usage sur les marchés traditionnels. Les groupes se livrant au trafic, moins rigides et hiérarchisés, sont plus innovants et capables de s’adapter. Les changements intervenus dans la manière dont les groupes criminels s’organisent ou opèrent sont susceptibles de les protéger des interventions de détection et de répression traditionnelles, étant donné que différents éléments de la chaîne d’approvisionnement ou du produit peuvent être remplacés.
- D’après les données les plus récentes, la culture illicite du cocaïer et du pavot à opium atteindrait des niveaux pratiquement sans précédent, mais l’interdiction décrétée en Afghanistan pourrait avoir une incidence sur la récolte d’opium en 2023, ce qui accroîtrait la nécessité de mener des activités de développement alternatif. La production mondiale d’opium est restée élevée en 2022, à 7 800 tonnes, du fait en premier lieu des grandes quantités produites en Afghanistan. La dynamique du deuxième marché mondial de la cocaïne, à savoir l’Europe occidentale, et l’efficacité accrue de la production de cocaïne à la source se sont traduites par un niveau record de fabrication, à 2 300 tonnes, en 2021.
Mesures envisageables :
La constante évolution des stratégies et tactiques auxquelles recourent les groupes criminels et trafiquants, qui délaissent les procédés et modes de production traditionnels, appelle des stratégies de détection et de répression plus ciblées et plus stratégiques.
| − | Les groupes qui se livrent au trafic de drogues étant de plus en plus fragmentés et ne gérant que certaines parties de la chaîne d’approvisionnement, les opérations de détection et de répression doivent, pour porter leurs fruits, cibler l’écosystème plus vaste des marchés illicites plutôt que des cellules ou des cargaisons isolées. Cela nécessite de procéder à une analyse opérationnelle complexe et d’instaurer un climat de confiance au sein des services nationaux de détection et de répression et entre eux, de sorte à favoriser l’échange de renseignements et, au besoin, une coopération rapide et sans heurts aux échelles nationale et internationale. |
| − | Vu que le trafic de drogues par cours d’eau et par mer au moyen de cargaisons conteneurisées augmente, les ports restent d’importants carrefours où les substances passent clandestinement les frontières, ce qui justifie un contrôle plus efficace des points d’étranglement potentiels. |
| − | L’expansion incessante de la fabrication de drogues synthétiques à de nouvelles régions et à de nouveaux procédés exige des efforts redoublés pour surveiller l’évolution des marchés et réagir par des politiques plus ciblées, qui visent à réduire l’accès aux précurseurs chimiques et l’approvisionnement en ligne. |
| − | L’interception de drogues risque d’avoir de moins en moins d’effet sur l’offre, car les groupes criminels ont les moyens de remplacer facilement et à moindre coût les produits saisis. Le rôle joué par les services de détection et de répression s’agissant d’évaluer la qualité et le type de drogues vendues sur les marchés est donc de plus en plus important pour mieux comprendre, d’une part, la manière dont les fournisseurs ajustent leurs stratégies et, d’autre part, les risques encourus par les personnes qui font usage de drogues. |
| − | Il est essentiel de se concentrer sur l’accès aux produits chimiques, notamment par une surveillance accrue des grandes entreprises et une lutte plus efficace contre la corruption, pour réduire l’offre d’intrants nécessaires à la fabrication de drogues synthétiques. |
| − | Le développement alternatif reste un pilier fondamental des politiques de réduction de l’offre pour les cultivateurs d’Afghanistan, de Bolivie (État plurinational de), de Colombie, du Myanmar, du Pérou, de République démocratique populaire lao et d’autres pays où sont pratiquées des cultures illicites, en ce qu’il procure des moyens de subsistance durables en dehors de l’économie de la drogue. |
| − | Une éventuelle réduction drastique de la culture illicite du pavot à opium en Afghanistan en 2023 aurait des retombées positives à l’échelle mondiale, aux dépens toutefois de nombreux cultivateurs du pays qui ne disposent d’aucune autre source de revenus. Le principe de responsabilité partagée veut que les donateurs, en particulier ceux qui bénéficieront le plus d’un recul du trafic d’héroïne afghane, apportent d’urgence leur aide aux populations rurales d’Afghanistan pour qu’elles trouvent des moyens de subsistance autres que la culture illicite du pavot. |

Cadres relatifs à l’usage médical des substances soumises à contrôle
De nouveaux travaux de recherche montrent que des substances soumises à contrôle pourraient permettre de traiter des problèmes de santé mentale, mais les autorités de réglementation risquent de faire plus de mal que de bien si elles sacrifient la santé publique aux intérêts commerciaux.
- Des essais cliniques dans le cadre desquels des substances psychédéliques sont employées pour traiter des problèmes de santé mentale et des troubles liés à l’usage de substances sont réalisés dans certains pays à un rythme sans précédent, faisant naître l’espoir que ces composés puissent être efficaces pour prendre en charge certaines affections psychologiques résistant aux traitements. Cependant, du fait de la rapidité avec laquelle les choses évoluent, les gens, en particulier les jeunes, sont encore plus susceptibles de percevoir ces substances comme « sûres » ou non nocives, quel que soit le contexte, ce qui pourrait favoriser un usage non supervisé, hors cadre médical.
- Donner la priorité aux questions de santé publique reste un défi face à l’intérêt commercial croissant que suscitent le développement de nouveaux marchés légaux de la drogue et les profits qui peuvent en être tirés. Si les cadres relatifs à l’usage médical ne sont pas judicieusement conçus et s’ils ne bénéficient pas de ressources suffisantes, de sorte que la disponibilité et l’accessibilité des substances destinées à des fins médicales soient assurées, les approches suivies pourraient contribuer à l’apparition de marchés illicites découlant d’une offre limitée ou du détournement de traitements à des fins non médicales.
- Les approches adoptées pour réglementer l’usage médical du cannabis sont diverses. Les choix faits par les autorités de réglementation au moment de définir un marché médical déterminent la porosité de celui-ci. Quels types de produits sont autorisés, qui peut produire pour le marché et qui peut prendre du cannabis pour quelle affection : ces importantes décisions peuvent délimiter la taille et la portée d’un régime du cannabis médical.
- Les approches réglementaires peuvent être conçues de telle sorte qu’elles garantissent une disponibilité suffisante de produits à l’innocuité et à l’efficacité prouvées, tout en restreignant l’accès aux seuls cas où il existe un besoin médical légitime. Elles peuvent aussi limiter le risque que ces produits ne se retrouvent sur un marché de substances destinées à un usage non médical ou récréatif.
Mesures envisageables :
Lorsque les pays envisagent d’élargir l’accès aux substances psychoactives pour une gamme plus étendue de traitements, une réglementation bien pensée peut contribuer à limiter les détournements, à affaiblir les marchés illicites et à réduire les dommages pour la santé publique.
− De plus en plus d’éléments indiquent que, selon sa nature, la réglementation de l’accès au cannabis à des fins médicales donne des résultats divers.
− Les politiques visant à contrôler le type de produit vendu pour des affections spécifiques semblent plus efficaces pour limiter l’accès à des fins non médicales ou récréatives que celles qui prennent en compte les intérêts commerciaux.
− À mesure que la recherche sur les substances psychédéliques progressera, les réglementations et politiques relatives au bon usage des nouveaux traitements joueront un rôle important pour ce qui est de prévenir les effets indésirables que sont l’usage non supervisé ou les détournements.
Synthèse de Rokhaya KEBE