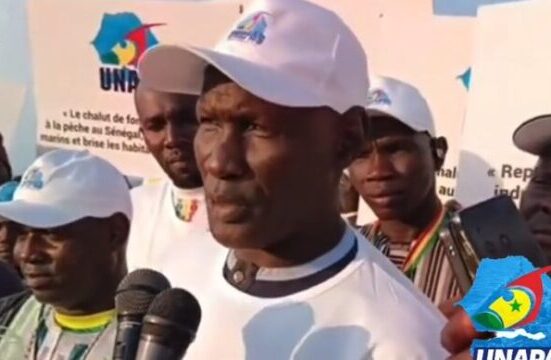La carté diplomatique marocaine s’est élargie ces dernières années. Aujourd’hui, il est quasiment impossible de parler de géopolitique en Afrique du Nord sans re référer au Maroc. Le royaume chérifien joue notamment une influence positive sur presque tous les plans dans les autres pays de l’Afrique, notamment dans la zone subsaharienne. Au-delà du continent africain, le Maroc fait aussi parler de lui au niveau international. C’est dans ce cadre que l’Institut d’études de géopolitiqueappliquée (IGA) a publié une étude intitulée « Le Maroc : les contours d’une nouvelle puissance ». Ledit document dont DakarTimes vous propose une synthèse de ce document qui a été réalisé par une équipe de chercheurs et d’experts qui ont abordé les principaux axes de la diplomatie et géopolitique marocaines.
RETOUR SUR LA POLITIQUE AFRICAINE DU MAROC
Compte tenu de sa forte croissance et surtout de ses ressources énergétiques, minières et naturelles, qui s’ajoutent à son immense marché potentiel, l’Afrique est convoitée et elle est devenue un espace de compétition entre les puissances classiques et les puissances émergentes. L’intensification des rencontres et des sommets autour de l’Afrique traduit d’une part l’intérêt et le poids que représente le continent africain dans la géopolitique mondiale et, d’autre part, la diversification des stratégies et politiques étrangères à l’égard de l’Afrique. Pays arabe, africain et du sud, le Maroc entretient depuis plusieurs siècles des relations avec les peuples et les pays d’Afrique subsaharienne. D’ailleurs, le royaume du Maroc est l’un des bâtisseurs de l’unité africaine dans le sens où il a abrité en janvier 1961 la conférence de Casablanca. Outre l’appui solidaire du Maroc à la lutte de libération des pays africains et les liens historiques, culturels mais également religieux, l’association entre le Maroc et les pays du continent africain s’appuie sur un partenariat économique, politique et stratégique qui ne cesse de prendre de l’ampleur. La dimension africaine du Maroc, ses liens solides avec les pays du continent ainsi que son positionnement géographique, pont entre l’Afrique et l’Europe, constituent de véritables atouts pour le pays. Dans ce contexte, une analyse profonde de la politique africaine du Maroc s’impose. L’objectif est de déterminer ses fondements, ses traits saillants, ses caractéristiques et ses perspectives notamment après le retour du Maroc au sein de l’Union africaine. L’Afrique subsaharienne : un axe stratégique de la politique étrangère du Maroc L’Afrique est au centre de la politique étrangère du Maroc. C’est pourquoi, malgré le retrait du royaume Maroc de l’Organisation de l’Unité africaine (OUA)19, e pays a pu développer depuis une dizaine d’années une véritable stratégie à destination du continent. L’Afrique subsaharienne constitue une priorité pour le Maroc depuis les années 2000. Outre les relations personnelles nouées par Hassan II avec de nombreux chefs d’État, le Roi Mohammed VI fait de l’Afrique une priorité de sa politique extérieure. Plusieurs signes forts peuvent être détectés durant ces dernières décennies et ainsi témoigner de la place grandissante de l’Afrique subsaharienne dans la politique étrangère marocaine. D’une part, l’annulation de la dette des pays africains les moins avancés (PMA) mais également l’exonération de taxes douanières à l’entrée du Maroc ont constitué les prémices d’une action diplomatique marocaine renforcée en faveur des pays de la région. D’autre part, la consécration dans la Constitution marocaine de la coopération avec les pays d’Afrique subsaharienne affirme le retour en force du Maroc sur la scène africaine. C’est ainsi que le préambule de la Constitution souligne que le Maroc s’engage à « consolider les relations de coopération et de solidarité avec les peuples et les pays d’Afrique, notamment les pays du Sahel et du Sahara » et à « renforcer la coopération Sud-Sud ». Il est ajouté que l’unité marocaine s’est nourrie et enrichie de « ses affluents africain, andalou, hébraïque et méditerranéen ». En réalité, face à la rivalité des puissances classiques et des puissances émergentes sur les marchés africains, le Maroc ne peut rester en dehors du jeu. Sa dimension africaine d’une part et ses relations historiques et ancestrales avec les différents pays du continent d’autre part lui permettent de jouer un rôle considérable et de contribuer efficacement au développement du continent. De même, les différentes transformations véhiculées par la mondialisation sur le plan régional et international exigent une réelle mobilisation du Maroc, afin de consolider son positionnement et renforcer sa place en Afrique. Par ailleurs, depuis 1999 jusqu’au la fin de l’année 2017, le Souverain a effectué cinquante-trois visites dans vingt-sept pays africains. Outre les alliés traditionnels du Maroc, « le Roi s’est rendu pour la première fois dans huit pays dont quatre en Afrique de l’Est (Éthiopie, Tanzanie, Rwanda, Soudan du Sud), deux en Afrique australe (Madagascar et Zambie) et deux en Afrique de l’Ouest (Nigeria et Ghana) » 20 . Les visites et les déplacements royaux en Afrique inaugurent une nouvelle ère dans la coopération maroco-africaine et visent à consolider une coopération sud-sud efficiente, dont l’objectif principal est de « développer un modèle de coopération économique mutuellement bénéfique, et d’améliorer les conditions de vie du citoyen africain » 21. C’est tout un symbole de la place grandissante de l’Afrique dans la politique étrangère du Maroc et dans la diplomatie royale. Force est de constater que la politique africaine du Maroc a suscité des inquiétudes auprès de certaines puissances, qui ont suivi de plus près les différentes visites et déplacements du Roi en Afrique. La signature des accords et des contrats entre le patronat marocain et le monde des affaires en Afrique n’a pas été du goût de tous. La coopération Sud-Sud : fondement de la politique africaine du Maroc Dans un contexte très particulier, caractérisé par l’essoufflement et la crise de la coopération NordSud d’une part ainsi que par l’insuffisance et l’inefficacité de l’aide publique d’autre part, tout en considérant la crise des institutions financières internationales, la coopération Sud-Sud (CSS) gagne une reconnaissance croissante22. La CSS se démarque de la coopération traditionnelle dans la mesure où elle n’est pas envisagée « comme une forme d’aide publique au développement, mais comme un partenariat entre égaux fondé sur la solidarité »23. La coopération maroco-africaine a pris de l’ampleur dans cette conjoncture et vise à apporter des solutions adaptées au contexte africain. La coopération maroco-africaine se démarque par son caractère multidimensionnel et multisectoriel, avec une attention particulière sur le partenariat économique. L’analyse des discours, messages et déplacements depuis l’avènement du Roi Mohammed VI permet de relever la place grandissante accordée à l’Afrique et notamment à la CSS. À plusieurs reprises, le Roi Mohammed VI a rappelé qu’à défaut de moyens nécessaires, les différents défis de l’Afrique ne peuvent être surmontés que par la coopération et la solidarité entre les peuples africains. La CSS se présente ainsi comme un remède contre la vulnérabilité dont l’Afrique fait montre depuis plusieurs décennies. La CSS est pour le Maroc « [u]n vecteur de l’émergence d’une Afrique nouvelle, confiante en ses potentialités et ouverte sur l’avenir » 24 . Par ailleurs, la commémoration de la Journée de l’Afrique au Maroc, le 25 mai de chaque année démontre l’intérêt que suscite l’Afrique dans la société marocaine. Ce rendez-vous annuel est une occasion pour le Maroc de rappeler son engagement en faveur d’une Afrique forte, solidaire et apte à répondre aux attentes de sa population. Aussi, l’organisation par le Maroc du Forum Crans Montana, rendez-vous annuel de personnalités intellectuelles et culturelles, issus du monde de la politique, de la culture, de l’économie et de l’information, mais également des ONG, afin de débattre et échanger dans les domaines intéressant le continent africain tout en permettant la formulation de solutions pratiques à plusieurs problématiques est une marque d’attachement du Maroc au développement de l’Afrique. Le choix des thématiques et la qualité des participants « [c]onfère au Forum une envergure internationale, tout en consacrant une attention particulière à notre continent d’avenir, l’Afrique ». Plus concrètement, la mobilisation du Maroc en faveur de la CSS peut être déclinée en trois plans : continental, bilatéral et régional. L’ouverture du Maroc sur l’Afrique subsaharienne durant ces dernières années constitue un choix réaliste et stratégique, en accord avec les reconfigurations actuelles de l’économie mondiale où le continent africain est appelé à « se positionner en tant que nouveau pôle mondial de croissance ». Le retour du Maroc au sein de l’Union africaine, le 30 janvier 2017, après avoir quitté l’OUA en 1984, a été suivi de près par les grands décideurs internationaux. Ce retour à la famille africaine était fortement attendu depuis plusieurs années dans le sens où il est de nature à renforcer l’image et la place de l’Afrique sur l’échelle internationale. La présence du Maroc au sein de l’UA permet d’une part d’établir un certain équilibre entre les pays francophones et les pays anglophones et, d’autre part, la contribution annuelle du Maroc au budget de l’UA permet d’atténuer le déficit budgétaire de l’organisation panafricaine. En sus de cet aspect économique, il est attendu du Maroc qu’il apporte une réelle valeur ajoutée à l’UA en contribuant à la promotion et à la défense des intérêts du continent25. Le rôle catalyseur que peut jouer le Maroc en matière migratoire est un autre exemple de la mobilisation du Maroc sur le plan continental en faveur d’une coopération Sud-Sud26 . Sur le plan bilatéral Les relations entre le Maroc et ses partenaires africains sont anciennes et ne cessent de prendre de l’ampleur afin de renforcer la coopération économique, humaine et sécuritaire des différentes parties. Outre la création des commissions mixtes, qui visent le suivi des projets et l’amélioration des relations bilatérales, le Maroc a conclu plus de 1000 accords avec plusieurs États africains, portant entre autres sur le commerce, l’exclusion de la double imposition ou encore la promotion et la protection des investissements. Ces accords bilatéraux visent essentiellement la création d’un cadre propice au renforcement de la CSS. La mobilisation du Maroc se traduit à travers la mise en place de projets de grande envergure et le renforcement du partenariat dans plusieurs secteurs. La formation universitaire est un autre maillon de la CSS entre le Maroc et ses partenaires africains. Encouragés par sa stabilité politique, son rapprochement géographique et la qualité de ses formations, de nombreux étudiants africains optent pour le Maroc comme pays d’accueil afin de terminer leurs études supérieures. Plus récemment (2017-2018), les établissements supérieurs marocains ont accueilli 10.000 étudiants africains dont plus de 80% sont boursiers27. Dans le même sillage, de nombreux cadres, administrateurs et décideurs africains se déplacent chaque année au Maroc pour effectuer des formations et stages dans différents secteurs28 . Le royaume a beaucoup investi dans des projets de sécurité alimentaire et sanitaire, où son expertise est reconnue (gestion de l’eau, élevage et création de centres de soins, etc.) La signature de l’accord entre le ministère de l’Industrie publique éthiopien et le groupe OCP (19 novembre 2016) portant sur la construction d’un complexe industriel d’engrais, ou encore l’accord entre le Maroc et le Nigéria (décembre 2016) portant sur le projet de gazoduc devant relier les deux pays et passant par onze États de la région ouest-africaine, visent à garantir un meilleur développement pour les partenaires africains du Maroc. Le « modèle marocain » de la CSS recouvre des volets variés et très divers. Il est présenté comme un modèle original, approprié et adapté aux attentes des pays du Sud. Le « modèle marocain » de la CSS se démarque par son caractère multidimensionnel et multisectoriel et, par conséquent, il inclut les domaines sécuritaire et militaire, économique, spirituel et culturel, mais également humanitaire et migratoire. Par ailleurs, dans le contexte de la pandémie liée au Covid-19, le Maroc a fait preuve de dynamisme et de solidarité à l’égard de ses partenaires africains. Le Maroc a pu apporter des réponses à la crise malgré quelques limites s’agissant de ses moyens matériels et la modestie de son infrastructure sanitaire. Le Maroc a engagé une opération humanitaire d’envergure au profit de plusieurs États de l’Afrique subsaharienne afin de les accompagner dans leurs efforts de lutte contre le virus29. L’aide marocaine à l’égard des pays africains réaffirme les principes et les valeurs défendus par le Maroc et surtout son engagement effectif pour l’accompagnement du développement du contient. C’est ainsi que le Maroc a opté pour une démarche pragmatique, orientée vers l’action et le partage d’expérience. D’ailleurs, le matériel envoyé aux États africains, portant le label made in Maroc peut être interprété comme un message à tous les pays du continent : l’Afrique doit agir et mobiliser ses propres ressources pour faire face à la pandémie. L’initiative marocaine a été grandement saluée à l’échelle africaine et internationale. D’une part, plusieurs chefs d’État, ambassadeurs, ministres et célébrités africains ont exprimé leur reconnaissance et leur gratitude à l’égard de l’initiative marocaine. D’autre part, plusieurs organisations internationales ont salué le soutien matériel marocain en faveur de plusieurs États de l’Afrique subsaharienne. C’est ainsi que l’Organisation mondiale de la Santé a félicité l’initiative du Roi Mohammed VI d’accorder des aides médicales aux pays africains, saluant un acte de générosité bienveillant et « une manifestation authentique et tangible de la solidarité régionale » dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Dans le même sillage, l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture a salué la solidarité et l’action humanitaire sous l’égide du Souverain destinées à soutenir la lutte contre la pandémie de Covid-19. L’initiative marocaine est un message fort, traduisant l’engagement effectif du Maroc en faveur de la solidarité interafricaine et la coopération SudSud. Il s’agit enfin d’une illustration du soft power marocain qui constitue un pilier de la politique africaine du Maroc. Conscient du poids des groupements régionaux et interrégionaux en matière de renforcement de la CSS, le Maroc poursuit ses efforts afin de renforcer sa présence dans l’architecture institutionnelle africaine. Le Maroc est un membre fondateur de l’UMA (1989), membre à part entière de la Communauté des États sahélo-sahariens (1998) et il œuvre pour prendre place à la Communauté économiques des États de l’Afrique de l’Ouest (1975). Les résultats performants des groupements régionaux en matière de CSS30 exigent un réel engagement des pays africains dans ce processus d’intégration régionale, qui ne peut être que bénéfique pour les États et les peuples d’Afrique. Force est de constater que le processus d’intégration régionale en Afrique est en cours de consolidation. Il atteste d’une montée en puissance durant ces dernières décennies grâce à la mise en place et au renforcement des Communautés économiques régionales (CER). Les défis de la mondialisation imposent aux pays africains d’agir à l’unisson pour promouvoir et défendre leurs intérêts. De nouvelles perspectives stratégiques de la politique africaine du Maroc après le retour au sein de l’UA Le processus d’intégration économique régionale en Afrique s’est beaucoup accéléré ces dernières décennies grâce à la mise en place et au renforcement des Communautés économiques régionales. Celles-ci sont non seulement les piliers du développement socio-économique et de la stabilisation politique du continent, mais également les vecteurs de l’intégration africaine dans la perspective de la création d’une Communauté économique africaine31. L’UMA, qui est la CER d’appartenance du Maroc compte tenu de sa position géographique sur le continent, peine cependant à concrétiser son agenda en raison des désaccords politiques et économiques entre ses États membres. Ce qui contraint ce pays à rechercher un nouveau positionnement régional, afin de mieux prendre part et de tirer profit de la dynamique d’intégration économique continentale. En outre, le Maroc a besoin de diversifier ses partenaires économiques et de gagner des marchés alternatifs pour son secteur privé face à la concurrence mondiale et aux difficultés que traverse l’économie européenne, premier débouché de la production marocaine. Dès son retour au sein de l’UA, le Maroc a déposé une demande d’adhésion auprès de la CEDEAO (24 février 2017), qui a été favorablement accueillie par la Conférence des chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO qui a donné son accord de principe lors de son 5ème sommet tenu en juin 2017 à Monrovia au Libéria32 . L’importance des implications d’une éventuelle adhésion du Maroc à la CEDEAO est une problématique dont la pertinence n’est pas à démontrer dans la mesure où cette Communauté a à son actif plus de quatre décennies de coopération et d’intégration entre ses États membres. La CEDEAO offre à cet effet une bonne opportunité, en raison de son important marché intérieur qui compte plus de 350 millions d’habitants, mais aussi de ses importantes ressources minières et pétrolifères comme dans le Golfe de Guinée par exemple. Au vu de ces progrès, la demande d’adhésion du Maroc à la CEDEAO, tout en suscitant des espoirs de part et d’autre, soulève également des défis auxquels les décideurs politiques ne peuvent que prêter attention. Mais une adhésion du Maroc à la CEDEAO offre également des opportunités à cette communauté économique, notamment en termes de croissance, de renforcement de la stabilité et de l’attractivité de la sous-région. Par ailleurs, le poids économique du Maroc est de nature à accroître l’influence du bloc CEDEAO sur l’échiquier continental et sur la scène internationale. Ainsi, une admission du Maroc au sein de la CEDEAO est porteuse d’espoirs pour les deux parties, mais elle se heurte aussi à des questions complexes. Parmi ces questions figurent notamment celles relatives à la libre circulation des personnes, à l’exercice du droit de résidence et d’établissement, la perspective d’adoption de la monnaie unique de la CEDEAO ainsi que les autres aspects techniques et juridiques des futures relations à la mise en place d’un cadre institutionnel d’adhésion du Maroc et la CEDEAO33 . Par ailleurs, le retour du Maroc dans l’UA lui a permis de prendre place et de siéger dans les instances panafricaines à l’instar du Parlement panafricain et le Conseil de paix et de sécurité (…), puis d’endiguer les tentatives visant à porter atteinte à ses intérêts stratégiques, notamment en ce qui concerne la question du Sahara. Plus concrètement, le Maroc a réussi lors du Sommet de l’UA à Nouakchott (juin 2018) à trancher sur la centralité de l’ONU s’agissant de la supervision du processus de résolution du conflit du Sahara. Dans le même sillage, la reconnaissance des États-Unis de la souveraineté du Maroc sur le Sahara (10 décembre 2020) constitue une victoire de la diplomatie marocaine. C’est un événement historique et déclencheur d’une dynamique puisque dans la lignée de cette déclaration américaine, plus de 21 consulats et représentations diplomatiques ont été ouverts à Dakhla et Laayoune dans le Sud du Maroc. Trois phases marquent l’évolution de la politique africaine du Maroc depuis l’accession du Roi Mohammed VI au trône en 1999. La première période illustre l’attention et le grand intérêt accordé par le Maroc à l’Afrique. Elle se concrétise par l’annulation de la dette des pays africains les moins avancés (PMA) et par l’exonération de leurs produits de taxes douanières à l’entrée du Maroc34 . La deuxième période se distingue par la mise en place des jalons de la coopération Sud-Sud entre le Maroc et ses partenaires africains. Elle se manifeste par la signature des contrats et conventions entre le Maroc et ses partenaires africains, afin de mettre en place les différents projets retenus. La troisième période se caractérise quant à elle à la fois par le diagnostic des différents projets mis en place afin de relever les insuffisances et optimiser les résultats et par l’ouverture sur d’autres pays d’Afrique afin de promouvoir et défendre les intérêts stratégiques du Maroc.
LA NOUVELLE GÉOÉCONOMIE DU MAROC EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE : DU CONFLIT DIPLOMATIQUE À LA DIPLOMATIE ÉCONOMIQUE
Après son indépendance, le Maroc a manifesté un regain d’intérêt pour l’Afrique, reprenant ainsi son rôle historique sur le continent, interrompu par le colonialisme. En effet, sous le règne du Mohammed V, la politique étrangère du Maroc était orientée vers l’appui aux indépendances des États africains sous la forme d’un soutien militaire, voire parfois de manière plus discrète, comme ce fut le cas avec le Front de libération nationale algérien. Cependant, l’admission de la République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD) au sein de l’Organisation de l’Unité africaine (OUA) entrainera le retrait du Maroc de cette organisation en 1984. Cette politique de la « chaise vide » sera compensée par des relations bilatérales. L’accession du Roi Mohammed VI au trône en 1999 va donner un nouvel élan à la diplomatie marocaine en Afrique, dans le cadre de la promotion d’une coopération Sud-Sud et gagnant-gagnant. C’est dans ce contexte marqué par un repositionnement du continent africain dans les intérêts économiques des grandes puissances et des puissances émergentes que la politique étrangère marocaine tire sa légitimité couplée à son héritage historique. Quel est, dès lors, est l’impact de la question du Sahara – prisme à travers lequel le Maroc considère son environnement international — sur la politique étrangère et en particulier sa diplomatie économique ? Le Sahara, la pièce maîtresse de la politique étrangère marocaine La question de l’intégrité territoriale est le nerf de la politique étrangère marocaine, en particulier dans sa déclinaison africaine. La déclaration suivante du secrétaire d’État au ministère des Affaires étrangères et de la coopération Taib Fassi-Fihri confirme cette règle fondamentale : « la bonne voie de notre relation dépend de 90 % de ce que dit l’Espagne à propos du Sahara… cette question à une importance cruciale pour tous les marocains »63. Historiquement, le Maroc a revendiqué l’indépendance de la Mauritanie, exigé la restitution de Tindouf et Colomb Béchar promise par l’accord signé avec le gouvernement provisoire de la République algérienne en 1961 et a clamé ses droits historiques sur le Sahara, alors que l’OUA recommande le respect des frontières héritées du colonialisme. La remise en cause par l’Algérie de l’accord précédent sur la délimitation des frontières va conduire en 1963 à la guerre des sables. L’Algérie, récemment indépendante, profite ainsi de l’absence politique du Maroc sur le continent africain. Le retour du royaume sur la scène africaine n’est réalisé qu’en 1969 après la reconnaissance de l’indépendance de la Mauritanie. L’Algérie va, de son côté, s’attacher à contrarier les liens du Maroc avec les États africains et à appuyer le Front Polisario, reconnu en 1976 par le comité de libération de l’OUA comme le seul mouvement légitime de libération du Sahara espagnol, puis à soutenir la création de « la République Arabe Sahraoui Démocratique ». L’Afrique est devenue dès lors un échiquier d’escalade diplomatique entre l’Algérie et le Maroc. Néanmoins, depuis le retrait de son adhésion à l’OUA en 1984 comme l’analyse à juste titre El Mellouki Riffi Bouhout64, le royaume a mené une politique de coopération caractérisée par « la flexibilité, le réalisme, le pragmatisme », moins conditionnée par les affinités politico-idéologiques, les relations personnelles entre chefs d’État et l’affaire du Sahara. Ce « mariage de raison » va aboutir à un rapprochement entre le Roi Hassan II et le Président algérien Chadli Bendjedid, à la création de l’Union du Maghreb Arabe en février 1989, ainsi qu’à l’intensification des visites des chefs d’État africains au Maroc en 1996 et au retrait de la reconnaissance de la RASD par neuf États africains au cours de la même année ainsi qu’en 1997. Une nouvelle diplomatie économique royale Lors de ses visites, accompagné de délégations d’opérateurs économiques marocains, le Roi Mohammed VI a renforcé les relations du Maroc avec le continent africain, par la signature et la consolidation de partenariats. Depuis 2000, sont comptabilisées 50 visites dans 25 États et la signature de 1000 accords, le premier ayant été signé avec la Mauritanie en 2001. Ce repositionnement marocain sur le champ diplomatico-économique africain s’effectue en quatre phases En 2000 et 2005, le Maroc s’engage dans une coopération Sud-Sud par l’annulation de la dette des pays africains les moins avancés65 et supprime les droits de douane pour les exportations sur le marché marocain. Entre 2005 et 2015, il s’agit d’une période durant laquelle entreront en vigueur des accords préférentiels appliqués par le Maroc sur les importations en provenance des pays africains, dans un contexte de repositionnement des États puissants et émergents en Afrique. En 2006, pas moins de trois présidents (russe, vénézuélien et iranien) et un premier ministre (turc) ont entamé leur première tournée en Afrique. Entre 2015 et 2020 il y a une intensification de la diplomatie économique royale66 par des visites aux États anglophones et lusophones, la candidature à l’adhésion à la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en 2017 – dont le Maroc est considéré comme le premier investisseur et le retour au sein de l’Union africaine (UA) par un vote des chefs d’État qui dépasse les deux tiers. C’est bien durant cette phase et après la chute des cours de pétrole en 2015 que la diplomatie du pétrole s’est infléchie face la diplomatie du phosphate. La quatrième phase est celle de 2020 à aujourd’hui, avec la reconnaissance de la marocanité du Sahara par les États-Unis. Cette reconnaissance s’inscrit dans le cadre de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël, qui sera couronnée par l’ouverture d’un consulat américain au Sahara, sachant que 75% des consulats ouverts sont des représentations africaines. Depuis lors, le Maroc mène une diplomatie offensive en particulier à destination des États européens ; ce qui peut être interprété comme un pas supplémentaire dans l’émancipation vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. Dans sa politique générale, le Roi Mohammed VI considère le Sahara comme le prisme absolu à travers lequel le Maroc observe et évalue son environnement international. L’ambition du Maroc est de se positionner comme un hub régional incontournable. Ce projet est crédible considérant la situation géographique du Maroc couplée au développement d’infrastructures portuaires de premier plan (Tanger Med, Dakhla) mais aussi routières (la double voie qui traverse le Sahara sera prolongée par l’axe routier marocomauritanien entre Dakhla et Nouadibou. Le rétablissement de cet axe de communication historique (commerce des caravanes) va relier le nord de l’Afrique avec l’Afrique subsaharienne et repositionner les centres de gravité socioéconomiques. C’est ainsi que le projet de gazoduc Nigéria-Maroc qui traverse 11 pays pour exporter du gaz vers l’Europe renforce cette intégration régionale, face à l’instabilité politique au Soudan, en Libye et au Mali. Ce projet de repositionnement est également rendu crédible par les accords de libre-échange établis par le Maroc avec l’Union européenne, la Turquie, les États-Unis, les pays arabes méditerranéens et les États de l’Association européenne de libre-échange, qui constituent un marché d’un milliard de consommateurs. Enfin, le projet est rendu crédible par les plans économiques mis en œuvre et le climat des affaires. Le Maroc est devenu une plaque tournante des investissements étrangers, grâce à la mise en place d’un programme industriel compétitif dans les secteurs de l’automobile, de l’électronique, de l’agroalimentaire, de l’industrie pharmaceutique entre autres. La coopération scientifique et technique dans des secteurs stratégiques n’est pas en reste. On peut ainsi évoquer le développement d’une grande plateforme de production d’engrais au Nigéria et en Éthiopie, la modernisation de l’agriculture, la mise en place des zones industrielles intégrées, le partage d’expérience en matière du développement humain et la mise en œuvre du principe de solidarité lors de crises humanitaires majeures. Ainsi, lors de la pandémie de Covid-19 des aides médicales ont été envoyées à 15 États africains67. Cette coopération médicale est couronnée par la mise en place d’une usine de fabrication des vaccins destinée au continent qui importe environ 94 % de ses médicaments. Les relations commerciales : un baromètre de la diplomatie économique L’Europe demeure le premier partenaire du Maroc. Elle accapare 64% de ses exportations et présente 56% de ses importations au cours de l’année 2022. Elle est suivie par l’Asie avec 15% des exportations et 27% des importations. Avec un volume des exportations chiffré à 9% et des importations à 3%, l’Afrique se positionne au quatrième rang après l’Amérique (10% des exportations et 14% des importations). Une telle disparité s’explique par les accords de libre- échange conclus par le Maroc avec l’Union européenne et les États-Unis, l’avantage comparatif des États, la stabilité politique et la sécurité face aux menaces armées et terroristes, ainsi que par la qualité des infrastructures de transport, sachant que 90% des échanges commerciaux mondiaux passent par la voie maritime. Quant aux investissements direct étrangers, le stock des investissements africains pèse environ 42% de l’ensemble des investissements marocains à l’étranger en 2020. Les échanges commerciaux Les échanges commerciaux sont conformes avec les quatre phases d’évolution des relations du Maroc avec l’Afrique sous le règne du Roi Mohammed VI. Le volume des exportations vers l’Afrique a été multiplié par 12 entre 1999 et 2022 et les importations par 7. Entre 1999 et 2015, la balance commerciale était négative pour le Maroc. Depuis 2015, les exportations sont stables et les importations en fluctuation, jusqu’en 2020 où elles reprennent leur croissance avec l’entrée en vigueur de la zone de libre-échange en mai 2019. Le poids des exportations et des importations respectivement de 42,2% et 38,3% avec les États qui reconnaissent la RASD affecte le volume total des échanges et explique la similitude des courbes des exportations et des importations. Les principaux produits exportés vers l’Afrique sont les engrais naturels et chimiques (25,3%), les préparations et conserves de poissons et crustacés (8,6%), le sucre brut ou raffiné (5,9%), les poissons frais, salés, séchés ou fumés (5,1%), les fils, câbles et autres conducteurs isolés pour l’électricité (4,0%) et les voitures de tourisme (3,6). En contrepartie, les principaux produits importés sont le gaz, le pétrole et autres hydrocarbures (25,3%), les houilles, cokes et combustibles solides similaires (5,3%), les dattes (5,1%), les matières plastiques et ouvrages divers en plastique (4,2 %). Les investissements évoluent en étroite relation avec la conjoncture économique internationale. C’est pourquoi des points d’inflexion sont constatés. D’abord en 2008, suite à la crise économique liée à la crise financière mondiale ; puis en 2017 avec la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Enfin, la crise sanitaire de 2020 aura également de multiples conséquences. Le Maroc est présent en Afrique à travers des investissements dans 29 États, réalisés majoritairement par des entreprises leaders de leur secteur (Maroc Telecom, l’Office Chérifien des Phosphates, Attijariwafa Bank). Ces investissements ont représenté 44% de l’ensemble des investissements à l’étranger en 2021. La Côte d’Ivoire à elle seule en a reçu 57%, l’Ile Maurice 14% et l’Égypte 6%. Ils concernent les secteurs de la banque, les télécommunications et l’immobilier. Quant aux recettes, elles sont faibles et ne représentent que 2% du total des recettes des investissements enregistrés au Maroc en 2021. La normalisation des relations du Maroc avec Israël (concrétisée par la signature de plusieurs accords concernant le secteur du tourisme, l’investissement, la sécurité), mais aussi les accords tripartites MarocÉtats-Unis-Israël et Maroc-Israël-Union européenne permettront des rapprochements sur les questions stratégiques, en particulier celles concernant l’Afrique. Les opportunités offertes par le continent sont importantes : des matières premières, un marché d’environ un milliard de consommateurs en 2030 et une croissance économique qui atteint 5% en moyenne. Quant au Maroc qui a opté, depuis les années 2000, pour une stratégie de diversification de ses partenariats et une politique pacifiste dans la résolution des conflits, il se retrouvera involontairement impliqué dans la confrontation entre l’occident, la Russie et la Chine, ceux deux dernières puissances continuant de se rapprocher à la faveur de la guerre d’Ukraine. L’Afrique constitue un champ de bataille économique.
LA DIPLOMATIE MAROCAINE EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE : UNE PUISSANCE RÉGIONALE EN COURS D’AFFIRMATION
Le Royaume du Maroc, 2 ème pays industrialisé du continent derrière l’Afrique du Sud selon le classement des économies africaines les plus industrialisées en 2022 5 ème économie en 2021 avec un PIB estimé 142.87 milliards $US69 et 7 èmepuissance militaire du continent, occupe une place non négligeable sur l’échiquier régional. L’Afrique subsaharienne est au cœur de la politique étrangère du Maroc des deux dernières décennies. Il convient dans un premier temps d’analyser les relations du Maroc avec ses voisins subsahariens à travers le prisme du dossier du Sahara, puis de s’attarder sur les dimensions sociales, humanitaires et religieuses de la politique africaine du Maroc, avant d’en étudier les aspects économiques. Le tropisme du dossier du Sahara dans la politique africaine du Maroc Plus qu’une cause nationale et sacrée, la question du Sahara est l’alpha et l’oméga des relations politiques extérieures du Maroc, c’est donc dire toute sa centralité dans la politique étrangère du Royaume. En novembre 1984, le Maroc a quitté l’Organisation de l’unité africaine dont il était l’un des architectes pour protester contre l’attribution de siège au Front Polisario, admis comme représentant de la République arabe sahraouie démocratique (RASD). La lecture du message de Feu Sa Majesté le Roi Hassan II par Ahmed Réda Guédira, ministre des Affaires étrangères d’alors est libellé en ces termes : « Voilà, et je le déplore, l’heure de nous séparer. En attendant des jours plus sages, nous vous disons adieu et nous vous souhaitons bonne chance avec votre nouveau partenaire71 ». Plus de trente ans après, en janvier 2017, le Maroc a décidé de rejoindre l’Union africaine -l’héritière de l’ancienne OUA – en mettant ainsi fin à sa politique de la chaise vide estimant qu’il est plus facile de défendre sa cause de l’intérieur que de l’extérieur. La détermination du Royaume est restée intacte le long des années passées, à l’instar de l’appel lancé par le Roi Mohammed VI dans son discours à l’occasion de la fête du Roi et du Peuple du 20 aout 2022 : « Je voudrais adresser un message clair à tout le monde : le dossier du Sahara est le prisme à travers lequel le Maroc considère son environnement international ». Les efforts diplomatiques du Maroc de ces dernières années ont fait changer les positions. D’abord, dès 2016, une dizaine de pays africains, sur les 26 qui soutenaient habituellement les positions algériennes concernant le Sahara, ont retiré officiellement leur reconnaissance du Front Polisario comme représentant légitime du peuple sahraoui, tandis que 28 pays africains ont déposé une motion pour suspendre la République arabe sahraouie démocratique (RASD) de l’Union africaine72 . Par ailleurs, 21 pays73 d’Afrique subsaharienne ont ouvert des consulats dans les provinces du sud du Royaume consacrant ainsi la marocanité du Sahara. Ces pays joignent par ailleurs leurs voix à celle du Maroc pour défendre son intégrité territoriale dans les instances internationales. Les dimensions sociales, humanitaires et religieuses de la politique africaine du Maroc La politique africaine du Maroc met un accent particulier sur le développement humain. Cet élan de solidarité du royaume envers ses voisins subsahariens prend forme de plusieurs manières. Le Maroc accueille ainsi chaque année un nombre important d’étudiants et de cadres subsahariens dans ses universités, instituts et centres de formation. Ce nombre ne cesse d’augmenter au fil des années en passant de « 1.040 en 1994 à 16.000 en 2013 dont 6.50074 étudiants bénéficient de bourses de coopération par le biais de l’Agence Marocaine de Coopération Internationale ». Ce nombre a atteint 19 25675 en 2021. En 2005, lors de la famine qui a frappé le Niger, le Roi Mohammed VI s’était alors rendu dans ce pays pour exprimer sa solidarité aux victimes. Le soutien du Maroc s’était matérialisé par l’implantation d’un hôpital militaire de campagne et l’envoi de milliers de tonnes de denrées alimentaires76 . Lors de la pandémie du coronavirus, le Maroc avait également envoyé une aide médicale à quinze pays d’Afrique subsaharienne. Le Maroc a participé à plusieurs opérations onusiennes de maintien de la paix en Afrique. Il s’agit de la « Mission des Nations unies pour la Stabilisation en République démocratique du Congo (RDC) en 2010, de l’Opération des Nation unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) mise en place en février 2004 par la résolution 1528 du Conseil de sécurité de l’ONU et de la Mission multidimensionnelle des Nations unies pour la Stabilisation du Mali (MUNISMA) qui a été créée par la résolution 2100 du Conseil de Sécurité de l’ONU en avril 201377 ». Sur le plan religieux, le Maroc a entrepris la diffusion de son modèle d’encadrement de l’enseignement et des pratiques religieuses, présenté comme un levier contre l’extrémisme, dans le cadre d’une « diplomatie de sécurité religieuse ». Celle-ci s’est illustrée par la formation d’imams de différents pays d’Afrique subsaharienne. Le lancement, en juillet 2015, de la Fondation Mohammed VI des Oulémas africains présidée par le Roi Mohammed VI et regroupant des imams de 29 pays africains, joue un rôle de premier plan dans la diffusion d’un islam modéré aux antipodes du fanatisme et de l’extrémisme violent. La diplomatie économique du Maroc en Afrique subsaharienne L’engagement diplomatique du Maroc sur le plan économique a permis au royaume de devenir le premier investisseur africain en Afrique de l’ouest et le deuxième à l’échelle continentale, après l’Afrique du Sud. Cet engagement a également permis une augmentation exponentielle des exportations marocaines sur le continent. Les investissements marocains sur le continent sont passés de 907 millions de dirhams en 2007 à 5,4 milliards de dirhams en 2019, selon la Direction des études et des prévisions financières du ministère de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’administration. Le groupe des télécommunications « Maroc Telecom » est présent dans plusieurs pays du continent. Il a fait son entrée, en décembre 2006, au Burkina Faso par l’acquisition de 51% du capital d’Onatel (Office National des Télécommunications du Burkina Faso). Il s’est également emparé de 51% du capital de Sotelma en juillet 2009 dans le cadre d’un processus de privatisation lancé par l’Etat malien78 . Depuis 1989, la Banque marocaine du commerce extérieur (BMCE) s’est implantée au Mali avec une participation de 27,38% dans la Banque de Développement du Mali. Quelques années plus tard, en 2017, la BMCE Bank a également pris le contrôle de 59,39% du groupe Bank Of Africa (BOA) au Mali, moyennant des prises de participation. Ce groupe est présent dans 14 pays africains et représente l’un des premiers réseaux bancaires au niveau de l’Union économique et monétaire de l’Afrique de l’ouest (UEMOA)79. La Banque centrale populaire (BCP) participe au capital de plusieurs banques sur le continent. C’est le cas de la Banque populaire maroco-guinéenne, créée en 1990, dont la BCP détient 53,9%80du capital. La banque Attijariwafa Bank a également investi sur le continent. En 2006, fut créée Attijariwafa Bank Sénégal qui, avec la Banque Sénégalo-Tunisienne, a formé « Attijari Bank Sénégal ». Cette banque a fusionné en 2008 avec la compagnie bancaire d’Afrique de l’ouest (CBAO) pour donner naissance à « CBAO groupe Attijariwafa Bank », détenue à hauteur de 51,93% par le groupe marocain81 . Attijariwafa Bank a également pris le contrôle de la Banque internationale du Mali en 2008 après avoir acquis 51%82 de son capital. Par ailleurs des entreprises marocaines comme le groupe Addoha, le groupe Holmarcom, le Groupe ONA (Omnium nord-africain) ou l’Office chérifien des Phosphates prospèrent dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, des infrastructures et des mines. Les échanges commerciaux du Maroc avec ses voisins subsahariens ont enregistré une croissance annuelle moyenne de 13,1% sur la période 2008- 2016. Les exportations du Maroc à destination par exemple de la zone CEDEAO (Communauté économique des États de l’Afrique de l’ouest) ont triplé depuis 2008 passant de 2,8 milliards de dirhams à 8,5 milliards de dirhams en 201683 avec une balance commerciale largement excédentaire en faveur du Maroc. En définitive, la diplomatie marocaine sur le continent repose sur une vision globale qui intègre à la fois les acteurs publics et privés. Cette stratégie globale a permis à de nombreuses entreprises marocaines de se faire une place sur le continent. Elle a également permis une augmentation exponentielle des exportations marocaines sur le continent.
LA DIPLOMATIE ÉCONOMIQUE DU MAROC DANS L’ESPACE DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE DES ÉTATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST
Le Maroc entretient des relations de coopération avec les pays de l’espace CEDEAO. Dans une perspective historique, ces relations ont comme point de départ le commerce transsaharien du moyen-âge entre le Maghreb et l’Afrique subsaharienne (l’Afrique de l’Ouest principalement). Elles ont ensuite survécu à l’époque coloniale pour enfin prendre des formes plus modernes, denses, diversifiées et dynamiques à l’accession du Maroc et des pays de l’espace CEDEAO à l’indépendance au début de la seconde moitié du XXème siècle. La communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest est une organisation d’intégration sousrégionale créée le 28 mai 1975. Avec une aire géographique de 5,2 millions de km², elle compte aujourd’hui quinze pays membres dont le Bénin, le Burkina Faso, le Cabo Verde, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Liberia, le Mali, le Niger, le Nigeria, la Sierra Leone, le Sénégal et le Togo. C’est la région la plus peuplée d’Afrique et naturellement le plus grand marché en termes de consommation. Des indépendances à aujourd’hui, le Maroc a noué et entretenu d’excellentes relations avec chacun de ces pays. Ces relations ont divers pans à savoir la politique, l’économie, la science, la culture, l’éducation et la religion. Le Maroc, fort de l’approche de la coopération sudsud et du partenariat gagnant-gagnant, a fait du continent africain l’espace naturel pour l’internationalisation de son économie84. La dynamique actuelle des échanges économiques entre le Maroc et les autres pays du continent, en particulier ceux de l’espace CEDEAO, participe de ce choix stratégique du Maroc. Faut-il le rappeler, le Maroc est actuellement le premier investisseur africain en Afrique de l’ouest et le volume des échanges commerciaux n’a de cesse d’augmenter. Derrière ce décor, une diplomatie économique sert de cadre pour la promotion et la défense des intérêts économiques du Maroc dans l’espace CEDEAO. Il s’agit d’une diplomatie qui combine des moyens politiques et économiques et mobilise des acteurs aussi bien nombreux que divers, notamment des acteurs publics et privés, le tout pour la promotion et la défense des intérêts économiques du Maroc dans l’espace CEDEAO. Dans une approche principalement descriptive, il conviendra de s’intéresser dans un premier temps aux acteurs et aux outils de cette diplomatie économique et, dans un second temps, aux enjeux économiques et politiques de cette dernière. Les acteurs et les outils de la diplomatie économique marocaine dans l’espace CEDEAO Le Maroc, en vue de promouvoir et de défendre ses intérêts en Afrique de l’ouest mobilise un nombre important d’acteurs et d’outils de diverse nature. Les acteurs La diplomatie économique se distingue par son approche horizontale et polycentrique, en ce qu’elle n’est pas du seul apanage des acteurs étatiques mais aussi des acteurs non étatiques, notamment les acteurs du secteur privé. La diplomatie économique marocaine dans l’espace CEDEAO ne déroge pas à cela. S’agissant des acteurs étatiques qui interviennent dans cette diplomatie, il convient de citer en premier le Souverain du Royaume. En effet, depuis son intronisation en juillet 1999, Sa Majesté, le Roi Mohammed a fait le choix de la dynamisation des relations maroco-africaines qui s’étaient en partie refroidies sous le règne de son prédécesseur en raison, notamment, de la question du Sahara. Sa diplomatie au Sommet caractérisée par ses nombreuses visites dans nombre de pays dans la quasi-totalité des pays de l’espace CEDEAO a permis la conclusion de nombreux accords avec les pays de la région. Pour preuve, la dernière tournée royale dans la région qui remonte à 2017 s’était déroulée en Côte d’Ivoire, en Guinée et au Sénégal85. Le parallèle entre la diplomatie au somment royale et la diplomatie économique s’explique par la contribution de la première à l’ancrage la deuxième par le biais de la signature d’accords économiques. Aussi, la présence des acteurs du secteur privé dans les délégations accompagnant le Roi lors de ses visites permet le réseautage des cercles d’affaires marocains et ouest africains pour la conclusion de partenariats d’affaires. En sus du Souverain, d’autres acteurs étatiques interviennent dans la conduite de cette diplomatie économique marocaine dans les pays de l’espace CEDEAO. Il s’agit notamment du ministère des Affaires étrangères par le biais des missions diplomatiques marocaines dans ces pays. En effet, le Maroc entretient des relations diplomatiques avec l’ensemble des quinze pays de la communauté et dispose de représentations diplomatiques dans la quasi-totalité de ces pays. Le Maroc, à l’instar d’autres pays dans le monde, en vue d’outiller ses ambassades des mécanismes de la diplomatie économique, a créé des postes de conseillers économiques au sein des ambassades chargés de la promotion et de la défense des intérêts économiques marocains. Les acteurs du secteur privé jouent un rôle clé aux côtés des acteurs étatiques dans la conduite de la diplomatie économique marocaine en Afrique de l’ouest. En effet, acteur et bénéficiaire de cette diplomatie, le secteur privé marocain joue sa partition dans l’expansion et la défense des intérêts marocains dans l’espace CEDEAO. Cela se traduit par sa participation aux visites des officiels marocains en Afrique de l’ouest, l’implantation des entreprises marocaines, notamment les grands groupes marocains (les champions nationaux) dans ces pays et la densification de leurs exportations à destination de ces derniers. Ici, le rôle de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), patronat du Maroc, est très révélateur de la place axiale du secteur dans le dispositif de la diplomatie économique marocaine en Afrique de l’ouest. La CGEM a dans son architecture institutionnelle la « commission Afrique » qui est d’ailleurs actuellement présidée par un sénégalais. Les missions de cette commission se rapportent à l’accompagnement du développement des entreprises marocaines en Afrique à travers des actions de diplomatie économique. Les outils Les outils auxquels les acteurs ont recours en vue de la promotion et la défense des intérêts économiques dans l’espace CEDEAO sont nombreux et varient selon la nature des acteurs. Ainsi, s’agissant des acteurs étatiques, ceux-ci ont recours à des politiques et juridiques. Il s’agit principalement de la conclusion d’accords économiques avec les pays de l’espace CEDEAO devant faciliter les échanges économiques. Cette pratique, longtemps demeurée bilatérale, est en train d’évoluer pour s’effectuer le Maroc et la CEDEAO ou l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA). Ce sont des accords commerciaux classiques fondés sur la clause de la nation la plus favorisée, des accords commerciaux préférentiels, des accords de promotion et de protection réciproques des investissements, des accords de non double imposition, des accords de financement et un accord de libre établissement (conclu avec le Sénégal). Par ailleurs, en cas d’adhésion à la CEDEAO (demande d’adhésion faite par le Maroc en février 2017), cela permettra aux entreprises marocaines d’exporter davantage vers les pays de l’espace CEDEAO et de s’y implanter à la faveur du cadre juridique communautaire de la CEDEAO de facilitation des échanges et de liberté d’investissement et d’établissement. Par ailleurs, convient-il de rappeler aussi la ratification du traité constitutif de la zone de libre-échange continentale africaine par le Maroc et presque tous les pays de la CEDEAO sauf le Bénin et le Liberia. Cette zone est une opportunité de plus pour la densification des échanges économiques entre le Maroc et l’espace ouest africain d’autant plus qu’elle se rapporte à la facilitation aussi bien des échanges commerciaux que des investissements intra zone. Quant aux acteurs non étatiques, en particulier la CGEM, les outils qu’ils mobilisent dans la défense des intérêts économiques du Maroc dans l’espace CEDEAO s’identifient aux accords de partenariats d’affaires avec leurs homologues en Afrique de l’ouest, la création de filiales ou succursales, la participation au capital des entreprises ouestafricaines, l’organisation de rencontres d’affaires entre les hommes d’affaires marocains et ceux des pays ouest-africains soit bilatéralement ou régionalement (dans le cadre de la CEDEAO). Les enjeux de la diplomatie économique marocaine dans l’espace CEDEAO Après avoir traité des enjeux de la diplomatie économique marocaine dans les pays d’Afrique de l’ouest, il importe de s’intéresser maintenant aux enjeux de cette forme de diplomatie mue par les acteurs étatiques que non étatiques en vue de la promotion et de la défense des intérêts économiques dans la région ouest-africaine, premier partenaire commercial du Maroc en Afrique subsaharienne. Ces enjeux sont identifiés aussi bien sur le plan politique que sur le plan économique.
Les enjeux politiques
La diplomatie économique marocaine dans l’espace CEDEAO est certes en voie d’ancrage mais elle annonce autant d’opportunités quant à une meilleure assise de l’influence politique marocaine dans la région. En effet, d’un point de vue politique, le Maroc est incontestablement l’un des pays les plus influents du continent. Cela s’explique par sa capacité à faire aligner d’autres pays africains sur ses positions sur divers sujets aussi bien d’intérêt national que de coopération. Le Maroc a inversé en sa faveur les positions de bon nombre de pays sur le Sahara. En témoigne le retrait de la reconnaissance de plusieurs États africains du Sahara occidental en tant que pays. Plusieurs pays africains ont davantage matérialisé la reconnaissance du Sahara en tant que territoire marocain par l’ouverture de consulats à Dakhla et Laâyoune, les principales villes se trouvant au Sahara. L’espace CEDEAO est le mieux représenté en termes de pays y disposant d’un consulat. Actuellement, ils sont au nombre de dix pays dont le Sénégal, la Gambie, la Guinée Bissau, la Guinée Conakry, la Sierra Leone, le Togo, la Côte d’Ivoire, le Cap Vert, le Libéria et le Burkina Faso87 . La diplomatie économique marocaine joue un rôle important dans la stratégie d’influence du Maroc dans l’espace CEDEAO. Par ailleurs, l’on pourrait faire un parallèle entre cette diplomatie économique marocaine et l’évolution progressive de la position de plusieurs pays de la CEDEAO concernant le Sahara, en particulier le Nigeria. En effet, le gazoduc MarocNigeria, actuellement en projet, au-delà de ses retombées économiques, permettra de renforcer les relations d’amitié entre les deux pays et, probablement, de faire aligner le Nigeria aux solutions marocaines pour le règlement définitif du problème du Sahara. Dans le même ordre d’idées, la diplomatie économique marocaine dans l’espace CEDEAO pourrait contribuer au renforcement de la coopération entre le Maroc et les pays ouest africains dans les instances régionales africaines, en l’occurrence l’Union africaine. Les enjeux économiques La diplomatie économique du Maroc dans l’espace CEDEAO est un des tremplins de la présence des entreprises marocaines ainsi de l’importance de leurs exportations vers les pays ouest africains. La région ouest africaine est le premier partenaire commercial du Maroc en Afrique subsaharienne et la première destination des investissements marocains en Afrique88. En 2020, l’espace CEDEAO comptait une grande part du stock des investissements marocains à l’étranger qui se chiffrait, selon l’Office des changes du Maroc, à 65,214 milliards de dirham89. La Côte d’Ivoire occupait la tête de la liste de l’encours des investissements directs marocains à l’étranger avec 7,875 milliards de dirham. D’autres pays de l’espace CEDEAO étaient également bien classés, à savoir le Sénégal avec 2,014 milliards, le Mali avec 1,592 milliards, le Burkina Faso avec 1,173 milliards, le Bénin avec 715 millions, la Guinée Conakry avec 546 millions, le Togo avec 495 millions, le Ghana avec 285 millions, le Nigeria avec 242 millions, la Guinée Bissau avec 212 millions et le Niger avec 181 millions90 . Nul doute que ces différentes statistiques gagneront davantage en volume dans les années à venir, pour diverses raisons. D’abord, la volonté politique des autorités marocaines de développer davantage les relations économiques avec les pays de la CEDEAO est toujours en filigrane de leur stratégie d’insertion de l’économie marocaine dans les chaînes mondiales, en particulier les chaînes de valeur ouest africaines. En témoigne, à titre illustratif, un mégaprojet d’infrastructure liant le Maroc et les pays de l’espace CEDEAO à savoir le gazoduc MarocNigeria aux retombées économiques partagées91 . Ce gazoduc permettra la fourniture du gaz nigérian vers le Maroc mais aussi aux pays traversés. Un facteur de plus du développement futur des intérêts économiques marocains dans les pays Afrique de l’ouest se rapporte aux politiques d’ouverture de leurs marchés mais aussi d’attractivité de ces derniers vis-à-vis des investisseurs étrangers. En effet, les pays de l’espace CEDEAO à l’instar des autres pays subsahariens accordent une place importante aux investissements étrangers dans leurs politiques de développement économique. Cela sert de terreau pour le drainage des capitaux étrangers, plus précisément marocains. L’importance du stock des investissements marocains dans l’espace CEDEAO en est un parfait témoin. Ces derniers sont portés principalement par les grands groupes marocains tels que BMCE Bank of Africa, Attijariwafa, Maroc Telecom, le Groupe OCP, le Groupe Addoha, etc. dans les secteurs de la banque, des assurances, de l’immobilier, des télécommunications, de l’agro-industries, des mines92, etc. Aussi, les années à venir augurent de bonnes perspectives pour le développement des exportations marocaines vers les pays de l’espace CEDEAO si l’on s’en tient à l’externalisation par plusieurs multinationales de certaines de leurs productions au Maroc, en l’occurrence celles opérant dans le domaine de l’automobile. Cela aura pour conséquence de diversifier les exportations marocaines vers l’Afrique et d’augmenter la part des produits de haute valeur ajoutée dans ces exportations. En bref, les enjeux politiques et économiques de la diplomatie économique marocaine dans les pays de l’espace CEDEAO sont grands à plus d’un titre. Expression de la stratégie d’internationalisation de l’économie marocaine, la diplomatie économique marocaine ira en grandissant pour la promotion et la défense des intérêts économiques marocains dans les pays de l’espace CEDEAO. La diplomatie économique marocaine dans l’espace CEDEAO participe de la volonté des autorités marocaines d’internationaliser l’économie marocaine par son inscription dans les chaînes de valeur mondiales, en particulier ouest africaines. S’inscrivant dans la logique de la promotion et de la défense des intérêts économiques marocains, cette diplomatie mobilise des acteurs aussi bien étatiques que non étatiques qui ont recours à des outils divers allant des instruments juridiques et politiques à l’organisation de forums entre les secteurs privés marocains et oust africains. Cette diplomatie économique marocaine est certes dans un processus d’ancrage mais, globalement, elle peut être évaluée de façon positive si l’on s’en tient à l’importance des intérêts économiques dans la région marquée par la première place du Maroc en tant qu’investisseur africain dans l’espace CEDEAO qui est d’ailleurs son premier partenaire commercial en Afrique au sud du Sahara. Par ailleurs, elle est appelée à se renforcer davantage dans les années à venir au vu de l’influence politique qu’elle permet au Maroc d’avoir dans la région et des bonnes perspectives de croissance économique aussi bien pour le Maroc que pour les pays ouest africains.
Synthèse de Amadou KA