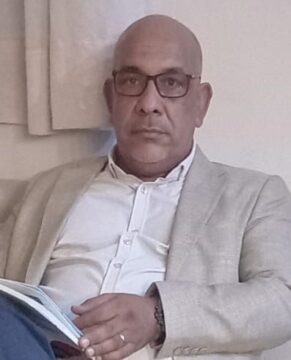Depuis près d’un demi-siècle, le conflit du Sahara occidental demeure l’un des plus persistants du continent africain, figé entre des principes intangibles et une réalité pleine d’obstacles. Les générations se sont succédé, les négociations aussi, sans que la paix ne prenne racine.
Pourtant, un tournant nouveau semble aujourd’hui se dessiner : celui d’un réalisme politique fondé sur l’inclusion et le dialogue, porté par la lassitude des peuples, l’évolution du contexte international et la nécessité de repenser les paradigmes classiques.
La guerre froide avait enfermé le conflit sahraoui dans une logique d’alliances idéologiques : le Maroc, soutenu par l’Occident, et le Front Polisario, appuyé par les régimes dits progressistes, incarnaient deux visions inconciliables de l’avenir du territoire.
Mais depuis la fin du XXᵉ siècle, le monde a changé, et avec lui les priorités stratégiques. Le Sahara occidental n’est plus seulement une question coloniale ou identitaire, mais un enjeu majeur de stabilité régionale, de sécurité transsaharienne et de gouvernance économique.
L’effondrement des États du Sahel, la montée du jihadisme, la pression migratoire et la compétition énergétique entre grandes puissances ont replacé la question sahraouie dans un cadre beaucoup plus large.
Dans ce contexte, la position récente des États-Unis, telle qu’exprimée dans le projet de résolution soumis au Conseil de sécurité, marque un tournant décisif.
En qualifiant la proposition marocaine d’autonomie de 2007 de « sérieuse, crédible et réaliste », Washington ne se limite pas à un simple appui diplomatique : elle réintroduit la logique du pragmatisme dans un débat longtemps captif du juridisme et de l’idéalisme.
Cette approche réaliste ne dicte pas une solution, mais redéfinit le cadre de la négociation autour des principes de coexistence, de dialogue et d’inclusion de toutes les sensibilités sahraouies.
Pendant des décennies, les discours officiels des deux camps ont agi comme des miroirs déformants : Rabat érigeant l’autonomie en unique horizon, le Polisario restant figé sur le référendum comme seul objectif.
Entre ces deux absolus, le peuple sahraoui s’est trouvé prisonnier d’une guerre des récits plutôt que d’un véritable processus de paix.
Or, l’histoire contemporaine prouve que l’attachement aveugle aux modèles du passé n’engendre pas de solutions nouvelles.
Le monde de 2025 n’est plus celui des années 1970.
Les générations sahraouies nées dans les camps de Tindouf, dans les villes de Laâyoune, Dakhla, Smara, ou issues de la diaspora, aspirent avant tout à la dignité, la stabilité et la participation politique, bien plus qu’à la reproduction des formules d’hier.
De ce vide politique est née une nouvelle dynamique sahraouie, incarnée par le Mouvement sahraoui pour la paix (MSP), qui se présente comme une plateforme alternative et une “troisième voie” fondée sur le dialogue et le consensus interne avant toute solution externe.
Le MSP affirme la nécessité de reconnaître la pluralité des voix sahraouies longtemps marginalisées.
Loin d’être un signe de faiblesse, cette diversité constitue la condition même d’une paix véritable : aucun règlement durable n’est possible tant que le destin du Sahara reste monopolisé par deux pôles opposés.
En peu de temps, le mouvement a réussi à rassembler cheikhs de tribus, personnalités influentes, acteurs civils et représentants de toutes les zones de présence sahraouie — des camps de réfugiés aux territoires du Sud, de la Mauritanie à la diaspora — à travers des conférences et forums s’étendant de Las Palmas à Dakar.
Ces rencontres, marquées par un pluralisme inédit, ont dégagé une idée commune : rejeter la logique de la guerre et s’inscrire dans une approche pragmatique, conforme à l’orientation des acteurs internationaux majeurs, en faveur d’une paix négociée et inclusive.
Ce mouvement traduit une conscience sahraouie nouvelle, fondée sur la conviction que la paix ne s’impose pas de l’extérieur, mais se construit de l’intérieur — par la reconnaissance mutuelle, la diversité des opinions et la recherche du compromis.
La pluralité du corps sahraoui n’est pas une menace : elle est le socle d’une réconciliation durable.
Depuis 1991, la Mission des Nations unies pour le référendum au Sahara occidental (MINURSO) est devenue le symbole d’un immobilisme onusien, réduite à une présence d’observation sans portée politique réelle.
Pourtant, l’Envoyé personnel du Secrétaire général, Staffan de Mistura, dispose aujourd’hui d’une occasion unique : un contexte international favorable, un soutien croissant américain, européen et africain à des solutions réalistes, et une urgence régionale à restaurer la stabilité dans le Sahel.
Mais le succès de sa mission dépendra de sa capacité à rompre avec la diplomatie circulaire et à élargir le dialogue au-delà des acteurs traditionnels.
La crédibilité de la médiation onusienne se mesurera à son audace : inclure toutes les voix sahraouies — élus locaux, acteurs civils, mouvements émergents — et non pas seulement les institutions officielles des deux parties.
Aujourd’hui, la question n’est plus de savoir qui détient la légitimité historique, mais qui détient le courage politique d’ouvrir la voie vers l’avenir.
À cet égard, le Mouvement sahraoui pour la paix (MSP) incarne — par son discours équilibré, ses initiatives pacifiques et sa reconnaissance internationale croissante — l’une des clés du réalisme constructif.
Un réalisme qui place l’être humain sahraoui au centre de toute solution, et fait du refus de la guerre non pas une faiblesse, mais un acte de lucidité et de responsabilité.
Par Hamoud Ghaillani