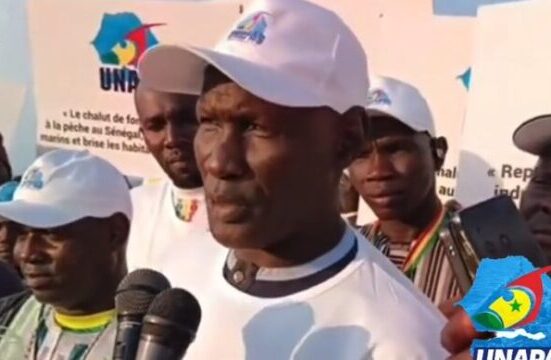Depuis la dernière mise à jour du 15 juin 2023, les indices des prix agricoles ont clôturé à plus 1 %, l’indice du prix des céréales à plus 3 % et l’indice des prix à l’exportation à moins 5 %. L’inflation des prix alimentaires intérieurs reste élevée dans les pays à faible revenu, à revenu intermédiaire et à revenu élevé. Selon la dernière analyse de la Banque mondiale à partir de données de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et d’une modélisation puisant dans les Perspectives de l’économie mondiale du Fonds monétaire international (FMI), la famine perdurera dans le monde.
Dans ses Perspectives à court terme du marché des engrais 2023-2027 publiées récemment, l’Association internationale des engrais (IFA) revient sur les dernières évolutions de l’offre et de la demande mondiales d’engrais et présente ses prévisions quinquennales. Évolution des prix mondiaux des produits agricoles de base Les indices des prix agricoles ont clôturé à 1 % de plus qu’il y a deux semaines, l’indice des prix des céréales à plus 3 % et l’indice des prix à l’exportation à moins 5 %. Le blé, qui a clôturé à plus de 8 %, a favorisé la hausse de l’indice des prix des céréales ; le maïs et le riz ont clôturé respectivement à 2 % et 1 % de plus qu’il y a deux semaines. En glissement annuel, les prix affichent une baisse de 18 % et 34 % respectivement pour le maïs et le blé, et une hausse de 11 % pour le riz. Les prix du maïs, du blé et du riz sont respectivement de 21 %, 4 % et 2 % plus élevés qu’en janvier 2021.
Tableau de bord de l’inflation des prix alimentaires
L’inflation des prix alimentaires intérieurs (mesurée par la variation d’une année sur l’autre de la composante alimentaire de l’indice des prix à la consommation (IPC) d’un pays) reste élevée. (Voir le tableau de bord à l’annexe A). Les dernières données mensuelles disponibles pour la période comprise entre février et mai 2023 font état d’une forte inflation alimentaire dans plusieurs pays à revenu faible et intermédiaire : 61,1 % des pays à faible revenu, 81,4 % des pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure et 77,0 % des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure ont enregistré des taux d’inflation supérieurs à 5 %, un grand nombre d’entre eux affichant même une inflation à deux chiffres. En outre, 80,4 % des pays à revenu élevé connaissent une forte inflation des prix alimentaires. Les pays les plus touchés se trouvent en Afrique, en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Asie du Sud, en Europe et en Asie centrale (figure 2a). En termes réels, l’inflation des prix alimentaires a dépassé l’inflation globale (mesurée par la variation annuelle de l’IPC global) dans 83,2 % des 161 pays pour lesquels les indices de l’IPC alimentaire et de l’IPC global sont disponibles (figure 2b). Les 10 pays qui affichent la plus forte inflation des prix alimentaires cette semaine, en valeurs nominale et réelle, sont répertoriés dans le tableau 1 (sur la base du dernier mois pour lequel des données sont disponibles entre février et mai 2023).
D’après les Estimations conjointes de la malnutrition infantile pour 2022, aucune avancée n’a été enregistrée
Les dernières Estimations conjointes de la malnutrition infantile pour 2022 révèlent que les cibles de l’Assemblée mondiale de la Santé et de l’Objectif de développement durable no 2 à l’horizon 2030 sont un peu plus hors de portée, et les effets du changement climatique, qui retentissent sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, menacent de freiner les progrès dans la réduction de la malnutrition. Un blog de la Banque mondiale analyse les données publiées récemment. Les progrès dans la réduction du retard de croissance, qui menace la santé et le développement de millions d’enfants à travers le monde, sont au point mort. D’après les nouvelles Estimations conjointes de la malnutrition infantile, 148,1 millions d’enfants âgés de moins de 5 ans ont souffert de retard de croissance en 2022, ce qui correspond à 1 enfant sur 5 de cette tranche d’âge dans le monde entier. Au cours des 5 dernières années, les taux mondiaux de retard de croissance ont stagné, s’éloignant un peu plus de la trajectoire nécessaire pour diminuer de moitié d’ici à 2030 (figure 3). L’Asie et l’Afrique subsaharienne ont été les plus durement touchées, la deuxième région comptant en 2022 plus de 2 millions d’enfants supplémentaires atteints de retard de croissance par rapport à 2020.
Les niveaux d’émaciation des enfants, mesurée par le rapport du poids sur la taille, montrent les effets aigus des crises alimentaires sur la malnutrition. Bien que l’absence d’informations ait empêché l’évaluation de l’émaciation en Europe et en Asie centrale, il ressort des données que le taux de cette maladie s’est quelque peu accru entre 2020 et 2022 à travers le monde, l’Asie du Sud comptant toujours un nombre disproportionné d’enfants émaciés. Les taux d’émaciation peuvent parfois être sous-estimés en raison du niveau élevé de mortalité chez les enfants qui en souffrent. Outre les taux de retard de croissance et d’émaciation, les taux de surpoids et d’obésité chez les enfants âgés de moins de 5 ans augmentent lentement, creusant davantage le fossé entre la trajectoire actuelle et la cible de l’ODD visant à ramener les taux de surpoids à moins de 3 % d’ici à 2030 ; 37 millions d’enfants sont en surpoids à travers le monde, pratiquement 4 millions de plus qu’en 2000. La Région Europe et Asie centrale est la seule dans laquelle le surpoids et l’obésité n’augmentent pas. Il est crucial d’agir sans tarder dans les régions Amérique latine et Caraïbes, Asie de l’Est et Pacifique et Moyen-Orient et Afrique du Nord. Dans cette dernière Région, 10 % des enfants sont en surpoids ou obèses. Des mesures doivent être prises de toute urgence pour combattre toutes les formes de malnutrition, particulièrement des mesures climato-intelligentes. Faute de quoi, on s’éloignera chaque jour un peu plus des cibles des ODD. Des stratégies visant notamment l’élargissement des interventions à fort impact, les politiques budgétaires, la réglementation des marchés et l’étiquetage des nourritures malsaines devraient être envisagées pour combattre à la fois la sous-alimentation et l’obésité. Les femmes sont généralement les premières à pâtir des aléas du climat, de la flambée des prix alimentaires et des pressions inflationnistes. Les estimations les plus récentes disponibles sur l’anémie chez les femmes en âge de procréer révèlent qu’en 2019, 30 % d’entre elles souffraient d’anémie (un taux inquiétant supérieur de 7 points de pourcentage au niveau requis pour atteindre la cible de l’ODD d’ici à 2030), et les données du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) indiquent que l’anémie est en augmentation chez les femmes.
Les prévisions de la Banque mondiale font état d’une aggravation croissante de l’insécurité alimentaire
L’on estime que les niveaux de famine ont connu une forte hausse à travers le monde. Selon les dernières analyses de la Banque mondiale à partir de données de la FAO et d’une modélisation utilisant les Perspectives de l’économie mondiale du FMI, les projections sur l’évolution de la famine dans le monde donnent à penser que la famine persistera. D’autres effets destructeurs des phénomènes météorologiques extrêmes et des conflits feront vraisemblablement sombrer de nombreux pays dans des crises. Cette année, pas moins de 1 milliard de personnes à travers le monde, soit 1 personne sur 8, ont éprouvé de sérieuses difficultés à obtenir de la nourriture, ce qui les a poussées à sauter des repas (figure 4). Ce chiffre a connu une hausse vertigineuse, avec environ 330 millions de personnes supplémentaires depuis 2015, soit pratiquement l’équivalent de la population des États-Unis, le troisième pays le plus peuplé au monde.
Après une décennie d’avancées régulières sur le plan du développement, le monde a connu ces dernières années une montée fulgurante de la famine. Plus de 220 millions de personnes seront probablement venues s’ajouter à celles souffrant d’insécurité alimentaire grave entre 2019 et la fin de 2023, en raison principalement des conflits, du changement climatique et des chocs économiques amplifiés par la pandémie de COVID-19.
La dernière estimation est plus élevée que dans les analyses officielles parce que, dans bon nombre de cas, les données sont publiées en retard. Il peut falloir des années pour que les chiffres à l’échelle mondiale rendent véritablement compte des effets des récents chocs. L’analyse porte sur 191 pays abritant dans l’ensemble plus de 99,9 % de la population mondiale, tandis que l’on dispose de données officielles pour moins de la moitié de la population mondiale, le reste étant estimé à partir des chiffres régionaux ou mondiaux. Deux tiers des personnes souffrant de famine sont des femmes, et 80 % habitent des régions durement touchées par le changement climatique. La plupart des pays qui sont loin d’atteindre l’Objectif de développement durable n0 2 sont soit fragiles, soit touchés par un conflit.
Le coût de la nourriture a augmenté entre 2019 et 2022, l’indice des prix alimentaires de la FAO (qui mesure l’évolution des prix mondiaux d’un panier de produits alimentaires comprenant le sucre, la viande, les céréales, les produits laitiers et l’huile végétale) étant passé de 95,1 points à 143,7 points. Même des flambées de prix temporaires peuvent avoir des effets durables. Des périodes de famine et de disette graves, même de courte durée, peuvent entraîner des problèmes de santé à l’origine de troubles physiques et cognitifs permanents, produisant des effets mesurables au fil des générations. Ces contrecoups intergénérationnels nuisent non seulement aux enfants souffrant de famine, mais aussi à leurs futurs enfants. Le dernier point sur la situation économique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord a conclu que la flambée des prix alimentaires observée de mars à juin 2022 peut, à elle seule, avoir augmenté le risque de retard de croissance chez les enfants de 17 à 24 % dans les pays en développement, ce qui correspond à 200 000 à 285 000 enfants environ qui seraient menacés de retard de croissance. Dans une tentative de quantification des effets de l’inflation sur la récente aggravation de l’insécurité alimentaire, le rapport a estimé que l’inflation était à la base de 24 à 33 % des prévisions d’insécurité alimentaire grave en 2023 dans la région.
Dans ses Perspectives à moyen terme du marché des engrais, l’IFA annonce une reprise durant l’exercice budgétaire 2023.
Depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine, le monde vit sous la menace d’une pénurie des stocks d’engrais et les prix de ces produits ont atteint des niveaux sans précédent en 2022. En dépit des difficultés causées par l’imposition de sanctions, le coût élevé des matières premières et les restrictions aux exportations, l’offre mondiale d’engrais a été meilleure que prévu en 2022. Les gouvernements, les organisations non gouvernementales (ONG) et les acteurs du secteur ont accompagné les chaînes d’approvisionnement, les nouveaux partenaires commerciaux et favorisé la baisse des prix des matières premières, toutes choses qui ont facilité les échanges et rendu la situation moins sombre qu’on le prédisait. Par conséquent, les prix des engrais sont redescendus de leurs niveaux vertigineux de 2022, ramenant ces produits à la portée d’un grand nombre. Malgré la baisse des prix, les dévalorisations monétaires intervenues dans de nombreux pays ont renchéri les importations d’engrais, ajoutant ainsi à la charge financière des utilisateurs d’engrais, à l’instar des petits exploitants agricoles, plus vulnérables aux coûts des intrants. De surcroît, de nombreuses incertitudes demeurent à court terme, en ce qui concerne notamment l’avenir de l’Initiative céréalière de la mer Noire, les exportations de potasse du Bélarus et l’évolution des prix de l’énergie durant le deuxième semestre de 2023. Dans ses Perspectives à court terme du marché des engrais 2023-2027, l’IFA examine les dernières évolutions de l’offre et de la demande mondiales d’engrais et présente ses prévisions quinquennales. Parlant de la production d’engrais, on estime que de 2021 à 2022, la production mondiale d’ammoniac a reculé de 1 %, pour s’établir à 182,2 tonnes métriques ; la production d’acide phosphorique s’est accrue de 2 %, atteignant 84,8 tonnes métriques après une année 2021 difficile ; la production de chlorure de potassium, quant à elle, a chuté de 15 %, tombant à 62,1 tonnes métriques. L’incertitude entoure toujours les prix du gaz en Europe pour l’hiver 2023, cette menace pesant sur les producteurs d’engrais européens dont bon nombre continuent de fonctionner au ralenti ou ont cessé leurs activités. S’agissant du potentiel de production (mesure de l’offre théorique sur la base de taux d’exploitation maximale typiques), l’IFA prévoit un accroissement des capacités de production. La capacité de production de l’azote croîtra principalement en Russie, où sont menés des projets utilisant le gaz naturel, et aux États-Unis, où des incitations fiscales ont considérablement augmenté les investissements. La production de phosphate et de potasse devrait aussi s’accroître, le nombre de producteurs augmentant en Afrique et en Asie de l’Ouest. Durant l’année budgétaire 2023, l’IFA prévoit une reprise de 4 % de l’utilisation des engrais dans le monde, pour atteindre 192,5 tonnes métriques, un peu plus que les 191,8 tonnes métriques de l’année budgétaire 2019. Les résultats de l’enquête réalisée par l’Association indiquent que l’accessibilité financière sera l’un des nombreux moteurs de la consommation d’engrais à moyen terme, même si des facteurs comme le changement climatique et la disponibilité de l’eau, la situation géopolitique mondiale, les réglementations nationales, l’aide publique aux agriculteurs, les macroéconomies nationales et la disponibilité des engrais sont de plus en plus importants. Selon les prévisions à moyen terme, l’Asie du Sud et l’Amérique latine seront la plus grosse source mondiale de demande d’engrais, bien que le marché africain doive connaître la croissance la plus rapide. Le plus grand risque réside dans la situation géopolitique versatile en Ukraine. Cela étant, les perspectives prédisent une reprise progressive, même si tout écart dans l’évolution nuirait à la consommation d’engrais en Ukraine comme dans le monde entier.
L’arrêt de l’Initiative céréalière de la mer Noire aggraverait l’insécurité alimentaire dans le monde.
Le 17 mai 2023, la Russie a accepté de participer à l’Initiative pendant 60 jours encore. Cet accord négocié par les Nations Unies et signé par la Russie et l’Ukraine le 22 juillet 2022 a permis à l’Ukraine d’exporter des céréales et d’autres produits agricoles bloqués depuis l’invasion russe en mi-février 2022. Il y a des raisons de craindre que la Russie se retire de l’Initiative le 17 juillet et les institutions des Nations Unies s’inquiètent des conséquences graves que la cessation de l’accord aurait particulièrement dans la Corne de l’Afrique. Dans un récent blog, l’IFPRI souligne les conséquences de l’effondrement du barrage de Nova Kakhovka et de la destruction d’une conduite d’ammoniac dans la région ukrainienne de Kharkiv ainsi que les conséquences de ces incidents sur l’accord céréalier et les répercussions probables d’une rupture de l’accord. Le 6 juin, une explosion a gravement endommagé le barrage de Nova Kakhova dans le sud de l’Ukraine, déversant un flot d’eau incontrôlable en aval du réservoir. En plus d’inonder des villages et des habitats fauniques, la rupture du barrage a détruit des zones de culture du blé, bien que des images satellites donnent à penser que les activités agricoles le long du fleuve Dniepr se sont singulièrement réduites au cours de l’année écoulée en raison du conflit. Le barrage et son réservoir contribuaient à l’un des plus importants systèmes d’irrigation en Ukraine, ses eaux arrosant plus de 500 000 hectares de terres consacrées à la culture du riz, des pommes de terre, des tomates et des légumes. Le ministre ukrainien de l’Agriculture, MykolaSolsky, s’est dit inquiet que le manque à gagner causé par cette destruction réduise les revenus et les investissements des producteurs, ce qui serait préjudiciable en fin de compte à pas moins de 1,5 million d’hectares de terres agricoles. Ailleurs, une conduite qui, avant la guerre, servait au transport d’ammoniac anhydre depuis Tolyatti en Russie jusqu’au port ukrainien de Pivdennyi (Yuzhny), non loin d’Odessa, a été détruite par une explosion. Bien qu’elle ne fonctionnât pas depuis le début de la guerre, la réouverture de la conduite était l’une des conditions posées par la Russie lors de récentes discussions pour rester dans l’Initiative céréalière de la mer Noire. Auparavant, la plupart des exportations d’ammoniac de la Russie étaient transportées via Pivdennyi, les autres itinéraires étant coûteux. On ignore l’ampleur des dégâts, mais ces derniers mois la Russie a fait passer ses exportations d’ammoniac par d’autres voies. L’Initiative céréalière de la mer Noire, qui a permis à l’Ukraine et à la Russie, deux grands fournisseurs de blé et d’engrais, de contribuer à répondre à la demande mondiale, menace à nouveau d’être interrompue, ce qui aurait de graves conséquences sur la sécurité alimentaire. Les incidents du barrage de Kakhovka et de la conduite d’ammoniac ont avivé les tensions, mettant en péril le renouvellement de l’accord. La décision de la Russie de restreindre les immatriculations au port de Pivdennyi, qui était reliée à la réouverture de la conduite d’ammoniac, a ramené le taux d’inspection quotidien moyen à 2,4 navires, contre plus de 5 plus tôt en 2023 et plus de 10 en septembre et octobre 2022. La chute brutale des exportations partant de Pivdennyi – l’un des trois principaux ports sur la mer Noire – qui sont passées d’une moyenne de 1,1 million de tonnes par mois entre août 2022 et avril 2023.
La cessation de l’accord aurait de profondes conséquences sur les prix des denrées de consommation, car l’exportation par voie terrestre à travers l’Europe de l’Est est coûteuse et limitée par les infrastructures existantes. Pour les producteurs ukrainiens, de nouvelles réductions du volume des exportations et une augmentation des coûts d’exportation feraient encore baisser les prix et les recettes. La baisse des prix signifierait moins d’incitations pour les agriculteurs à cultiver, et la fin de l’Initiative pourrait faire baisser davantage l’offre alors que les stocks exportables de blé et de maïs ukrainiens pour la campagne de commercialisation 2023/2024 seraient inférieurs de près de 40 % aux niveaux de 2021/2022. Les prix plus bas que favorise l’Initiative sont largement avantageux pour les importateurs de céréales ukrainiennes et les consommateurs. L’annulation de l’accord augmenterait l’insécurité alimentaire mondiale et réduirait les stocks de produits agricoles au-delà de la campagne agricole en cours.
Afrique de l’Ouest et du Centre
Plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, dont le Burkina Faso, le Mali et le Nigéria, seront confrontés à des situations catastrophiques de juin à novembre 2023. Dans les zones touchées par les conflits au Burkina Faso et au Mali, on prévoit que 45 200 personnes connaîtront des niveaux calamiteux d’insécurité alimentaire (phase 5 de l’IPC). Dans le cas du Burkina Faso, il s’agit de la proportion de la population la plus importante jamais appelée à connaître une insécurité alimentaire effroyable, et c’est la première fois qu’on estime que des populations maliennes sont confrontées à des niveaux d’insécurité alimentaire correspondant à la phase 5 de l’IPC. Les conflits et la violence font partie des principales causes de l’insécurité alimentaire catastrophique au cours de la période considérée, avec des risques de détérioration supplémentaire en cas de précipitations supérieures à la moyenne, comme prévu. L’insécurité alimentaire aiguë devrait également s’aggraver au Nigéria, où l’on prévoit que 24,8 millions de personnes seront en situation d’insécurité alimentaire aiguë entre juin et août 2023, notamment 1,1 million en situation d’urgence (phase 4 de l’IPC). Les effets conjugués d’une crise sécuritaire complexe, de conditions macroéconomiques peu favorables et de nombreux aléas naturels agissent sur l’insécurité alimentaire au Nigéria. En outre, certaines parties de l’Afrique de l’Ouest et du Centre ont fait l’objet d’une alerte en raison des criquets pèlerins. Des groupes de larves et d’ailés ont été signalés dans la partie occidentale de l’Afrique du Nord (Algérie, Maroc, Sahara occidental). Les pluies saisonnières d’été ont commencé à la mi-juin, entraînant des précipitations moyennes ou supérieures à la moyenne et bien réparties dans toute la région ; elles pourraient favoriser les invasions acridiennes dans tout le Sahel en direction du Tchad, du Mali, de la Mauritanie et du Niger, ce qui menacerait la production agricole régionale et augmenterait le nombre de personnes en situation d’insécurité alimentaire dans la région au cours des prochains mois.