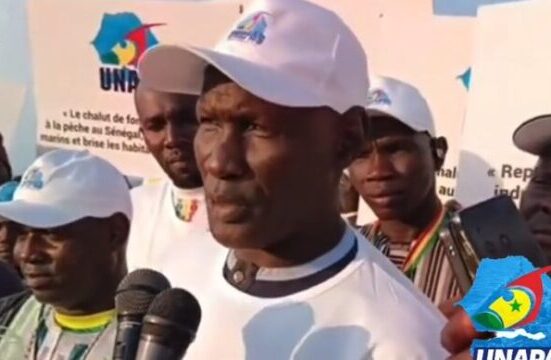Parmi les drogues les plus fréquemment utilisées, on trouve le cannabis (1,8 % de consommateurs au cours de la vie parmi l’échantillon) et la cocaïne (1,1 %). Si l’usage au cours de la vie de ces deux produits est au-dessus de 1 % pour l’ensemble des jeunes enquêtés, les usages actuel et récent se situent en deçà. Ces résultats sont conformes aux tendances globales de consommation parmi les jeunes selon lesquelles le cannabis est la substance la plus consommée après l’alcool et le tabac (UNODC, 2018; ESPAD Group, 2020). Pour les autres drogues considérées, les différents niveaux d’usage au cours de la vie, d’usage récent et d’usage actuels sont résumés dans le Tableau 8 ci-après. La consommation au cours de la vie, au cours de l’année ou du mois écoulé sont en dessous de 1 % pour l’ensemble de l’échantillon. Il est à noter que les effectifs sont extrêmement restreints pour les substances comme la méthamphétamine, l’ecstasy, le crack, l’opium, la morphine, le Spice ou les hallucinogènes.
Les filles sont, en général, moins consommatrices de drogues que les garçons (Tableau 7), mais il existe des différences notables lorsque l’on s’intéresse aux drogues individuellement. Les garçons sont plus consommateurs de cannabis, de crack et cocaïne, héroïne et morphine (Tableau 8). De leur côté, les filles se distinguent par des usages d’amphétamines plus élevées.
Peu de jeunes interrogés ont répondu à la question sur l’âge à la première expérimentation de drogues, les effectifs sont donc limités et ne donnent qu’une vision partielle et non représentative de l’âge d’initiation. En moyenne, la première expérimentation de cannabis se déroule vers 14,3 ans (médiane = 15) et il en est de même pour les amphétamines. Pour la cocaïne, l’âge moyen à l’initiation est de 13 ans (médiane =15). Ces chiffres sont à considérer avec attention dans la mesure où plusieurs travaux ont montré que des consommations précoces de cannabis, avant l’âge de 16 ans, peuvent être liées à un risque accru de développer des troubles mentaux, comme des troubles de la personnalité, de l’anxiété ou de la dépression (Deidre & al, 2012; Shelder & Block, 1990).
De même, lorsque les élèves ont été interrogés sur la première substance qu’ils ont essayée au cours de leur vie (médicament ou drogue), le taux de réponse reste bas et ne permet d’avoir qu’une image superficielle des potentielles substances à l’origine d’un début de consommation4 (Tableau 9). Il existe aussi une part non négligeable des jeunes qui ont déclaré ne pas connaître la substance qu’ils avaient ingérée. Les médicaments (tranquillisant ou antidouleurs prescrits) ou le cannabis semblent être les premières substances à l’origine d’une consommation.

COMPARAISON REGIONALE
D’autres enquêtes auprès de jeunes ont été réalisées récemment dans la région avec les mêmes méthodologies et il est intéressant de pouvoir comparer leurs résultats à ceux trouvés au Sénégal. Les niveaux d’usage au cours de la vie de différentes drogues observées au Sénégal auprès des jeunes scolarisés sont inférieurs à ceux trouvés en Côte d’Ivoire et au Libéria pour le cannabis (Figure 11). Pour les autres produits comme la cocaïne ou les amphétamines, le Sénégal et le Libéria présentent des niveaux de prévalence au cours de la vie similaires et inférieurs aux niveaux de consommation trouvés en Côte d’Ivoire.

USAGE D’UNE OU PLUSIEURES SUBSTANCES PSYCHOACTIVES
Il est fréquent que les jeunes aient eu l’occasion de consommer plusieurs substances au cours de leur vie : que ce soit du tabac, de l’alcool, des médicaments ou des drogues. Il est intéressant de se pencher sur les prévalences par catégories et plus particulièrement sur l’usage au cours de la vie.
Si 15 % des jeunes interrogés ont consommé des cigarettes ou de l’alcool au cours de leur vie, 7,8 % ont consommé des médicaments (tranquillisants ou antidouleurs prescrits) au cours de leur vie. En cumulant les médicaments et les drogues, il apparaît que près d’un jeune sur 10 (9,3 %) âgé de 15-16 ans en a consommé au cours de sa vie. Enfin, si l’on considère l’ensemble des substances psychoactives (tabac, alcool, médicaments et drogues), les jeunes sont presque un quart (21 %) à en avoir utilisé au cours de leur vie.

FACTEURS DE RISQUES ET FACTEURS DE PROTECTION VIS A VIS DE L’USAGE DE SUBSTANCES PSYCHOACTIVES
Un certain nombre de facteurs ont été identifiés comme étant associés à l’initiation de l’usage de substances psychoactives, puis au passage à une consommation régulière et pouvant entraîner des conséquences négatives sur l’adolescent ou le jeune adulte. Ces facteurs sont souvent en dehors de leur contrôle (UNODC, 2018) et rendent les adolescents plus vulnérables à l’usage de substance psychoactives. Ils peuvent être liés à des éléments environnementaux de niveau macro (comme le niveau socioéconomique ou l’environnement physique) ou de niveau micro (comme la structure familiale et parentale, l’influence des pairs), mais également à des éléments relevant du domaine plus personnel tels que les comportements individuels et caractéristiques psychologiques. À l’inverse, il existe aussi des facteurs protecteurs comme certaines influences sociales positives qui protègent les jeunes individus (Figure 13).
Toutefois, les études montrent que la vaste majorité des jeunes ne consomment pas de drogues, et que la minorité qui en consomment effectivement ont généralement été exposés à des facteurs de risque significatifs en matière d’usage de drogues (UNODC, 2018). L’influence de ces facteurs fait que les jeunes ne sont pas égaux face au risque d’initiation et d’usage de substances psychoactives, d’où la nécessité de prendre en considération l’ensemble de ces éléments pour une meilleure compréhension des mécanismes d’initiation. C’est généralement la combinaison entre la présence de facteurs de risques et l’absence de facteurs protecteurs à un moment particulier de l’adolescent qui fait la différence dans son exposition à l’usage.
Problèmes de santé mentale, comportementaux, pauvreté, manque d’implication des parents et de support social, manque d’opportunité ou encore l’isolement sont les facteurs de risques les plus communs parmi les jeunes qui développent des problèmes liés à la consommation de drogues (UNODC, 2018) (Figure 13). Ainsi, tant du point de vue de la prévention et de l’initiation à la consommation, que de celui du développement et de la prévention des troubles qui y sont liés, il est essentiel d’avoir une bonne compréhension des modèles de consommation ainsi que des influences, sociales, environnementales et personnelles pouvant entraîner ces usages.
DISPONIBILITE ET ACCESSIBILITE AUX SUBSTANCES PSYCHOACTIVES
La consommation de produits psychoactifs est directement corrélée avec leur accessibilité, et inversement (ESPAD group, May 2002; ESPAD Group, 2020). Les jeunes ont été interrogés sur l’accessibilité d’une liste de substances5 (« Auriez-vous du mal à vous procurer les produits ci-après si vous le vouliez ?»). Ainsi, il n’est pas surprenant de constater que la perception de l’accessibilité des substances soit déclarée plus facile parmi les consommateurs alors que les jeunes qui n’ont jamais consommé de substances au cours de leur vie, déclarent eux, une accessibilité plus difficile voire impossible. D’une manière générale, la perception de l’accessibilité des produits déclarée est majoritairement « impossible ou très difficile » (Tableau 10). Même pour les cigarettes qui sont, a priori, facilement accessibles au Sénégal auprès de vendeurs ambulants ou dans les magasins, deux tiers des jeunes interrogés estiment qu’elles sont impossibles ou très difficiles à se procurer. La perception de l’accessibilité de l’alcool aussi très basse est directement liée au contexte culturel et au tabou religieux autour de sa consommation dans la société sénégalaise. L’ensemble des médicaments et des drogues ont une accessibilité déclarée encore plus basse que les cigarettes ou l’alcool (Tableau 10).
Les jeunes qui ont consommé au cours de leur vie des cigarettes, des tranquillisants, de l’héroïne, de l’opium au cours de leur vie, sont deux fois plus nombreux à déclarer une accessibilité à ces produits moyennement facile ou très facile que ceux qui ne les ont pas consommés (Tableau 10). Ceux qui ont consommé du crack, de la cocaïne, des amphétamines, des méthamphétamines, ou encore de la morphine au cours de leur vie sont au moins deux fois plus nombreux à répondre que l’accessibilité est moyennement difficile plutôt qu’impossible ou très difficile.
Les différences déclarées entre les garçons et les filles en termes de perception d’accessibilité reflètent les écarts de niveaux de consommation. En effet, les garçons plus consommateurs de tabac, ont une perception de l’accessibilité des cigarettes plus facile ; la tendance est similaire pour l’alcool alors que pour l’accessibilité aux tranquillisants il n’existe pas de différence entre les sexes. En ce qui concerne les drogues, les filles déclarent une meilleure accessibilité à la cocaïne et au crack (p=0,38) ; c’est la seule différence notable et sans que l’on puisse fournir une explication du comportement différentiel en dehors des faibles effectifs sur lesquels sont basés ces chiffres.
Il existe, en revanche, des différences de perception de l’accessibilité en fonction de l’âge. Les jeunes nés en 2003 (âgés de 16 ans au moment de l’enquête) déclarent moins de difficultés pour accéder aux produits que leurs pairs plus jeunes d’une année (15 ans) ; cette différence est uniquement significative dans le cas des cigarettes (p=0,29).
PROBLEMES LIES A L’USAGE D’ALCOOL OU DE DROGUES
Le questionnaire comprenait des questions sur certains événements ou problèmes déjà rencontrés par les élèves dans la vie, ces problèmes pouvant être liés à une consommation d’alcool ou de drogues6. La littérature établit que les élèves qui déclarent un usage de substance psychoactive sont plus susceptibles de rapporter ou de rencontrer plus fréquemment ce genre d’événements.
Au total 1,5 % des élèves interrogés déclarent avoir déjà eu dans leur vie au moins un problème lié à la consommation d’alcool, et seulement 0,6 % au moins un problème lié à la consommation de drogues. On n’observe pas de différence significative dans les occurrences de problèmes liés à la consommation d’alcool entre les garçons et les filles. Mais la différence est en revanche significative (p=0,056) pour les occurrences liées à la consommation de drogues. Dans la majorité des cas (90 % en fonction du problème en question), les élèves déclarent ne jamais avoir eu de problèmes (Tableau 11). Parmi les problèmes les plus fréquemment rencontrés par les élèves, figurent les disputes ou bagarres, accidents ou blessures, perte d’argent ou d’objet de valeur et enfin les problèmes relationnels avec les amis. Dans ces derniers cas, d’autres raisons sont à l’origine de l’événement (Tableau 11).

Concernant la question des différences entre les sexes dans la survenue de ces problèmes, il semble, du fait de la faible quantité de jeunes ayant rapporté un événement problématique lié à l’alcool ou à des drogues, plus approprié de s’intéresser au nombre de problèmes survenus à cause d’une consommation d’alcool ou de drogues. Parmi les usagers d’alcool au cours de la vie, 13,8 % déclarent avoir rencontré un ou plusieurs problèmes liés à leur consommation d’alcool. Et il n’existe pas, dans ce cas de figure, de différence de genre. Parmi les consommateurs de drogues au cours de la vie, 6,6 % déclarent avoir eu un ou plusieurs problèmes liés à leur consommation de drogues ; comme pour l’alcool. Malgré la différence de pourcentage, la différence n’est pas significative entre les deux sexes (Figure 14).

APPROBATION ET RISQUES PERCUS DE L’USAGE DE SUBSTANCES PSYCHOACTIVES
Les attitudes envers certains comportements et la perception des risques sont des facteurs importants dans le processus de décision d’initiation et de consommation de substances. Il est dans ce cas attendu que les jeunes qui ont déjà utilisé une substance psychoactive déclarent un risque moindre que ceux qui n’en ont jamais consommé (ESPAD group, May 2002). Le risque perçu de la nocivité de la substance est également un indicateur de la consommation récente ou actuelle (plus le risque de nocivité est bas, plus le risque de consommation de la substance est élevée). Il a été demandé aux répondants de déclarer s’ils approuvaient ou désapprouvaient la consommation de certaines substances, et si, selon eux, les consommateurs de ces substances « risquent de se faire mal » (physiquement ou autrement).
La question sur les jugements de valeur demandait, pour des raisons éthiques et pour éviter l’approbation de consommation de substances, si les jeunes étaient « contre les pratiques » de consommation. Une des limitations dans l’interprétation des réponses données par les élèves à ces deux questions est que le questionnaire ne reprenait pas les mêmes catégories de réponse pour les deux questions et ne couvrait pas les mêmes substances non plus. Par conséquent, les réponses aux deux questions doivent être étudiées indépendamment.
Qu‘il s’agisse du tabac, de l’alcool, des tranquillisants ou des drogues citées, le niveau de désapprobation est assez similaire dans l’échantillon (aux environs de 40 %). Une fois de plus, sans doute du fait de la stigmatisation culturelle de l’alcool, les niveaux de désapprobation de la consommation d’alcool sont équivalents à la désapprobation de consommation de drogues. Il est également raisonnable de supposer que les risques perçus des différentes substances ne reflètent pas seulement les attitudes personnelles mais aussi les cultures et stigmatisations nationales, des niveaux de consommation et de disponibilité dans la société plus largement (ESPAD group, May 2002). À titre de comparaison, les niveaux de désapprobation de ces substances étaient beaucoup plus élevés dans l’enquête en Côte d’Ivoire, avec une désapprobation en moyenne autour de 60 % (UNODC, 2020).
PARENTALITE
La parentalité mais également divers autres aspects de l’environnement familial peuvent influencer le comportement d’usage d’un enfant puis d’un adolescent (UNODC, 2018). Une étude internationale sur les adolescents en Europe a montré que la surveillance et le suivi parental pourraient être liés à de faibles niveaux de consommation de drogues parmi les jeunes (Tornay & al, 2013). Et que cette surveillance parentale est moins fréquente chez les familles qui connaissent des difficultés socio-économiques que parmi les familles qui n’en ont pas (Fallu & al, 2010).
Dans différentes parties du questionnaire, les relations avec les parents ou tuteurs et les amis ont été abordées : la satisfaction des relations familiales (Q.5), les règles de conduite établies par les parents (Q.6), le partage d’information sur les sorties du samedi soir (Q.7), et les rapports avec les parents et les tuteurs (Q.49 à Q.57).
D’une manière générale, les réponses à la question Q.5 montrent que les jeunes sont satisfaits de leurs relations familiales, 86 % déclarant être « très satisfaits » de leur relation avec leur mère, 74 % de leur relation avec leur père ou leurs frères et soeurs. Les élèves qui se déclarent « pas du tout satisfaits » sont moins de 2 % : 0,9 % sont insatisfaits de leur relation avec leur mère, 1,8 % de leur relation avec leur père et enfin 1,2 % de la relation avec leurs frères ou soeurs.
En ce qui concerne les sorties du samedi soir, les adolescents scolarisés déclarent dans 76 % des cas que leurs parents savent « toujours » ou « assez souvent » où ils passent les samedis soir. On observe sur ce point une différence entre les filles et les garçons, entre les non-consommateurs et les consommateurs, mais pas en fonction de l’âge actuel (Tableau 13). Il est donc plus fréquent que les parents de filles savent où elles passent le samedi soir comparativement aux parents de garçons. De même, les élèves qui n’ont jamais consommé d’alcool, de médicaments ou drogues au cours de leur vie partagent leurs plans du samedi soir avec leurs parents plus fréquemment que les consommateurs.
Les questions Q.49 à Q.57 portaient sur les rapports des élèves avec leurs parents ou leurs tuteurs. Sur la presque totalité de ces questions, les filles sont plus nombreuses à déclarer une communication et des rapports plus harmonieux avec leurs parents (Tableau 14). Il est intéressant de constater que si les parents sont jugés comme répondant en majorité aux besoins de leurs adolescents (54,5 % de l’ensemble des élèves interrogés), peu d’entre eux déclarent recevoir de l’argent de leurs parents (seulement 40 %). Les sorties après l’école ou pendant la nuit sont relativement peu encadrées : 46 % des parents essayent de savoir où leurs enfants étaient pendant la nuit ou après l’école et la moitié savent réellement où étaient leurs enfants.

SANTE MENTALE
Au total, quatre questions qui se rapportaient à la santé mentale des jeunes étaient incluses dans le questionnaire de l’enquête (Q.45 à Q.48). Parmi ces questions, une était en lien avec la consommation d’alcool ou de « drogues »7.
Les questions Q.45 à Q.47 ayant été formulées de la même façon dans le questionnaire, il est possible de considérer les réponses apportées ensemble. Les élèves avaient à indiquer s’ils avaient été préoccupés au cours des 12 derniers mois : parce qu’ils voulaient « consommer de l’alcool ou d’autres drogues » (Q.45) :
– parce qu’ils n’arrivaient pas à « manger ou n’avaient pas faim » (Q.46),
– parce que qu’ils n’arrivaient pas à « rester concentrés sur les devoirs ou d’autre choses qu’ils avaient à faire » (Q.47).
L’analyse des réponses collectées est extrêmement pertinente, car, comme cela a déjà été mentionné, les caractéristiques psychologiques et psychopathologiques sont des facteurs qui sont associés à l’initiation ou la consommation de substance, voire au développement de pathologies ou comorbidités. À titre d’exemple, la dépression et l’anxiété, les troubles de l’attention, les troubles de la personnalité sont fortement et systématiquement liés au risque de consommation nocive de substances (Amstrong & Costello, 2002). Et les personnes qui développent ces troubles sont plus susceptibles que les autres de consommer des substances, et ce, à un âge plus précoce (Rowe & al, 2004). Les troubles mentaux sont également très répandus parmi les adolescents, une estimation récente de l’OMS donnait un chiffre de 1 adolescent sur 7 (âgé de 10 à 17 ans) (OMS, 2020).
Il a également été démontré que la présence de troubles de santé mentale et comportementaux peut exacerber le rôle de la pauvreté et de la réaction au stress dans le développement des trajectoires de consommation (UNODC, 2018; UNODC, 2020; Blair, 2010). Inversement ; une exposition à la pauvreté pendant l’enfance peut également être associée à des problèmes de santé mentaux pendant l’adolescence (Boe, et al., 2017).
PREOCCUPATIONS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS
S’agissant des différentes préoccupations, le manque d’appétit ou le manque de capacité à se concentrer sont plus répandus parmi les élèves que la forte envie de consommation d’alcool ou drogues (Tableau 15). Et c’est le manque de concentration qui semble être le problème le plus fréquemment rencontré par les répondants (36,6 % sont préoccupés). Dans l’ensemble, le niveau de préoccupation relatif à la consommation de produits reste relativement bas (98 % de l’échantillon déclare ne jamais être préoccupé) mais les garçons déclarent plus souvent avoir été préoccupés que les filles par ce problème (p=0,006). À l’inverse les filles sont plus préoccupées par leur manque d’appétit ou le fait de ne pas arriver à manger (p=0,016). Il n’existe pas de différence significative entre les deux sexes sur la capacité à rester concentré. A SUIVRE
DakarTimes avec ONUDC, Ministère de l’Education,
Mission Interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives