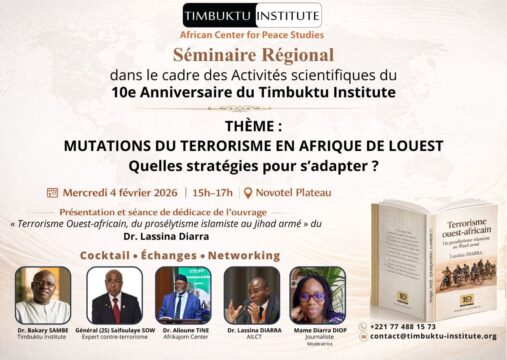Augustin Bollue, assistant de recherche au Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité (GRIP) et à l’Observatoire Boutros-Ghali a disséqué dans un éclairage publié par le GRIP ce février, la guerre au Soudan. Le chercheur est parti de la date d’avril 2023, pour dire que depuis lors le Soudan est, à nouveau, le théâtre d’une guerre voyant s’affronter deux groupes armés dotés de moyens considérables : les Forces de soutien rapide (Rapid Support Forces – RSF) commandées par le général Mohamed Hamdan Dagalo, dit « Hemedti » et les Forces armées soudanaises (Sudanese Armed Forces – SAF) placées sous les ordres du président actuel, le général Fattah al-Burhane. Cette situation a déclenché une crise humanitaire aux conséquences désastreuses pour la population soudanaise. Malgré les efforts et avertissements des Nations unies, d’organisations non gouvernementales (ONG) et d’autres acteurs présents sur le terrain, l’aide humanitaire peine à atteindre les populations dans le besoin pour des raisons diverses que cet éclairage entend justement exposer.
L’auteur rappelle que le 15 avril 2023 marque le début des combats opposant les RSF et les SAF. Les conflits touchent d’abord Khartoum, la capitale du pays, qui se trouve assiégée par les RSF. Ces dernières mettent alors la main sur de nombreux bâtiments stratégiques (banques, usines, bureaux, studios de télécommunication, etc.). Depuis, le conflit s’est étendu à la quasi-entièreté du territoire du Soudan2. Les violences ont engendré une des pires crises humanitaires actuelles selon l’Organisation des Nations unies (ONU), avec plus de 8,8 millions de déplacés en interne et 3,3 millions de réfugiés dans les pays limitrophes. Plus de 15 000 personnes ont perdu la vie et l’ONU estime à 25 millions le nombre d’individus face à un besoin urgent d’aide humanitaire, ce qui équivaut à près de la moitié de la population du pays4. En août 2024, le Programme alimentaire mondial (PAM) a dû faire face à une situation de famine au sein du camp de Zamzam dans le Nord Darfour, où un demi-million de personnes sont réfugiées. Treize autres zones sont à risque aigu de famine, principalement au sud et à l’ouest du pays, soit les régions les plus impactées par le conflit. Les besoins immédiats sont variés : alimentaires, médicaux, sanitaires, etc.
Malgré l’urgence humanitaire, plusieurs obstacles entravent l’acheminement de l’aide. L’objet de cet Éclairage est précisément de les identifier en procédant en trois étapes. La première aborde les obstructions à l’aide humanitaire par les parties belligérantes (1). La seconde étape traite des défis climatiques compliquant la situation humanitaire du pays (2). La troisième et dernière étape met en lumière le manque de visibilité internationale dont souffre ce conflit et ses conséquences sur l’approvisionnement humanitaire au Soudan (3).
Les entraves à l’acheminement de l’aide humanitaire par les parties au conflit
L’obstruction à l’acheminement de l’aide humanitaire est un phénomène récurrent dans un conflit armé. En plus de retarder l’acheminement d’aide et de matériel humanitaire pour des populations civiles, les obstacles mettent directement en danger le personnel humanitaire. Cette section aborde les spécificités du cas soudanais, à savoir les obstacles administratifs entravant l’accès au territoire, ainsi que l’absence de protection des infrastructures civiles et humanitaires.
Premièrement, la neutralité de l’aide humanitaire n’est pas reconnue et les belligérants adoptent une approche « avec ou contre nous7 ». Ceci impacte considérablement le parcours administratif pour l’accès au territoire soudanais. Les problèmes récurrents sont notamment l’obtention de visas et du statut de travailleur humanitaire ; le manque de reconnaissance de la nature humanitaire d’un convoi ; l’obtention ardue de permissions de passage ; ou encore la protection inexistante du personnel humanitaire. Une fois sur le territoire soudanais, le nombre d’acteurs au conflit pose aux organisations humanitaires des dilemmes de stratégie. Bien que la guerre oppose essentiellement les RSF aux SAF, les deux parties s’appuient sur une pluralité de milices armées et un leadership peu centralisé. Cela implique que les travailleurs humanitaires doivent négocier l’accès à leurs zones d’intervention avec des groupes extrêmement diversifiés. Concrètement, les organismes d’aide qui agissent sur le territoire d’influence d’une milice se voient souvent interdire l’entrée dans les espaces contrôlés par une autre. Les régions où une seule entité est présente sont parfois plus facilement accessibles aux travailleurs humanitaires, car les négociations impliquent une autorité unique. C’est le cas dans l’est et le nord du Soudan, principalement contrôlés par les SAF. À l’inverse, dans les nombreuses zones encore disputées, les lignes de démarcation évoluent rapidement, ce qui oblige les travailleurs humanitaires à renégocier constamment leur présence, et entrave donc leur capacité à mener leurs projets de manière continue.

En ce qui concerne la logistique, lorsque les convois humanitaires transfrontaliers ne sont pas fortement ralentis par le mauvais état des routes endommagées, il leur arrive d’être bloqués ou pillés. Ils n’ont d’ailleurs parfois aucune garantie de passer la frontière ou du moins de la passer sans connaître des délais conséquents. C’est le cas au poste frontalier d’El-Tina, un des seuls points d’accès aux régions du Darfour et Kordofan depuis le Tchad, dont l’état des routes et les contrôles de sécurité fréquents retardent fortement le passage. Le point de contrôle d’Adré au Darfour, aussi à la frontière avec le Tchad, considéré comme « la voie la plus efficace et la plus courte pour acheminer l’aide humanitaire au Soudan », a été fermé par les SAF de février à août 2024. De plus, aucun couloir humanitaire n’est tenu de manière continue au Soudan, laissant les convois à la merci des belligérants qui s’en approprient régulièrement le contenu15. Un exemple récent est l’interruption de convois humanitaires du PAM à destination du camp de Zamzam, qui, après avoir été bombardé début décembre 2024, requiert une assistance d’urgence.
Deuxièmement, le non-respect du statut protégé des civils et humanitaires, et de leurs infrastructures, les met directement en danger. Le premier rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies publié le 18 avril 2023 fit déjà état de la destruction de nombreux bureaux et stocks humanitaires, entraînant l’arrêt temporaire d’aide humanitaire à Nyala et Al Fasher. Début mai 2023, le syndicat des médecins soudanais signale que 60 des 86 hôpitaux situés dans les zones touchées par la guerre ne sont plus en état de fonctionner.
Beaucoup d’agences d’aide internationale ont évacué leur personnel et fermé leurs bureaux pour cause d’insécurité. En avril 2023, le PAM a temporairement cessé ses activités à la suite de la mort de trois de leurs collaborateurs et de nombreux convois pillés. Des témoignages relatent qu’en novembre 2024, près de 50 humanitaires sont détenus par les SAF et RSF dans la région de Khartoum, dans l’attente d’une rançon. Souvent, les parties au conflit les accusent d’être des informateurs ou des complices de l’ennemi, toujours dans une logique partisane refusant leur neutralité.
Compte tenu de ces difficultés, l’assistance humanitaire au Soudan repose en grande partie sur le travail d’agences et d’ONG locales, s’organisant à l’échelle des villes ou des villages directement gérés par la population. Pour ne citer qu’eux, les Emergency Response Rooms, sont des groupes d’aide capables de fournir tout type de denrées. Ces acteurs locaux peinent à voir leur neutralité respectée et font souvent l’objet d’attaques par les parties belligérantes, au même titre que les acteurs internationaux.
Les acteurs humanitaires au Soudan sont confrontés à de véritables défis et dangers opérationnels causés par les parties impliquées dans le conflit. Cependant, ils se confrontent à d’autres difficultés, tels que les conditions climatiques, complexes au Soudan, ce que la section suivante explore.
Obstacles climatiques
Cette seconde section met en lumière les éléments climatiques impactant le travail humanitaire au Soudan – l’un des dix pays les plus exposés au changement climatique. Un rapport de 2024 publié par Médecins sans Frontières (MSF) décrit comment le changement climatique impacte les prestations humanitaires : en exacerbant les besoins et en compliquant les interventions.
Les besoins de la population sont caractérisés par une forte variabilité régionale en matière de climat, une situation qui est exacerbée et rendue imprévisible par le réchauffement climatique. La région entourant le Nil est souvent sujette à des inondations alors que la région sahélienne subit des sécheresses répétées. La fréquence accrue de ces événements rend l’agriculture – secteur d’activité de près de 75% de la population soudanaise – presque impossible. Ces phénomènes météorologiques extrêmes compromettent la qualité de l’air, l’accès à l’eau potable, à la nourriture et à des abris sûrs. Ces situations sont également propices au développement de maladies, telles que la dengue, la malaria, ou encore le choléra30. Enfin, la production et l’accès à l’électricité sont impactés par la disponibilité fluctuante de l’eau, étant donné que près de la moitié de l’apport du pays en énergie provient de sources hydrauliques 31. Ce contexte contribue à mettre en péril la santé des populations et des humanitaires.
Ces phénomènes climatiques compliquent matériellement l’intervention humanitaire et l’acheminement de l’aide en rendant le terrain difficilement praticable et dangereux. En mai 2021, dans l’État d’Al Qadarif, de fortes précipitations, des tempêtes de vent et des inondations ont frappé hors de la saison des pluies. L’aide humanitaire a alors été paralysée, une grande partie du travail accompli se trouvant balayé. Un cercle vicieux s’installe et aggrave la dépendance des populations soudanaises à une aide extérieure touchée par les mêmes sinistres environnementaux. L’incertitude liée aux événements climatiques est une source de stress supplémentaire pour les humanitaires sur le terrain32.
Les facteurs sécuritaires et environnementaux sont ici expliqués de façon distincte, mais, en réalité, ces deux éléments sont fortement imbriqués. En addition à cela, le manque de visibilité internationale de ce conflit génère des effets pernicieux sur la disponibilité de l’aide, comme il sera expliqué dans la section suivante.
Contexte politique du conflit soudanais de 2023
Depuis son indépendance en 1956, le Soudan est soumis à une domination militaire quasi constante. Les coups d’État se succèdent en laissant peu de place à la démocratie33. En 2019, le régime dictatorial du général al-Bashir en place depuis 1989 est renversé et une période de transition civile s’ouvre34. Durant cette période, un Conseil de souveraineté de transition est mis sur pied et présidé par al-Burhane, luimême secondé par Hemedti. Ce dernier, à la tête des RSF depuis 2013, a fortement dynamisé ce groupe paramilitaire35. Son intégration au sein des institutions nationales lui permet d’acquérir des armes, de recruter et d’entraîner du personnel militaire, formant aujourd’hui les RSF. Cette position le rend capable de déclarer son hostilité aux SAF lorsque ses relations avec al-Burhane se détériorent. En 2021, un coup d’État interrompt la période de transition et profite au général al-Burhane, qui s’autoproclame président. Il démet Hemedti de ses fonctions et promulgue un décret dissolvant les RSF le 19 mai 2023, provoquant ainsi l’embrasement du conflit.

Le manque de visibilité internationale et ses conséquences sur l’aide humanitaire
Sur la scène internationale, le conflit soudanais tend à être relégué au second plan des ordres du jour diplomatique et de la couverture médiatique. Cette discrétion du conflit soudanais et de la crise humanitaire qu’il engendre limite la prise de conscience de ses défis et de la gravité de la situation, ce qui complique le financement adéquat de l’aide humanitaire. Cette invisibilité relative est aggravée par les risques auxquels sont confrontés les journalistes locaux souvent réduits au silence par la censure et les violences.
La chercheuse Selma El Obeid observe que le Soudan souffre d’une attention réduite au sein des institutions internationales, en comparaison à d’autres crises. Elle identifie différentes explications potentielles : l’absence d’une voix unifiée depuis le Soudan, notamment due à l’identification compliquée d’une cause unique au conflit ; la présence limitée de médias locaux et internationaux ; et une « fatigue générale » quant à la complexité des conflits africains37. Cette invisibilité est aggravée par les dangers auxquels sont confrontés les journalistes, souvent réduits au silence par la censure et les violences.
Ce désintérêt pour la situation soudanaise engendre deux conséquences directes sur le terrain. Il s’agit, d’une part, d’un déficit de financements et, d’autre part, d’une insécurité importante pour les journalistes avec ses effets induits sur la sensibilisation aux enjeux humanitaires. Pour ce qui est de l’aspect financier, Martin Griffiths, Sous-Secrétaire général de l’ONU pour les affaires humanitaires, admet que l’ONU n’a pas réussi à protéger et à aider la population soudanaise à hauteur de ses besoins. Sept mois après la Conférence humanitaire internationale pour le Soudan en avril 2024 à Paris, au cours de laquelle trente-trois pays se sont engagés à fournir une aide de 2,2 milliards USD, le Plan d’intervention humanitaire pour le Soudan 2024 n’a reçu que la moitié de l’aide requise en date de novembre 2024.
Pour ce qui concerne l’information au Soudan, la dynamique est aggravée par le faible nombre de journalistes soudanais. Ceux-ci sont estimés à seulement 20 en 2024. Les restrictions quasi totales à l’entrée pour les journalistes internationaux comptent également dans l’invisibilité de la crise. La destruction des studios et de matériel limite aussi considérablement les moyens des agences de presse et des reporters pour fournir une couverture de qualité. Dans ce manque d’information qualitative, les campagnes de désinformation et de mésinformation souvent orchestrées par l’une ou l’autre des parties au conflit prospèrent sur les réseaux sociaux et dans les médias nationaux. Les journalistes soudanais et étrangers sont en quelque sorte « pris au piège de la guerre civile ». À l’instar des humanitaires, le terrain et la multiplicité des acteurs impliqués compromettent gravement leur sécurité. Aucune partie au conflit n’offre de garantie – tant d’accès que de protection – à la presse, et toutes recourent à des arrestations, à la torture, voire à la violence léthale afin de museler l’information. Les violences sexuelles sont une réalité pour toutes les femmes, journalistes incluses. Au 1er novembre 2024, le Syndicat des journalistes soudanais recensait plus d’une cinquantaine d’arrestations et de séquestrations de professionnels de la presse.
Eliott Brachet, journaliste indépendant français ayant récemment exercé au Soudan, estime que ces conditions de travail entretiennent un cercle vicieux avec le désintérêt global de la communauté internationale pour ce conflit. En l’absence d’un soutien international qui inciterait les parties au pouvoir à respecter la liberté de la presse et les droits des journalistes, ces derniers continuent d’opérer dans des conditions particulièrement difficiles.
En conclusion, l’auteur dira que la guerre civile au Soudan a placé la population au cœur d’une crise humanitaire sans précédent. Entre les entraves systématiques à l’acheminement de l’aide imposées par les belligérants, les aléas climatiques et l’insécurité chronique qui prévaut dans les zones de conflit, les besoins vitaux des populations demeurent largement insatisfaits. Cette situation est aggravée par l’inaction des acteurs internationaux, dont la réponse tardive et les engagements insuffisants constituent un manquement préoccupant face à l’urgence humanitaire.
Par ailleurs, le déficit de visibilité médiatique et le sous-financement des opérations humanitaires illustrent une indifférence globale compromettant les espoirs de stabilisation durable. Face à ce constat, la clé d’une action humanitaire efficiente repose dans une collaboration étroite et concertée entre acteurs internationaux et organisations locales, pour renforcer l’approvisionnement de l’aide. Un tel effort pourrait aussi améliorer la protection des civils et des intervenants sur le terrain. Il serait aussi susceptible de contribuer à poser les bases d’un dialogue politique constructif. Il est tout autant crucial que journalistes et reporters puissent opérer en sécurité au Soudan, pour qu’une information fiable sur le conflit soit relayée.
Toutefois, les perspectives de paix crédibles restent limitées. Les pays voisins, tentant déjà de gérer les flux de réfugiés fuyant le conflit, ne sont pas en mesure de fournir un soutien suffisant au Soudan. Ce soutien lorsqu’il existe n’est d’ailleurs pas désintéressé étant donné que le conflit au Soudan est marqué par des ingérences régionales, certains États soutiennent plus ou moins discrètement les RSF, comme les Émirats arabes unis, tandis que d’autres, tels que l’Égypte, l’Iran, la Turquie, le Qatar et l’Algérie, supportent les SAF.
En date de février 2025, il est impératif de débloquer l’aide pour limiter l’intensification de la famine au Soudan, tout en garantissant la sécurité des travailleurs humanitaires. Toutefois, cette démarche nécessite une volonté politique forte, considérant que l’un des principaux obstacles à l’avancement des négociations et à l’établissement d’une paix durable réside dans l’incapacité des parties en conflit à privilégier le dialogue plutôt que la solution militaire.
Synthèse de Awa BA